22/06/2015
Marie Étienne, extrait de Onze petits contes

3 janvier 2008
Elle constatait avec effroi que son appartement dominait, surplombait la falaise. Ou plus exactement que son prolongement, un espace ni privé ni public, ne se terminait pas, se terminait sur le néant, un vide après lequel il n’y avait plus rien.
Et elle pensait à la petite qui lui rendrait visite, au terrible danger qu’elle y rencontrerait, elle s’étonnait, elle s’insurgeait contre elle-même : comment avait-elle pu ne pas en tenir compte au moment de l’achat ?
Son compagnon disait : la falaise s’effondre. Il avait ajouté quelque chose sur la bêtise des promeneurs qui abîmaient les bords de mer, et sur ceux, qui ensuite, y dressaient leur maison.
Et justement c’était son cas. Devait-elle en changer ?
À quelques jours de là, elle aperçut un pré en pente, très incliné, planté peut-être de lavande — une herbe drue et bleue. En haut du pré, une haie d’arbres, irrégulière, derrière laquelle une maison. « Sa » maison qui l’attend. « Sa » ou « une » mais c’est elle qu’elle attend.
Marie Étienne, Onze petits contes, dans Marie Étienne : organiser l’indicible, textes réunis et présentés par Marie Joqueviel-Bourjea, éditions L’improviste, 2013, p. 117-118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, extrait de onze petits contes, maison, falaise, danger, vide | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2015
Francis Cohen, Les choses que nous savons

Crasse
(Peut-être... Écoutez... Vous avez commencé la lecture de la traduction écrite. La voix qui vous parle où il n’y a rien.
Il a écrit ceci.
Il vous parle, il écrit : Non, je n’ai pas vu ceci, je suis en train.
Je suis en train d’écrire ?)
Où suis-je ?
Un dossier.
Ils savent en venir à bout.
Vous savez ce que c’est, chaque jour suffit, en quelques minutes, en musique.
Il y a beaucoup à dire à leur propos. Exactement tout ce qu’ils ne peuvent raconter jusqu’à leur disparition complète.
Quand il n’existe plus, elle meurt de confusion.
Il gobe l’air, inerte. Ils abusent de l’eau, d’ailleurs les mains ne ferment pas les yeux. Point de réaction entre les doigts — soit une bave nacrée.
Oui. Amorphe si bien qu’elle danse sans fin. Ils l’épuisent pour des mains plus propres.
Se ride, se fendillent. Les peurs fendent l’oubli.
[...]
Francis Cohen, Les choses que nous savons, NOUS, 2015, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis cohen, les choses que nous savons, écrire, peur, crasse, danse | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2015
Erich Fried, La Démesure de toutes choses

Valeur durable de la littérature
On demandait à un écrivain allemand qui n’avait pas mauvaise opinion de lui-même s’il aimerait changer sa place avec celle du président des États-Unis.
« D’un côté, oui, dit-il enfin. Si on considère les choses à court terme, j’aurais même le devoir de faire l’échange. On éviterait presque à coup sûr une guerre atomique. Des centaines de milliers d’êtres humains qui sont aujourd’hui menacés resteraient en tous cas en vie. Même contre la faim en Aise, an Afrique et en Amérique du Sud, je saurais faire mieux que simplement promouvoir la libre économie de marché. Mais d’un autre côté... » Il secouait la tête, plein de scrupules.
« Quoi, d’un autre côté ? lui avons-nous demandé. Qu’est-ce qui pourrait encore contrebalancer cela ? »
Il nous a regardés longuement : « Ce n’est pas du tout aussi simple. Considérez donc : cet homme serait du coup écrivain à ma place. Imaginez les écrits qu’ils concocterait, et certainement qu’il publierait, dans sa soif d’un vaste public. Je le sais, la littérature n’a pas un effet aussi immédiat que les bombes atomiques, en revanche son action en est plus durable, se prolongeant souvent pendant des siècles. Non, il est impossible de se représenter quel genre de malheur il en sortirait à long terme. »
Nous l’avons quitté, un espoir en moins.
Erich Fried, La Démesure de toutes choses, traduit de l’allemand par Pierre Furlan, Actes Sud, 1984, p. 80-81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, la démesure de toutes choses, échange, érivain, président | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2015
Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant

Haï-kaï
nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyo
et Yokohamaî
À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la Lune entre les nuages est comme sept femmesblanches.
La tête sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.
Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.
Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant, dans Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau..., préface de Jacques Petit, Poésie / Gallimard, 1974, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l'oiseau noir dans le soleil levant, haï-kaï, lune, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2015
Bruno Fern, Le petit test

En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».
« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59):
préférant (et de loin) le trou Perrette
qui sent pas que la violette
mais le rose nuancé bat
ant jusqu’au sang [..]
On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :
celer mes amours
seul et " "
semer " "
seller " "
serrer " "
céder " "
cesser " "
c.v. " "
Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».
Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.
Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.
Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.
La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».
Bruno Fern, Le petit test, Sitaudis, 2014, 72 p.
Cette recension a été publiée dans Les Carnets d'eucharis, n° 45, printemps 2015.
lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/
———————————
1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.
2. noté ici entre crochets.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, le petit test, villon, humour, socité | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2015
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière

L’encre des signes
Ignorant de ma fin et de mon commencement, j’écris aveuglément
pour apprendre de l’encre des signes
ce qui ordonne et croise
la trame des images et la chaîne des mots
j’écris pour que la blancheur irrévocable
qui ajoure et cerne les mots saisis par l’encre
se souvienne du souffle qui les assemble
en les mêlant à l’air qui me traverse.
Je veux qu’entraîné par la nappe de silence
qui sourd et s’étend quand la page se détache de moi
soient abolis regrets, désirs, attente
et que, même fragment, l’écrit s’achève
dans le deuil blanc qui le suit, alors
je serai libre, écrire serait naître.
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière, La Lettre volée, 2014,
p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre burgart, gris lumière, l'encre des signes, écrire, naître | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2015
Rose Ausländer, Été aveugle

Roméo et Juliette à Central Park
Roméo et Juliette
à Central Park
ne disent mot de leur parents
à l’autre bout du monde
où le saule pleureur
pleure
non
Juliette et Roméo
deux flammes vertes
dans l’herbe
embrassées par
l’air de juin
à même le cœur
Danse d’autos
yeux d’écureuil et
le jeu qui tourne
en boucle
Devant les visages à dollars
flottant
des nuages de souffle
parfums de juin
le globe vert
au jeu de la fleur qu’on effeuille
Roméo et Juliette
immortels
sous les trembles
éclairs rouges sur les cils
soleil vert à l’oreille
les lèvres de Roméo
les cheveux de Juliette
le globe tourne
autour du oui vert
autour du oui rouge
autour de l’herbe souffle coupé
Rose Ausländer, Été aveugle, traduction
de Michel Vallois, Héros limite, 2015,
p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, Été aveugle, roméo et juliette à central park | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2015
Sanda Voïca, Exils de mon exil

La conquête impossible
Sur ce bateau vaguant pour la première fois
Qu’on me mette dans son ventre bas,
d’où je guetterai le jour de l’an.
Ma vie est une fête.
Mais ceux que je ne connais pas
ont-ils les mêmes fêtes, le même calendrier ?
Leur année a-t-elle la même durée que la mienne ?
Comment conquérir et aimer un peuple
qui n’arrive pas au bout de l’année ?
Comment remplir le temps qui n’existe pas ?
De mon coin j’enverrai des signes :
La vie est une fête ; d’un jour, d’un an,
mais de ma longueur,
une étendue impossible pour les autres.
On n’est jamais conquérant
Mais on est toujours aimant
en avalant le temps.
Voilà ce que je vous dis,
mais ce que je ne peux pas vous dire
c’est d’où je vous parle :
C’est quoi cette boule mouvante, visqueuse,
mélange de lumière et matière,
qui me garde au chaud,
qui me pousse à écrire ?
Assise tantôt dedans, tantôt dessus.
Ne croyez surtout pas qu’avec ces détails
je vous ai tout dit.
Sanda Voïca, Exils de mon exil, Passages d’encre,
2015, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda coïca, exils de mon exil, conqiête impossible, temps, signe, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2015
Marlene Dumas, Art et protitution ; une Europe unie

Art et prostitution
Si la Prostituée est une personne
qui a pour profession
de satisfaire de le désir de diverses personnes
pour des raisons de gain économique,
où un implication émotionnelle peut
ou non être présente —
Alors elle ne me semble pas très éloignée
de ma définition de l’artiste.
En général les artistes aiment faire semblant.
En général les artistes font semblant d’aimer
plus qu’ils ne peuvent porter.
Ils désirent le désir de tous
tout en ne désirant personne.
Une Europe unie
Je n’ai jamais pensé rester
Je suppose que c’est ce qu’elle disent toutes.
C’était ma première fois dans un peep-show
aussi quand la fille m’a regardée
je lui ai dit, « je ne fais que regarder », et elle m’a répondu
« C’est comme àa que j’ai commencé ici moi aussi ».
Marlene Dumas, traduit de l’anglais par Martin Richet, dans Koshkonong, n7, Printemps 2015, p. 18 et 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marlene dumas, art et protitution ; une europe unie, artiste, peep-show | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2015
Antonio Porta, Les rapports
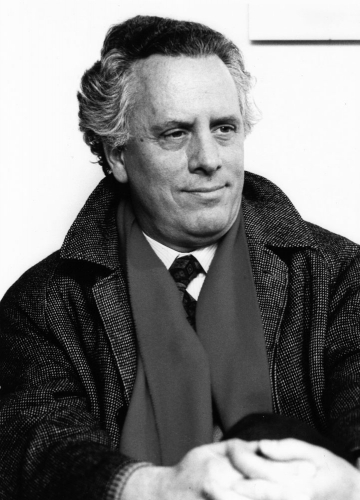
Que peut-on justifier ?
à Edoardo Sanguineti
I
Prends garde à ce mois de juin vénéneux, privé de racines et de
fourmis, ce discours n’a aucun sens, plus, tout le monde
le sait, si vous voulez savoir quelque chose des origines de la vie,
elle n’est pas d’origine, du monde, s’en moque, plus,
ce mois de juin n’est pas né, sachez-le, cessez de penser
à l’argent et choisissez, entre l’histoire et le drame ou
la tragédie, la vérité, je crois, et les faits tels quels, si
il n’y a pas de lieu, où l’on est né, ni la maison, personne
ne sait où c’est, et ainsi ne m’écoutez pas et je vous dis de
lui couper les bras, ce sera extraordinaire, qu’ils se libèrent
les grands seins, et mâchez, jusqu’au bout, dedans
la société et ses légendes, petites et grandes lèvres, dans
le parc qu’il s’invente, dans les buissons, pour enflammer le pénis,
où l’on court, au sens métaphorique, car en réalité
je suis à bout de souffle.
[...]
Antonio Porta, Les rapports, traduit de l’italien par Caroline Zekri, préface d’Alessandro De Francesco, postface de Judith Balso, NOUS, 2015, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porta, les rapports, juin, origine, vérité, société | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2015
Albane Prouvost, meurs ressuscite

dans la maison glacée
où je ne suis pas autorisée
combien de cerisiers
acceptent de revenir
accepte poirier
ici je commence ici
les pommiers sont des sorbiers
accepte
un pommier accepte-t-il
puis sauvagement il accepte
accepte poirier
accepte puisque tu acceptes
les poiriers sont tous bons
ainsi accepte
cher compatible tu me manques tu me manques tellement
pardonne aux poiriers, bon pardonne aux pommiers puisque c’est fait bon
pardonne aux jeunes glaciers
tu traînes comme un jeune pommier
parce que tu traînes toujours comme un jeune pommier
un jeune glacier est un jeune pommier
tu ne vas pas concurrencer la glace quand même
serait un jeune poirier un jeune cerisier serait un jeune pommier
en train de devenir pratique
j’ai besoin des pommiers
ou j’ai besoin des poiriers
ou j’ai besoin de leur pure capacité
un jeune glacier n’espère plus être un jeune pommier
[...]
Albane Prouvost, meurs ressuscite, P.O.L, 2915, p. 9-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albane prouvost, meurs ressuscite, maison, arbres, pommier, cerisier, poirier, glacier | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2015
Pascal Commère, Des laines qui éclairent

Seraient-ils perdus une fois encore les mots,
par la terre brune et collante qui entérine
en silence toute mort en juin comme une boule
de pluie sur tant d'herbe soudain qui verse, avec
dans la poitrine ce serrement, par les collines
presque en haut, quand la route espérée dans un virage
d'elle-même tourne et disparaît... Je reconnais
le menuisier qui rechignait au guingois des portes
cependant que vous gagnez en ce jour de l'été
la terre qui s'est tue, humide et qui parlait
dans votre voix soucieuse ; à chaque mot j'entends
le travers du roulis des phrases le tonnerre
d'un orage depuis longtemps blotti dans l'œuf, la coque
se fissure — sont-ce les rats qui remontent, ou le râle
des bêtes hébétées dans l'été, longtemps résonne,
comme les corde crissent, lente votre voix digne
par-dessus l'épaisse terre menuisée, les vignes
bourrues... Et sur mon épaule, posée, la douceur
ferme de votre main pèse sans appuyer.
Pascal Commère, De l'humilité du monde chez les bousiers (1996),
dans Des laines qui éclairent, Le temps qu'il fait, 2012, p. 211.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, des laines qui éclairent, mots, herbe, terre, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2015
Henri michaux, Nous deux encore

Nous deux encore
Air du feu, tu n’as pas su jouer.
Tu as jeté sur ma maison une toile noire. Qu’est-ce que cet opaque partout ? C’est l’opaque qui a bouché mon ciel. Qu’est-ce que ce silence partout ? C’est le silence qui a fait taire mon chante.
L’espoir, il m’eût suffi d’un ruisselet. Mais tu m’as tout pris. Le son qui vibre m’a été retiré.
Tu n’as pas su jouer. Tu as attrapé les cordes. Mais tu n’as pas su jouer. Tu as tout bousillé tout de suite. Tu as cassé le violon. Tu as jeté une flamme sur la peau de soie pour faire un affreux marais de sang.
Son bonheur riait dans son âme. Mais c’était tromperie. Ça n’a pas fait long rire.
Elle était dans un train roulant vers la mer. Elle était dans une fusée filant vers le roc. Elle s’élançait quoique immobile vers le serpent de feu qui allait la consumer. Et fut là tout à coup, saisissant la confiante, tandis qu’elle peignait sa chevelure, contemplant sa félicité dans la glace.
Et lorsqu’elle vit monter cette flamme sur elle, oh...
Dans l’instant la coupe lui a été arrachée. Ses mains n’ont plus rien tenu. Elle a vu qu’on la serrait dans un coin. Elle s’est arrêtée là-dessus comme sur un énorme sujet de méditation à résoudre avant tout. Deux secondes plus tard, deux secondes trop tard, elle fuyait vers la fenêtre, appelant au secours.
Toute la flamme alors l’a entourée.
[...]
Henri Michaux, Nous deux encore [1948], dans Œuvres complètes, II, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 149-150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, nous deux encore, feu, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2015
François Muir, L'infamie de la lumière

Jardins
Lumière, lumière blanche, pas à pas
Lente approche, éphémère confrontation
Ombres souriantes, corolles de rose
De près, terre foulée, lents écarts
Corps sans attache, repos loin du ciel
Escale, séjour d’îles en îles
Fleuve
Frôlements
Nu, nage isolée
Passage sur la terre
Insensible au feu, à ses ramifications
Feu qui ne s’allume, ni ne s’éteint
Tête à tête, celui qui veille, celui qui s’absente
Cendres
Coupure, flots de silence
Converti à l’Autre, aux états, aux états
Loin du tumulte, étrave impassible
Cendres sur la terre, cendres dans les os
Lumière dans la lumière, sans laisser de traces
François Muir, L’infamie de la lumière, La Lettre volée,
2015, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois muir, l'infamie de la lumière, jardin, fleuve, cendres | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2015
Caroline Sagot Duvauroux, 'j

[...]
Qui pleure-t-on ?
Y a-t-il un secours ?
Couper dans soi ?
Tu fut-il ?
Je n’est plus pour le savoir ?
Si tu n’est plus pour que je
Y a-t-il un autre destinataire du monde ?
Sans doute.
Pour qui sont ces serpents ?
Y a-t-il encore du blanc aux fleurs de camélia ?
Le lierre coule-t-il encore des parois ?
Le crime de défaire ?
Ne fait pas très bon, là
Faut-il refaire ces choses où je fut malhabile ?
La mort ? Je ne sais pas
Apprends-moi ce que je sais
pour que je reconnaisse
Où es-tu ? je ne peux me souvenir
Quelle contingence avec demain ?
Indigne de contingence ?
Dès aujourd’hui mais
demain ? qu’est-ce dire ?
Qui suis-je ? est-ce ? et pour qui sont ?
Rêvais-tu ?
Je n’étais pas là
Rêvais-tu pour carner le dogme ?
J’faut
sans la violence
Faudrait
mais sans la violence
Et dire encore merci ?
Tu ne seras pas là je n’étais pas là
Je ? là ? qu’est-ce ?
Nous n’étions qu’ici
Qui dans le feu tord une aurore ?
pour légender l’instant d’un incipit
au point du jour
Avant l’erreur point de jour au rideau
[...]
Caroline Sagot-Duvauroux, ’j, éditions Unes,
2015, p. 46-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j, deuil, identité, perte | ![]() Facebook |
Facebook |





