25/03/2015
Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre
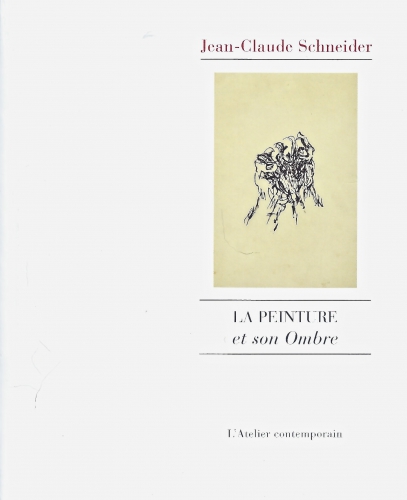
L’épaisseur du réel, peintures de Nicolas de Staël
[...]
D’autres peintures se vouent à l’expression de l’espace ou de la lumière ou des vibrations de couleurs, celle de Nicolas de Staël, d’emblée, veut dire l’épaisseur de la matière. Elle, matière, dont ma vue subit la brutalité lorsque l’obstrue ce chaos qui ne me parle pas encore. Masses opaques. Scellées. Ternes et mates. Où le densité croit avec la profondeur. Une infinité de gris. De murs. Pénétrant leur substance, j’habiterai ce mutisme, y décèlerai des assonances avec mes contradictions, mes apories, devinant qu’elles répètent les doutes, mes atermoiements. C’est cela qui affleure dans les toiles alors retenues par le peintre : un accord avec le monde dans lequel il se sent englué, et qu’au visage fermé des apparences répondent les traits illisibles de chorégraphies intérieures. Les titres énoncent l’âpreté de la tâche : la vie est dure, les portes n’ont pas de porte, contre le mur et l’horizon se brise l’élan des lames ; pour approcher le monde clos comme la prison de Piranèse qu’évoque une des toiles les chemins dénoncent leurs entraves. Tout : compact, confus, impénétrable. La lumière même est obstacle, l’air a pris corps. Les vides se comblent, non d’ajours, mais d’opacité. Il faut, pour traduire la nuit des fonds, saturer les tons les plus sombres, et qu’ils diffèrent à peine tant ils ont absorbé la moindre respiration, éteint toute vibration moins sourde. On n’irait pas, s’y enfonçant, traversant, vers le jour, mais vers plus de ténèbres encore. Graduée du plus dense au moins ténu, la pigmentation, de la teneur de l’ombre, énumère dans ces Compositions — ô la chimie des cémentations, la tectonique des intrications — la même abondance de textures, de chairs, que les natures mortes des primitifs hollandais. Les complexes charpentes qui étayent et tendent les peintures des années 47-49 morcellent et multiplient l’espace, y creusent un labyrinthe obscur et profond, citerne aux colonnes brisées ou voûtées, aux anfractuosités dérobées, enchevêtrées. C’est l’intérieur d’un corps.
[...]
Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre, "L’Atelier contemporain", éditions François-Marie Deyrolle, 2015, 208 p., p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude schneider, la peinture et son ombre, nicolas de staël, matière, lumière, opacité, nature morte, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2014
Ossip Mandelstam, Des derniers poèmes

Me suis égaré dans le ciel... Le remède ?
Vous, qui en êtes proches, répondez-moi
Plus aisé de faire résonner les neuf
disques pour athlètes des cercles de Dante.
Nul divorce entre moi et la vie — qui rêve
de massacrer, puis aussitôt de caresser,
afin que l'oreille, les yeux, les orbites
palpitent d'une nostalgie florentine.
Sur mes tempes ne posez, ne posez pas
la caresse de cet épineux laurier,
déhiscez(1)-moi plutôt, fissurez mon cœur
en lambeaux qui vibrent de tintements bleus.
Et, mourant, mon temps de service achevé,
en ami, ma vie durant, de tout vivant,
que retentisse et plus immense et plus haut
la réponse, écho du ciel, dans ma poitrine.
Mars 1937
Ossip Mandelstam, Des derniers poèmes, traduction Jean-Claude Schneider, dans Rehauts, 2ème semestre 2013, p. 96.
(1) verbe construit sur le latin dehiscere, "s'ouvrir" (note de T. H.)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, des derniers poèmes, jean-claude schneider, vie, ciel, caresse, espoir | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2013
Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937
Une semaine avec les éditions de La Dogana

Encore il se souvient de l'usure des souliers —
De la majesté fruste de mes semelles
Et moi, de lui : sa voix aux sonorités diverses.
Ses cheveux noirs, au bord de la montagne de David.
Retapées à la craie ou au blanc d'œuf,
Les enfilades de rues couleur de pistache,
La pente des balcons, le fer à cheval, le balcon-cheval,
Les petits chênes, les platanes, les ormes lents.
Et l'enchaînement féminin des lettres bouclées
Plus enivrant pour l'œil dans l'enveloppe de lumière,
Et la ville si bien faite, qui se prolonge en robustesse
Jusque dans l'été juvénile et vieillissant.
7-11 février 1937, Voronèje
Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937, traduit par Philippe Jaccottet, Louis Martinez, Jean-Claude Schneider, postface de Florian Rodari, La Dogana, 2011 [1994], p. 134.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, choix de poèmes 1908-1937, jaccottet, jean-claude schneider, louis martinez | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2013
Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929)

Le titre rend compte du fait que le texte, jamais publié du vivant de Mandelstam, était son quatrième écrit en prose après Le Bruit du temps, Le Timbre égyptien et un volume d'essais ; Nadejda, son épouse à qui il l'avait dicté en 1929, le mit au net en 1940 à partir de deux manuscrits. "Autres textes" regroupe de courts récits et des pages sur ses séjours au Caucase et en Crimée entre 1922 et 1927, avec en ouverture une brève réponse à une enquête, faite par une revue en 1928, sur "L'écrivain soviétique et la révolution d'octobre" : elle donne la position de Mandelstam vis-à-vis de ce que demande alors le pouvoir politique. Le poète refuse sans équivoque d'être un écrivain fonctionnaire, en rejetant la question posée : « S'interroger sur ce que l'écrivain doit être est une question que je ne comprends absolument pas. » S'il y a une exigence, elle est de former les lecteurs, en premier lieu à l'école, et pour ce qui est de l'écrivain, il ne l'est qu'à l'écart du pouvoir. Cette position, qu'il développe dans La Quatrième prose, lui vaudra de perdre ses moyens de vivre et de mourir dans un des camps soviétiques.
La Quatrième prose est un écrit de circonstance, et l'on apprécie la force de son contenu grâce aux notes précises de Jean-Claude Schneider. Une maison d'édition, après avoir sollicité Mandelstam pour améliorer une traduction de Till Eulenspiegel, publie le volume en ne mentionnant que son nom pour la traduction ; malgré le rectificatif de l'éditeur, les critiques se déchaînent, notamment un certain Cornfeld, et crient au plagiat. Les explications de Mandelstam ne servent à rien et il finira par être exclu de l'Union des écrivains. Les seize séquences de La Quatrième prose reflètent la violence des attaques que subit le poète, mais aussi son talent de critique et la clarté de ses engagements.
Ce que Mandelstam ne peut accepter, c'est la soumission qui conduit à abandonner toute création : ce n'est qu'avec la liberté intérieure que l'expression peut naître, et ce qui s'écrit alors pourrait, éventuellement, servir à la nouvelle société si les dirigeants comprenaient que la transformation des esprits exige la liberté de penser. Les choix du pouvoir politique sont tout autres et il attend que l'écrivain « griffonne des dénonciations, tape sur ceux qui sont déjà à terre, exige l'exécution des détenus ». Mandelstam ajoute : « la littérature partout et où qu'elle intervienne, n'a qu'une seule mission ; aider les autorités à maintenir les soldats dans l'obéissance, les juges à éliminer sommairement les accusés ». Il partage les publications entre celles « permises et celles écrites sans autorisation. Les premières, c'est de l'ordure, les autres, de l'air volé ». Quant à ceux qui acceptent de glorifier le régime, il multiplie les qualifications péjoratives pour les définir, ces "judas" vivant dans leurs « vomissures » et, s'opposant à eux, il met en avant « la noble appellation de juif dont [il] s'enorgueilli[t] ».
La situation des écrivains était d'autant plus précaire que, du jour au lendemain, il leur devenait impossible de publier leur travail et qu'ils étaient réduits à des tâches alimentaires loin de leurs préoccupations ; ce fut le cas pour Mandelstam comme pour son presque contemporain Daniil Harms, d'abord exilé, puis gagnant son pain en écrivant des livres pour enfants. La méfiance des bolcheviques, dès le début des années 1920, s'est progressivement accrue avec Trostky (Littérature et révolution, en 1924, condamne le poète Andréï Biély), puis avec la prise de pouvoir par Staline en 1927. Plutôt éloigné des bolcheviques, Mandelstam n'est pas du tout du côté de la bourgeoisie, dont il critique le comportement avec ironie dans La Quatrième prose : « Une question m'a toujours intéressé : où le bourgeois va-t-il pêcher son air dégoûté et son prétendu sens des convenances ? Cette aptitude à savoir ce qu'il convient de faire, c'est évidemment ce qui apparente le bourgeois à l'animal. » Par ailleurs, dans un de ses brefs récits, il qualifie de « bourgeois ignorant » le socialiste belge Vandervelde venu s'extasier sur la nouvelle société.
Il y a dans les récits et les relations de voyage une grande vivacité des notations, un art du portrait, un goût de l'observation et, toujours, le plaisir répété de vivre dans la ville, telle quelle, avec sa pauvreté — « Il n'aime pas la ville, celui qui n'en apprécie pas les guenilles, les lieux modestes, pitoyables, qui ne s'est pas essoufflé sur ses escaliers de service ». Il y a aussi la littérature russe, présente par une allusion ou la citation d'un vers, les auteurs français (Villon, Flaubert ou les ïambes d'Auguste Barbier) et, constamment, une écoute attentive des manières de parler, ici des expressions entendues à Kiev, là de la langue du bazar qui, « pareille à une petite bête carnassière, fait étinceler l'éclat de ses petites dents blanches. »
Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929), traduit du russe par Jean-Claude Schneider, La Dogana, 2013, 168 p.
Article paru sur Sitaudis.fr
* La Quatrième prose a été par ailleurs traduite par André Markowicz (Christian Bourgois, 1993, puis collection "Titres", 2006).
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, la quatrième prose & autres textes (1922-1929), jean-claude schneider, liberté, camp de travail, critique. | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2012
Georg Trakl, Nuit d'hiver, dans Œuvres complètes

Nuit d'hiver
De la neige est tombée. Passé minuit, tu quittes, enivré de vin pourpre, le quartier sombre des hommes, la flamme rouge de leur foyer. Ô les ténèbres !
Gel noir. La terre est dure, l'air a un goût d'amertume. Tes étoiles se ferment en signes mauvais.
À pas pétrifiés, tu longes lourdement la voie, les yeux écarquillés, comme un soldat à l'assaut d'un rempart noir. Avanti !
Amères, neige et lune !
Un loup rouge qu'un ange étrangle. Tes jambes tintent en marchant comme de la glace bleue et un sourire plein de tristesse et d'orgueil a pétrifié ton visage et le front blêmit dans la volupté du gel ;
ou bien il se penche, muet, sur le sommeil d'une sentinelle qui s'est écroulée dans sa cabane de bois.
Gel et fumée. Un blanc linge d'étoiles brûlent les épaules qui supportent et les vautours de Dieu lacèrent ton cœur de métal.
Ô la colline de pierre. En silence fond, et oublié, le corps froid dans la neige d'argent.
Noir est le sommeil. L'oreille suit longtemps les sentiers des étoiles dans la glace.
Au réveil, les cloches sonnaient dans le village. Le jour rose entra, à pas d'argent, par la porte de l'est.
Georg Trak, Œuvres complètes, traduites de l'allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 125.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, nuit d'hiver, marc petit, jean-claude schneider | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2011
Ossip E. Mandelstam, Simple promesse

Je ne sais s’il y a bien longtemps
Qu’on chante cette rengaine :
Sourdine aux feutres du voleur,
Au bourdon du roi des moustiques…
Je voudrais pour ne rien dire
Parler encore une fois,
Chuinter comme une allumette,
Houspiller la nuit, l’éveiller,
Soulever le bonnet de l’air
Suffoquant comme une javelle
Secouer et vider le sac
Bourré de grains de cumin,
Pour que le lien de sang rosé,
Carillon de ces herbes sèches,
Lien dérobé, soit retrouvé :
Outre-siècle, outre-fenil et rêve.
1922
Ossip E. Mandelstam, Simple promesse (choix de poèmes 1908-1937), traduits du russe par Philippe Jaccottet, Louis Martinez et Jean-Claude Schneider, Postface de Florian Rodari, Genève, La Dogana, 1994, p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, philippe jaccottet, louis martinez, jean-claude schneider | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2011
Georg Trakl, L'automne du solitaire, dans Œuvres complètes

L’automne du solitaire
L’automne sombre s’installe plein de fruits et d’abondance,
Éclat jauni des beaux jours d’été.
Un bleu pur sort d’une enveloppe flétrie ;
Le vol des oiseaux résonne de vieilles légendes.
Le vin est pressé, la douce quiétude
Emplie par la réponse ténue à des sombres questions.
Et, ici et là, une croix sur la colline désolée ;
Un troupeau se perd dans la forêt rousse.
Le nuage émigre au-dessus du miroir de l’étang ;
Le geste posé du paysan se repose.
Très doucement l’aile bleue du soir touche
Un toit de paille sèche, la terre noire.
Bientôt des étoiles nichent dans les sourcils de l’homme las ;
Dans les chambres glacées s’installe un décret silencieux
Et des anges sortent sans bruit des yeux bleus
Des amants, dont la souffrance se fait plus douce.
Le roseau murmure ; assaut d’une peur osseuse
Quand la rosée goutte, noire, des saules dépouillés.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduites de l’allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, l'automne du solitaire, marc petit, jean-claude schneider | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2011
Johannes Bobrowski, Terre d'ombres fleuves

Der Judenberg
Spinnenreise
weiß, mit rötlichem Sand
stäubte die Erde — Wald,
flechtenhaarig, Tierschrei,
stieß um die Wange ihm, Gras
stach seine Schläfe.
Spät, wenn der Uhu, Sausen
aus hundert Nächten, umherstrich
durch den Schlaf der Geniste,
hob er sich in der Grillen
Schwirrgesträuch, einen fahlen
Mondweg zu sehn, der heraufkam
an die seufzende Eiche, die Greisin, in ihrem
Wurzelgeflecht verging.
Über das Bruch sah er hin.
Jäh, undeutbar, Lichtschein
flog vorüber, diesen
Herzschlag lang ragte wüstes
Schaufelgeweih aus der Finsternis,
zottig, ein tränendes Haupt.
Unter die Hände gepreßt
Zet, unbenannt: die Schwärme,
gelb, die dem Curragh
folgten, tönende Wolken
über der See, die Bienen
folgten dem frommen Vater,
er rührte die Ruder, et sagte :
Ich werde tot sein im grünen Tal.
Le mont des Juifs
Voyage d’araignée,
blanc, la terre se répandait en poussière
de sable rougeâtre — forêt,
comme chevelure de tresses, cri d’animal,
lui heurtait la joue, herbe
piquait ses tempes.
Tard, lorsque le grand duc, bruissement
de cent nuits, traversait
le sommeil des genêts,
il se levait dans le hallier frémissant
des grillons pour voir un
blême chemin de lune qui montait
dans l’entrelacs des racines.
Il regardait par-delà le marécage.
Abrupt, indistinct, un reflet de lumière
le frôlait de son vol, le temps de ce
battement de cœur une sauvage
empaumure émergea des ténèbres,
hérissée, tête larmoyante.
Pressé entre les mains
le temps, non nommé : les essaims
qui, jaunes, suivaient
Curragh, nuées grondantes
au-dessus du lac, les abeilles
suivaient le pieux père,
il remuait les rames, il disait :
Je serai un mort dans la verte vallée.
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves, traduit de l’allemand par Jean-Claude Schneider, Atelier La Feugraie, 2005, p. 84-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, jean-claude schneider, le mont des juifs | ![]() Facebook |
Facebook |





