10/07/2025
Camille Loivier, torii

les écureuils traversent d’un jardin à un autre, transfrontaliers grâce aux arbres dont les branches se rejoignent par-dessus les murets, ils vont du passé au présent car chaque jardin contient une tranche de temps. La strate la plus ancienne où je sais qu’ils se retrouvent me fait les envier. Ils côtoient un temps que je n’ai pas vécu, cachent des noisettes là où des souvenirs qui ne m’incluent pas me préoccupent. Ils peuvent aller et venir dans le temps avec l’aisance d’une qui écrit, qui se balance d’avant en arrière. Qui, dans les lignes qu’elle trace, avance puis recule.
Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2025
Camille Loivier, torii

si les sonorités des chants d’oiseaux m’ont éloignée de ma route bordée de murets longs et étroits, au moins aurai-je écrit, au moins cette durée vaine de vivre aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée qui me semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite je n’ai fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, je me suis résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire
Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2025
Armand Robin, Le Monde d'une voix

Jamais de destinée
Une aube oblongue, jarre ébréchée
Sitôt que touchée,
Une jambe lancée
Sur la fuite des rosées,
Un ciel tendu, lancé
En toiles d’araignées, sitôt brisées,
Une âme en feuille dépliée
Jamais de destinée.
Debout, me sauvant en sauvage apparence,
Pur, injurié, rebelle torturé…
Jamais de destinée.
Armand Robin, Le Monde d'une voix,
Gallimard, 1968, p. 139
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, destinée | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2025
Armand Robin, Le Monde d'une voix

Vie avec toutes les autres vies
(Vie sans aucune vie)
Toutes les autres vies sont dans ma vie
Par les nuages nuage pris,
Ruisseau d’herbe en herbe étourdi,
Je me fais de vie en vie
Hâte sans fin rafraîchie.
Je dépasserai le temps,
Je me ferai mouvant, flottant,
Je ne serai qu’une truite d’argent.
Armand Robin, Le Monde d’une voix,
Gallimard, 1968, p. 137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2025
Armand Robin, Le Monde d'une voix

Tous Prisonniers
Tous les vivants en rang (plus ou moins en rang)
Fusils derrière, fusils devant.
Plus le droit de vivre de la rivière !
On a mis sous séquestre les prairies ;
On demande de marcher affamé dans la poussière,
On est traîné.
On donnera plus tard
D’autres villages, d’autres ruisseaux,
D’autres haltes, d’autres repos,
On nous dira de répéter les mêmes mots,
De nous tromper.
On ne nous laisse pas de papier
Où crier : « Nous voulons espérer ! »
Armand Robin, Le Monde d’une voix,
Gallimard, 1968, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, vivant | ![]() Facebook |
Facebook |
Armand Robin, La Monde d'une voix

En tout, partout je tiens debout
Je veux jusqu’à ma tombe qu’on me calomnie,
Je veux qu’après ma tombe encore on me nie.
Grande source inaltérée
Mes beaux cris
Arabes, russes, chinois, japonais
Vous ne pourrez me sauver !
Jamais je n’ai séparé les terres,
Tous les cris bafoués dans ma bouche ont remué,
Ont repris vie
Furent à neuf sur mon sang respectés.
J’eus une âme d’amour et de pureté,
Mes passions furent la brume, les fleurs la lune.
J’ai fait mon âme menue
Pour que la plus faible lune, lorsqu’une nue
L’assiège, puisse chez moi trouver demeure
Humble, amie,
Pour sa grande face incertaine.
Et la nuit, malgré ses étoiles messagères,
Est une étrangère.
Armand Lubin, Le Monde d’une voix,
Gallimard, 1968, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, passion | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2025
Armand Robin, Le Monde d'une voix

Un homme
Je ne serai jamais à la mode
Je ne serai jamais commode.
Aragon passe très bien ;
C’est un petit homme de rien,
Mi-bourgeois et mi-malin.
Armand Lubin, Le Monde d’une voix,
Gallimard, 1968, p. 59 .
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2025
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l'inverse)
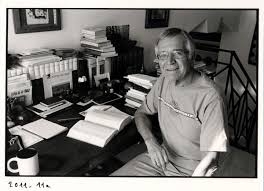
Dans l’agréable fraîcheur de la matinée
Puces de la Mosson, le gris des arbres
Un thé avec un brin de menthe
La vieille dame qui va le servir
Essuie soigneusement le fond du verre
Table fragile en plastique vert sombre
Un bruit de souvenirs vient dans la tête ;
On est au Café Populaire à Sidi Slimane
Frappe des dominos et des verres sur les tables
Ou quelque part à Dar Belamri
Dans un matin tranquille
Verre de thé, méloui, c’est plutôt bruits de mots qui sont
Comme autant d’objets dépareillés qui te racontent
On se demande bien quoi dans ce marché de plein air.
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l’inverse),
PUHR, 2025, p. 128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des objets nous accompagnent (ou l'inverse), souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
02/07/2025
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l'inverse)

Une bibliothèque prend peu à peu beaucoup de place ;
Toute une pièce pour les livres de poésie. Deux grands murs pour les autres
Et dans un troisième endroit, de beaux livres (comme on dit)
À cause de voyages qu’on a faits,
Un rayonnage pour les revues dans le garage.
Le temps dispersé de la bibliothèque.
Le corps dispersé de la bibliothèque.
Autant dans la maison que dans le temps d’une vie.
Quelque chose dont la forme se perd
En des livres venus là par hasard ou qu’on n’a pas lus
Et d’autres qui n’y sont pas, qu’on empruntait
Là où pendant longtemps on travaillait.
Une bibliothèque de lectures oubliées.
Chaque livre somme un miroir sans tain
On y regarde dans le vide d’avoir vécu
Sans rien relire de ce qu’on a lu.
James Sacré, Des objets nous accompagnent
(ou l’inverse), PURH, 2025, p. 82-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des objets nous accompagnent (ou l'inverse), bibliothèque | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2025
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l'inverse)
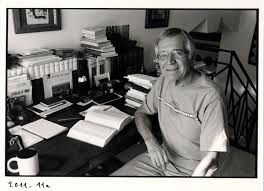
De petites croix, fines ou trapues,
Elles sont pour la plupart fabriquées au Mexique
(C’est indiqué au verso comme on le dirait
Pour une page écrite ou pour une peinture)
Des croix avec un message (au recto donc)
Peintes qu’elles sont avec des figurines d’étain ou de fer blanc :
Milagris dijes ou promesas, sortes d’ex-voto
Ou seulement des charmes porte-bonheur, porte-chance.
On les trouve parmi d’autres objets,
Ou c’en est tout un assortiment dans un panier
Colorado Nouveau Mexique et l’Arizona,
Boutiques pour les touristes et pas que
Et dans les musées. Elles sont de la couleur et des matières
Agréables devant les yeux, dans les mains :
Bois, céramique, une en cuivre,
Quelque chose de solide et de vécu.
On se souvient que Jésus
Sans doute a travaillé
Avec son père artisan charpentier.
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l’inverse),
PURH, 2025, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des objets nous accompagnent (ou l'inverse) | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2025
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l'inverse)

Quelque part en Galicie.
Le tour permet aux mains du potier
De monter une grande quantité de bols, les voilà mis
Dans presque tout l’espace de l’atelier, comme si
L’obscur z la terre nue
Fleurissait par-dessus le ciment.
Sur le haut d’un meuble chez moi
D’autres bols de fabrication marocaine :
Les regarder met du plaisir
Dans les mots silencieux.
James Sacré, Des objets nous accompagnent (ou l’inverse),
PURH, 2025, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des objets nous accompagnent (ou l'inverse) | ![]() Facebook |
Facebook |
29/06/2025
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Aux Champs Élyséens
Sur les Champs Élysées de Marcel Proust
les marronniers endurent une foule
hétéroclite et veule il eût dit : oust !
l’enfant au cerceau dont perdu le moule
il narra la fin d’un monde qui croule
sous la poussée de barbares nouveaux
ont fait depuis longtemps rôtir le veau
d’or pour convertir tout en marchandise
tout jusques à vos rêves vous est vo
lé reste une uniforme bâtardise
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?,
La Rumeur libre, 2025, p. 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, décadence | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2025
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Compte tenu des mots
Deux perdrix font un trou dans la poussière
du hangar s’y vautrant en un nid
la faune vous a de ces mœurs princières
dommage qu’on en ait été bannis
ce non pas suite d’un décret éni
gmatique mais du fait de la parole
vu qu’elle abstrait on n’est plus à la colle
avec le « monde muet » qu’il prisait
Ponge remonté contre le symbole
pas pour autant le gars qu’il se taisait
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?
Le Merle moqueur, 2025, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, parole, animal | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2025
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Hors de question d’aller sur fesse bouc
où se débonde libre un tombereau
d’accablantes niaiseries c’est un souk
nauséabond où se montrent les crocs
où s’exhibent les fesses des héros
du jour mais tenez-vous voici le pire
on se soumet de facto à l’empire
des sens prostitués : à la canto
nade on divulgue son minable dire
version abâtardie du bel canto
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?
Le Merle moqueur, 2025, p. 34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ?, bel canto | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2025
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?

Rosebud
Regard de qui reconnaît son désir
après avoir troué les subterfuges
comme il s’embue qui voulait se durcir
tant qu’il n’avait remémoré sa luge
- s’arcbouter sur sa lésine vous gruge
serré dans son bouton la rose attend
que l’enclos de ses larmes se déten
de et les laisse s’écouler et les laisse
l’ouvrir elle la rose tant et tant
que la haine de soi plus ne la presse
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ?
Le Merle moqueur, 2025, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent foucaut, sacrée marchandise, hein ?, rosebud, cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |





