30/09/2025
La langue est un grand étonnement, entretien evzc Étienne Faure
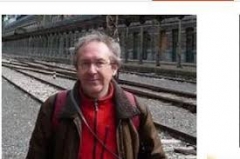
« la langue est un grand étonnement »
Quand avez-vous commencé à écrire ?
À l’adolescence. J’ai bien eu le goût de faire quelques petits écrits plus tôt, mais c’était lié à la confection de livres, je fabriquais des livres et il fallait donc les remplir, raconter des histoires... Au début, j’ai commencé par écrire des sonnets, c’était cela qui me semblait la forme la plus pertinente, la plus seyante... Ensuite, il y a eu le contact un peu foudroyant avec le surréalisme. J’ai essayé de pratiquer l’écriture automatique, le cadavre exquis … tout ce que l’on peut explorer
pour amplifier la découverte…C’était intéressant pour sortir d’un carcan un peu classique. Leschoses sont parties comme cela, mais moderato cantabile. Je suis peu à peu entré dans d’autres
problématiques, par exemple l’importance de l’étymologie, de son poids dans le texte, tout ce querecèlent les mots, et bien sûr leur mouvement via la syntaxe. La langue est un grand étonnement…Parallèlement je lisais beaucoup de poètes, français, étrangers, anciens ou contemporains, mais aussi beaucoup de prose (les auteurs russes, allemands, tchèques, polonais….). Au fond je progressais dans la trilogie indivisible de la langue « lue, parlée, écrite » qu’on inscrit dans son curriculum vitae pour aller se vendre sur le marché du travail. « Lue, parlée, écrite » est aussi le titre d’une des parties de Légèrement frôlée.
Le principe du poème est de créer une contrainte. J’ai traversé une période où le blanc était fortement dominant, dans les années fin 1970 et 80, le blanc avait une grande autorité, et j’ai fréquenté cette poésie-là. Il faut tout lire, y compris les auteurs dont on se sent le plus éloigné parla façon ou le regard, cela sert de poil à gratter… Ensuite j’ai eu besoin de retrouver une forme plus compacte avec des contraintes. L’usage du blanc entraînait un démantèlement qui ne m’allait pas, même si je restais très intéressé par les travaux où les mots montent en charge, prennent du poids, résonnent très fortement. Cela me parlait plus qu’un simple désossement sur la page – j parle un peu ardemment ! – qui ne m’allait pas. Je voulais retrouver du corps dans le texte. Cela
dit, il y a énormément de poèmes, de diverses époques, où le blanc est grandement présent, et qui me parlent beaucoup.
Avant Légèrement frôlée et Vues prenables, vous avez d’abord été abondamment publié en revue ?vi
Oui, c’est une chance de rencontrer un lectorat différent d’une revue à l’autre, en passant de La NRF à Conférence, à Théodore Balmoral, Rehauts, Europe, Le Mâche-Laurier... Ce sont des revues d’unton et d’un parti pris différents et il y a eu le plaisir de se retrouver en présence d’autres auteurs – parfois même déjà morts – dans le grand atelier contemporain où la poésie se fabrique. Les textes peuvent ainsi gagner à attendre, à être un peu remâchés, ne pas mimer la logique marchande qui met en circulation tout et tout de suite… Ne pas craindre les ratures… Le revers de l’affaire, c’est qu’au bout d’un moment on a le sentiment d’être un auteur un peu émietté, un peu disséminé. Il fallait donc franchir le seuil et arriver au livre avec la difficulté souvent soulevée par certains auteurs de dépasser le simple assemblage, de constituer un peu plus qu’un recueil pour parvenir à
un ensemble, à un livre. La question de l’homogénéité de Légèrement frôlée et de Vues prenablesrésulte d’un travail de tamis, d’élimination de textes qui me paraissaient un peu courts, dans toutes les acceptions du terme, où souvent prédominaient un esprit un peu grinçant et un
humour qui ne collaient pas vraiment avec le reste. Je m’étais aperçu que cela mettait les ensembles un peu de guingois quand on laissait ces petits textes à côté des autres. Il y a donc une forme de sélection qui s’est opérée.
Mais l’humour s’est maintenu dans certains poèmes de vos deux livres.
Vous êtes le premier à me le dire... On m’avait jusqu’alors parlé d’une ironie ou d’un ton
caustique. L’humour est une chose délicate, a fortiori en poésie où il faut faire léger, mais j’espère qu’il est un peu apparent. C’est quelque chose que j’essaie de conserver.
Je retiens un exemple ; vous jouez sur le sens d’une expression, "à ravir" dans le vers : – la robe allait à vous ravir.
Il y a cette tentation de détourner, de décaler un petit peu le sens ; c’est par excellence le travail sur l’écriture, ce n’est pas nouveau, mais j’essaie de réprimer un peu cette tendance parce qu’ellepourrait apparaître comme un amusement anecdotique qui, à certains moments, pourrait sonner un peu faux dans le reste du texte.
On lit aussi dans vos textes un autre travail de l’écriture, qui aboutit à détourner l’attention de ce qui peut êtregrave par ailleurs, par exemple avec les derniers vers de "les langues de sable" :
partout zone de cabotage clapotis charabia,
le remuement aux mille langues.
Le reste du poème est très grave – notamment avec la présence de la mort.
C’est un peu ce qui est suggéré dans le titre, Légèrement frôlée, une manière d’alléger la gravité, trèssouvent présente chez moi, de faire en sorte de ne pas trop s’y attarder pour ne pas s’enliser dans un pathos de mauvais aloi. Donc la forme ici permet d’alléger, par effet de contraste; c’est une propension fréquente, un peu comme si l’on avait le pas lourd : j’essaie d’y introduire un peu de contrariété pour que le pas soit un peu moins scandé, un peu moins pesant, le tempo plus alerte.
Si la forme était trop solennelle, eu égard au propos, cela ferait trop mastoc.On me renvoie toujours au fait que la mort est extrêmement présente dans mes poèmes, mais il me semble qu’il y a la mort et le rire, que ce sont deux déclencheurs importants. La difficulté est
de les faire cohabiter par un écrit pas trop sombrement teinté ; et puis d’essayer de passer autrechose à autrui en évitant d’en rester à une simple singularité.
En dehors du rire, il y a un travail autre dans la langue. On relèverait quantité de fragments du type : car ignorant / à tout coup tout de la géographie [...].
C’est sans doute la marque d’une défiance au regard de l’éloquence, c’est clair, et aussi du « bien tourné », de la chose qui tombe trop bien comme un pli de pantalon sur une chaussure, vous savez… Sans doute faut-il conserver une petite fêlure, une rupture, non pas pour à tout prix chercher l’incongru, le saugrenu, mais pour arriver à être audible différemment, peut-être pour surprendre le lecteur quant à ce qu’il pensait découvrir après le virage du vers, qu’il y trouve autre chose.
La mort est présente, cela est sûr, mais on ne peut pas, par exemple, parler de la mort des fruits. Ne s’agit-il pas plutôt d’une disparition continue ?
Le pendant de cela, dans Vues prenables, c’est la citation d’Henri Thomas, donnée avant un poème, « rien vécu » : J’ai compris que l’écriture remplace la vie, enfin quelle essaie, que nous essayons de vivre deux fois.
C’est cette écriture en boucle que l’on a dans "Venise en creux", ou que constituent les répétitions dans le théâtre avec « Bonté des planches », ou la répétition des nuits. On est en effet dans un
système en boucle qui se nourrit avec ses morts, ses disparitions, ses oublis, et on les revit en permanence. Sur la disparition, je dirais que l’on écrit dans la nostalgie de ce qui est, bien sûr, passé, et aussi dans la nostalgie de ce qui bientôt va disparaître, – nostalgie au futur antérieur, lesdés sont déjà jetés. On a donc une espèce de répétition inlassable, jusqu’à la vraie.
De là l’importance de toute la littérature.
Les citations, les présences, les noms sont importants. Sans doute y a-t-il le sentiment d’appartenance à une chaîne, c’est-à-dire d’écrire de concert, en quelque sorte, dans l’esprit d’une recherche de synthèse avec ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous entourent. Cette idée de synthèse est par exemple dans le poème "toutes les nuits" et c’est ce qu’aborde littéralement le texte "les poètes" :
Puis le tréma chutant les poëtes
jadis présumés la tête dans les nues
sans ailes, en bas laissés pour compte à la rue
sans couvre-chef et sans rien qui parât
à leur propre folie,
endossaient des peaux d’hommes, allaient à pied
mandatés par les morts pour vivre
avec le même corps ou peu s’en faut, même peau
bâtie d’après d’anciens patrons, usant
leur poids de ciel endossés, vieux paletots,
tissus d’hier que la pluie alourdit
à ne savoir jusqu’où la porter, cette peau, pelisse
de fils élimés aux manches
pour déambuler à leur tour par la plaine
et finir dans la peau d’un ours, d’un singe
pareillement conspués, applaudis, aux prises
avec la chaîne.
Par ailleurs, tous les poètes sont autodidactes, j’ai mis du temps à le comprendre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’école de la poésie, il faut être un peu ignorant pour écrire en poésie – pas complètement, un peu... L’école est double, c’est celle de la vie, avec l’apprentissage de la mort,
de l’ivresse, de la beauté, de l’amour, etc., donc être homme avant d’être homme-poète comme disait Max Jacob ; mais c’est aussi l’école de la lecture des anciens, des contemporains, lecture que l’on intègre comme des incrustations, des collages dans le texte parce qu’on écrit avec, et parfois contre, ceux qui nous ont précédé et ceux avec qui nous vivons. Cette présence de la littérature, c’est cette aspiration à revendiquer une espèce de synthèse, une aspiration symphonique.
Au passage, on ne saluera pas assez les travaux de Poezibao qui offre un inventaire permanent despoètes et de la poésie avec un esprit d’ouverture qui frappe. Les contributions, dont les vôtres,
sont une grande chance. Ouvrir cette fenêtre, c’est aussitôt être en présence d’auteurs lointains, contemporains, étrangers, morts ou vivants… Cela donne des envies de retourner dare-dare à la librairie ou à la bibliothèque
entretien en Octobre 2009, publié dans Poezibao en novembre 2009
(à suivre)
Publié dans ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien avec Étienne faure | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2025
Georges Perros, Papiers collés, 3

Il y a toujours quelque chose d’illisible dans un poème (digne de ce nom). L’illisible, c’est le poème lui-même, rendu équivalent à la nature. Incueillable. On se donne des gants en semant.
La culture fait des perroquets. Une partie de la poésie moderne — mais qu’entends-je par là ? — est le fait de type pas bêtes qui ont lu jusqu’à la garde, et peuvent à leur volonté singer tel ou tel prédécesseur de leur choix.
Tout le monde est capable d’écrire n’importe quoi en se réclamant de la poésie.
Un poème, c’est l’intérieur et l’extérieur, quelque chose au cœur de laquelle on peut habiter. Et quand l’intérieur est trop confortable, permet une pose, voire un repos, ça se sent tout de suite. Un poème fait partie du monde, il s’intègre à tout l’invisible, à tout l’ailleurs, à ce que Bonnefoy appelle l’arrière-pays. Il y a des choses qui passent en nous, qui nous traversent, nous travaillent, comme on dit que la mer est travaillée, sans que nous en soyons les maîtres. Ni les esclaves. Le matériau nous ignore, nous lui sommes parfaitement indifférents. À prendre ou à laisser. L’art n’est pas autre chose que la récupération difficile de ces signes qui échappent au quotidien élémentaire, mais comme le tout échappe au détail.
Ce qu’on entend généralement par poésie est devenu la tarte à la crème de notre délicieuse société. On va même jusqu’à l’enseigner — l’ensaigner ? — dans les universités, ce qui pourrait suffire à incendier l’immeuble si l’exercice professoral n’était de longue date voué au ridicule de l’inefficacité absolue. Mais il est vrai, vérifiable, que pas mal d’individus diplômés continuent d’expliciter Rimbaud, Cummings, etc. En tout rien toute horreur. Les étudiants n’y voient que du feu, mais ce feu ne prend pas. Nulle part. Ils connaîtront trois vers de X. Y. Z., juste assez pour les citer de travers quand ils seront devenus députés, ministres, président de je ne sais quelle république.
Georges Perros, Papier collés 3, Gallimard, 1978, p. 15, 46, 46, 69, 169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geores perros, papiers collés, poésie " | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2025
L'Ours blanc : Cécile Sans et Natacha Muslera, Sous la voix : recension.

Au fil des années, avec régularité, L’Ours Blanc propose dans chaque livraison un texte (un seul) plus ou moins long qui, presque toujours, déconcerte le lecteur. Parce que la revue s’est vouée à publier ce qui apporte un point de vue sur la lecture et l’écriture à côté de l’ordinaire des revues, avec comme l’écrivent ses responsables l’« envie d’aborder le champ littéraire comme un espace dont les limites n’ont rien de définitif ni de contraignant. » Ce que propose la dernière livraison correspond bien à ce projet général puisqu’il s’agit de poésie sonore que le lecteur-auditeur peut (pourrait) construire en utilisant les matériaux réunis par les deux auteures. La notice qui présente Cécile Sand (enseignante-chercheuse) indique qu’elle travaille à une audio-écriture pour un film de Natacha Muslera (poète sonore, chercheuse autodidacte et cinéaste) et Stefano Canapa (cinéaste).
La revue s’ouvre avec des dessins qui semblent représenter des montagnes : il s’agit d’une notation pour suggérer les modulations de la voix dans l’interprétation des textes. Une fois admise cette manière de noter la musique vocale, qui ne peut qu’introduire des variations dans l’interprétation, le lecteur peut s’essayer à suivre cette partition dessinée en tenant compte de la durée des différents fragments, notée dans la dernière page, et des conseils qui laissent, eux aussi, beaucoup de liberté. Par exemple, pour la partition 3, cinq minutes et quarante-huit secondes, on lit, « les doigts et les yeux balaient la partition librement ». La durée est comptée et contraignante mais, ici, la voix garde une partie de son autonomie. On comprend que l’ajout d’un enregistrement qui complèterait dessins et texte serait incongru : un choix d’interprétation serait imposé alors que cette audio-écriture devrait être prise en charge différemment à chaque lecture orale/chantée ; pour la partition 7, la légende implique explicitement des interprétations très nombreuses : « pulsation et rythme arrivent par accident ».
Ce qui ne varie pas, ce sont les textes — au moins tels qu’ils sont écrits et lus ; il est probable que des lectures différentes, telles qu’elles sont suggérées, modifieront dans certains cas la signification, et il faut ajouter que certains d’entre eux ne sont pas aisément situables : l’absence de contexte peut entraîner des changements pour l’interprétation. On cherche ce qui peut unifier la soixantaine de textes de contenus très divers et de longueur variée, de trois mots à quatre lignes. Les cinq premiers semblent donner une orientation ; dans l’ordre : évocation du projet par la mention des voix (« mots rauques » et « voix de femmes »), de l’« enregistrement » dont la voix des enfants serait exclue, et de l’absence probable de compréhension de ce qui serait retenu (« langues inconnues ») ; ensuite, brièvement, mention de mouvement, de parfum, de couleur, pour finir par la pleine vue (« je voulais le voir à la lumière »). Ces divers éléments sont repris ici et là dans la suite, sans que d’autres soient exclus.
Un texte, daté (1842), son titre donné et présenté (« Il écrit son premier texte »), suggère une autre unité de l’ensemble. Ce « premier texte » qui rappelle « La loi sur le vol des bois » est de Karl Marx ; une nouvelle mention en est faite plus avant et, lié à cette question, est rappelé ensuite le droit coutumier qui permettait le ramassage du bois. Le lecteur en conclut que tous les textes sur des sujets très variés sont unis par le fait qu’il s’agit de citations ; elles en ont au moins l’apparence et parfois même la forme, posées parfois comme telles avec des guillemets. On repère assez rapidement un fragment de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (article maçonnerie) grâce à son écriture et un conte d’Andersen (La petite sirène), puis, avec un peu d’obstination, on retrouve par exemple avec l’internet la présence d’extraits de Gerty Danbury (Silences) et de Rachid Boudjedra (La Prise de Gibraltar) — on suppose que la liste est loin d’être close.
Ces deux possibilités de donner une unité au texte destiné à être oralisé sont complémentaires. Elles apportent, outre une relation forte à la littérature, un caractère particulier à cette audio-écriture en mêlant des fragments historiques et politiques à d’autres tirés de contes, des descriptions à des embryons de textes techniques, etc. Ce qui convainc que cette audio-écriture ne consiste pas (comme certains imaginent la pratiquer) à improviser en étant sur une estrade
Cécile Sans et Natacha Muslera, "Sous la voix", dans 'Ours blanc, 2025, n° 46, 28 p., 6 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 juillet 2025.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2025
Charles Reznikoff, Holocauste
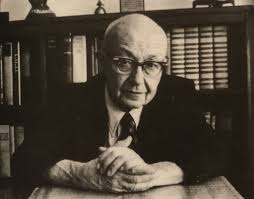
IV
GHETTOS
1
Au début il y avait deux ghettos à Varsovie :
un petit et l’autre grand,
et entre eux un pont.
Les Polonais doivent passer sous le pont et les Juifs dessus ;
et à côté, se trouvaient des gardes allemands pour voir si les Juifs ne se mêlaient pas aux Polonais.
Du fait des gardes allemands
tout Juif qui ne retirait pas son chapeau en signe de respect en traversant le pont
était abattu —
et beaucoup le furent —
et certains furent abattus sans aucune raison du tout.
2
Un vieil homme portait des morceaux de bois à brûler
pris dans une maison qui avait été détruite :
on n’avait donné aucun ordre contre ça —
et il faisait froid.
Un commandant S.S. le vit
et lui demanda où il avait pris ce bois,
et le vieil homme répondit que c’était dans une maison qui avait été détruite.
Mais le commandant sortit son pistolet,
le plaça sur la gorge du vieil homme
et l’abattit.
3
Un matin des soldats allemands et leurs officiers
entrèrent de force dans les maisons du quartier où les Juifs avaient été rassemblés,
en criant que tous les hommes devaient sortir ;
et les Allemands prirent tout dans les armoires et les placards.
Parmi les hommes se trouvait un vieil homme portant la robe — et le chapeau — de la secte pieuse des Juifs qu’on nomme les Hassidim.
Les Allemands lui mirent une poule dans les mains
et on lui dit de danser et de chanter ;
puis il dut faire semblant d’étrangler un soldat allemand
et cela fut photographié.
[…]
6
À trois heures un après-midi
une cinquantaine de Juifs étaient dans une cave.
Quelqu’un poussa le sac qui bouchait l’ouverture
et ils entendirent une voix :
« Sortez !
Sinon nous allons lancer une grenade. »
Les S.S. et la police allemande avec des bâtons dans les mains
se tenaient prêts
et se mirent à frapper ceux qui se trouvaient dans la cave.
Ceux qui en eurent la force
furent mis en file selon les ordres
et furent emmenés vers une place
et alignés sur un seul rang pour être abattus.
Au dernier moment
un autre groupe de S.S. arriva et demanda ce qui se passait.
Un de ceux qui étaient prêts à tirer répondit
qu’ils avaient sorti les Juifs d’une cave
et qu’ils s’apprêtaient à les abattre selon les ordres.
Le commandant du second groupe dit alors :
« C’est des Juifs gras.
Tous bons à faire du savon. »
Et ils emmenèrent les Juifs à un convoi
qui n’était pas encore parti pour un camp de la mort —
des wagons de marchandises russes sans marchepied —
et ils durent se hisser l’un l’autre dans les wagons.
Charles Reznikoff, Holocauste, traduit de l’américain et préfacé par Auxeméry, suivi d’un entretien avec Charles Reznikoff, Prétexte éditeur, 2007, p. 28-30 et 32-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, holocauste, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2025
Pierre Oster-Soussouev, Requêtes ; Pour un art poétique

Je parie sur la rationalité fondatrice de l’acte de poésie. L’attention — ou l’amour — commande en effet le moment de l’analyse et celui de la connaissance. Plus qu’attentifs, nous ne les séparerons pas.
*
Une définitive rupture menace le poème. Bien sûr, aucun acte littéraire n’aboutit. Cela posé, le refus d’aller jusqu’à la source de la phrase... Et de suivre la route de la phrase... De se mouvoir dans l’espace de la phrase...
*
Poésie comme implicite de la syntaxe, des successions insignes que l’harmonie inférieure engendre ; poésie méditée qui dégage et amplifie des structures libératrices.
*
Quête d’une simplicité inaccessible ; ou d’une complexité inapparente.
*
Ne rien anéantir jamais de ce que les siècles ont produit. Ne jamais rien dissoudre de ce qu’ils consacrent. Et ne contrevenir en rien à ce qui fait qu’ils se consument.
*
Prose, essence miroitante : horizon éclatant du vers. Les forces que dans le vers nous privilégions relèvent de l’art synthétique de la prose. Et les réussites même brèves du vers sont fonction de la prose infaillible.
*
Rejoue une à une les chances de chaque vers ; traduis les ruines du langage.
Pierre Oster Soussouev, Pour un art poétique dans Requêtes, version nouvelle suivie de Pour un art poétique, Le temps qu’il fait, 1992, p. 59, 59, 62-63, 64, 66, 67, 76.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piere oster-soussouev, requêtes, pour un art poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2025
André Frénaud, La Sainte Face ; Notre inhabileté fatale

L’irruption des mots
Je ris aux mots. J’aime quand ça démarre,
qu’ils s’agglutinent, et je les déglutis
comme cent cris de grenouille en frai.
Ils sautent et s’appellent,
s’éparpillent et m’appellent
et se rassemblent et je ne sais
si c’est Je qui leur réponds ou eux encore
dans un tumulte intraitablement frais
qui vient sans doute de nos profondes lèvres,
là-bas où l’eau du monde m’a donné vie.
Je me vidange quand m’accouchent ces dieux têtards.
Je m’allège et m’accroîs par ces sons qui dépassent,
issus d’un au-delà, presque tout préparés.
J’en fais le tour après, enorgueilli,
ne me reconnaissant qu’à peine en ce visage
qu’ils m’ont fait voir et qui parfois m’effraie,
car ce n’est pas moi seul qui par eux me démange.
27 janvier 1948
André Frénaud, La Sainte Face, Gallimard, 1968, p. 78.
J’ai dit comment se constituait chez moi un long poème : à partir d’une irruption de mots, sans conception architecturale préalable, et m’y reprenant à plusieurs fois, non sans beaucoup de réflexions sur la place de tel élément et sur ce qui manque ailleurs, ces constructions verbales de dimension souvent vaste, avec des raccourcis et des ruptures, des raccordements imprévus, tous les bouleversements d’une longue phrase qui tâche de s’y retrouver et de s’inventer une certaine unité.
André Frénaud, Notre inhabileté fatale, entretien avec Bernard Pigaud, Gallimard, 1979, p. 170.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, notre inhabileté fatale, irruption des mots, bernard pingaud | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2025
Jacques Dupin, L'embrasure

(…) Excédante, inexpiable, la poésie ne comble pas mais au contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscitent. Et ce n’est pas pour qu’elle triomphe mais pour qu’elle s’abîme avec lui, avant de consommer un divorce fécond, que le poète marche à sa perte entière, d’un pied sûr. Sa chute, il n’a pas le pouvoir de se l’approprier, aucun droit de la revendiquer et d’en tirer bénéfice. Ce n’est qu’accident de route, à chaque répétition s’aggravant. Le poète n’est pas un homme moins minuscule, moins indigent et moins absurde que les autres hommes. Mais sa violence, sa faiblesse et son incohérence ont pouvoir de s’inverser dans l’opération poétique et, par un retournement fondamental, qui le consume sans le grandir, de renouveler le pacte fragile qui maintient l’homme ouvert dans sa division, et lui rend le monde habitable.
Jacques Dupin, L’Embrasure, dans L’Embrasure, précédé de Gravir, Poésie/Gallimard, 1971, p. 135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, manque, tourment | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2025
Pierre Reverdy, En vrac

La poésie est atteinte quand une œuvre d’art quelconque s’intègre, ne fût-ce qu’un moment, à la vie réelle de l’homme par l’émotion qu’elle provoque dans son esprit et comme dans sa chair. La poésie n’est dans rien d’autre que dans la mise en commun d’aspirations diverses auxquelles l’œuvre d’art peut donner la violente illusion de s’être rencontrées.
Le poète ne s’occupe pas et ne doit pas s’occuper de l’émotion que pourra provoquer son œuvre. Il ne doit et ne peut connaître ou reconnaître, dans son œuvre, que l’émotion qui lui a donné l’élan nécessaire à sa création. Mais, plus cette œuvre sera loin de cette émotion, plus elle en sera la transformation méconnaissable et plus vite elle aura atteint le plan où elle était, par définition, destinée à s’épanouir et vivre, ce plan d’émotion libérée où se transfigure, s’illumine et s’épure l’opaque et sourde réalité.
On ne fait pas de la poésie. On écrit des poèmes en risquant sa chance ; on peint des tableaux, on compose un morceau de musique et il s’en dégage de la poésie ou il ne s’en dégage pas, c’est-à-dire qu’on a écrit, peint, composé absolument pour rien, ou bien…
Le poète doit voir les choses telles qu’elles sont et les montrer ensuite aux autres telles que, sans lui, ils ne les verraient pas.
L’art et la poésie ne sont là que pour puiser dans la nature ce que la nature ne fait pas.
Je vis, d’abord — j’écris, parfois, ensuite. Mais il m’arrive de sentir davantage ce que veut dire vivre en écrivant.
Pierre Reverdy, En vrac, Flammarion, 1989, p. 33, 42-43, 78, 96, 99, 185.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, en vrac, émotion, réalité" | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2025
André du Bouchet, Carnet 2
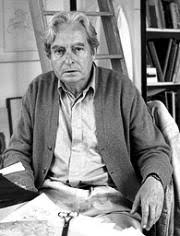
comme je passe j’ai trouvé
puisque cette fois de nouveau je ne cherche
rien d’autre
que déjà la porte ouverte
poésie — jusqu’au silence du désenchantement de nouveau conduit
en coup de vent à un réveil
dans le calme
de la lecture, ce retentissement, commotion en retour — de la parole perdue, en place alors, et perdue
une parole dans laquelle celui qui a écrit cherche la vérité de
ce qu’il veut atteindre
rouvre à silence dans le tumulte
parole, le silence qui la porte, c’est le souffle — et
souffle qui l’emporte aussi bien
je cours vers la figure
de nouveau disparue quand j’ai couru vers elle
un défaut de la langue éclaire éclaire aussi la langue
ce qui aère la langue — en sortir aussi rapidement qu’on a pu y entrer
le sol, c’est la langue
André du Bouchet, Carnet 2, Fata Morgana, 1998, p. 9, 29, 73, 90, 91, 97, 116, 143, 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet 2, andré du bouchet, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2025
Jacques Réda,

Tombeau de mon livre
Livre après livre on a refermé le même tombeau.
Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée
Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.
Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau
Double infidèle et désormais absorbé dans le site,
Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —
Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil
Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —
Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future
Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.
Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli
Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,
Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe
Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.
Jacques Réda, L’herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2025
Jean Paulhan, À demain la poésie
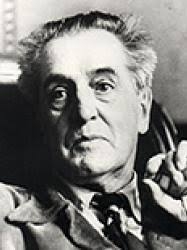
CE QU'EN DIT LE PREMIER VENU
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du monde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, à demain le poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2025
Agnès Rouzier, Non rien
Qu’importe la chambre, – si ce n’est tout entier le temps – qu’importe la chambre ? Pouvait-on même dire : refuge ? (Je effacé par nous mais recevant de cet insistant pluriel la légèreté principale. Je s’écoutant rire.) Qu’importe la chambre, hors les autres cellules qui l’écrasent, l’enserrent, l’entourent, la protègent, qu’importe la chambre hors ces escaliers qu’il faut monter pour l’atteindre, qu’importe la chambre si ce n’est cette île, en plein ciel, portée par d’autres îles, et ce personnage anonyme qui y accède (mettons qu’il se souvienne de … ou de tout autre). Qu’importe ce faisceau de questions, hors cette clôture que nul ne déchiffre, mais que chacun touche et parcourt. Voici que le vent a tourné et que la plage oblique vers un autre espace : la mer impatiente. Jadis chaude, maintenant glacée, frangée d’une même route, même rangée d’immeubles, jadis glacée : roulé en boule dans un creux de sable, un chandail abandonné. Qu’importe la chambre – ou salle à manger – et nous le revoyons dans la petite cuisine – je vous en prie il faut le délivrer – dans la petite cuisine en désordre – mais toujours le bocal de cornichons au sel, à moitié vide – devant le bol de café au lait (odeur et couleur écœurantes, bord ébréché), qu’importe, si nous l’effaçons il se crée – ici bougeant, ici dormant, homme, paysage, et ville, et machine, et fleuve, insecte ou vague, ici endormi et plus dense, de tout son corps pesant attiédi de sueur et d’odeur nocturne (au plus fort), ou bien éveillé les pieds nus après la douche, dans le plaisir infiniment fragile de l’été, avant d’avaler – aliment complet et réminiscences — un verre de lait glacé, ô mères… Qu’importe la chambre et ce récit qui le délivre, l’enserre : le roi dit : nous voulons. Et toi, penché tu te souviens : moi-je. (ou bien la rue, la pluie, les courses, le matin fatigant, et les oranges que l’on transporte déjà fades.)
Agnès Rouzier, Non rien, dans Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1985, p. 30-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, non rien, chambre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2025
Valérie Rouzeau, Récipients d'air
Photo T. H.
Pommes poires et tralalas merles renards flûtes à bec
Et les petites bottes bleues enfoncées dans la boue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Au bois sifflaient les ziaux les loups les pâtres grecs
Beaucoup d’airs de toutes sortes faisaient gonfler nos joues
Pommes poires et tralalères merles renards flûtes à bec
Il n’y avait pas d’euros de dollars de kopecks
On pouvait chanter fort la gadoue la gadoue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Dans le vent murmuraient le lièvre et le fennec
Tournaient les grues les elfes les roues
Pommes poires et tralalères merles renards flûtes à bec
Au soleil se grisaient les drontes et les pastèques
Les porcelets songeurs échappés de la soue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Mais de ce temps bon vieux ont eu lieu les obsèques
Et je sens ma chanson de vilain qui s’enroue
Pommes poires et tralalas merles renards flûtes à bec
Après la peine la joie revenait aussi sec
Valérie Rouzeau, Récipients d’air, Le Temps qu’il fait, 2005, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, récipients d'air, fruit | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2025
Jacques Dupin, L'Embrasure

Excédante, inexpiable, la poésie ne comble pas mais au contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscitent. Et ce n’est pas pour qu’elle triomphe mais pour qu’elle s’abîme avec lui, avant de consommer un divorce fécond, que le poète marche à sa perte entière, d’un pied sûr. Sa chute, il n’a pas le pouvoir de se l’approprier, aucun droit de la revendiquer et d’en tirer bénéfice. Ce n’est qu’accident de route, à chaque répétition s’aggravant. Le poète n’est pas un homme moins minuscule, moins indigent et moins absurde que les autres hommes. Mais sa violence, sa faiblesse et son incohérence ont pouvoir de s’inverser dans l’opération poétique et, par un retournement fondamental, qui le consume sans le grandir, de renouveler le pacte fragile qui maintient l’homme ouvert dans sa division, et lui rend le monde habitable.
Jacques Dupin, L’Embrasure, dans L’Embrasure, précédé de Gravir, Poésie/Gallimard, 1971, p. 135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, manque | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2025
Jacques Dupin, Gravir

Le partage
Une larme de toi fait monter la colonne du chant.
Une larme la ruine, et toute lumière est inhabitée.
La corde que je tresse, la rose que j’expie,
N’ont pas à redouter de lumière plus droite.
Le peu d’obscurité que je dilapide en montant
C’est de l’air qui me manque à l’approche des cimes.
Par le versant abrupt, la plus libre des routes,
Malgré le timon de la foudre et mes vomissements.
L’initiale
Poussière fine et sèche dans le vent,
Je t’appelle, je t’appartiens,
Poussière, trait pour trait,
Que ton visage soit le mien,
Inscrutable dans le vent.
Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 29 et 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, gravir | ![]() Facebook |
Facebook |






