28/09/2015
Takuboku Ishikawa, Ceux que l'on oublie difficilement

J’ai compté les années d’espérance
et je fixe mes doigts
je suis fatigué du voyage
Il se demandait en riant
s’il se marierait
Il n’a toujours pas pris épouse
Il m’a donné la nourriture
et je me suis retourné contre lui
que ma vie est lamentable
Le soir au moment de se séparer
à la fenêtre du wagon j’ai bâillé
de tout cela je n’ai plus que regrets
Mon ami venait m’emprunter quelques sous
il s’en retourne
les épaules couvertes de neige
Takuboku Ishikawa, Ceux que l’on oublie difficilement, traduit du japonais par Alain Gouvret, Yasuko Kudawa et Gérard Pfister, Arfuyen, 1989, p. 8, 11, 12, 17, 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : takuboku ishikawa, ceux que l’on oublie difficilement, haiku, amitié, regrets | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2015
Jacques Roubaud, Dix hommages / Octogone
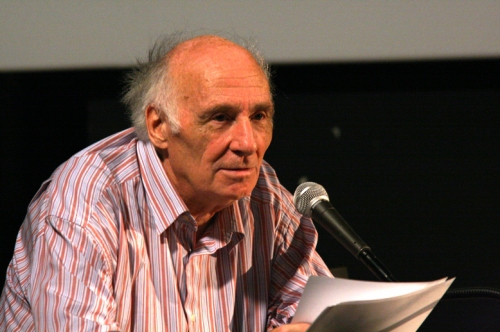
In memoriam Edoardo Sanguineti
sopra il secondo versodi un sonetto rovesciato
Ed. S., in Renga, 1971.
Quelques jours avant la mort nous évoquions
Par lettre écrite, à l’ancienne, ces moments
<Antiques (quarante ans !) dans la fosse aux lions
De l’Hôtel Saint-Simon, quadri-dialoguant-
Sourds, ce renga occidental : lui, moi, pions
Agités plus qu’erratiques insolents
Dans le jeu par Octavio conçu : sonetto,
Sonnet, la chose italienne où Shakespeare
A passé ; Góngora, Marino, les pires
Poètes, et meilleurs ; Mallarmé, Giacomo
« Caro padre » notre, peu profond ruisseau
Calomnié la mort. La forme où l’écrire
Fut notre lien en toutes ces années. Dire
Cela soit ma poussière sur ce tombeau.
Jacques Roubaud, Dix hommages, Ink, 2011, np,
repris dans Octogone, Gallimard, 2014, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, dix hommages, octogone, edoardo sanguineti, sonnet, tombeau | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2015
Édouard Levé (1965-2007), Œuvres

1. Un livre décrit des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.
3. La tête de Proust est dessinée sur une page d’À la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte.
57. Un homme tient dans la main gauche Les Fleurs du Mal et dans la main droite un manuel de savoir-vivre du dix-neuvième siècle. Il lit à voix haute en prélevant aléatoirement des mots dans les deux livres, et s’efforce de formuler des phrases grammaticalement correctes.
425. Une voix fait le récit de la réalisation d’une œuvre non réalisée, comme si elle l’avait été : amonceler des pipettes dans el désert du Sahel.
Édouard Levé, Œuvres, P.O.L, 2015, p. 7, 7, 57 et 144.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, Œuvres, livre, proust, baudelaire, copie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2015
Cédric Demangeot, Une inquiétude

L’ennui est le mètre étalon de l’intelligence à la française. Se donner l’air d’aimer l’ennui en matière d’art, revient à se donner l’air intelligent. Il est de mauvais goût d’être saisi, d’être emporté, ravi & ravagé par l’œuvre. Tout ce qui fait violence ou péripétie, tout ce qui fait rythme ou force vive est méprisé, considéré comme impur ou de basse inspiration. Qu’on ne s’y trompe pas, ce critère n’est jamais que celui d’une petite coterie, aussi étriquée dans ses vues que totalitaire dans l’exercice de son pouvoir. Cette esthétique de la constipation idéale, où beauté rime avec propreté et mesure, est depuis quatre siècles environ, celle simplement d’une classe sociale qui aimerait bien se faire passer pour une aristocratie de l’esprit, et qui s’érige à ce titre en arbitre intangible de la culture nationale. Ceux qui en sont se reconnaissent. Ils se transmettent de père en fils leurs privilèges, leur chlorose et leur néant.
Cr réflexe crypto-classique sectaire, s’il est éminemment français, est aussi, me semble-t-il, une réminiscence de l’idéal chrétien de frustration : ce qu’on s’interdit, ce qu’on réprime et qu’on va jusqu’à condamner, c’est encore ici le plaisir et l’effroi, et c’est encore l’intensité vitale. C’est la vie.
Cédric Demangeot, Une inquiétude, Poésie / Flammarion, 2013, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, intelligence, classicisme, sectaire, esthétique, classe sociale | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2015
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo
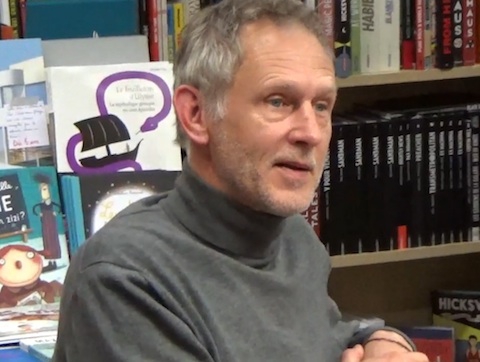
Aperçu, à la morsure, à la langue de cendre,
illuminé, ses draps déchirés dans la puanteur,
oublié près du gouffre, la salive à la bouche,
comme un garçon d’argile foudroyé, peint, dévoré et sali,
à l’agonie sur l’herbe du pré, puni, poussé dans le trou,
dévorant son foie et touchant l’eau, choisissant,
triant les coquilles dans le noir, écrasant les
bouquets qui puent et qui salissent, les morceaux
perdus dans l’obscurité, Innocent pinçant la fleur,
la feuille rouge de l’arbre, les lèvres sur le bois poli,
la bouche fermée, prêt à mourir, toujours châtié,
toujours libre, les pieds nus sur le limon, en odeur
de neige.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,
1986, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, corps, odeur, obscurité | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2015
Carol Snow (née en 1949), Pour, dans Rehauts

Postures du corps VI
Voulant non seulement l’immobilité des collines
mais une médiation — comme un regain
sur les collines — mur
de silence au-dessus des collines. Moore sculpte une figure
massive en marbre noir : un corps
de femme, couchée, courbée ; une éloquence
d’os, de coquillage,
pierres portées par-delà la contradiction.
Tu t’es arrêtée
au bord de la route, étalement
de collines à mi-distance, quelques maisons. Seules les vertes
étendues du vignoble dans l’entre-deux
semblaient accessibles, c’est-à-dire humaines — question
d’échelle : silence imposant, tel que seules
les collines (également
imposantes) pouvaient reposer.
Cézanne, penché sur sa toile, aurait maîtrisé
cette vue, penses-tu : les bleus et les verts
et les ocres du proche et du lointain, cette posture
précaire de la danse, non le dessin qui unit
le dissemblable, par exemple les corps, mais le maintien
séparé du corps et du terrain, tu étais si
figée, tu pensais que tu pourrais devenir ces collines,
ou bien être née de ces collines
ou bien ton corps
aurait été un modèle pour ces collines.
Carol Snow, Pour, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès,
p. 3-4.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, rehauts, maïtreyi et nicolas pesquès, collines, corps, femme, cézanne | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2015
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes
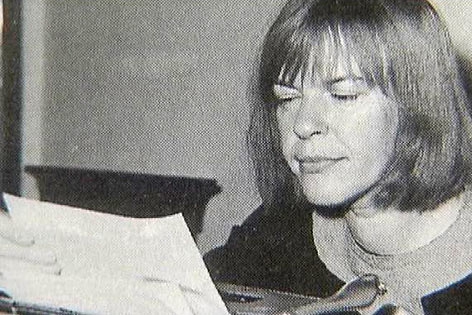
Tu dors, dors, c’est
une histoire, non pas l’Histoire
interprétable. Alors il vaut mieux te rendormir.
Servies secrets
réfugiés
quand les premiers mots
retentissent, alors
tu dors,
tu n’as pour les mots
plus aucun intérêt
Tôt le matin
quand les procès
commencent et que les
doux visages
des assassins et
les juges
prononçant la sentence
s’évitent,
quand une aile
d’avion effleure
tes cheveux, quand tu
trouves
ton corridor,
vers la mort, vers
l’isolement
vers l’oubli
alors tu
dors, quand le gong
retentit, et
ils parlent
du sommeil comme
d’un miracle.
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe
a des ailes, édition, présentation et traduction
de Françoise Rétif, Poésie / Gallimard, 2015,
p. 491 et 493.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, dormir, histoireassassin, juge, isolement, miracle | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2015
Ted Hughes, Birthday Letters, traduction Sophie Doizelet
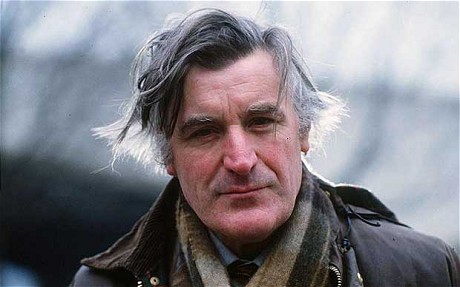
Wuthering Heights
Walter était le guide. Le cousin de sa mère
Avait hérité de quelques assiettes à soupe des Brontë.
Il se sentait désolé pour elles. Les écrivains
Sont des gens pitoyables. Ils se cachent de la réalité,
La déguisent. Mais ton euphorie transatlantique
L’a rendu euphorique. Il est entré en effervescence
Comme son vin de rhubarbe gardé trop longtemps :
Une récolte de légendes et de racontars
Au sujet de ces pauvres filles. Puis,
Après le presbytère, après la chaise longue
Où était morte Emily, les minuscules livres faits main,
Les dentelles délicates, les chaussures pour petites fées,
Ce fut le chemin tracé depuis Stanbury. L’ascension,
Un mile toujours plus loin, plus haut, menant
À l’Éden privé d’Emily. C’était pour toi à présent
Que la lande se soulevait, déployait
Ses fleurs sombres. C’était bien.
Plus sauvage, peut-être, qu’Emily ne l’avait jamais vu.
Les pieds mouillés, la tête nue,
Elle montait péniblement cette colline pour rejoindre ses seuls amis —
On peut l’imaginer. Une forteresse obscure.
[...]
Ted Hughes, Birthday Letters, traduit de l’anglais et présenté par
Sophie Doizelet, Poésie / Gallimard, 2015, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ted hughes, birthday letters, sophie doizelet, emily brontë, wuthering heights, évocation, portrait | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2015
Rose Ausländer, Pays maternel

Marianne Moore
Dessiné
À la plume d’oiseau
Son visage
Chaque trait
Un modèle mathématique
Tiré
Par un regard incorruptible
Froid échantillon poétique
Et pourtant
Chaque figure réchauffée
Du sang de son idée
Rose Ausländer, Pays Maternel, traduction
Edmond Verroul, Héros-Limite, 2015,
p. 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, marianne moore, poésie, portrait | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2015
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes
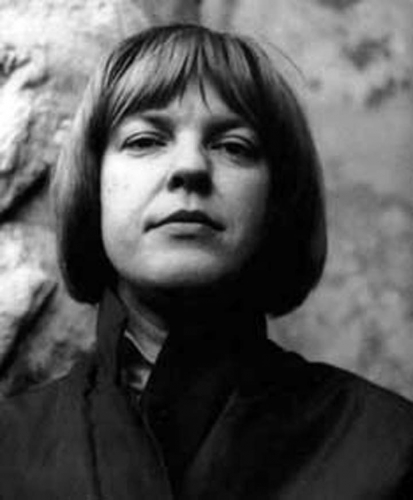
Une sorte de perte
Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.
Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.
Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.
Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.
De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.
De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.
Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,
porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,
(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)
intrépide en religion car ce lit était l’église.
La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.
Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.
Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.
Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.
Ce n’est pas toi que j’ai perdu,
c’est le monde.
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2015
Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts
Comment fonctionne le théâtre, c’est la question dès qu’on entre dans le paysage d’une station, l’été balnéaire, au bord du débordement, puis vide l’hiver de toute âme, vacance qui accentue le décor de plage : vieux ressac, débris de fioles, de jouets, de sandales monoparentales, de raquettes, de râteaux, de sacs en plastique, tout un fourbi détaché des corps hier étalés sur le sable — sur le dos sur le ventre — criant ne t’éloigne pas trop.
Nous sommes dans la mémoire crois-tu entendre quand c’est la baignoire du théâtre qui t’accueille. On y écoute d’une seule oreille d’anciens acteurs de sable, les morts dans un coquillage. Tu parles.
Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, souvenirs souvenirs, rehauts, plage, hiver, oubli, théâtre | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2015
Virginia Woolf, Les années
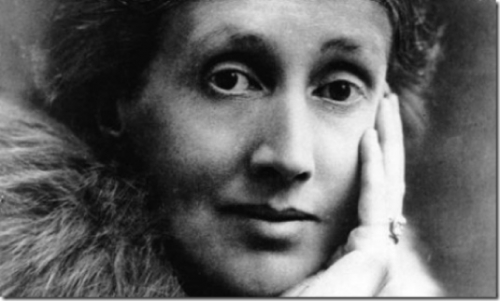
C’était un soir d’été ; le soleil se couchait ; le ciel était encore bleu, ais teinté d’or, comme si un fin voile de gaze flottait dans les airs, et ça et là, dans l’immensité bleu doré, un îlot de nuages était suspendu. Dans les champs, les arbres s’élevaient majestueusement caparaçonnés, avec leurs innombrables feuilles dorées. Les moutons et les vaches, blanc perle et bariolées, étaient allongés ou avançaient en broutant dans l’herbe à demi transparente. Une bordure de lumière entourait toutes choses. Une vapeur rouge doré s’élevait de la poussière des routes. Même les petites villas de briques rouges sur les grandes routes étaient devenues poreuses, incandescentes de lumière, et les fleurs dans les jardins des maisons, couleur lilas et rose comme des robes de coton, étaient veinées à leur surface et brillaient comme éclairées de l’intérieur. Les visages des gens qui se tenaient aux portes des maisons ou qui marchaient sur les trottoirs montraient tous le même rougeoiement lorsqu’ils faisaient face au soleil qui se couchait lentement.
Virginia Woolf, Les années, traduction André Topia, dans Œuvres romanesques, II, édition Jacques Aubert, Pléiade / Gallimard, 2012, p. 977.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, les années, lumière du soir, soleil, rouge, variations | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2015
Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts

Photo H. Lagarde
l’eau
même froide
troue la neige lors
qu’elle y tombe je film
e la bassine d’eau chaude
qu’on jette sur un sol de ne
ige toute fraîche à peine tom
bée devant la maison je film
e son délire impressionniste, son éloqu
ence muette, son grabuge blanc, je pense
à Degas comme étant le mieux
placé non pour le peindre
mais pour s’en délecter
sans limite et sans
restriction dans le
blanc jusqu’aux confins
de la peinture qu’il n’en fait pas
Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts, n° 35,
printemps 2015, p. 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile mainardi, poèmes à la coque, rehauts, eau, neige, degas, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2015
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

L’existence tout de même quel problème
J’en ai assez de vivre et non moins de mourir
Que puis-je faire alors ? sinon mourir ou vivre
Mais l’un n’est pas assez et l’autre c’est moisir
Aussi me peut-on voir errer plus ou moins ivre
C’est un fait je pourrais écrire un bien beau livre
Où je saurais bêler en me voyant périr
Mais cette activité nullement ne délivre
De faire de la mort l’objet de son désir
Les arbres qui marchaient n’inclinaient point leur tête
Les collines courant s’apprêtaient à la fête
De son haut le soleil semait dru ses rayons
La nature en ses plis absorbait ses victimes
L’absurde coq chantait ses prouesses minimes
Et je cherchais la rime en rongeant des crayons
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, dans Œuvres complètes, I, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 322.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, vivre, mourir, livre, désir, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2015
Raymond Queneau, L'instant fatal, II

Quelqu’un
Quand la chèvre sourit
quand l’arbre tombe
quand le crabe pince
quand l’herbe est sonore
plus d’une maison
plus d’une coquille
plus d’une caverne
plus d’un édredon
entendent là-bas
entendent tout près
entendent très peu
entendent très bien
quelqu’un qui passe et qui pourrait bien être
et qui pourrait bien être quelqu’un
Pins, pins et sapins
Le ciel la mer saline et les rochers plein d’eau
le cœur de l’anémone auprès des pins têtus
la marche auprès du ciel la marche auprès de l’eau
et la course assoiffée auprès des pins têtus
herbes mousses lichens et toutes les bestioles
le regard s’est perdu sous les sapins têtus
le regard qui s’égare après tant de bestioles
les peuples effarés sous les sapins têtus
le ciel la mer saline où sabre le soleil
tranche la tête plane aux sapins éperdus
se cabrant dans le ciel et se cabrant dans l’eau
tandis qu’une bestiole à l’ombre d’un lichen
cerne de son trajet le bois des pins têtus
sans qu’un regard disperse une route inutile
Raymond Queneau, L’instant fatal, II, dans Œuvres complètes, I, édition Claude Debon, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 96-97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, l’instant fatal, ii, quelqu'un, pin, sapin, ciel, eau, regard | ![]() Facebook |
Facebook |






