07/02/2023
Jean Grosjean, Une voix, un regard

Nos jours
Il a fallu différer les départs
dont nous rêvons
et recevoir tout à tour
les jours inconnus
lourds de soleil ou de pluie.
Les uns donnaient des pépites,
de l’encens ou du pavot,
mais d’autres d’un air candide
lançaient des questions
qui n’ont jamais de réponse.
L’un posait des chrysanthèmes
sur le lit de nos parents,
l’autre offrait aux fronts d’enfants
pour leur faire ombrage
les lauriers des fortsen thème.
Comment vouliez-vous qu’on parte
quand tant de futurs arrivent
et qu’aucun d’eux ne retire
son rire ou son deuil
sans qu’un autre lui succède ?
Mais dès que les nouveaux jours
seront moins nombreux aux portes
nous irons sur l’autre berge
voir quels anciens jours
sont près à nous recevoir.
(Cahiers de l’ENS, Meknès, n° 4, 1983)
Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes
retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 96-97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, une regard, partir, futur, passé | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2021
Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique
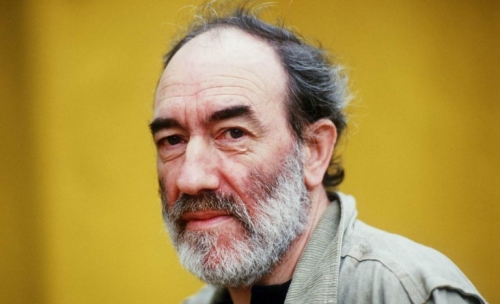
le mal des anges
un jour je suis parti
pour ne plus revenir
les gendarmes m’ont pris
et je suis revenu
une autre jour encore
plus tard un vingt octobre
j’ai descendu la Meuse
le vieux fleuve impassible
et j’ai quitté ses rives
pour les rives du Rhin
et le bac du passeur
qui n’avait pas de chien
car ce n’était pas l’heure
de la dernière obole
mais celle d’un ailleurs
magique et sans école
Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique,
La Table ronde, 2012, p. 293.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, le mal des anges, partir | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2020
Étienne Faure, La vie bon train

Lents comme des états d’âme,
après l’été les trains revenaient,
las d’avoir trimballé tous ces corps
à la mer, dans les montagne, dans les contrées
dont furent natifs les pères (introuvables sur la carte),
à grincer de nouveau en gare,
y faire leur rentrée, annoncer le pire
qui toujours sera à venir,
le soleil ras rougissant la face des ultimes
voyageurs ; c’était l’automne,
chacun se rappelait les vers
d’Apollinaire — un train qui roule ; ô ma saison mentale
et la violente espérance de vie :
devait-on revenir
quand il aurait fallu ne partir jamais
— et puis après,
dans la gare sans issue,
on n’allait pas pleurer pour ça.
revenir
Étienne Faure, La vie bon train, Champ Vallon,
2013, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, la vie bon train, partir, revenir | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2017
Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Ne m’en veuillez pas, c’est ainsi !
je ne barguignerai pas avec les mots :
elle est alourdie, affaissée,
ma jolie tête dorée.
Ne plus aimer ni la ville, ni mon village
comment le souffrirais-je ?
Je largue tout. Me laisse pousser la barbe.
Et je vais bourlinguer en Russie.
J’oublierai livres et poèmes,
j’irai le ballot sur l’épaule
— au noceur dans la steppe, on le sait,
le vent fait fête comme à nul autre.
Je puerai le raifort et l’oignon.
Et troublant la torpeur du soir
me moucherai bruyamment dans les doigts.
Partout je ferai l’idiot.
Je ne réclame d’autre bonheur
que de me perdre dans le blizzard :
car sans ces extravagances
je ne puis vivre sur terre.
Sergueï Essenine, Journal d’un poète, traduction
du russe Christiane Pighetti, éditions de la
Différence, 2014, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d’un poète, mal de vivre, partir, vagabond | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2016
John Donne (1572-1631), L'expiration

L’expiration
Achève cet ultime et gémissant baiser
Qui nos âmes aspire et résout en buée.
Partons, spectres tous deux, par chemins opposés
Laissant la nuit couvrit notre heureuse journée.
Nous aimâmes sans tiers ; nul tiers n’aura de part
À cette chiche mort où suffit le mot « Pars ».
Pars, donc. Et si ce mot ne t’a pas fait mourir,
Fais-moi, le redisant une mort point cruelle ;
Sinon, que sur moi-même il vienne rebondir
Et frapper justement une âme criminelle !
À moins que pour ainsi périr il soit trop tard,
Mort deux fois, de partir, et de te dire « Pars ».
John Donne, Poèmes, traduction J. Fumier et
Y. Denis, Poésie / Gallimard, 1991, p. 197.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, l'expiration, baiser, spectre, mourir, partir | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2015
Fernando Pessoa, Poésies d'Alvaro de Campos

27 septembre 1934
À la veille de ne jamais partir
du moins n’est-il besoin de faire sa valise
ou de jeter des plans sur le papier,
avec tout le cortège involontaire des oublis
pour le départ encore disponible du lendemain.
Le seul travail, c’est de ne rien faire
à la veille de ne jamais partir.
Quel grand repos de n’avoir même pas de quoi avoir à se reposer !
Grande tranquillité, pour qui ne sait même pas hausser les épaules
devant tout cela, d’avoir pensé le tout
et d’avoir de propos délibéré atteint le rien.
Grande joie de n’avoir pas besoin d’être joyeux,
ainsi qu’une occasion retournée à l’envers.
Que de fois il m’advient de vivre
de la vie végétative de la pensée !
Tous les jours, sine linea,
repos, oui, repos...
Grande tranquillité...
Quelle paix, après tant de voyages, physiques et psychiques !
Quel plaisir de regarder les bagages comme si l’on fixait le néant !
Sommeille, âme, sommeille !
Profite, sommeille !
Sommeille !
Il est court, le temps qui te reste ! Sommeille !
C’est la veille de ne jamais partir !
Fernando Pessoa, Poésies d’Alvaro de Campos, traduit du portugais et préfacé par Armand Guibert, Gallimard, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poésies d'alvaro de campos, partir, voyage, immobilité, dormir | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2015
Robert Duncan, Passages & Structures, traduction Serge Fauchereau
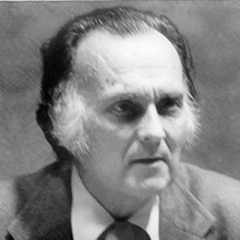
Allons, que je me délivre
Allons, que je me délivre de tout ce que j’aime.
Que je délivre de moi tout ce que j’aime et que je lui donne sa liberté.
Car je veux obéir sans être attaché,
servir comme je sers.
Allons que je me délivre de ce maître que je me suis donné
que je doive alors prendre mesure
de toute rectitude,
de toute justice. Aujourd’hui.
Je suis en route, près de la route,
je fais de l’auto-stop. Mais, d’un côté,
comme je suis heureux que personne ne soit passé.
Car je suis à un tournant. Je suis chez moi
au soleil. Je n’attends pas, je suis là, debout.
Et d’un autre côté, j’attends,
d’être en route, que ce soit ma route.
Je suis impatient.
Oh que je sois à présent délivré de ma route,
pour tout ce que je m’attache
— et je m’attache ce que j’aime,
chaînes et parages rassurants —
laissons partir ces choses aimées et moi avec.
Car je suis en travers de la route, ma destination barre la route !
Robert Duncan, Passages & Structures, traduit de l’américain et présenté par Serge Fauchereau, Christian Bourgois, 1977, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, passages & sstructures, serge fauchereau, partir, rester, route | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2014
Eugène Savitzkaya, Sang de chien

J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.
Pas besoin de lumière pour me raser. Dans l’obscurité, je me frotte au rasoir électrique qui bourdonne. Un petit rasoir suffit à ma barbe claire. Les vibrations du moteur plaisent à ma peau. Les objets lourds qui tombent sur le plancher ne résonnent pas dans ma poitrine. Pourrais-je encore escalader le frêne et me baigner dans le lac froid Enol ? Il n’y a que le vent qui me fasse encore du bien, ce même vent qui fronce la surface de l’eau et me dégoûte de la pêche au flotteur dans ce bras mort du fleuve.
Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.
Quand ai-je pleuré pour la dernière fois en plein air ou enfermé, dans quelle maison dans quelle prairie, sur quel toit, nu ou en chemise, fatigué par le soleil ou à peine éveillé, seul ou en compagnie, sur la montagne pointue ou sur la mer plate ? Et l’avant-dernière fois ? Juste un spasme, une contraction du menton et pas de larmes, à peine comme une brève transpiration. Et avant ? Je devais être saoul, ça ne compte pas. Et avant ? Enragé, devant la mer. Et avant ? Encore de rage, sang de chien, ça ne compte pas. Et avant ? En regardant mon jardin sous le soleil, les hautes tiges des asperges, les plumes, le feuillage épuisé, la glycine en bout de course. Et avant, avant ? À peine un désir, mais les larmes ne se commandent pas. Et le dernier bonheur, où, avec qui, à l’aide de quels outils ? [...]
Eugène Savitzkaya, Sang de chien, éditions de Minuit, 1988, p. 8-10.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, sang de chien, partir, corps, lumière, vent, main, pleurer | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2013
Ophélie Jaësan, La Mer remblayée par le fracas des hommes

Éloge de la disparition
« Ce que nous appelons démesure, ce que Sophocle appelle la démesure, ce qui, d'après lui, est immédiatement puni de mort puni par les dieux, n'est que l'ensemble de nos propres mesures. » Jean Giono, Noé.
Parfois j'ai ce besoin — vital quasiment, du moins viscéral — d'être sur le départ. J e me souviens du ciel et de la terre, mais c'est un souvenir qui n'est plus ancré dans ma chair et il me faut aller tout de suite à sa rencontre, nourrir sa revivifiance, au risque de ne plus savoir quelque chose d'essentiel sur moi.
Moi ou eux — les hommes pareillement.
C'est donc d'abord une voie ferrée et je m'en vais, je fuis la ville, son agitation, son trop-plein, ses machines et autres engins. Je tente la campagne. Après un long voyage, j'arrive enfin dans une gare. Une simple gare avec un quai et une guérite. Alentour : rien. La nature. Je quitte la gare, seule. Je marche longtemps, très longtemps. Même fatiguée, il me faut poursuivre, car c'est autre chose qu'une nature remodelée par l'homme que je cherche.
Lorsque l'auto franchit le col, le temps change brusquement. La pluie cède à la neige, il y a du vent et du brouillard. L'autoroute que nous allons bientôt quitter ressemble à une nationale sans envergure. Un tapis blanc recouvre tout — les dernières maisons, les murets, les barrières, les barbelés —, tapis qui s'épaissit de minute en minute. Le ciel trop bas semble avoir eu le désir d'écraser la plaine. Brumes et vapeurs ont noyé la ligne de démarcation entre le ciel et la terre. Voilà qu'ils ne font plus qu'un. En silence, j'admire leur fusionnement.
Les cimes des arbres, leur branches, leurs troncs ont également été recouverts par la neige. Des arbres qui me paraissent maintenant figés dans une expression étrange, oscillant entre la sérénité et l'inquiétude.
Petit à petit, les traces du dernier passage des animaux dans la plaine ont toutes été effacées et les cris des oiseaux se sont tus.
Sur ce monochrome blanc, je rêve éveillée. Naît en moi alors le besoin d'écrire sur — ou à partir de — la disparition progressive des choses. Comme on ne peut plus les voir, on ne peut plus les nommer et elles finissent par disparaître. Mais en apparence seulement, puisque tout homme est Noé. Tout homme porte en lui la mémoire du monde. Longtemps après sa disparition.
Ophélie Jaësan, La Mer remblayée par le fracas des hommes, Cheyne, 2006, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ophélie jaësan, la mer remblayée par le fracas des hommes, la disparition, partir, nature, neige, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2012
Marie-Laure Zoss, Une syllabe, battant de bois

I.
pars, érafle de tes jours le dedans, tes jours à mesure sous tes gestes déboîtés ; ton visage de plusieurs feuillets : tu n'en connais plus aucun, tu empaquètes l'ordinaire ; dans un no man's land faire mine d'être là, sur un filet de souffle déjà rétracté ; agrégé dans sa propre farine — ne la tourne plus dans celle du monde, quelque chose te réfrène vers l'intérieur, toi si singulier soudain — l'intérieur, s'il en est encore un ; plie bagages ; s'infliger telles désertions, dites, qui le voudrait ?
à travers la nuit l'esprit ficelle dans les vallées l'aboiement des chiens errants, déballe des rouleaux d'ombre sur la caillasse ; comme si on avait changé d'espèce : une chair recroquevillée, à la merci du vaste, où s'engouffrent froid bouillon d'urine, vent himalayen et suif ; et ce vert, l'étincelant mercure des saules
2.
ni la tasse d'eau à boire d'un trait, ni l'assiette — jamais ne l'entameras, posée sous le ciel ; moins qu'une miette sur un toit d'argile, pas de pays — qu'un puits d'azur entre autre solives ; toi à la traîne des vivants, soigneusement balaie dans un seul angle tes navrantes forces ; par ce châssis de peuplier fondra le soleil d'hiver jusqu'aux rigoles, et le compte des jours qui restent, un par un s'étouffant dans la vallée qui fatigue ses poussières carrossables, le cœur devenu dur battant d'une cloche de bois — tu aurais mieux fait de ne jamais ; une plaine soulève, à rebours de soi, le pas, sans relâche pique ses meutes de terre pelée
Marie-Laure Zoss, Une syllabe, battant de bois, dans fario, 11, printemps-été 2012, p. 167-168.
L'ensemble des poèmes composant Une syllabe, battant de bois a été publié en 2012 aux éditions Cheyne.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, une syllabe, battant de bois, partir | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2012
Leonor Fini, Rogomelec

Je savais qu'il ne fallait pas se laisser tenter. Qu'il faudrait savoir rester chez soi, éviter les voyages dans cette époque barbare, les affreuses bousculades, l'humiliation de ce que l'on appelle les "villégiatures".
« Le vain travail de voir divers pays », Maurice Scève l'avait écrit ; je me le répétais.
Mais on m'avait parlé de ce lieu solitaire, de ce climat assoupissant. Imaginant un bien-être particulier, je suis donc parti rejoindre le navire.
C'était le Port Saïd.
D'autres navires hurlaient déjà très fort. Pour le Port Saïd, il y avait encore du temps ; au moins une heure. Passaient des chariots avec des ballots d'odorantes épices — safran peut-être, cannelle — une bonne odeur et de la poussière jaune or tout autour. Cette poussière voilait parfois ces groupes d'humains vociférants, tous habillés de mêmes couleurs, me semblait-il.
Il n'y avait qu'un homme différent et peu recommandable. Mais à l'observer plus attentivement, je lui trouvai davantage l'aspect d'un assassiné que celui d'un assassin. Il se frayait un chemin pour rejoindre une jeune femme blonde qui parut surprise en l'apercevant et certainement ne le connaissait pas. Lui se baissa un peu et murmura quelque chose à l'oreille de la femme qui, contre le soleil, apparaissait d'une transparence fragile. Puis elle baissa le regard vers cette main ouverte, tendue à la hauteur de sa taille ; elle poussa un petit cri, mais le passage d'un chariot chargé de ballots qui sentaient le safran et la cannelle la fit disparaître à mes yeux.
Je ne la voyais plus.
La foule s'épaississait.
Je m'apercevais que je suivais cet homme.
Leonor Fini, Rogomelec, éditions Stock, 1979, p. 9-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonor fini, rogomelec, partir | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2011
Eugène Savitzkaya, Sang de chien
 J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.
J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.
Pas besoin de lumière pour me raser. Dans l’obscurité, je me frotte au rasoir électrique qui bourdonne. Un petit rasoir suffit à ma barbe claire. Les vibrations du moteur plaisent à ma peau. Les objets lourds qui tombent sur le plancher ne résonnent pas dans ma poitrine. Pourrais-je encore escalader le frêne et me baigner dans le lac froid Enol ? Il n’y a que le vent qui me fasse encore du bien, ce même vent qui fronce la surface de l’eau et me dégoûte de la pêche au flotteur dans ce bras mort du fleuve.
 Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.
Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.
Quand ai-je pleuré pour la dernière fois en plein air ou enfermé, dans quelle maison dans quelle prairie, sur quel toit, nu ou en chemise, fatigué par le soleil ou à peine éveillé, seul ou en compagnie, sur la montagne pointue ou sur la mer plate ? Et l’avant-dernière fois ? Juste un spasme, une contraction du menton et pas de larmes, à peine comme une brève transpiration. Et avant ? Je devais être saoul, ça ne compte pas. Et avant ? Enragé, devant la mer. Et avant ? Encore de rage, sang de chien, ça ne compte pas. Et avant ? En regardant mon jardin sous le soleil, les hautes tiges des asperges, les plumes, le feuillage épuisé, la glycine en bout de course. Et avant, avant ? À peine un désir, mais les larmes ne se commandent pas. Et le dernier bonheur, où, avec qui, à l’aide de quels outils ? [...]
Eugène Savitzkaya, Sang de chien, éditions de Minuit, 1988, p. 8-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzakaya, sang de chien, partir | ![]() Facebook |
Facebook |





