19/07/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
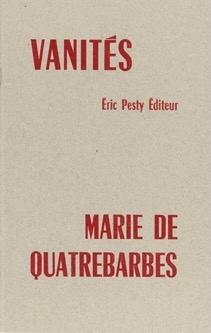
« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi »
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie sz quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités : recension

« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis en mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités

Brève histoire au regard de l’infini mouvement des astres, des cendres jetées au croisement d’une mer & et trois océans, par exemple, repoussent au loin la décomposition, alors
Si elle porte ses fruits & s’il y a quelque chose de caché entre ses feuilles, un dépôt, une masse en lévitation, le « A » de quelque choses, tracé sur la poitrine de celle qui
Garde à l’ombre ce tout petit ceci que nous avons de commun, en somme le sujet ne sera pas traité du pont de vue de la science, ni de l’anecdote, ni du sentiment, nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre
De même qu’après la discussion portant sur l’existence d’une semence féminine, un sang rouge coule sur le sol & à l’endroit où il a coulé pousse une fleur également rouge.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Éric Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, mouvement, discussion | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités

« Fleurs » : j’ai dit ce mot par prudence, mais il importe peu. Tout ce qui bat et s’agite, cherche refuge.
On l’appelle aussi « petite chose », comme on le dit d’une personne hors de portée, aspirant l’air par les pieds
Plutôt que de prendre racine, nous passons ; construire une maison n’est plus notre propriété
Où nos pas nous portent, nous allons les pas chargés d’indices, suivant les lignes futures d’un mystère probable.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Érid Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, fleur, mouvement, avenir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités

Un monde vit sous ce monde, dedans, dessus, invisible& dans l’air, mêlé à nos liquides, circule en nous, inaperçu
Tout existe à l’état mélangé & caché, dispersé en mille particules, sous la terre, peu importe dans quelle région de l’univers où tu te situes
Coquillage, génération dorée des paons, insecte géant qu’on appelle cerf-volant, parfum de myrrhe, saveur de vanille, débris blancs, coques, antennes, proues, nymphes, expression d’une multitude imbriquée
Choses nombreuses & qui errent, rebondissant sans fond à travers le vide, agitées d’accords & de désaccords, changent de route, en tous sens.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Éric Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie e quatrebarbes, vanités, mélange, dispersion, contraires | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2022
Marie de Quatrebarbes, Aby : recension

Qui est Aby, le personnage principal du roman ? Il s’agit d’Aby Warburg (1866-1929), historien de l’art dont les travaux ont jeté les bases de l’iconologie, ce que nous apprend toute encyclopédie. Son immense bibliothèque est aujourd’hui à Londres, réunie dans le Warburg Institute ; plusieurs livres ont été consacrés à sa vie et à son œuvre (le Postscriptum du livre les signale) et Georges Didi-Huberman a étudié ses écrits, dont son Atlas *. On se demanderait pourquoi ce savant a une place dans une fiction si l’on ignorait, outre l’étendue de ses lectures, l’attention que porte Marie de Quatrebarbes notamment aux questions de la mémoire (du passé et de l’enfance), de l’image, du double, de la difficulté de vivre le corps, questions toujours présentes dans ses précédents livres et qui, ici, donnent son unité au roman.
Descriptif rapide : le livre compte treize chapitres titrés (Masques, Falaises, Crise, etc.), de dimension sensiblement égale, suivis d’un bref postscriptum et accompagnés de treize illustrations (photographies, dessins). Chaque ensemble débute par un nom de ville et une date, le premier avec « Hambourg, 1903, mais le lieu le plus présent est Kreuzlingen, en Suisse, où Aby a été interné. Le lecteur reçoit quelques renseignements au début du roman : Aby Warburg, fils d’un banquier juif, aurait renoncé à son droit d’ainesse au profit de son cadet, Max, à condition de pouvoir acheter tous les livres qui lui seront nécessaires pour ses recherches. Dans ce contrat avec son frère, il a une position ambiguë, il refuse l’argent de la spéculation bancaire mais accepte le « transfert spéculatif entre le savoir et l’or ». Donc : ne pas être banquier et étudier pour épuiser le savoir. Les choses sont en place, la fiction peut commencer et l’auteure y pousse son personnage : « Peu importe si le souffle te manque, Aby, voyons où le vent te mène ».
Le lecteur est un peu déconcerté, Aby Warburg est connu de tous ceux qui s’intéressent aux fonctions de l’image, tout comme les psychiatres qui apparaissent à différents moments pour établir un diagnostic sur l’état d’Aby ou le soigner ; en outre, plusieurs passages résument des travaux de médecine. On peut ajouter qu’un ensemble (Pandora) est consacré à la danseuse américaine Loïc Fuller (1862-1928), une des créatrices de la danse contemporaine. Si l’on ne retenait que ces éléments, on aurait le sentiment de lire une biographie — mais Aby n’a jamais rencontré Loïc Fuller, ni d’ailleurs d’autres personnes citées. Le roman de Marie de Quatrebarbes, comme tout roman, part de faits réels et, précisément, selon le principe du montage qui était cher à Warburg, il rapproche des éléments de manière inattendue (Aby et Loïc Fuller, par exemple), se construit à partir « de relations, d’analogies entre des images, des objets, des idées »*. Le lecteur dispose d’un jeu de pièces qu’il assemble, progressivement, tout en comprenant que la construction du texte ne peut être qu’inachevable, comme tout ce qui est vivant, semblable au ruisseau qui « déborde et tout en lui déborde de cette vie saturée qui suppure et dégorge, incessamment se reconfigure et invente de nouvelles trajectoires pour contenir ce qui incessamment le sature ».
Lorsqu’Aby se rend chez les Indiens Hopis, en 1896, il apprend ce qu’est le rituel du serpent : pour conjurer leur peur, les hommes dansent avec un serpent capturé dans le désert, l’approchant de leur bouche comme pour se l’intégrer, et la danse doit faire venir la pluie. On lit ici plusieurs des motifs qui charpentent le roman. Le rituel du serpent sera au centre de la conférence d’Aby, le 21 avril 1923, moment de la sortie de sa folie ; mais il se rattache aussi au thème de la métamorphose, du changement (la danse apporte la pluie) — voir l’image du ruisseau — et à celui de la peur. Loïc Fuller avait mis au point sa "danse serpentine" (copiée par des dizaines de danseuses), « elle se métamorphose successivement en papillon, en nuage, en orchidée, en lis, en marcheuse pompéienne, en derviche tourneur, en figurine de Tanagra, en Ménade de Thiase de Dionysos », faisant revenir du passé les arabesques propres aux paysages des peintres anglais. « Si Aby l’avait vue, il aurait reconnu « le geste de la nymphe florentine sur le point de s’envoler, entraînant à sa suite l’Antiquité survivante ».
On voit comment l’auteure construit Aby, avec les traits de Warburg mais en en faisant un personnage de fiction. Ainsi, elle lui attribue très tôt une difficulté à « se diriger dans le monde » et date du séjour au Nouveau Mexique « ses peurs (...), enroulées sur elles-mêmes comme un nid de serpents ». Pendant la guerre de 1914-1918, il accumule les documents de toutes sortes, textes et images, pour tenter de comprendre les raisons du conflit, mais « les documents restent muets et le ciel est vide » : il n’y a pas de logique dans le chaos. Pour Aby, toute hiérarchie entre les choses disparaît, la compréhension du monde — le rapport entre la matière et les signes — devient impossible ; et la « terreur (...) grandit » : la folie est là. La description de ses peurs pendant son internement est saisissante ; Marie de Quatrebarbes énumère longuement ce qui traduit vivement la perte de la réalité pour l’esprit, son impossibilité aussi de s’orienter dans le temps, tout comme les cris et les injures d’Aby disent un corps qui refuse tout échange. Mais il peut aussi reprendre ses recherches, écrire, et être un hôte agréable, reçu pour le thé par l’épouse du docteur Binswanger et, alors, très proche des enfants qu’il sait amuser.
Un autre thème récurrent du roman, justement, c’est l’enfance. Le conflit en lui, ce dédoublement, l’auteure le voit comme « ressurgi [ ...] de l’enfance où tout le ramène toujours ». Elle le présente se réfugiant dans la bibliothèque de quartier pour lire James Fenimore Cooper et, ensuite, « les livres affluent autour de lui et font barrage contre la mort ». Le retour dans sa famille, en 1924, est celui d’un autre Aby. Warburg reprendra ses travaux, il prépare des conférences, un bâtiment est construit pour ses livres mais il est devenu autre après ce long séjour « dans l’obscur ». Ce qui demeure intact pour Marie de Quatrebarbes, c’est ce qui lie Aby à l’enfance : il parle toujours aux objets, vivant alors « le même réconfort qu’un enfant parlant à ses jouets. »
On termine troublé ce voyage avec un homme brisé de ne pouvoir faire tenir ensemble les éléments disparates de la réalité : avec force, le roman fait constamment réfléchir sur l’inconnu et l’obscur dans notre réel ; il entremêle réalité et fiction au point que, parfois, le lecteur se demande si tel nom renvoie ou non à un personnage inventé.
* Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, L’œil de l’histoire’, 3, éditions de Minuit, 2011, p. 14.
Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, 208 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2022.
Publié dans Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2022
Marie de Quatrebarbes, Aby

Le rêveur, lorsqu’il se réveille, transporte avec lui un peu de son rêve, et les mots que le rêve lui donne pour le dire disent ce que le rêve donne par devers soi comme petit peu contenant le rêve à transporter. Un trouble léger survient alors, qui déborde le sens qu’il prête au rêve et le dévie. Le mot, la phrase se brouillent comme l’eau se trouble, la mare se strie de rondes sous le jet du caillou et s’obscurcit, car les mots du rêve sont ceux du trouble, ils sont vivants comme les grives, les petits pains en miettes qui flottent à la surface. Le caillou a des arêtes tranchantes qui coupent tout ce qu’elles trouvent. Elles coupent le rêve à l’endroit où se reflète le visage du rêveur.
Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, p. 169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby, rêve, trouble, image | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2022
Marie de Quatrebarbes, Aby

Chez les patients du Dr Kraepelin, il y a des brumes, de l’air démoniaque, des odeurs de charbon, de cadavre, d’étranges fumées envahissent les chambres, on les noie dans le Tigre, ou on tue leurs parents, on vole leurs pensées, ou leur nourriture est mélangée à de la chair humaine, à des déchets, on y verse du poison, du musc, du jus d’aiguilles et de chaussure, de la potasse. Leur sommier pleure quand ils dorment, il est planté d’aiguilles, on les cloue à un arbre, on les pique avec des tarentules, des courants électriques traversent leur corps, on leur injecte un sang étranger, on rend leurs membres raides, de grosses grenouilles rentrent dans leur nez et leurs oreilles avant de sortir par leur bouche. Ça sent le soufre, le roussi, les aliments ont un goût de poison, de pourriture, quelqu’un parle à l’intérieur de leurs organes génitaux, ils sont des loups-garous, des chiens sans maître, on vole leur sang pour en faire quelque chose d’incongru, du boudin, des offrandes au diable. Un jour, ils se laissent mourir sur leur tombe et on salit leurs cheveux, on transforme leur visage en quelque chose d’autre, ils ne se reconnaissent plus, quelqu’un fabrique leurs pensées, influence leurs actes, leur souffle leurs mots. [...]
Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, p. 74-75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby, folie, incohérence, absurde | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2022
Marie de Quatrebarbes, Aby

(...) Quelques années plus tard un autre homme, Ernst Friedrich, fera éditer un livre dans lequel il tentera de donner un visage à cette guerre [= Première Guerre mondiale]. Son titre, Guerre à la guerre !, est un retour à l’envoyeur adressé aux chefs d’escadron, aux patriotes et autres publicitaires qui jettent les corps prolétaires dans la guerre sans en subir eux-mêmes les conséquences. Comme Aby, Ernst rassemble des images et des documents qu’il accompagne de légendes. Prélevée dans les tranchées, les camps de prisonniers, les fosses communes, les potences, les fabriques de munitions, les bordels à soldats, les forêts décimées, les corps mutilés, les chansons militaires, les règlements de police, les articles de presse et de propagande, la littérature enfantine et jusqu’aux jouets conçus pour prédisposer au maniement des armes, la collection d’images se resserre, dans les dernières pages du livre, sur les visages décomposés des survivants et les tombes profanées. Ces visages soustraits, ravagés comme la terre soulevée par les obus, déchirée si profondément qu’on ne saurait dire, des cadavres exposés au grand jour ou des vivants ensevelis, lesquels portent le deuil des autres, ont vu la guerre de leurs propres yeux.
Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, p. 41-42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby, photographie, guerre, témoignage | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres
Décembre 13
Images indistinctes démêlées du fond. Lieux communs mille fois traversés. Idiomes intacts. On voudrait s’assécher, former autour d’elles un pur esprit de mailles. On laisse les portes entrebâillées. Elles ne changent pas d’aspect avec le temps. Autre découverte : si vous êtes le cœur, il faut rêver les membres. La marque d’une fiction change, un rien superficiel. Maintenant avance, charge ta viande. Travaille-la soigneusement, fût-elle avariée. Avec un papier plié dans la bouche pour dévier ton souffle, tu ne peux pas faire de bruit.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, P.O.L, 2021, p. 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres

22
Si je conjugue ces moments hors de moi passés si loin de toi avec ce loin qui est « je vois » et toi qui est « si loin de moi », plus ces moments-)là sont lointains plus ils existent en dehors de moi, mieux je les sens. Comme parfois je te sens vivante, je te cueille et j’en ai plein les poches. Ce serait une belle idée de remplir nos poches de toutes les présences qu’on aurait connues pour les retrouver. Et quand je marche avec au-devant, toi, quand je marche aveuglément, empéguée dans mon ombre qui est mon projet, aveugle et aveuglée, les papiers collent à ma marche et crépitent au fond de mes poches. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu sais, quand quelque chose s’échappe de mes poches avec ton rire qui vient vers moi.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, PO.L, 2021, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, moment, poche, marche | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2019
Marie de Quatrebarbes, Voguer

Prière pour Pepper LaBeija, mère de la Maison LaBeija, décédé au Roosevelt Hospital de Manhattan en 2003.
Une maison est faite pour y vivre. Une maison est une famille pour ceux qui n’ont pas de maison. C’est une réalité quand on n’a pas de famille. C’est comme ça que naissent les maisons, là où une mère accueille les enfants rejetés par leurs parents biologiques. C’est important pour moi d’être la mère. Aussi, je mène ma maison d’une main de velours. Je prends soin de mes enfants, mes filles et mes fils. J’ai remporté tous les trophées. Et tant que je vivrai, mes filles et mes fils seront protégés, et je mènerai ma maison d’une main de velours. C’est comme traverser le miroir d’Alice. Comme se préparer pour un grand événement. Je me vois sur un lit de roses. Je me vois dans une robe de roses qui s’adapte à chacun de mes gestes. Je me déplace en montgolfière et je jette par-dessus bord des poignées de pétales chiffonnés. C’est mon état d’esprit. Je vais quelque part. Je peux être agressive, mais la plupart du temps je reste calme. Je veille sur mes enfants, mes filles et mes fils. Je me consacre à l’observation des oiseaux et au sport. J’étudie la parade nuptiale des moineaux et leurs stratégies d’accouplement.
[…]
Marie de Quatrebarbes, Voguer, P. O. L, 2019, p. 29-30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, voguer, pepper labeija, maison, fille, fils | ![]() Facebook |
Facebook |





