04/05/2016
William Blake, Chanson de folie

Chanson de folie
Les vents sauvages pleurent,
La nuit est glacée ;
Viens ici, Sommeil,
Et dévoile mes chagrins.
Mais voici le point du jour
Dans les hauteurs de l’Orient
Et les oiseaux frémissants de l’aube
S’envolent loin de la terre.
Voyez, jusqu’au zénith
De la voûte céleste,
Chargés de douleur
Mes accents sont portés ;
Ils frappent l’oreille de la nuit,
Et font couler les larmes du jour ;
Ils font rugir les vents en folie
Et se jouent avec la tempête.
Comme un démon dans la nue
Hurlant de douleur
Suivant la nuit je me hâte
Et avec la nuit je m’en irai
Me détournant de l’Orient
D’où nous est venue consolation,
Car la lumière frappe mon âme
D’un indicible mal.
William Blake, Esquisses poétiques, dans
Poèmes, traduction L. M. Cazamian,
Aubier-Flammarion, 1968, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william blake, chanson de folie, esquisses poétiques, nuit, vent, orient | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2016
Rose Ausländer, Été aveugle

Les étrangers
Des trains amènent les étrangers
qui descendent et regardent autour d’eux l’air perdu
Dans leurs yeux nagent
de craintifs poissons
Ils portent des nez étrangers
des lèvres tristes
Personne ne vient les chercher
Ils attendent le crépuscule
qui ne fait pas de différences
ils pourront alors visiter leurs proches
dans la soirée lactée
dans les cratères de la lune
L’un d’eux joue de l’harmonica —
des mélodies bizarres
Une autre gamme habite
l’instrument :
une suite inaudible de
solitudes
Rose Ausländer, Été aveugle, Héros-Limite, traduction
de l’allemand Michel Vallois, 2015, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, été aveugle, les étrangers, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
02/05/2016
Christian Prigent, Les Amours Chino

Après Les enfances Chino (2013), roman en prose,
une suite en vers, Les Amours Chino, est
disponible aujourd’hui en librairie.
VI Chino à sa Dame
I
(1994, autoportrait patheux)
Madame je ne vis qu’en étonnement
Furieux en ahuri primal ou congé
Nital mon œil furibond natif il s’en
Fonce et me recule assez loin enragé
Des mondes abondants posés sur le gla
Cis de flotte asphyxié gigotant pour ne pas
Couler — à ma périphérie tétanos
D’espacetemps dans la cuirasse os
Tensible des significations (acta :
Professeur en explicitation d’émoi
Abstracteur de ma quintessence extra
[Con]testeur de mes données comprenez-moi)
Christian Prigent, Les Amours Chino, P.O.L, 2016,p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino, dame, autoportrait | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2016
Jean Genet, Ce qui reste d'un Rembrandt déchiré...
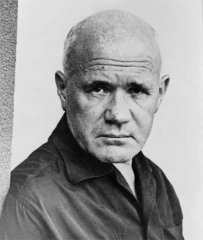
Ce qui est resté d’un Rembrandt…
Comme une odeur d’étable : quand, des personnages, je ne vois que le buste (Hendrijke à Berlin) ou seulement la tête, je ne peux m’empêcher de les imaginer debout sur du fumier. Les poitrines respirent. Les mains sont chaudes. Osseuses, noueuses, mais chaude. La table du Syndic des Drapiers est posée sur de la paille, les cinq hommes sentent le purin et la bouse. Sous les jupes d’Hendrijke, sous les manteaux bordés de fourrure, sous les lévites, sous l’extravagante robe du peintre les corps remplissent bien leurs fonctions : ils digèrent, ils sont chauds, ils sont lourds, ils sentent, ils chient. — Aussi délicat et grave que soit son regard, la Fiancée juive a un cul. Ça se sent. Elle peut d’un moment à l’autre relever ses jupes. Elle peut s’asseoir, elle a de quoi. Madame Trip aussi. Quant à Rembrandt lui-même, n’en parlons pas : dès son premier portrait sa masse charnelle ne cessera de s’accélérer d’un tableau à l’autre jusqu’au dernier, où il arrive, définitif, mais non vidé de substance. Après qu’il a perdu ce qu’il avait de plus cher — sa mère et sa femme — on dirait que ce costaud va chercher à se perdre, sans politesse envers les gens d’Amsterdam, à disparaître socialement.
Vouloir n’être rien, c’est une phrase qu’on entend souvent. Elle est chrétienne : faut-il comprendre que l’homme cherche à perdre, à laisser se dissoudre ce qui, de quelque manière, le singularise banalement, ce qui lui donne son opacité, afin, le jour de sa mort, de présenter à Dieu une pure transparence, même pas irisée ? Je ne sais pas et je m’en fous.
Jean Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, dans Ouvres complète, IV, Gallimard, 1968, p. 21-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, ce qui reste d'un rembrandt déchiré.., corps, portrait, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
30/04/2016
William Cliff, En Orient

j’ai vu la chambre où Cavafis est mort
dans la misère
il avait dû vendre l’appartement
qu’il possédait
pour n’en occuper qu’une seule chambre
avec l’Arabe
un « serviteur » qui vécut près de lui
jusqu’à sa mort
celui qui m’a fait visiter la chambre
m’a déclaré
que Cavafis est mort dans l’ignorance
du monde entier
pas un seul de ses congénères hellènes
ne l’a aidé
quand le cancer a rongé son pharynx
et l’a tué
l’image que certains nous ont donnée
de Cavafis
est celle d’un monsieur très distingué
qui recevait
chez lui de fins lettrés et leur disait
ses beaux poèmes
en buvant de l’ouzo et grignotant
la noire olive
à la lumière de chandelles pour
qu’on ne voie pas
les rides courir et laisser leurs stries
sur son visage
on dit aussi qu’il allait dans la rue
enveloppé
d’une vaste cape noire et flottante
pour se donner
l’air d’un artiste il était d’une taille
indifférente
le nez tombant le visage allongé
et assez laid
mais les yeux dilatés d’une étonnante
vivacité
se jetaient en tous sens pour scruter les
gens qui passaient
étant de famille aristocratique
mais tout à fait
ruinée il aurait eu trop de fierté
pour demander
la charité et se serait ainsi
laissé mourir
dans ce meublé qui s’appelle aujourd’hui
Pension Amir
au numéro quatre deuxième étage
rue Sharm-el-Sheik
ne vivent plus que des Arabes à deux
ou trois par chambre
avec entre les lits un bec à mèche
pour bouillir l’eau
du thé qu’on offre aux étrangers qui viennent
voir où vécut
un des plus grands poètes de ce siècle
mort inconnu
William Cliff, En Orient, Gallimard, 1986, p. 61-63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, en orient, cavais, charme, misère, poète, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2016
Laurent Albarracin, Le Grand Chosier

Les orages grondent et grondent mais ils grondent
Sans qu’on sache d’où cela vient, comme une vitre
Tremble, comme sous la poussée d’un taureau vague,
Un taureau venant, taureau se formant dans l’air.
Né de son souffle, de son pas ou de son coup
D’épaule, les orages grondent et ils naissent
D’eux-mêmes, de la caresse de leur puissance,
Du doux frisson de la colère qui les roule,
Grondent de plaisir comme un éboulis de fauve
Où ronronne un torrent d’eau claire entre ses dents,
Eau qui est salive qui dévaste sa pente.
Tels des châteaux d’air en marche sur le gravier —
L’être est amplification de sa venue —
Les orages grondent en s’en faisant l’écho.
Laurent Albarracin, Le Grand Chosier, Le corridor bleu,
2016, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, le grand choisir, orage, puissance, colère, écho | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Pourquoi la littérature, l’art en général, dites-vous ? Hé bien comme libération, la seule, de la servitude, de la finitude.
Couleurs, textures, senteurs, odeurs, bruits, sons, matières, substances : tout cela nous requiert et nous attache, besoin éprouvé et satisfaction profonde.
La mort physique à quoi l’on assiste fait éprouver avec une évidence violente qu’elle est bien la seule réalité, le seul événement qui valide le « toujours » et le « jamais plus ».
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 64, 81, 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, vivre, art, libération, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2016
Roger Giroux, L'arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre

J’étais l’objet d’une question qui ne m’appartenait pas. Elle était là, ne se posait, m’appelait par mon nom, doucement, pour ne pas m’apeurer. Mais le bruit de sa voix, je n’avais rien pour en garder la trace. Aussi je la nommais absence, et j’imaginais que ma bouche (ou mes mains) allaient saigner. Mes mains demeuraient nettes. Ma bouche était un caillou rond sur une dune de sable fin : pas un vent, mais l’odeur de la mer qui se mêlait aux pins.
Roger Giroux, L’arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre, Mercure de France, 1979, p. 9.
Lieu-je et Lettre ont été réédités par Éric Pesty éditeur, avril 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, l’arbre le temps, suivi de lieu-je et de lettre, question, voix, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2016
Umberto Saba, Il Canzionere

Je rêvais abattu sur le sol...
Je rêvais abattu sur le solà un bien ancien.
J’étais à Trieste, dans ma petite chambre.
Je regardais un léger nuage rose
planer, en se fanant, dans le ciel bleu.
Il se dissipait dans les airs ; je me représentais mon destin
par le sien dans une brève poésie.
Alors « maman — disais-je — je sors » et en hâte,
je me précipitais chez mon cher ami pour la lire.
« Que fais-tu, fainéant ? » Et une main m’éveilla :
et je vis, en ouvrant les yeux vers le ciel,
au milieu de la fumée et des explosions l’avion sur nous.
Je vis des décombres de maisons effondrées,
des soldats courir comme fuyant dans la débâcle,
et au loin, au loin le rivage.
Umberto Saba, Il Canzoniere, traduction René de
Ceccatty, L’Âge d’Homme, 1988, p. 177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2016
André Frénaud, La Sainte Face

La femme de ma vie
Mon épouse, ma loyale étoffe,
ma salamandre, mon doux pépin,
mon hermine, mon gros gras jardin,
mes fesses, mes vesses, mes paroles,
mon chat où j’enfouis mes besoins,
ma gorge de bergeronnette.
Ma veuve, mon essaim d’helminthes,
mes boules de pain pour mes mains,
pour ma tripe sur tous mes chemins,
mon feu bleu où je cuis ma haine,
ma bouteille, mon cordial de nuit,
le torchon pour essuyer ma vie,
l’eau qui me lave sans me tacher.
Ma brune ou blanche, ma moitié,
nous n’aurons fait qu’une couleur,
un soleil-lune à tout casser,
à tous les deux par tous les temps,
si un jour je t’avais reconnue.
André Frénaud, La Sainte Face,
Poésie /Gallimard, 1985, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, la femme de ma vie, énumération | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2016
Christian Prigent, La Vie moderne

(une petite panne)
Joue la moderne un peu question sexe et va
Pas t’écouter cuvette auto-déplora
Triste ô pâle ahuri touriste à pas sa
Voir à quel sein vouer tes desiderata.
C’est fête la fesse et la chair non oui oh
Oui je dis j’obtempère et si mon petit
Doigt va dans des trous gais goûter le coulis
Des perplexités ça va ça va mollo
La libido (zéro alibi : au trot !),
Mais le vache accroc c’est madame qu’on pâme
À ne pas savoir où l’immiscer son âme
Parmi l’incarnate promiscuité, no ?
Christian Prigent, La Vie moderne, un journal,
P.O.L, 2012, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, une petite panne, sexe | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2016
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux

Il ne suffit pas d’ouvrir la fenêtre
pour voir les champs et la rivière.
Il ne suffit pas de n’être pas aveugle
pour voir les arbres et les fleurs.
Il faut également n’avoir aucune philosophie.
Avec la philosophie il n’y a pas d’arbres : il n’y
a que des idées.
Il n’y a que chacun d’entre nous, tel une cave.
Il n’y a qu’une fenêtre fermée et tout l’univers
à l’extérieur ;
et le rêve de ce qu’on pourrait voir si la fenêtre
s’ouvrait,
et qui n’est jamais ce qu’on voit quand la fenêtre s’ouvre.
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux, traduction
Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, armand guibert, philosophie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2016
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize : recension
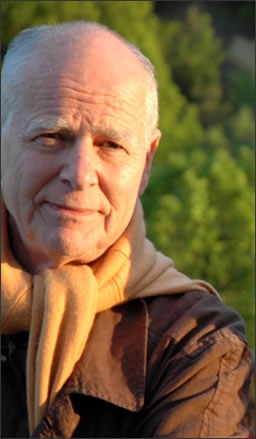
Commençons par un court descriptif. J 13 débute par un bref Prologue (daté de 2009), suivi de deux séquences de dimensions inégales (2010, ‘’Le grand pense-bête », 2011, ‘’Les formules’’(1)) ; l’année 2011 fournit également J 14 et J 15, et le volume se clôt avec J 16 pour l’année 2012. Si l’on ne considère que les datations qui organisent le texte, J 13 et J 14 se présentent sous la forme d’un journal, mais journal parfois abandonné ; rien entre 13 octobre 2010 et le 17 janvier 2011, entre le 28 avril et le 28 mai 2011. S’y mêlent réflexions sur la relation au monde, sur l’écriture, etc., en prose ou en vers, la distinction étant parfois inopportune. J 16, écrit en vers, ne cesse pas, loin de là, d’interroger le rapport au langage. Cette esquisse descriptive vise à souligner que ce nouveau volume est très construit, comme les précédents ; parmi les motifs qui reviennent d’un livre à l’autre, celui de la séparation me semble être privilégié dans la mesure où il est mis en valeur dans J 15, qui ne compte que deux mots :
nous
sommes
Il y a là, en même temps, affirmation de la présence et constat d’une coupure. Voilà qui évoque le ‘’coup de foudre’’ qui retient par ailleurs l’attention de Pesquès : il aide en effet à comprendre que « l’origine est une fracture ; et qu’avec lui, derrière lui, après lui, l’œuvre relève de la fragmentation. » (175) Écrire la colline de Juliau, ce qu’elle est, ne peut se faire que dans son absence et une part importante des remarques portent sur ce point, la séparation, le « gouffre » entre ce qui est vu, entre les choses, et la langage, les mots. Il s’agit bien de « faire des choses avec des mots » (54), mais la colline, comme le corps, ne sont en rien « ce que les mots en disent » (19). D’une certaine manière, il n’est peut-être pas d’autre sujet d’écriture que celui-là ; le paysage, le corps sont devant moi, et sont pour toujours obscurs en ceci qu’avec les mots je vais les construire, mais pas les donner à voir. Ce que reprend inlassablement Pesquès d’un livre à l’autre. Ici : les phrases sont vouées à « la construction d’un colline » (27), « la construction d’une sensation, c’est tout l’effort d’écrire » (112) ; au hasard, dans un des livres précédents : « Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu’ils séparent »(2).
Cette séparation acceptée justifie le caractère inachevable de l’écriture de Juliau, et certaines ‘’formules’’ écrites au cours des années « demandent à être revisitées, repensées, débattues » (9) : ce qui est avancé dans le prologue annonce que l’objet du livre ne peut être nouveau. Donner le nom de ce qui est devant soi est possible « trajectoire du renard, histoire de la limace, chevreuil dans les vignes » (125), et l’on pourra lire les mots grillon, sauterelle, huppe, mulot, blaireau, pie, ou « Chevreuil à dix pas. Perdrix mixte » (123), on ne sera pas pour autant dans la représentation. Il ne s’agit pas de ‘’découvrir » » que les mots ne sont pas les choses ! Ce qui importe, ce sont les approches de ce qu’est la séparation entre le langage et les choses. Quand Pesquès écrit « Il n’y a séparation que parce qu’il y a quelque chose qui veut être retrouvé, je veux dire inventé à nouveau pour avoir été tranché » (87), la proposition est proche du lien établi à différents moments entre « séparation » et « origine ». Proximité encore avec les vers cités d’Alain Veinstein (153) :
Je ne fais rien d’autre, au fond,
Que m’enfouir le visage dans ces phrases
Pour y retrouver l’odeur de ma mère
La tentative, toujours à recommencer, de dire ce qui est vu — ce qui est vu est mis en cause dès que les mots sont écrits — divise le sujet, alors partie avec les choses, partie avec les mots. Il n’est guère concevable de passer outre, ou plutôt le silence ne peut être compris que « désir interdit, inhumain, transgressif », il n’est que dans « la jouissance et la mort » (163) ; le tragique, dans la relation à la langue, est justement que son usage implique « l’éloignement, la séparation » (55), les choses étant « toujours en excès sous la phrase » (152)
Donc : il faut s’obstiner à écrire, pour accepter ce qui est dessaisissement, condition pour « le pluriel vécu de l’identité » (130), le désir. Si le jaune est omniprésent dans les volumes de La face nord de Juliau, c’est qu’il est la couleur de la sexualité (« pas du jaune, du sperme »,150), et qu’il porte la pluralité, écrit par anagramme nauje, aujen (117) ou « Jaune, JAUNE, jaune » (107). Ce corps en désir, pluriel, est plus présent dans J 16, dans la mesure où la colline s’éloigne, où s’imposent alors « 2 nus/sans le moindre mot » (231), une approche du silence étant possible. D’ailleurs les mots et des connotations liées traditionnellement au corps amoureux imprègnent le long poème pour exprimer « une sorte d’amour réel » : nu (nue, nus), nudité, jouir, ventre, chair, excitée, anfractuosité, écoulement, tendu, « l’épanouie imprenable » — et envahissent le discours, jusqu’aux « cuisses de la phrase ». Ce n’est donc pas hasard si dans la dernière section du livre Pesquès entend « écrire sans accessoires ni chuchotement » (212) — on reconnaît là une citation de Mallarmé dans Crise de vers —, et ainsi (tenter de) trouver une « langue brisée d’amour » (227).
Il faudrait, il faudra, relire tous les volumes de La face nord de Juliau, suivre le lent cheminement et comprendre, dans ce qui peut n’être qu’inachevable, que la poésie bute « sur le fin fond du dicible » (92). Suivre aussi la relation complexe entretenue avec la peinture — les essais de Pesquès dans ce domaine sont à lire avec sa poésie ; ici, est évoqué le peintre de Lascaux, qui « parle dans la nuit » et « en arrache une image » (124). Alors relire l’ensemble comme « une sorte de ready made du gouffre de toute vie, l’évidence du désir incluant son accomplissement écarté. À la fois le « parti pris des choses » et ce qu’elles sont : insaisissables. » (126).
——————————————————————————————
- Certains éléments laissent penser à des ajouts postérieurs : Pesquès introduit des citations dans J 13, II et III (2011) — une liste des auteurs sollicités est donnée page 155 —, mais les vers repris d’Alain Veinstein sont extraits de Scène tournante publié en 2012.
- Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, 252 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 7 avril 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, treize à seize : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2016
Étienne Faure, Légèrement frôlée
La nuit quelqu’un pleure en elle
plus souvent qu’autrefois.
Sur le ponton, sa peur
— chair évidée des poissons servant d’appâts —
cent fois réveillée, c’est la noyade.
Ce chagrin d’un autre, elle le porte
ainsi qu’un deuil à très haute tension
dans la gorge, au sternum, sous les os.
Puis, le jour revenu, le sang circule,
chacun respire,
de nouveau la vie va reprendre,
on a eu peur ; pourtant
l’amour que le mort lui porte
n’a pas quitté ce corps, chair votive
où la beauté résiste à fleur de peau
— tant le mort pense à elle —
comme en janvier fleurissent
les camélias du littoral
malgré le froid, puis fanent,
offerts à la jetée.
les camélias du littoral
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon,
2007, p. 60.
Étienne Faure a publié Vues prenables (2009),
Horizon du sol (2011), La vie bon train (2013),
Ciné-plage (2015).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, légèrement frôlée, les camélias du littoral, perte, chagrin | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2016
Robert Pinget, Mahu ou le matériau
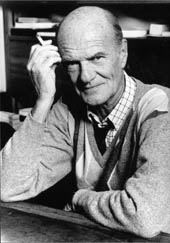
Le chèque
Un chien se présente au couvent de Sainte-Fiduce. Il demande à la bonne sœur de faire des prières pour que son maître le retrouve. Son maître l’a perdu un jour à la chasse et depuis personne n’en a entendu parler. Mais lui, il a rôdé sans cesse jusqu’à cette idée de prières.
La bonne sœur le fait attendre au parloir. Elle revient quelques instants après et lui dit que la Mère Supérieure ne veut pas entendre parler de prières pour les chiens. Inutile d’insister. Les dernières faites au couvent contre la règle l’ont été pour une chèvre. Des ennuis épouvantables en sont issus. Cette chèvre apparaissait à tout propos, un peu partout, dans des attitudes pieuses, et vraiment ça n’était pas convenable. On finissait dans le pays par la confondre avec sainte Fiduce elle-même qui, comme chacun sait, apparaît souvent.
Le chien à ces paroles rougit, rougit, rougit. La bonne sœur lui demande ce qu’il a. Et lui, naïvement, lui dit qu’il a été cette chèvre assez longtemps. Qu’il n’y pouvait rien, qu’il espérait retrouver son maître plus facilement sous cette forme. « Mon maître m’a perdu en chassant le jour de la Toussaint. »
[...]
Robert Pinget, Mahu ou le matériau, éditons de Minuit, 1952, p. 82-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert pinget, manu ou le matériau, chien, chèvre, maître, nonne | ![]() Facebook |
Facebook |






