03/08/2016
Rafael Alberti, Qui a dit que nous étions morts ?

Chanson du Parana (1953-1954)
1
Aujourd’hui les nuages m’ont apporté
en volant, la carte d’Espagne.
Si petite était sur le fleuve
et si grande était sur l’herbage
cette ombre qu’elle projetait !
Elle s’est emplie de chevaux,
cette ombre qu’elle projetait.
Moi, à cheval, parmi cette ombre
j’ai cherché village et maison.
Je suis entré dans le patio
qui avait été ombre et eau.
La fontaine n’y était plus,
et cependant elle y bruissait.
Et l’eau qui ne coulait plus est
revenue me donner de l’eau.
Rafael Alberti, Qui a dit que nous étions morts ?,
Traduction de l’espagnol Claude Couffon, Les
Éditeurs français réunis, 1964, p. 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rafael alberti, qui a dit que nous étions morts ?, retour d'exil | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2016
Christian Prigent au festival de Sète

Le festival de Sète, Voix vives, est terminé. À lire le projet (que l’on retrouvera intégralement sur la Toile), on est intéressé, même si une « approche plurielle » de la poésie, ce n’est pas très clair :
« Chaque année au mois de juillet, le Festival de poésie voix vives, de Méditerranée en Méditerranée accueille à Sète plus de cent poètes venus de toutes les Méditerranée. Ils sont entourés d’artistes, conteurs, musiciens, chanteurs, comédiens qui offrent avec eux une approche plurielle de la parole poétique.
De nombreuses rencontres sont proposées chaque jour dans des lieux accessibles à tous : places, jardins publics et privés, rues, lieux du Patrimoine situés dans une partie historique de la ville retenue pour être Le Village du Festival. »
C’est la poésie à la portée de tous, on va de place en place pour écouter x et y. Pourtant, tous les « invités » ne partagent pas l’euphorie qui devrait être générale.
Ainsi Christian Prigent :
VENI, VIDI, FUGI
Arrivé le vendredi 22 à Sète pour participer au festival de poésie «Voix vives», j'en suis reparti une heure après. Le temps de constater la désinvolture de l'accueil et l'indignité de l'hébergement proposé. Le festival «Voix vives» n'est qu'une affiche. Cette affiche arbore un grand nombre d'invités et leur répartition «internationale», une multiplication d'«événements» festifs et l'abondance du «public». C'est pour susciter l'écho médiatique et attirer l'argent (les subventions). Cet argent sert à salarier une administration, à publier un catalogue luxueux, à financer quelques spectacles de variété, à payer la publicité. Aux poètes invités : clopinettes. Et que la prime de plaisir narcissique d'être invités par ce festival «prestigieux» leur fasse avaler les couleuvres : logis en caserne, honoraires faméliques, prestations quotidiennes aux quatre coins des rues, panels hétéroclites — et, last but not least, l'absence radicale de souci artistique d'un festival qui, sur la poésie, ne sait rien faire d'autre qu'aligner les niaiseries «humanistes» qu'ose, en préface du catalogue, son Président d'honneur.
Christian Prigent
25 Juillet 2016
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent au festival de sète | ![]() Facebook |
Facebook |
01/08/2016
Guillaume Apollinaire, La tzigane

La tzigane
La tzigane savait d’avance
Nos deux vies barrées par les nuits
Nous lui dîmes adieu et puis
De ce puits sortit l’Espérance
L’amour lourd comme un ours privé
Danse debout quand nous voulûmes
Et l’oiseau bleu perdit ses plumes
Et les mendiants leurs Ave
On sait très bien que l’on se damne
Mais l’espoir d’aimer en chemin
Nous fait penser main dans la main
À ce qu’a prédit la tzigane
Guillaume Apollinaire, Alcools, dans
Œuvres poétiques, édition M. Adéma et
M. Décaudin, Pléiade / Gallimard,
1967, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, la tzigane, prédiction, destin, espérance | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2016
André du Bouchet, Orion

Orion aveugle à la recherche du soleil levant : la figure venue de droite, verte, qui fait silencieusement irruption dans le grand paysage du Metropolitan Museum demeure, sur l’instant, inapparente. On l’appréhende, car elle en occupe toute la hauteur, sans la discerner. Ce n’est qu’un arbre en marche parmi les arbres. Les dieux se retirent. D’autres puissances règnent, déjà frappées : la peinture de Poussin marque volontiers un tel moment. À l’échelle de la nature alors figurée, sans être retranchés du monde des piétons, tout concourt à leur évanouissement comme à leur résurgence. De vastes formes telluriques surplombent, dominent, traversent la terre — à la fois plus diffuses et moins vagues que les nuages, puisqu’elles précipitent en même temps l’acquis de l’histoire humaine — avant de se résoudre, loin des dieux évanouis, dans cette même terre qu’elles foulent. Leur immersion parachevée, les assises de ce théâtre de nues, de montagnes et de fleuves paresseux se dénouant, chez Poussin, dans un infini sans vapeurs, demeurent irréductibles.
André du Bouchet, Orion, Deyrolle, 1999, p. 11-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, orio, soleil levant, poussin | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2016
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière
En hommage à Yves Bonnefoy, 1923-1er juillet 2016
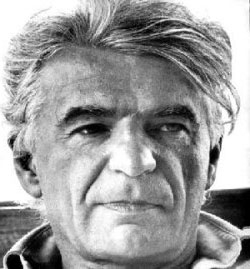
L'agitation du rêve
I
Dans ce rêve le fleuve encore : c'est l'amont,
Une eau serrée, violente, où des troncs d'arbres
S'entrechoquent, dévient ; de toute part
Des rivages stériles m'environnent,
De grands oiseaux m'assaillent, avec un cri
De douleur et d'étonnement, — mais moi, j'avance
À la proue d'une barque, dans une aube.
J'y ai amoncelé des branches, me dit-on,
En tourbillons s'élève la fumée,
Puis le feu prend, d'un coup, deux colonnes torses,
Ont un porche de foudre. Je suis heureux
De ce ciel qui crépite, j'aime l'odeur
De la sève qui brûle dans la brume.
Et plus tard je remue des cendres, dans un âtre
De la maison où je viens chaque nuit,
Mais c'est déjà du blé, comme si l'âme
Des choses consumées, à leur dernier souffle,
Se détachait de l'épi de matière
Pour se faire le grain d'un nouvel espoir.
Je prends à pleines mains cette masse sombre
Mais ce sont des étoiles, je déplie
Les draps de ce silence, mais découvre
Très lointain, très proche la forme nue
De deux êtres qui dorment, dans la lumière
Compassionnée de l'aube, qui hésite
À effleurer du doigt leurs paupières closes
Et fait que ce grenier, cette charpente,
Cette odeur du blé d'autrefois, qui se dissipe
C'est encore leur lieu, et leur bonheur.
[...]
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, Poésie / Gallimard, 1995 (1987), p. 85-86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, ce qui fut sans lumière, rêve, feu, cendre, blé | ![]() Facebook |
Facebook |
02/07/2016
Jacques Baron, L'Allure poétique

Attendre
Un petit chemin de fer
Qui coule comme un tord-boyau
À la guerre comme à la guerre
L’extrême durée de l’espace
Depuis le temps des fafiots
O rouges coquelicots
Hirondelles en mal d’amour
Le mal d’armes et le pas rude
Mal de tête des plaines nues
Une ombre à peine portée
L’incertitude qui t’enlace
Repeint ton cœur au minium
Plaisir usé. Refaire le temps
Refaire une plainte éternelle
Le bien s’est à tire d’aile
échappé de ma maison
Jacques Baron, L’Allure poétique,
1924-1973, Gallimard, 1974, p. 85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques baron, l'allure poétique, attente, refaire le temps | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2016
Jacques Bens, Sonnets irrationnels

Nostalgique
Je ne hanterai plus les graves officines
Où mes amis, tout doucement, prennent racines,
Racines que j’envie sous mes airs fanfarons,
Car, au-delà de tout, j’aime l’odeur des livres.
Si j’ai troqué la plume pour les mancherons
C’est façon de parler, poétique et vaccine),
Si j’ai, dis-je, choisi les champs et les fascines,
Je n’ai pas renié mon sang d’écriveron :
Toujours, par dessus tout, j’aime l’odeur des livres.
Ah, connaître à nouveau ce monde qui m’enivre !
Retrouver, chaque jour, mes cousins correcteurs !
Renifler le parfum froid des clichés de cuivre !
Revivre, enfin, la vie qui déjà m’a fait vivre,
Et, parbleu ! débarquer comme un triomphateur !
Jacques Bens, Sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, sonnets irrationnels, vers, alexandrin, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2016
Christian Bachelin, Neige exterminatrice

Grince une tôle un tuyau hurle
Immémorialement mystère et solitude
Sur les palissades stagne le sang étrange
Une ortie blanche obsède la pâleur du temps
Descente d’Eurydice au tombeau écarlate
En hiver sous la haute neige de misère
Dans le brouillard d’angoisse erre la mort tzigane
Chevelure dénouée au gouffre des mansardes
Seriez-vous morte ou prise d’un autre silence
Mémoire de l’enfance hibernante mémoire
Comme une ombre en allée de moi-même et menant
Son destin parallèle en des châteaux d’absence
Dans le pli des rideaux neige la solitude
Schizophrénie et brumes des contrées occultes
À contre jour vivant des présages du ciel
S’enchante la misère à la fenêtre abstraite
Christian Bachelin, Neige exterminatrice, Poésies 1967-2003,
Préface de Valérie Rouzeau, Le temps qu’il fait, 2004, p. 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian bachelor, neige exterminatrice, valérie rouzeau, eurydice hiver | ![]() Facebook |
Facebook |
29/06/2016
Li Yù (937-978), Les sens de l'Absent
Tracé sur un mouchoir comme sur une tablette funéraire
Pâle et frêle
Notre vie a flotté.
Mes années de vigueur
Ont perdu ta grâce et ta beauté.
[Le mouchoir] essuie la sueur
De ta main. Reste une tache
Qui embaume.
Il te touche le sourcil.
Demeure la ténèbre du fard.
Li Yù (937-978), Les sens de l’Absent, traduit
du chinois et présenté par Thierry Faut, dans
L’étrangère, n° 40-41, décembre 2015.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : li yù (937-978), les sens de l’absent, temps, usure | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2016
John Ashbery, Fragment

Le quartier restant est fermé en avril. Tu
Vois les intrusions assombrir son visage
Comme dans le souvenir qui t’est resté d’une
Tolérance antérieure qui s’épuise dans sa
Retombée à des fins hermétiques,
La compassion des fleurs jaunes.
Jamais notées dans les signes du jour oblong
Les flammes à dents de scie et le point d’un autre
Espace non donné, et encore que ne faisant défaut
Jamais encore imaginé : l’injonction d’un instant.
John Ashbery, Fragment, traduction Michel Couturier,
Seuil, 1975, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbury, fragment, michel couturier, souvenirs, instant | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2016
Jacques Audiberti, Poésies 1934-1948

Raminagrobis
Mangez, mes petits ! Mangez, mes petits ! Mangez !
Demain nous aurons nos sites changés.
Demain nous saurons, de la mort, la tendre,
la seule raison qui n’est que d’attendre.
Buvez, mes petits ! Buvez, mes petits ! Buvez !
Demain nous aurons nos pouces lavés.
Nous pourrons, demain, sous la pamplemousse,
graisser, des saisons, le dard, s’il s’émousse.
Aimez, mes petits ! Aimez, mes petits ! Aimons !
Nous sommes des feux vêtus de phlegmons.
Nous font, nous guettant, fléchir goutte à goutte
trop d’yeux sur ces murs et sur cette voûte.
Mourez, mes petits, mourez, mes petits, et tous !
Qu’il n’en reste un seul, eût-il nom Titous.
Il rebâtirait un temple quelconque.
La pierre des soirs tourne dans la conque.
Jacques Audiberti, Poésies 1934-1948, préface de
Georges Perros, Gallimard, 1976, p. 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques audiberti, poésies, raminagrobis, georges perros, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2016
Pierre Pachet, Autobiographie de mon père
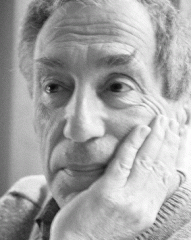
En hommage à Pierre Pachet, 1937-21 juin 2016
Dans l’enfance, je m’ennuyais beaucoup. Je vois avant tout l’enfance livrée à de longs déserts d’ennui, impossibles à traverser, pendant lesquels le corps est torturé, livré au temps, à l’incompréhensible attente. Seule ma mère avait la sympathie et la finesse nécessaires pour me comprendre et m’aider : elle acceptait de bonne grâce de jouer avec moi à la bataille, aux dominos, à la belote à deux, lorsque je n’avais pas d’amis sous la main. Mon père, lui, n’émergeait de son travail que pour rechercher le repos, en « s’allongeant » ou en allant se promener. Mais l’ennui, chez moi, ne voulait pas des promenades.
Pourtant une fois — une fois qui a dû se produire de nombreuses fois que ma mémoire condense parce que d’abord mon expérience l’a ressentie comme une seule fois, une fois venant après beaucoup d’autres mais enfin saisie comme telle — une fois, prenant en pitié mon corps et mon âme torturés, mon père me dit : « Tu t’ennuies ? Tu n’as qu’à avoir une vie intérieure ! Alors tu ne t’ennuieras jamais. »
Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, Belin, 1996, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre pachet, autobiographie d mon père, enfance, ennui, vie intérieure | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2016
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Soneto a Napoli
All’sole, all’luna
All’ sabato, all’canonico
E tutti quanti
Con pulcinella !
Il n’est pas de Samedi
Qui n’est soleil à midi ;
Femme ou fille soleillant
Qui n’ait midi sans amant !...
Lune, Bouc, Curé cafard
Qui n’ait tricorne cornard !
— Corne au front et corne au seuil
Préserve du mauvais œil.
… L’ombilic du jour fuyant
Son macaroni brûlant,
Avec la tarentela ;
Lucia, Maz’Aniello,
Santa-Pia, Diavolo,
— Con pulcinella —
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
dans Charles Cros, T. C., Œuvres
Cpmplètes, Pléiade/Gallimard, 1970, 784.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, soneto a napoli, pulcinella | ![]() Facebook |
Facebook |
23/06/2016
Jacques Réda, La course

Gitans à Montreuil
Dans les vergers à l’abandon qui dominent Montreuil
Les filles des Gitans fument près des roulottes
Sous des cordes à linge où sèchent leurs culottes,
Elles rôdent avec la grâce du chevreuil.
On n’ose jeter en passant qu’un rapide coup d’œil
Des vieilles à l’affut suspendent leurs parlotes
(Les hommes sont allés vendre des camelotes
Dans le grand déballage, en bas). Pourquoi ce deuil
Au fond de la lumière, alors qu’elle irradie,
Et dans l’air vif ce goût fade de maladie ?
Les filles des Gitans ont beau se déhancher,
L’espace fourbu gît sous ses propres décombres :
Cabanes à lapins, potagers à concombres
Sous la fumée inerte et sans feu d’un pêcher
Rose.
Jacques Réda, La Course, Gallimard, 1999, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, la course, gitans à montreuil | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2016
Philippe Beck, Opéradiques

Hilarité
Je refais l’opéra des enfants,
leurs planches tachetées usinées,
les rues barrées
avant le poème scénique,
l’opus couvrant, que Berg tient
en respect en principe.
Les enfants lisent la presse
depuis cent ans. Enfants réalisants.
Ils mélologuent,
ils connaissent la méthode
du rire. Le ballet retournant.
Le dérampement.
Wallacetown maintenant.
Blackness maintenant.
Balfour Street
en demi-lune méthodique
et aventurée.
Le bâton est électrisé.
Il électrise la panthère.
Pré-musiquée.
Philippe Beck, Opéradiques, Poésie /
Flammarion, 2014, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, opéradiques, l'opéra des enfants, berg, musique | ![]() Facebook |
Facebook |





