02/10/2016
Esther Tellermann, Sous votre nom

Vivions-nous
à même
nos linges
et nos tessons
pour finir
nos bouches
d’ombre ?
Ou bien nous
nourrissions d’oracles
et de couronnes
d’eau que retiennent
les marges ?
Esther Tellerman, Sous votre
Nom, Flammarion, 2015, p. 104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, sous votre nom, vivre, bouche, oracle | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2016
Cole Swenson, Si riche heure

Photo Carl Sokolow
Le 1er décembre : La Chasse
À chaque mois
son animal
animal
rythme la régularité un régulum
Pour construire un métronome
(reste une contre pulsation)
(poids)
et contre-poids, par exemple
sur le point, suspendu dans son toujours
pourvu que
Compte-les Mais c’est le cœur qui fait ça C’est sa tâche ; il compte
chaque instant de la vie d’une bête et le rend presque égal
Cole Swensen, Si riche heure, traduit de l’anglais par Maïtreyi et Nicolas
Pesquès, Corti, 2015, p. 113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swenson, si riche heure, la chasse, animal, bête | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2016
Édith Azam, Vous l'appellerez : Rivière

Elle se demande : comment savoir quand la parole est solide ? Il se pose la même question. D’une rive à l’autre, le courant. Il et Elle savent qu’à l’intérieur une épaisseur se crée, prend toute : son envergure. Mais est-ce l’ombre des longs arbres qui les abrite.
On dit
que Rivière
se jette
dans le fleuve.
C’est une erreur.
Elle s’engouffre.
Rivière :
dans le silence
.
Édith Azam, Vous l’appellerez : Rivière, La Dragonne, 2013, p. 63
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, vous l'appellerez rivière, question, parole, abri, fleuve | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2016
Lautréamont, Poésies I
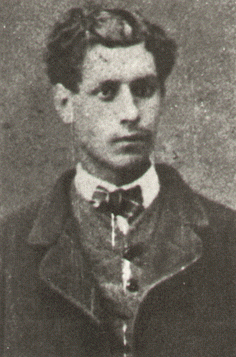
Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur. Gardez cela pour vous.
[…] La poésie personnelle a fait son temps de jongleries et de contorsions contingentes. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, brusquement interrompu depuis la naissance du philosophe manqué de Ferney, depuis l’avortement du grand Voltaire.
Il paraît beau, sublime, sous prétexte d’humilité ou d’orgueil, de discuter les causes finales, d’en fausser les conséquences établies et connues. Détrompez-vous, parce qu’il n’y a rien de plus bête ! Renouons la chaine régulière avec les temps passés ; la poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre. Elle a reculé. Grâce à qui ? aux Grandes Têtes-Molles de cette époque. Chateaubriand, le Mohican-Mélancolique ; Senancour, l’Homme-en-Jupon ; Jean-Jacques Rousseau, le Socialiste-Grincheur ; Anne Radcliffe, le Spectre-Toqué ; Edgar Poe, le Mameluck-des-Rêves-d’Alcool ; Maturin, le Compère-des-Ténèbres ; George Sand, l’Hermaphrodite-Circoncis ; Théophile Gautier, l’Incomparable-Épicier ; Leconte, le Captif-du-Diable ; Gœthe, le Suicidé-pour-Pleurer ; Sainte-Beuve, le Suicidé-pour-Rire ; Lamartine, la Cigogne-Larmoyante ; Lermontov, le Tigre-qui-Rugit ; Victor Hugo, le Funèbre-Échalas-Vert ; Mickiewicz, l’Imitateur-de-Satan ; Musset, le Gandin-Sans-Chemise-Intellectuelle ; et Byron, l’Hippopotame-des-Jungles-Infernales.
Lautréamont, Poésies I, dans Lautréamont, Germain Nouveau, Œuvres complètes, édition P.-O. Walzer, Pléiade / Gallimard, 1970, p. 268-269.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lautréamont, poésies i, malheureux, poésie personnelleimpersonnelle, cause finale, tête molle | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2016
André Gide, Journal, 1939-1949

8 juin [1949]
(…) J’ai traversé une longue période de fatigue presque constante où souhaiter sortir du jeu ; mais impossible de se retirer. Et, de même qu’en économie « la mauvaise monnaie chasse la bonne », les fâcheux, les importuns usurpent et restent maîtres de la place ; il n’y en a plus que pour eux.
Le pire c’est de prêter à penser : « Oui, depuis le prix Nobel, Gide est devenu distant. » Après quoi il n’y a plus qu’à s’aller noyer ou pendre. Et précisément depuis que la chaleur est revenue, je n’en ai plus du tout envie. Mais auparavant, je me sentais, certains jours, déjà tout décollé ; ceci pourtant me retenait : l’impossibilité de faire comprendre, de faire admettre, la réelle raison d’un suicide : comme ça du moins on me laissera tranquille, on me fichera la paix. Mais partir en voyage… dès le marchepied du wagon, quel soulagement de se sentir hors d’atteinte. Mais aller où ? […] Requis sans cesse, je dois remettre de jour en jour ; et sans cesse j’entends la Parque, la vieille, murmurer à mon oreille : tu n’en as plus pour longtemps.
André Gide, Journal, 1939-1949, Pléiade / Gallimard, 1954, p. 326.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, journal, pris nobel, suicide, voyage, la vieille parque | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2016
Michel Leiris, Mots sans mémoire
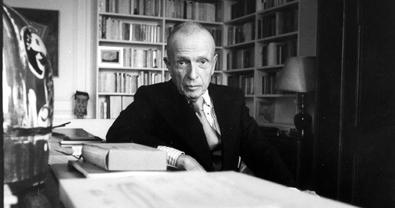
Marrons sculptés pour Miró
I
Les poches veuves de cailloux blancs,
viens-nous en
où va la ligne qui s’envole
sans avoir à jeter du lest.
II
Ciel comme celui du lit
étoile comme celle de la mer,
cardinal comme le gentil oiseau que dénomme sa couleur,
chinois à l’eau-de-vie
III
Quelque chose de l’ordre d’un feu frais
un d’un désert surpeuplé.
À chaque battement d’horloge
roses des sables et flambées de plumes
jaillissent du creuset de ses doigts
et marquent le vide à son chiffre.
[…]
Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1969, p. 135-137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémoire, marrons sculptés pour miró | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2016
Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance
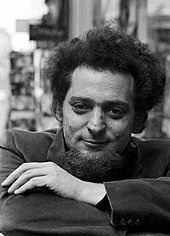
Photo André Perlstein
Une autre fois, il me semble qu’avec plein d’autres enfants, nous étions en train de faire les foins, quand quelqu’un vint en courant m’avertir que ma tante était là. Je courus vers une silhouette vêtue de sombre qui, venant du collège, se dirigeait vers nous à travers champs. Je m’arrêtai pile à quelques mètres d’elle : je ne connaissais pas la dame qui était en face de moi et qui me disait bonjour en souriant. C’était ma tante Berthe ; plus tard, je suis allé vivre presque un an chez elle ; elle m’a peut-être alors rappelé cette visite, ou bien c’est un événement entièrement inventé, et pourtant je garde avec une netteté absolue le souvenir, non de la scène entière, mais du sentiment d’incrédulité, d’hostilité et de méfiance que je ressentis alors ; il reste, aujourd’hui encore, assez difficilement exprimable, comme s’il était le dévoilement d’une « vérité » élémentaire (dorénavant, il ne viendra à toi que des étrangères ; tu les chercheras et tu les repousseras sans cesse ; elles ne t’appartiendront pas, tu ne leur appartiendras pas, car tu ne sauras que les tenir à part…) dont je ne crois pas avoir fini de suivre les méandres.
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994, p. 137-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, guerre, inconnu, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2016
Jules Supervielle, Le Corps tragique

Amour
Venant de tours indifférentes
Les regards des guetteurs s’échappent.
L’amour de l’homme et de la femme
Naît dans des citernes sans âme.
Combien faut-il d’obscurité
Avant que s’affrontent les corps
Tâtonnant vers leurs nudité
Et leurs plus obstinés trésors.
Les deux êtres soudain tout proches
Dardent leurs anguilles sous roche
Et, de feu sous les chastes cieux,
Croisent le fer voluptueux.
Les deux marées mâle et femelle
Rompent les digues de leur nuit
Formant un seul torse rebelle
Qui ruisselle de barbarie
Jusqu’à ce que le long des corps
Les mains lasses miment la mort.
Jules Supervielle, Le Corps tragique, dans
Œuvres complètes, édition Michel Collot,
Pléiade/Gallimard, 1996, p. 603.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps tragique, amour, nudité, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2016
Jack Spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça

Une brouette rouge
Repose-toi et regarde cette satanée brouette. Quoi que
Cela soit. Chiens et crocodiles, lampes à bronzer. Pas
Pour leur signification.
Pour leur signification. Pour être humain
Les signes t’échappent. Toi, qui n’es pas très brillant
Es un signal pour eux. Pas,
Je veux dire, les chiens et les crocodiles, les lampes à bronzer. Pas
Leur signification.
L’amour
Tendre comme un aigle il plonge
Lavant tous nos visages avec sa langue rêche.
Enchaîné à un rocher et dans ce rocher, nus,
Tous les visages.
L’amour II
Tu as attaché ses ailes. Le marbre
Expose ses ailes attachées.
« Mort à l’arrivée » :
Dis-tu avant qu’il n’arrive quelque part.
Le marbre, où ses ailes et nos ailes d’une manière semblable fleurissent.
In-
Fini.
Jack Spicer, c’est mon vocabulaire qui m’a fait ça, traduit de l’anglais par
Éric Suchère, préface de Nathalie Quintane, Le bleu du ciel, 2006, p. 163.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça, Éric suchère, nathalie quintane, la brouette rouge, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2016
Stefan Themerson (1910-1988), Ouah ! Ouah ! ou qui a tué Richard Wagner ?,

J’ai découvert, il y a longtemps, que je préfère les gens — je parle de mes amis — quand ils sont déprimés. Dès qu’ils deviennent ministres, dès qu’ils achètent des voitures puissantes, dès qu’ils rencontrent le succès, je m’aperçois qu’ils n’ont plus de temps à accorder à mon amitié, et la distance qui nous sépare augmente comme celle de deux vaisseaux sans gouvernail flottant à la merci des vagues ; sauf quand il leur arrive d’être déprimés. Je voyais Lampadophore dans cette vaste et puissante (bien que lente) automobile, mais je remarquais qu’il n’avait pas l’air très heureux.
— Qu’est-ce qui vous arrive, Lampadophore ? demandai-je.
Alors il me parla de sa crainte qu’un jour quelqu’un ne trouve logique de l’amputer de la jambe gauche et du bras droit.
Stefan Themerson (1910-1988), Ouah ! Ouah ! ou qui a tué Richard Wagner ?, traduit de l’anglais par J.-M . Mandosto, Allia, 2000, p. 31-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan themerson (1910-1988), ouah ! ouah ! ou qui a tué richard wagner ?, dépression, amitié, mutilation | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2016
Walter Benjamin, Sur Proust
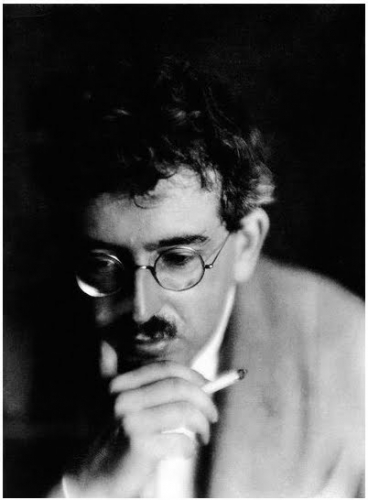
Les Romains disaient d’un texte qu’il était un tissu, et aucun ne l’est davantage et n’est plus dense que celui de Marcel Proust. Rien n’était trop dense ni trop durable pour lui. Gallimard, son éditeur, a raconté que les habitudes de Proust corrigeant ses épreuves mettaient les typographes au désespoir. Les placards revenaient toujours les marges pleines. Mais aucune faute d’impression n’avait été corrigée ; tout l’espace disponible était rempli d’un nouveau texte. Ainsi la loi du souvenir s’exprimait jusque dans l’ampleur de l’œuvre. Car un événement vécu est fini, en tant qu’il est contenu dans une seule sphère du vécu, alors qu’un événement remémoré est sans limites, car il n’est que la clé pour tout ce qui a eu lieu avant lui et après lui.
Walter Benjamin, Sur Marcel Proust, traduit de l’allemand et présenté par Robert Kahn, NOUS, 201, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sur proust, texte, correction, souvenir, œuvre, vécu | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2016
Paul Celan, Renverse du souffle
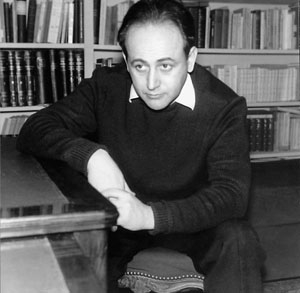
L’Écrit se creuse, le
Parlé, vert marin,
brûle dans les baies,
dans les noms,
liquéfiés
les marsouins fusent,
dans le nulle part éternisé, ici,
dans la mémoire des cloches
trop bruyantes à — mais où donc ?,
qui,
dans ce
rectangle d’ombres,
s’ébroue, qui
sous lui
scintille un peu, scintille, scintille ?
Paul Celan, Renverse du souffle, traduit
de l’allemand et annoté par Jean-Pierre
Lefebvre, Seuil, 2003, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, renverse du souffle, écrit, nom, mémoire, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2016
Miche Leiris, Le ruban au cou d'Olympia
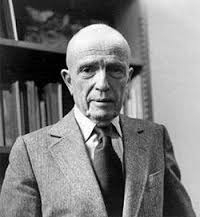
À main droite,
ma manie de manipuler,
démantibuler,
désaxer et malaxer les mots,
pour moi mamelles immémoriales,
que je tète en ahanant.
Murmure barbare en ma Babel,
tu me tiens saoul sous ta tutelle
et, bavard balourd, je balbutie.
À main gauche,
mes machins,
mes zinzins,
mes zizanies,
les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,
mes singeries, momeries et moraleries.
Ô gagachis qu’agacé j’ai sagacement jaugé et tout de go gommé,
jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis.
Au milieu,
le mal mou qui me moud,
me mord,
me lime,
m’annule,
m’humilie
et que, miel amer, je mettrais méli mélo à mille lieues mijoter,
mariner,
macérer.
M’a-t-il dit que ce monde dément demande un démenti,
le démon qu’enmantèle, emmêle et me démantèle ?
Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 176-177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d’olympia, jeux d mots, manipuler, mal, miel | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2016
Bashô, Le Faucon impatient

Ne vous cognez pas la tête
est-il écrit sur la porte
À perte de vue le ciel
est une nuée d’azur
Dans cette terre
qui ne convient aux radis
ils sont tout tordus
À peine les poules
ont-elles gagné le juchoir
lune de crépuscule
Dans la montagne un portail
et lune du point du jour
Du printemps peu à peu
complètent la figure
lune et prunier
Bashô, Le Faucon impatient, traduit du
Japonais par René Sieffert, POF, 1994,
- 19, 21, 39, 51, 55, 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basha, le faucon impatient, lune, printemps, ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2016
Ivan Diviš (1924-1999), Thanathea

Mais tiens Holbein qui vient
là avec sa lance il marche boisé
Déjà le heaume s’assombrit déjà le fourmilier à la lisière
tire la langue dans le grouillement des poèmes
Déjà le crâne de panthère rougi de l’intérieur à la lumière
d’une bougie flottant à travers la véranda livre
le succus paradula
Moi le dernier
cétacé carré à l’horizon
j’étends le rideau brumeux dans l’azur
Allez donne déjà donne les fers les cordes les pitons
Je rampe déjà à travers la prière je creuse la nuit du boutoir
je révoque mes insultes
et délivre les torts aux latrines
Par aucune pitié enfin ne pouvant servir
Traîne jusqu’où ne commence ni le rêve ni le repentir
Hop ma vieille
saute par là
enjambe moi
arrête la plume
arrose par l’entrejambe
Ivan Diviš, Thanathea, adapté du tchèque par
André Ourednik, La Baconnière, 2016, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan diviš, thanathea, langue, lumière, nuit, pitié, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |





