27/03/2023
Rehauts, 2022, n° 49 : recension
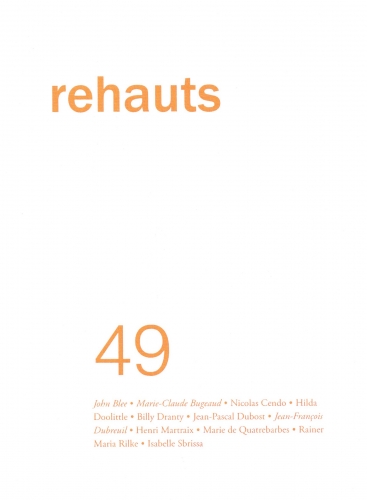
Le mythe d’Orphée est probablement l’un de ceux qui ont le plus fasciné les humains : le retour possible à la vie terrestre après la mort touche quelque chose de profond dans l’imaginaire. Les créateurs se sont attachés à ce thème dans tous les domaines, dès Ovide. L’opéra a très régulièrement repris le thème ; depuis 1600 (L'Euridice, favola drammatica de Giulio Caccini et Jacopo Peri) et, surtout, l’Orfeo de Monteverdi (1607), le drame a inspiré de nombreux compositeurs jusqu’à Philip Glass (Orphée, 1991, à partir du film de Cocteau) ou Pascal Dusapin (Passion, 2008) ; le théâtre, la peinture et le cinéma ont aussi illustré le mythe tout comme la poésie, de Tristan L’Hermitte et Apollinaire aux Sonnets à Orphée de Rilke. Ouvrant cette livraison de Rehauts, Patrick Beurard-Valdoye a choisi de traduire un poème de Rilke, un autre de H. D. ; cette fois, c’est le regard d’Eurydice qui occupe les poèmes à propos de la tentative d’Orphée de la sortir des Enfers. Chez Rilke c’est un narrateur qui rapporte la remontée des Enfers et le comportement d’Eurydice : « son état de morte / la satisfaisait », elle semble ne rien attendre, elle marche sur le « chemin qui remontait à la vie » sans penser à qui l’attend, elle avance « le pas contraint par de longs bandeaux de corps / incertaine, placide et sans nulle impatience » ; quand Orphée se retourne et qu’Eurydice doit redescendre vers les Enfers, ces deux vers, repris, terminent le poème. Dans le poème de H. D. (Hilda Doolittle), c’est Eurydice qui raconte l’épisode en s’adressant à Orphée ; il lui aurait ôté la possibilité de regagner la terre « à cause de son arrogance », et c’est ce thème qu’annonce le premier vers du poème, « Donc tu m’as rejetée en arrière / moi qui aurais pu marcher parmi les âmes vives ». Le tort d’Orphée, puisqu’il a perdu Eurydice en se retournant, c’est justement de ne pas l’avoir laissée où elle était (« je t’aurais oublié / et le passé aussi ») puisque, répète-t-elle comme s’il était présent, « l’enfer n’est pas pire que ta terre ». Grand chant lyrique entre nostalgie des fleurs et acceptation du destin, « Au moins ai-je mes fleurs à moi, / et mes pensées aucun dieu / ne peut prendre ça ». On souhaiterait lire les textes originaux avec les deux traductions pour mieux apprécier le passage d’une langue à l’autre, dans le poème de Rilke quand on lit la restitution de tels vers (« sylve et val / et voie et ville, fleuve et pré et bête ») ou l’emploi d’un mot rare (« nastié ») à propos du sexe d’Eurydice, dans le poème de H. D. pour la restitution du ton véhément et familier d’Eurydice. Les poèmes sont suivis de deux dessins de John Blee, figures abstraites d’Orphée, Eurydice et Hermès.
Il s’agit d’une toute autre mort dans les proses de Jean-Pascal Dubost, "Animaleries, Un bestiaire de la souffrance", la destruction des espèces animales sans même l’"excuse" d’une raison économique, il s’agit aussi de souffrances gratuites pour le plaisir (?) de spectateurs, de leur disparition provoquée par le "progrès" (automobiles, agriculture intensive). Dubost change d’approche dans chacune des dix proses, ce qui fait l’intérêt de la lecture. La première, non ponctuée, comme les suivantes, cite au début un texte du moyen français et, dans la dernière partie, la pratique des sauniers — clouer un goéland mort sur un piquet pour éloigner les oiseaux de leur saline — se justifie selon eux par son ancienneté : « pourquoi croyez-vous que c’est une pratique ancestrale ? » ; on n’oublie pas quelques mots archaïques, les assonances et allitérations « ça (= les déjections) cause trop de gros dégâts graves dégradant les parcelles et le sel de leurs sales selles ».Dans la cinquième prose, les huit courtes séquences s’ouvrent par « Pensée pour », suivi d’une brève description de la violence faite à tel animal : « Pensée pour el toro aux cornes goudronnées paniquant dans les rues d’Espagne c’est un spectacle pyrotechnique dit sanglant wiki ». La huitième prose retient des "performances" fondées sur la souffrance animale ou leur destruction ; après leur description, l’adjectif « heureux » est repris, précédé d’un intensif (« très, plus que, super », etc.) : « (…) follement heureux le chien errant maigre et décharné exposé en galerie jusqu’à sa mort de faim par Habacue (…) ». La prose s’achève avec une allusion à un sonnet de du Bellay (« Heureux qui comme Ulysse… »). Pas de sensiblerie : des variations de la forme pour refuser que « des discours conceptuels objectifient [la mort] c’est de l’art ».
On souhaite, à en lire des extraits, la publication du récit d’Isabelle Sbrissa, "Jmanvè" (= Je m’en vais ; transcription des échanges entre les deux personnages). Il met en scène Lucile, jeune fille qui ramasse sur les chemins des fossiles et des pierres avec selon elle une forme particulière ; elle rencontre Enzel qui voudrait comme elle chercher de petits trésors, « le monde des cailloux forme petit à petit un double au monde des humains ». Enzel part au village voisin pour une fête foraine, prise en route dans le pickup d’un groupe qui acheté une maison pour la rénover avec « la certitude d’inventer un monde nouveau » ; elle a choisi d’être seule, avec le « besoin d’un retrait pour exister avec les autres (…), pour regarder au-dedans d’elle-même. » Le lecteur est curieux de la suivre, qui garde dans sa poche un caillou en forme de cœur, petit cadeau de Lucile, autre personnage énigmatique.
Marie de Quatrebarbes propose plus de jeux avec les formes que de détails météorologiques avec ses "Poèmes de pluie" : 12 strophes de 3 vers pour "Traversée", 8 ensembles de 3+3 vers, "Suite", qui débutent tous par « Débris de cœur sur la plage », 9, 7 et 8 distiques pour "Première giboulée", "Seconde…" et "Troisième…".Il est question dans le premier poème du passé, de l’enfance, de l’absence et d’une disparition — thèmes récurrents de l’auteure —, mais aussi de la mer, présente également dans le second poème avec des goémoniers une plage, des mouettes. Les giboulées sont liées à la venue du printemps (« mars », « forsythia ») ; la présence de la neige, affirmée dans le premier ensemble, ne l’est plus ensuite (« je ne sais dire au juste / s’il neige ou quoi… », « est-ce que dehors il neige véritablement »). On est dans un monde sans véritable assise, sans rien qui puisse être tenu pour stable, et même réel avec une « lumière grise », le « silence », qui ne semble habité que par des tourterelles, des chenilles et des fleurs.
Il faut reprendre la lecture de Rehauts, pour les poèmes et proses de N. Cendo, B. Dranty et H. Moutrais, aussi pour les longues recensions de Guennadi Aïgui et Muriel Pic par Jacques Lèbre. C’est une des caractéristiques d’une revue d’exclure une lecture continue, on l’abandonne un temps, nourri par un texte, pour y revenir et, à nouveau, y trouver matière à plaisir. Rehauts, 2022, 96 p., 14 € ; Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 15 février 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, 2022, n° 49 | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2023
Rehauts, n° 49, 2022
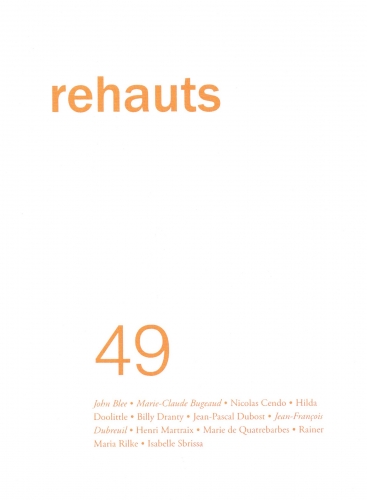
Le mythe d’Orphée est probablement l’un de ceux qui ont le plus fasciné les humains : le retour possible à la vie terrestre après la mort touche quelque chose de profond dans l’imaginaire. Les créateurs se sont attachés à ce thème dans tous les domaines, dès Ovide. L’opéra a très régulièrement repris le thème ; depuis 1600 (L'Euridice, favola drammaticade Giulio Caccini et Jacopo Peri) et, surtout, l’Orfeo de Monteverdi (1607), le drame a inspiré de nombreux compositeurs jusqu’à Philip Glass (Orphée, 1991, à partir du film de Cocteau) ou Pascal Dusapin (Passion, 2008) ; le théâtre, la peinture et le cinéma ont aussi illustré le mythe tout comme la poésie, de Tristan L’Hermitte et Apollinaire aux Sonnets à Orphée de Rilke. Ouvrant cette livraison de Rehauts, Patrick Beurard-Valdoye a choisi de traduire un poème de Rilke, un autre de H. D. ; cette fois, c’est le regard d’Eurydice qui occupe les poèmes à propos de la tentative d’Orphée de la sortir des Enfers. Chez Rilke c’est un narrateur qui rapporte la remontée des Enfers et le comportement d’Eurydice : « son état de morte / la satisfaisait », elle semble ne rien attendre, elle marche sur le « chemin qui remontait à la vie » sans penser à qui l’attend, elle avance « le pas contraint par de longs bandeaux de corps / incertaine, placide et sans nulle impatience » ; quand Orphée se retourne et qu’Eurydice doit redescendre vers les Enfers, ces deux vers, repris, terminent le poème. Dans le poème de H. D. (Hilda Doolittle), c’est Eurydice qui raconte l’épisode en s’adressant à Orphée ; il lui aurait ôté la possibilité de regagner la terre « à cause de son arrogance », et c’est ce thème qu’annonce le premier vers du poème, « Donc tu m’as rejetée en arrière / moi qui aurais pu marcher parmi les âmes vives ». Le tort d’Orphée, puisqu’il a perdu Eurydice en se retournant, c’est justement de ne pas l’avoir laissée où elle était (« je t’aurais oublié / et le passé aussi ») puisque, répète-t-elle comme s’il était présent, « l’enfer n’est pas pire que ta terre ». Grand chant lyrique entre nostalgie des fleurs et acceptation du destin, « Au moins ai-je mes fleurs à moi, / et mes pensées aucun dieu / ne peut prendre ça ». On souhaiterait lire les textes originaux avec les deux traductions pour mieux apprécier le passage d’une langue à l’autre, dans le poème de Rilke quand on lit la restitution de tels vers ((« sylve et val / et voie et ville, fleuve et pré et bête ») ou l’emploi d’un mot rare (« nastié ») à propos du sexe d’Eurydice, dans le poème de H. D. pour la restitution du ton véhément et familier d’Eurydice. Les poèmes sont suivis de deux dessins de John Blee, figures abstraites d’Orphée, Eurydice et Hermès.
Il s’agit d’une toute autre mort dans les proses de Jean-Pascal Dubost, "Animaleries, Un bestiaire de la souffrance", la destruction des espèces animales sans même l’"excuse" d’une raison économique, il s’agit aussi de souffrances gratuites pour le plaisir (?) de spectateurs, de leur disparition provoquée par le "progrès" (automobiles, agriculture intensive). Dubost change d’approche dans chacune des dix proses, ce qui fait l’intérêt de la lecture. La première, non ponctuée, comme les suivantes, cite au début un texte du moyen français et, dans la dernière partie, la pratique des sauniers — clouer un goéland mort sur un piquet pour éloigner les oiseaux de leur saline — se justifie selon eux par son ancienneté : « pourquoi croyez-vous que c’est une pratique ancestrale ? » ; on n’oublie pas quelques mots archaïques, les assonances et allitérations « ça (= les déjections) cause trop de gros dégâts graves dégradant les parcelles et le sel de leurs sales selles ».Dans la cinquième prose, les huit courtes séquences s’ouvrent par « Pensée pour », suivi d’une brève description de la violence faite à tel animal : « Pensée pour el toro aux cornes goudronnées paniquant dans les rues d’Espagne c’est un spectacle pyrotechnique dit sanglant wiki ». La huitième prose retient des "performances" fondées sur la souffrance animale ou leur destruction ; après leur description, l’adjectif « heureux » est repris, précédé d’un intensif (« très, plus que, super », etc.) : « (…) follement heureux le chien errant maigre et décharné exposé en galerie jusqu’à sa mort de faim par Habacue (…) ». La prose s’achève avec une allusion à un sonnet de du Bellay (« Heureux qui comme Ulysse… »). Pas de sensiblerie : des variations de la forme pour refuser que « des discours conceptuels objectifient [la mort] c’est de l’art ».
On souhaite, à en lire des extraits, la publication du récit d’Isabelle Sbrissa, "Jmanvè" (= Je m’en vais ; transcription des échanges entre les deux personnages). Il met en scène Lucile, jeune fille qui ramasse sur les chemins des fossiles et des pierres avec selon elle une forme particulière ; elle rencontre Enzel qui voudrait comme elle chercher de petits trésors, « le monde des cailloux forme petit à petit un double au monde des humains ». Enzel part au village voisin pour une fête foraine, prise en route dans le pickup d’un groupe qui acheté une maison pour la rénover avec « la certitude d’inventer un monde nouveau » ; elle a choisi d’être seule, avec le « besoin d’un retrait pour exister avec les autres (…), pour regarder au-dedans d’elle-même. » Le lecteur est curieux de la suivre, qui garde dans sa poche un caillou en forme de cœur, petit cadeau de Lucile, autre personnage énigmatique.
Marie de Quatrebarbes propose plus de jeux avec les formes que de détails météorologiques avec ses "Poèmes de pluie" : 12 strophes de 3 vers pour "Traversée", 8 ensembles de 3+3 vers, "Suite", qui débutent tous par « Débris de cœur sur la plage », 9, 7 et 8 distiques pour "Première giboulée", "Seconde…" et "Troisième…".Il est question dans le premier poème du passé, de l’enfance, de l’absence et d’une disparition — thèmes récurrents ce l’auteure —, mais aussi de la mer, présente également dans le second poème avec des goémoniers une plage, des mouettes. Les giboulées sont liées à la venue du printemps (« mars », « forsythia ») ; la présence de la neige, affirmée dans le premier ensemble, ne l’est plus ensuite (« je ne sais dire au juste / s’il neige ou quoi… », « est-ce que dehors il neige véritablement »). On est dans un monde sans véritable assise, sans rien qui puisse être tenu pour stable, et même réel avec une « lumière grise », le « silence », qui ne semble habité que par des tourterelles, des chenilles et des fleurs.
Il faut reprendre la lecture de Rehauts, pour les poèmes et proses de N. Cendo, B. Dranty et H. Moutrais, aussi pour les longues recensions de Guennadi Aïgui et Muriel Pic par Jacques Lèbre. C’est une des caractéristiques d’une revue d’exclure une lecture continue, on l’abandonne un temps, nourri par un texte, pour y revenir et, à nouveau, y trouver matière à plaisir.
Rehauts, n° 49, 2022, 96 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 février 2023/
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, 2022 | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2022
Rehauts, janvier 2022, n° 48 : recension

Si une revue de poésie a pour but de proposer aux lecteurs des voies/voix contemporaines variées, la dernière livraison de Rehauts répond entièrement à cet objectif : on y lit des poèmes de facture classique, la recherche formelle y a sa place, y compris la poésie orale, la volonté d’être témoin de notre temps voisine avec le choix d’ignorer le présent.
Des poèmes de Pierluigi Cappello (1957-2017), comme l’indique la brève notice biographique, ont déjà été publiés dans la revue Europe mais aucun de ses livres n’a été traduit. Les cinq poèmes en vers libres donnés par Giovanni Angelini ont une unité : poésie qui évoque le village natal (Chiusaforte) et ceux qui y ont vécu, poésie du souvenir de celui qui « porte (...) la grande mémoire / de ceux qui ont peu de choses à raconter », poésie de la nostalgie qui sans cesse rassemble les moments et les gestes du passé, « pour que cela ne s’estompe pas dans la grisaille du soir ». Les extraits d’un livre en cours de Jean-Pierre Chevais sont aussi tournés vers le passé, celui d’un couple en train de se défaire (« que reste-t-il des premiers mots », « que reste-t-il qui soit de vous »). Quatre des strophes de cinq vers de ce long poème empruntent un vers, adapté à la situation, à la Bérénice de Racine, comme : « pourrais-je dire enfin : je ne veux plus vous voir ? », mais la strophe qui clôt l’ensemble reprend un hémistiche de Chimène accompagné d’un commentaire qui prend pour acquise la fin d’une histoire amoureuse, « va, je ne te hais point ! — je me dis ça en douce / pile je pars face je perds, ça s’est terminé ainsi », ce qui donne un caractère emphatique et dérisoire aux emprunts précédents.
Les quatre proses de Patrick Beurard-Valdoye ont chacune pour titre un nom de cours d’eau, "Seine" et "Marne" pour la première et la dernière, où il est question d’Antonin Artaud, "Donau" (nom allemand du Danube) et "Jadro" (nom d’une rivière de Croatie) pour la seconde et la troisième, consacrées à Ivan Illich ; d’autres liens rapprochent les deux écrivains outre leur critique radicale de la société, à commencer par leur naissance au mois de septembre. Mais c’est l’écriture de P. B-V qui fait l’unité de ces proses. Le mot "rose" et la chose, présents dès l’exergue, sont repris de diverses manières dans le texte, y compris par une citation de Rose Ausländer. On reconnaît le plaisir de mêler les langues, avec des fragments en anglais, en espagnol, en allemand, en bulgare (na magareu, « sur l’âne »), celui de citer : Artaud et Illich, mais aussi Saint-Pol-Roux, Cardoso, Celan, William Blake, Silesius, etc. On reconnaît aussi le goût des néologismes, de l’usage des majuscules, celui de désarticuler les mots pour n’en conserver qu’une syllabe ("TEMBRE" pour septembre) ou de réunir des éléments d’un syntagme ("AMOURDULIEU"). Il faut relire ces pages (y compris les notes partie intégrante du texte) extraites d’un livre à paraître, pour les apprécier.
Les poèmes de Benoît Casas, extraits également d’un livre en cours, sont moins déconcertants que, par exemple, Précisions (paru en 2019), ensemble de poèmes écrits à partir d’extraits de centaines d’ouvrages. Mais si les vingt poèmes ne sont pas la traversée d’une bibliothèque, ils sont construits en suivant des règles précises. Sur chaque page, deux poèmes en regard avec des relations entre les motifs ; par exemple, dans l’un d’eux, il s’agit du flux des mots, chacun cédant dans la parole la place au suivant et, en regard, répond l’image du cours d’eau qui déborde. Formellement, pour chaque poème le premier vers est entre crochets, un mot est donné en italique et le dernier en romain gras. Benoît Casas affirme un principe : « [minima]:/ moralia/faire/poèmes/de/tout/faire/poèmes/ de//rien ; il n’empêche que l’on retrouve dans cet échantillon restreint quelques-uns de ses thèmes : la nature, l’écriture notamment.
Le titre "Mes lettres pour la voix" est relativement explicite, le texte est à écouter, ou plutôt à lire à voix haute : ce que fait régulièrement son auteur, Luc Bénazet, accompagné d’un musicien qui improvise. Les énoncés sont désarticulés, ce qui provoque une hésitation continue dans la lecture ; les mots ne sont pas toujours reconnaissables, les lettres les composant n’étant pas à leur place jusqu’à ce que le brouillage cesse, comme dans ce court exemple : « épragé en / &eprarggé / épargné ». Cette poésie sonore est évidemment dérangeante sur le papier, elle est à écouter mais il est bon que le lecteur en ait une trace écrite.
Il reste encore beaucoup à lire dans cette livraison de Rehauts. On s’attachera au récit de Marie Étienne, "Le vieil amant", lui aussi extrait d’un livre à paraître. La narratrice retrouve, donc, un vieil amant, marqué par l’âge, amaigri et malade, de plus devenu maladroit ; ce soir pluvieux, dans l’appartement il trébuche sur le tapis après n’avoir pas su fermer son parapluie ; « gênée pour lui », elle l’entraîne dans un restaurant où, entre deux toux, il ne sait que se plaindre des femmes qu’il a connues. Elle se souvient de son machisme, de sa prétention dans les étreintes, prétention qui l’avait éloigné longtemps de lui. La maladie a raison de ce « vieil amant » et le récit se clôt par son enterrement — elle restant à l’écart pour cacher ses larmes.
On voudrait dire aussi la qualité des proses de Daniel Cabanis, brefs tableaux autour de la vie aujourd’hui dans notre société "libérale", à la limite parfois du fantastique. On lira et relira aussi les poèmes de Patrick Watteau, ceux en prose de Dominique Quélen, les triolets de Daniel Pozner. La lecture critique est présente et la publication semestrielle de la revue n’est pas un inconvénient, les deux auteurs présentés par Jacques Lèbre ne sont pas liés à une quelconque actualité, le Russe Boris Ryh et l’Irlandais Pat Boran.
Rehauts, janvier 2022, n° 48, 96 p., 13 €. Cette recension a été publié par Sitaudis le 3 mars 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, janvier 2022, n° 48, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2020
Rehauts, n° 45, printemps été 2020 : recension

La livraison du numéro de printemps s’ouvre sur un choix de notes d’Antoine Emaz, prises de 1992 à 1996, notes analogues à celles lues dans plusieurs ensembles qu’il avait préparés1. Elles portent donc sur l’écriture, la poésie, la fonction des carnets (« une sorte de puisard »), mais aussi sur les choses de la vie, l’importance de la réalité, visible, sans cesse présente, « Il manque du ciel, pas du bleu, de la profondeur, du ciel ». C’est là une constante dans ses livres, la présence des choses est « un socle », une « certitude » ; mais si un poème ne peut être issu que du fait de vivre, il est aussi « aux prises avec la langue » et, dans tous les recueils de notes, revient le souci de toujours prendre pour matériau la langue commune : Antoine Emaz affirme « L’épaisseur des mots-choses comme tabouret – évier — lino — platane » et la nécessité de travailler cette langue pour parvenir à trouver quelque chose d’équivalent à la musique. Certaines notes, moins nombreuses, concernent sa relation au fait même d’écrire, lié au besoin de maîtriser des peurs, les carnets aidant alors à mettre en forme ce qui, sinon, resterait noué. Ces extraits s’ajoutent aux livres publiés, tous construisent progressivement les principes d’un art de vivre et les éléments d’un art poétique résumé, justement sous ce titre :
ne dire que du vrai
payé comptant
quel que soit l’angle
quelle que soit la débâcle des mots
et travailler ensuite
même le dégoût du vrai
même sa laideur
son insignifiance
On retiendra aussi une définition lapidaire de ce que peut être un poème : « ce qui, écrit, ne correspond à rien », à partir de laquelle on pourrait lire bien des livres contemporains.
La singularité voulue par Antoine Emaz, elle est présente dans les poèmes de Sarah Plimpton, peintre et poète américaine qui a longtemps vécu à Paris. Mathieu Nuss a traduit également cette année un livre de 1976, Ciels singuliers (Single skies) ; on connaissait quelques poèmes publiés par la revue PO&SIE en 2005 (10 poèmes, traduction David Mus) et L’Autre soleil (2008, bilingue, traduction collective). On apprécie la restitution de ces poèmes extraits d’un livre de 2013 (The Every Day) dont le texte original est en regard de la traduction. Presque toujours brefs, aux vers très courts (parfois d’un ou deux mots), ce sont souvent des variations autour de quelques mots — ciel, terre, pierre — associés au mots visage, lumière ; choses du monde vues mais qu’il faut sans cesse recommencer à regarder et à rapprocher les unes des autres, sans cependant chercher une quelconque représentation, ce que suggère peut-être le dernier poème, dés : « une tête secouée / comme dés les mots / jetés / pierres sur la chaussée / à heurter du pied ».
Tout autres sont les trois poèmes en prose de Mathieu Nuss ; le titre de l’ensemble, Aria, implique une continuité, mais elle est difficile à se former, même si l’on passe de chère, ex- pour le titre du premier poème à chère, extrême puis à chère, extrêmement. Certes, on peut écrire en caractères gras « je t’aime », puis « l’élégie » et enfin « chérie-séduire », mais cette mise en valeur est noyée dans un flux de « mots qui parlent beaucoup trop », d’autant plus que la quasi absence de ponctuation accentue le fait que les mots « ne se laissent pas volontiers utiliser » pour que puisse s’exprimer « le concret ».
On souhaiterait lire les quelques poèmes de Fabienne Courtade dans un ensemble pour mieux suivre sa méditation sur le temps, autour de l’enfance et à propos de la vie quotidienne dans la ville, qui se conclut mélancoliquement puisque « Les mondes passent », que « rien ne change ». On attend aussi de lire plus que des extraits d’un livre à paraître de Serge Ritman ; proses et vers se mêlent et sont à dire, comme le plus souvent ses poèmes :
quand je rougis tu ris et nous apprenons
sans savoir à parler dans ta voix
j’ajoute dire bondir
ça traverse coule peinture poème
tout ça nos voix
dans des sens qui courent
le monde en pluralité
Les cinq poèmes d’Henri Droguet2 peuvent, eux, se lire séparément même si un motif les unit. Le premier introduit l’idée de chaos dans le monde avec le Géant Encelade que la déesse Athéna « troua larda planta / perça de part en part » et qui, toujours « souffle s’éreinte s’exténue / secoue sa carcasse écrabouillée » au fond de l’Etna, de sorte que « la terre tremble » ; c’est au bord de ce volcan, « bord des enfers », que selon la légende Empédocle laissa sa sandale avant de s’y jeter. Poèmes du recommencement avec "Saisons", avec la mer puisque avec elle aussi « tout recommence » ; la promeneuse passe et le monde disparaît avec elle, mais il se reconstruit quand un voyageur vient, quant au miroir « mouroir », il ne présente que « reflet de reflet de reflet de / rien mirage et leurre ».
Rehauts propose également des proses de Sami Sahli, des dessins et poèmes de Pascal Pesez, des dessins et proses de Jean-Loup Cornilleau, une prose de Solange Clouvel. Le numéro de printemps se clôt avec une recension du dernier livre de poèmes d’Olivier Barbarant (Un grand instant) par Jacques Lèbre.
1 Antoine Emaz a publié cinq recueils de notes, Lichen lichen (2003), Lichen encore (2009) et Planche (2016) aux éditions Rehauts, Cambouis (Seuil, 2009, Publie-net, 2010) et Cuisine (Publie.net, 2011).
2 Henri Droguet vient de publier Grandeur nature aux éditions Rehauts.
Rehauts n° 45, printemps été 2020, 96 p., 13 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 13 septembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, n° 45, printemps 2020 | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2017
Karl Lubomirski, Le ciel..., dans Rehauts

Le ciel
est un pavot bleu
qui enivre
qui endort.
Le Mystère de la question
du Pourquoi
délie le lien.
Dociles les mains de feu
se posent
sur le corps écailleux du Temps.
Toute âme veut rentrer chez elle
soit rossignol
soit rose
ou pierre
veut être un élément
de la pyramide
des flancs de laquelle
elle a chu.
Karl Lubomirski, traduction de l’allemand Jacques Legrand, dans Rehauts, n° 40, novembre 2017, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl lubomirski, rehauts, jacques lagrand, ciel, mystère, question temps | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2017
Rehauts, n° 39

Connaissez-vous David Constantine ? Poète et nouvelliste, né en 1944, il est aussi traducteur de Hölderlin, Kleist, Brecht, de Michaux et Jaccottet ; on a pu lire en 1992 Sorlingues (La Dogana) dans une belle traduction de Yves Bichet et quelques poèmes, dans la revue en ligne Recours au poème grâce à Delia Morris et André Ughetto. Rien d’autre alors que l’œuvre compte plus d’une dizaine de titres. Rehauts, qui propose toujours en ouverture une traduction, en donne 12 poèmes, traduits par Perrine Chambon et Arnaud Baignot : c’est un choix varié qui va de l’observation d’un nuage et de rêverie devant une photographie au thème de la fenêtre miroir.
Des peintures de Stéphanie Ferrat, dont on connaît par ailleurs les livres poèmes, accompagnent un long poème de Caroline Sagot Duvauroux, "au commencement longtemps déjà" ; on y retrouve, pour le dire vite, ce qu’elle poursuit depuis ses premiers écrits : questionner l’ordre de la langue dans ce qu’il a d’indécidable, d’ambigu et, en même temps, faire que la vie, le visible, soient toujours présents dans l’écriture, jamais comme représentation — on se souvient qu’elle écrivait que « Si la vision était lisible on cesserait d'écrire. »1 :
Un lac vert dans les yeux d’un homme. Deux
barques s’y croisent. Sur l’une, deux meurent de
honte. Sur l’autre, un peuple meurt d’espoir. Un
détroit de silence.
Le numéro publie également des poèmes d’Étienne Faure ; on y reconnaît le ton mélancolique qui affleure dans plusieurs de ses recueils, mais ici sur un motif nouveau : le narrateur se souvient d’un amour perdu. Remémoration du temps passé, de la lecture commune de Trakl, solitude de la vie présente comme dans ce début du premier poème :
Je dors dans un caisson nommé chambre,
suis là-dedans
et meurs tous les jours sous le sceau du secret
puis vais en ville essaimer des paroles,
amorcer la joie toujours après la peine (…)
On voudrait citer encore, au hasard dans ce riche numéro, Max de Carvalho ou les alexandrins rimés de William Cliff, qui poursuit l’exploration de son enfance, les poèmes de Stéphane Korvin et ceux de Bruno Grégoire, les souvenirs de Jacques Josse. On lira aussi les notes de lecture de Jacques Lèbre ; la première est consacrée au très beau livre d’Antoine Emaz, Limite (Tarabuste, 2016) la seconde permet de découvrir le poète danois Soren Ulrik Thomsen, traduit par Pierre Grouix (Les arbres ne rêvent sans doute pas de moi, Cheyne, 2016).
- dans Le livre d’El, d’où (Corti, 2012).
Rehauts, n° 39, mars 2017, 112 p., 13 €.
Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 5 mai 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, n°39, david constantine, stéphanie ferret, sagot duvauroux | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2017
David Constantine, Gare d'Oxford, 15 février 1997
Gare d’Oxford, 15 février 1997
Et puis tout s’arrêta, tout devint très calme.
Je regardais plein nord un petit nuage dans le ciel bleu
Un ciel bleu vers lequel s’éloignaient les rails.
Un bleu, si sereinement bleu, qu’il me troubla
Comme quelque chose d’inimaginable que je pouvais voir
Et pour lequel je n’avais pas de mot, je regardai le nuage
Un seul nuage blanc dans ce ciel sereinement vide
Léger comme une plume au bord des lèvres
Pour tester le souffle, ultime preuve de la vie.
David Constantine, dans Rehauts, n° 39, mars 2017, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david constantine, gare d'oxford, rehauts, nuage, bleu, ciel, vide, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2016
Jean-Pierre Chevais, Sans titre, dans Rehauts n° 36, automne 2015

Sans titre
on fait la pause on a eu en partant un sandwich mais on est deux ils n’ont pas dit ce qu’il y avait dedans on fait quand même la pause
on a fini la pause on n’a plus rien à faire, on en aurait eu un chacun on serait encore à s’occuper pas longtemps mais un peu
on fait une deuxième fois la pause on n’a en partant rien eu d’autre on hésite à poursuivre on va quand même le faire
en rentrant de la pause on a trouvé dans la cour un sandwich il était pas trop abîmé mais on est deux on l’a pas ramassé
ils nous cachent quelque chose on va rentrer de la pause un peu plus tard peut-être qu’ils ont besoin d’un peu de temps c’est tout
la fois suivante on n’a pas eu le temps de rentrer ils ont demandé pourquoi qu’est-ce qu’on en sait et même si on savait
[...]
Jean-Pierre Chevais, ‘’Sans titre », dans Rehauts, n° 36, automne 2015, p. 47-48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, sans titre, sandwich, travail, énigme, rehauts | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2015
Carol Snow (née en 1949), Pour, dans Rehauts

Postures du corps VI
Voulant non seulement l’immobilité des collines
mais une médiation — comme un regain
sur les collines — mur
de silence au-dessus des collines. Moore sculpte une figure
massive en marbre noir : un corps
de femme, couchée, courbée ; une éloquence
d’os, de coquillage,
pierres portées par-delà la contradiction.
Tu t’es arrêtée
au bord de la route, étalement
de collines à mi-distance, quelques maisons. Seules les vertes
étendues du vignoble dans l’entre-deux
semblaient accessibles, c’est-à-dire humaines — question
d’échelle : silence imposant, tel que seules
les collines (également
imposantes) pouvaient reposer.
Cézanne, penché sur sa toile, aurait maîtrisé
cette vue, penses-tu : les bleus et les verts
et les ocres du proche et du lointain, cette posture
précaire de la danse, non le dessin qui unit
le dissemblable, par exemple les corps, mais le maintien
séparé du corps et du terrain, tu étais si
figée, tu pensais que tu pourrais devenir ces collines,
ou bien être née de ces collines
ou bien ton corps
aurait été un modèle pour ces collines.
Carol Snow, Pour, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès,
p. 3-4.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, rehauts, maïtreyi et nicolas pesquès, collines, corps, femme, cézanne | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2015
Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts
Comment fonctionne le théâtre, c’est la question dès qu’on entre dans le paysage d’une station, l’été balnéaire, au bord du débordement, puis vide l’hiver de toute âme, vacance qui accentue le décor de plage : vieux ressac, débris de fioles, de jouets, de sandales monoparentales, de raquettes, de râteaux, de sacs en plastique, tout un fourbi détaché des corps hier étalés sur le sable — sur le dos sur le ventre — criant ne t’éloigne pas trop.
Nous sommes dans la mémoire crois-tu entendre quand c’est la baignoire du théâtre qui t’accueille. On y écoute d’une seule oreille d’anciens acteurs de sable, les morts dans un coquillage. Tu parles.
Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, souvenirs souvenirs, rehauts, plage, hiver, oubli, théâtre | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2015
Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts

Photo H. Lagarde
l’eau
même froide
troue la neige lors
qu’elle y tombe je film
e la bassine d’eau chaude
qu’on jette sur un sol de ne
ige toute fraîche à peine tom
bée devant la maison je film
e son délire impressionniste, son éloqu
ence muette, son grabuge blanc, je pense
à Degas comme étant le mieux
placé non pour le peindre
mais pour s’en délecter
sans limite et sans
restriction dans le
blanc jusqu’aux confins
de la peinture qu’il n’en fait pas
Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts, n° 35,
printemps 2015, p. 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile mainardi, poèmes à la coque, rehauts, eau, neige, degas, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2015
James Sacré, Cherchet-on le père qu'on a eu ?, dans Rehauts

Juste après qu’on a dépassé Carcassonne
Venant de Montpellier
On entre comme dans les couleurs que sont
Les toiles de Bentajou, visage rouges
En bord de labours ocre rose ou marron
Ou leurs feuillages morts
Avec des traces de verdure. Bentajou
A tiré de cela des figures comme il dit
Qui sont et ne sont pas ces paysages
Mais ce qui est venu
Quand il a mis du temps et ses mains
À l’épreuve de la couleur, oubliant peut-être
Ou se perdant. Pourrait-on pas dire
Que toi mon père te relevant
En bout d’un arpent de vigne, en Vendée
Tu n’étais plus
Que tremblement de formes et de couleurs
Dans la longueur de ton travail paysan ?
James Sacré, Cherche-t-on le père qu’on a eu ?, dans Rehauts, n°34, automne 2014, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, cherchet-on le père qu'on a eu ?, rehauts, bentajou, vendée, vigne, paysan | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2014
Jean-Baptiste Para, Laromira

Laromira
Pardonne-moi si je te dis à l'oreille des choses tristes
Quand j'entends le bruit de mes pas dans mes os
Un silence m'a sauvée du mot
Un autre silence sauvera le mot
Et le vent sera ma demeure
J'ai vu nager les étoiles et j'ai vu les beaux reins du lièvre
J'ai appris qu'en allant de rivière en rivière
Rien n'était véritablement loin
J'ai longtemps tourné une bague à mon doigt
J'ai appris que l'on pensait autrement dans le froid
Et le vent sera ma demeure
Il pouvait neiger dans toute l'étendue de mes veines
La patience était en moi comme le pain sur la table
Mes pouces façonnaient des visages d'argile
De la main gauche je savais aérer le lait
Il y avait dans mes yeux un peu d'ambre
Un peu de vert de nos marais
Et le vent sera ma demeure
Comme le merle et l'abeille sauvage
J'étais l'amie du sureau noir
J'aimais la nonchalante fierté
Des hommes et des tournesols
Le rire où rebondit
La petite perle d'un collier défait
Et le vent sera ma demeure
[...
Jean-Baptiste Para, Laromira dans Rehauts, n°32,
second semestre 2013, p. 39-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, laromira, rehauts, vent, demeure, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2013
Antoine Emaz, "Planche", dans Rehauts, n° 31, avril 2013

Planche
Il n'y a pas vraiment de morale de vivre, sauf vivre, et quelques principes que chacun invente, rabote, bricole au fil des années. La vie n'est ni simple ni compliquée, elle est alternativement facile et chaotique, et souvent bêtement neutre.
Seul dans la maison, je ne suis pas seul. Je suis avec la maison
Il y a ces moments de vie où le temps rattrape, prend au collet, étrangle. Dans le même instant, on voit ce qu'on a misérablement gagné, et puis tout ce qu'on a perdu. On ne peut plus faire machine arrière, il n'y a plus de route. On ne peut pas rejouer ; les cartes sur table ont disparu et celles que l'on a encore en main laissent peu de chance. Au mieux, dans ces moments, on devient sage ; au pire, on devient méchant.
La poésie n'est pas plus issue qu'impasse, elle est. Tout comme, selon les moments, une fenêtre est ouverte ou fermée.
Poésie lichen. Par les temps qui courent, je ne vois aucune honte à considérer que le seul but est de persister. Il faut mesurer l'ambition à l'aune de ce qui est possible., et poser clairement le choix d'une résistance durable plutôt qu'un combat sans doute glorieux mais suicidaire, dans une avant-garde qui combat des moulins ou une arrière-garde qui sonne de l'olifant.
Vieillissement lent des choses : portes, fenêtres... La peinture s'écaille, le gris et le moisi s'installent. Et il y a vieillissement parallèle de mon côté : nettement moins d'allant pour me lancer dans un chantier de bricolage. Et je ne peux plus compter sur l'aide de mes filles. Vrai aussi qu'avec le temps je renâcle de plus en plus à me dire que je vais passer la journée à peindre un volet, comme s'il était toujours plus urgent d'être à la table. Évolution lente du corps et du comportement. On constate le glissement sur une longue période, avec le recul, pas au jour le jour.
Le doute forme le fond de la conscience créatrice. Même l'accord de l'éditeur ou l'adhésion enthousiaste d'un lecteur ne parviennent pas à lever cette interrogation sur la valeur du travail, ou bien, partielle mais tout aussi tenaillante, cette question : est-ce que je n'aurais pas pu aller plus loin ?
Antoine Emaz, "Planche", dans Rehauts, n° 31, avril 2013, p. 27, 28, 28, 30, 31, 34, 36.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, "planche", rehauts, vivre, vieillir, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |







