04/12/2025
Jean-Pierre Schlunegger, Feu de grève

Écriture
Pipe éteinte gueule de nuit sur la table
Objets dissous à peine formulés
Comme une rivière
Tout l’infini des rêves
Vides de sens
Des trous dans l’air
Monde crapaud
En mal de disparaître
Où les objets
Se meurent séparés
Halo tueur
La lampe rit
Blancheur de linge
Et sur la plage
Les mots suffoquent
Leurs pattes noires
Tremblent encore
Semblant de vie
À peine éclose
Ici mes mains
Là le reflet de mon visage
Surnagent mollement
Dans le pâle décor
En moi le même avortement d’images
Jean-Pierre Sclunegger, Feu de grève dans
La revue de belles-lettres, II, 2025, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre schlunegger, feu de grève, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Nous avons tant écrit
les pierres s’ouvrent, sans retour sur le chemin
les voix des bêtes couvent,
petits feux dans des lieux sans carte
et les étoiles tissent l’espace
hors de nous.
Nous avons trop écrit peut-être
les mots sont plus lourds que des pierres
nous les lançons avec le fol espoir
qu’ils deviennent flamme, éclair, oiseau.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski,
Arfuyen, 2025, p. 128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevsk, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2025
Octavio Paz, Salamandre

Intérieur
Pensées en guerre
veulent briser mon front
Par des chemins d’oiseaux
avance l’écriture
La main pense à voix haute
le mot en convie un autre
Sur la feuille où j’écris
vont et viennent les êtres que je vois
Le livre et le cahier
replient les ailes et reposent
On a déjà allumé les lampes
comme un lit l’heure s’ouvre et se ferme
Les bas rouges et le visage clair
vous entrez toi et la nuit
Octavio Paz, Salamandre, dans Œuvres,
éditionJean-Claude Masson, Pléiade/Gallimard,
2008, p. 241.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, salamandre, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2025
Kafka, Journal

Le voisin fait pendant des heures la conversation à la logeuse. Tous les deux parlent bas, la logeuse est presque inaudible, ce n’en est que plus énervant. J’ai interrompu l’écriture qui était repartie depuis deux jours, qui sait pour combien de temps. Désespoir pur. En est-il ainsi dans chaque logement ? Une telle détresse ridicule et nécessairement mortelle m’attend-elle chez chaque logeuse, dans chaque ville ? (…) Mais cela n’a pas de sens de désespérer immédiatement, plutôt chercher des moyens d’action, si fortement que — non cela ne va pas contre mon caractère, il y a encore un reste de judaïsme coriace en moi mais voilà, le plus souvent il aide la partie adverse.
Kafka, Journal, traduction Robert Kahn, 2020, NOUS, p. 745.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journal, écriture, désespoir | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2025
Kafka Journal

Ce sentiment de fausseté que j’ai en écrivant pourrait être représenté par cette image : quelqu’un attendrait devant deux trous creusés dans le sol une apparition qui ne doit surgir que de côté droit. Mais alors que justement ce trou-là reste obstrué par une paroi assez opaque, une apparition après l’autre sort du côté gauche, cherche à attirer le regard sur soi et finit par y parvenir sans effort grâce à une ampleur croissante, qui finit même par recouvrir la bonne ouverture, quel que soit le moyen de défense pour empêcher cela. Mais voilà, si on ne veut pas quitter cette place — et cela on ne le veut à aucun prix — on doit s’accommoder de ces apparitions, qui pourtant, en raison de leur fugacité — leur force s’épuise dans le fait même d’apparaître — ne peuvent suffire, mais, quand par faiblesse, elles s’arrêtent, on les disperse vers le haut et dans toutes les directions, juste pour en susciter d’autres, parce que leur vision prolongée vous est insupportable et aussi parce que l’espoir subsiste qu’après épuisement des fausses apparitions les vraies pourront enfin surgir.
Kafka, Journal (27/12/1911), traduction Robert Kahn, éditions NOUS, 2020, p. 281.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journal, écriture, apparition | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice

(...) Je répugne absolument à parler. Du reste ce que je dis est faux à mon sens. A mes yeux la parole ôte à tout ce que je dis importance et sérieux. Il me semble qu’il ne peut en être autrement, étant donné que mille choses et mille pressions extérieures ne cessent d’influencer le discours. Je suis donc taciturne par nécessité, mais aussi par conviction. L’écriture est la seule forme d’expression qui me convienne.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 511.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, parole, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2024
Claude Chambard, Cet être devant soi

Le crayon est le chemin par lequel je peux parcourir le monde. Il me faut y arriver vivant. Ce n’est pas une mince affaire. J’ai toujours pensé que, dans le livre, le monde ne pouvait être vu qu’à hauteur d’enfance. L’écriture commence & prend fin dans une classe du cours préparatoire, pour toute la vie & pour tous les livres, dans toutes les bibliothèques. De même la lecture. Manipulations, transgressions, interprétations, variations — archaïques. Encre violette & papier réglé à grandes marges, encrier en porcelaine, plumes Sergent Major, buvards publicitaires… Apprendre à dessiner — les caractères apprendre à dessiner - les traits portraits &c - lisibilité, blanc, équilibre, approche, classe, ce qu’on ne voit pas permet ce que l’on perçoit - comme on oublie la ponctuation lorsqu’elle est juste, lorsqu’elle va de soi la lecture va de soi — l’écriture jamais. Ton corps est dans le livre, personne ne le voit, même pas moi, mais je le reconnais, aussi les oiseaux dans le ciel & le corps des écrivains dans leur écriture.
Claude Chambard, Cet être devant soi, Æncrages, 2012, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être devant soi, écriture, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2023
Edoardo Sanguineti, Codicille

je fais de l’écriture, et ne suis pas écriture :
reste le fait tout de même, que je fais des étincelles
(avec le feu et les flammes) : (je fais l’amour, et je te fais pitié) : (et j’ai fait les sept
rêves) : (et je fais le joyeux, et je ne le suis pas)) : (et je fais la tête que tu me vois) :
(je la fais longue et grosse, et cuite et crue) : (j’ai les yeux plus gros que le ventre) :
(je fais le bras de fer, je montre mes muscles) : (et je vais me faire voir et foutre) :
(m’occuper de mes oignons, de mes affaires) : (j’en fais pour trois, à moi tout seul : pour ainsi dire) :
(et pour faire et défaire) : (je me mets en quatre, en cent, et je sais y faire) : (et
enfin j’y mets fin) : n’étant pas écriture, donc, en attendant,
je garde en tête la similitude :
(et ainsi je la transmets à ce papier) :
Edoardo Sanguineti, Codicille, traduction Patrizia Atzei et Benoît Casas, éditions NOUS, 2023, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguineti, codicille, vivre, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2022
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent

les lignes indéfiniment se poursuivent
mais les lignes transversales — les branches des arbres qui passent au-dessus des murs, les rivières qui courent au-dessous des ponts, les ronces qui vont partout comme les bêtes à quatre pattes, les oiseaux qui sillonnent le ciel bas tout à leur aise, les nuages, les éclaboussures, les brises — ne nous ont pas encore traversée, elles continuent prises dans leur élan de s’éloigner, vers l’ubac et vers l’adret
si l’image de l’éléphant, si les sonorités du piano nous ont éloignée transversalement de notre route bordée de murs longs et étroits, au moins aurons-nous écrit, au moins cette durée vaine de vie aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée, qui nous semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite nous n’avons fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, nous nous sommes résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire
[...]
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, dans la revue de belles-lettres, 2022, I, p.77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, lignes, écriture, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2022
Pierre Vinclair, L'Éducation géographique

Je vois deux stratégies d’écriture : tenter,
vénérant la littérature, une Aufhebung
dans un livre total dont quelque qualité
littéraire (arrêtée par un secret
décret de qui ?) traduira quoi ? l’admiration
plutôt que le salut dont nous aurions besoin,
en dédommagement des quinze années perdues
à donner une forme à ce machin ;
ou plus modestement, passer quelques minutes
à écrire un sonnet sans plus de raison d’être
qu’un pensum affranchi par sa musique,
amusé, amusant avant de regagner
le cimetière des ratés prétentieux
qu’on vénère au rayon littérature.
Pierre Vinclair, L’édiucation géographique, Flammarion, 2022, p. 253.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, l’édiucation géographique, sonnet, écriture, raté | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2022
Pierre Vinclair, L'Éducation géographique
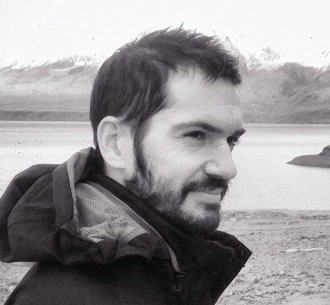
je vois deux stratégies d’écriture : tenter
vénérant la littérature, une Aufhebung
dans un livre total dont quelque qualité
littéraire (arrêtée par un secret
décret de qui ?) produira quoi ? l’admiration
plutôt que le salut dont nous aurions besoin,
un dédommagement des quinze années perdues
à donner une forme à ce machin ;
ou plus modestement, passer quelques minutes
à écrire un sonnet sans plus de raison d’être
qu’un pensum affranchi par sa musique,
amusé, amusant avant de regagner
le cimetière des ratés prétentieux
qu’on vénère au rayon littérature.
Pierre Vinclair, L’Éducation géographique, Flammarion, 2022, p. 253.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, l’Éducation géographique, écriture, littérature, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
16/07/2021
James Sacré, Broussaille de bleus

Fontaine de mémoire
Une fontaine fait son bruit de fontaine
Donne son eau claire
Au silence des buissons, on ne sait plus
Si le jour est grand bleu ou larges avancées de nuées
Tout s’efface ou brille un peu
Parmi des débris de mémoire.
Des pays traversés s’emmêlent
En quelques mots familiers qui furent
Ceux donnés par une enfance oubliée.
Quels paysages reviendraient dans le courant d’une écriture ?
Un poème fait son bruit de poème, son bruit de poème.
James Sacré, Broussaille de bleus, dessins de Jacques Barral, Le Réalgar, 2021, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, fontaine de mémoire, enfance, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2020
Virginia Woolf, Journal d'adolescence, 1897-1909

Samedi 13 mai [1905]
Un silence aussi inquiétant signifie— comme je l’ai reconnu précédemment — que ce Journal se dirige vers une mort prématurée. C’est une entreprise impossible : noircir tous les jours une page supplémentaire, alors que j’ai écrit tellement par nécessité, me casse les pieds & ce que je raconte est sans intérêt.
Mercredi 31 mai
Nous allons solennellement renoncer à ce Journal à présent que nous arrivons à la fin du mois & que, par bonheur, ce cahier n’a plus de pages — car elles seraient restées vierges.
Un exercice comme celui-ci n’est concevable que s’il émane d’une volonté & que les mots viennent spontanément. L’écriture directe est un travail — pourquoi, se demande-t-on, s’ infliger pareil châtiment ? Les bienfaits s’annulent. Mais ce genre de réflexion n’a point lieu d’être. Ces quelques 6 mois trouvent ici une espèce de miroir d’eux-mêmes ; de l’image reflétée, on tire un enseignement ou un plaisir.
Virginia Woolf, Journal d’adolescence, 1897-1909, traduction Marie-Ange Dutartre, Stock, 1993, p. 426.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d’adolescence, 1897-1909, écriture, page | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2019
Maurice Blanchot, La bête de Lascaux
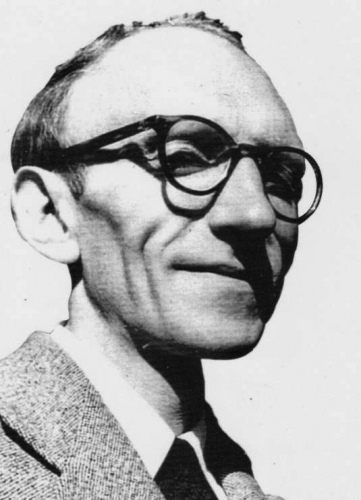
Parole écrite : parole morte, parole de l’oubli. Cette extrême méfiance pour l’écriture, partagée encore par Platon, montre quel doute a pu faire naître, quel problème susciter l’usage nouveau de la communication écrite : qu’est-ce que cette parole qui n’a pas derrière elle la caution personnelle d’un homme vrai et soucieux de vérité ? L’humanisme déjà tardif de Socrate se trouve ici à égale distance de deux mondes qu’il ne méconnaît pas, qu’il refuse par un choix vigoureux. D’un côté, le savoir impersonnel du livre qui ne demande pas à être garanti par la pensée d’un seul, laquelle n’est jamais vraie, car elle ne peut se faire vérité que dans le monde de tous et par l’avènement même de ce monde. Un tel savoir est lié au développement de la technique sous toutes les formes et il fait de la parole, de l’écriture, une technique.
Maurice Blanchot, La bête de Lascaux, Fata Morgana, 1982, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, la bête de lascaux, écriture, oubli, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2019
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Je n’écris pas trop mal, parce que je ne me risque jamais.
Il a du talent ou n’en a pas selon qu’on est bien ou mal avec lui. Tout n’est que sympathie ou antipathie.
Brute : pas de cervelle, du cervelas.
Il a perdu une jambe en 70 : il a gardé l’autre pour la prochaine guerre.
Un rhume de cerveau fait bien plus souffrir qu’une idée.
Jules Renard, Journal 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1018, 1018, 1018, 1023,1018, 1025.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910, écriture, talent, humour | ![]() Facebook |
Facebook |





