02/09/2016
Laurent Mauvignier, Ce que j'appelle oubli

et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière que le type aura gardé assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l’accuser de volet et se vanter, après, de l’avoir repéré et choisi parmi les autres, là, qui font leurs courses, le temps pour lui d’essayer — c’est ça, qu’il essaie de courir vers les caisses ou tente un geste pour leur résister, parce qu’il pourrait comprendre alors ce que peuvent les vigiles, ce qu’ils savent, et même en baissant les yeux et en accélérant le pas, s’il décide de chercher le salut en marchant très vite, sans céder à la panique ni à la fuite, le souffle retenu, les dents serrées, un mouvement, ce qu’il a fait, non pas tenter de nier lorsqu’il les a vus arriver vers lui et qu’ils se sont, je ne dirais pas abattus sur lui, parce qu’ils étaient lents et calmes et qu’ils n’ont pas du tout fondu comme l’auraient fait, disons, des oiseaux de proie, non, pas du tout, au contraire, ils se sont arrêtés devant lui et c’était très silencieux […]
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, éditions de Minuit, 2013, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent mauvignier, ce que j’appelle oubli, vol, vante de bière, vigile | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2016
Paul de Roux, Poèmes des saisons
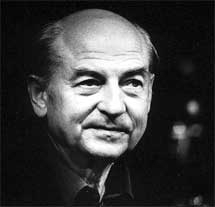
En hommage à Paul de Roux, décédé dans la nuit du 27 au 28 août
D’où viens-tu, Été qui n’est plus là quand même
ce serait ta saison, et qui soudain nous effleures et nous gagnes ?
toi qui te vêts des plus lourds, des plus fastueux atours,
des feuilles les plus larges et des denses poussières, Été
à la trop courte nuit, renversant villes et campagnes
sous des ciels où s’effrite longuement la lumière, nuit
inventant des labyrinthes pour ses amants,
levant des futaies pour de blanches larmes de lune, et toi
oublié ou absent, soudain
faisant mentir le poids des jours, l’effluve
du tilleul chevauchant une imperceptible brise
serait ta résidence parmi nous ?
Paul de Roux, Poèmes des saisons, dessins de Gabrielle
de Roux, le temps qu’il fait, 1989, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, poèmes des saisons, été, nuit, labyrinthe, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
31/08/2016
Raymond Queneau, Fendre les flots
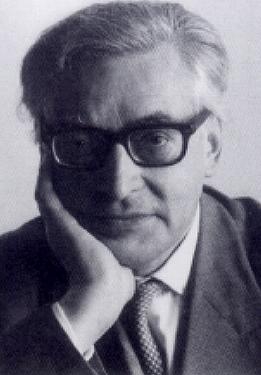
La sirène éliminable
Je ne sais qui chantonne à l’ombre du balcon
c’est un chant de sirène ou bien de vieux croûton
il faudra que j’y aille afin de voir si je
me suis trompé ou bien si j’ai mis dans le mille
si c’est un vieux croûton je le pousse du pied
doucement dans le ruisseau pour qu’il vogue et qu’il
aille vers la mer où il sera libéré
des balais éboueux des tracas de la ville
si c’est une sirène alors serai surpris
je lui dirai madame un tel chant m’exaspère
vous avez une voix qui ne me charme guère
elle me répond : monsieur j’ai eu un prix
au conservatoire autrefois dans ma jeunesse
donnez au moins l’aumône au titre de noblesse
Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,
1969, p. 98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, sirène, chant, voix, jeunesse, charme | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2016
Raymond Queneau, Courir les rues

Zoo familier
Chats pigeons chevaux perruches
quelques moustiques quelques mouches
les ânes les chèvres les poneys
des champs de Mars ou Élysées
des singes et des perroquets
parfois même des araignées
chiens de race ou simples roquets
dans leurs vases des poissons rouges
dans leurs toisons les pauvres pous [sic]
raee qui tend à disparaître
les cancrelats et les punaises
les merles les corbeaux les pies
les très peu nombreux ouistitis
les mulots les rats les souris
le perce-oreille issant du fruit
mille-pattes et charançons
sur les faces des comédons
les urus dans les mots croisés
quelques vers dans les framboises
de rares aigles
dans sa cage chante un serin
et puis des humains
et puis des humains
Raymond Queneau, Courir les rues,
Gallimard, 1967, p. 110-111.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queanu, courir les rues, zoo, humains | ![]() Facebook |
Facebook |
29/08/2016
Raymond Queneau, Battre la campagne

Le repos du berger
Y a-t-il un obstacle
à la poursuite du vent ?
Y a-t-il obstruction
à ce que volent les mots ?
Y aura-t-il empêchements
à la pose des inscriptions ?
le vieillard berger sonore
hurle et crie dans la vallée
que l’écho redise encore
les injures ondulées
en a-t-il donc à la pierre ?
aux arbres ? aux rus ? aux serpents ?
aux sucs de la bonne terre ?
aux herbes tout envahissant
mais ce ne sont plus des injures
car le vent en les emportant
les sasse et les voilà pures
les phonèmes du dément
les mots caressent donc la pierre
les arbres les rus les serpents
les sucs de la bonne terre
les herbes tout envahissant
et le berger devenu sourd
à sa propre injustice
s’étend pour enfin dormir
dans le silence enfin complice
Raymond Queneau, Battre la campagne,
Gallimard, 1965, p . 140-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, battre la campagne, le berger, injure, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
28/08/2016
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute

Savoir Être une femme
Psychologie féminine — Psychologie des femmes
Comment doit être une femme (Physiquement et moralement) pour…
Vidéos correspondant à comment être une femme
Comment (re)devenir 1 femme ?
Évidence : comment être un homme, comment être une femme
Comment être la femme qu’ils aiment — Love — Intelligence ?
« J’ai décidé de devenir une femme » — Agora Vox, le média citoyen
Comment être la femme parfaite — Questions/réponses ?
Comment être une femme au travail ?
Comment être une femme fontaine ?
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine, 2014, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, être une femme | ![]() Facebook |
Facebook |
27/08/2016
Johannes Bobrowski, Terres d'ombres fleuves
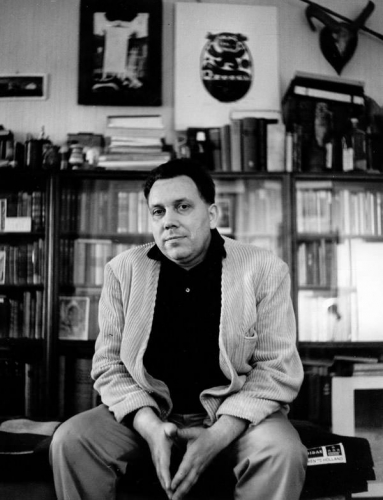
Le mont des Juifs
Voyage d’araignée,
blanc, la terre se répandait en poussière
de sable rougeâtre — forêt,
comme chevelure de tresses, cri d’animal,
lui heurtait la joue, herbe
piquait ses tempes.
Tard, lorsque le grand duc, bruissement
de cent nuits, traversait
le sommeil des genêts,
il se levait dans le hallier frémissant
des grillons pour voir un
blême chemin de lune qui montait
dans l’entrelacs des racines.
Il regardait par-delà le marécage.
Abrupt, indistinct, un reflet de lumière
le frôlait de son vol, le temps de ce
battement de cœur une sauvage
empaumure émergea des ténèbres,
hérissée, tête larmoyante.
Pressé entre les mains
le temps, non nommé : les essaims
qui, jaunes, suivaient
Curragh, nuées grondantes
au-dessus du lac, les abeilles
suivaient le pieux père,
il remuait les rames, il disait :
Je serai un mort dans la verte vallée.
Der Judenberg
Spinnenreise
weiß, mit rötlichem Sand
stäubte die Erde — Wald,
flechtenhaarig, Tierschrei,
stieß um die Wange ihm, Gras
stach seine Schläfe.
Spät, wenn der Uhu, Sausen
aus hundert Nächten, umherstrich
durch den Schlaf der Geniste,
hob er sich in der Grillen
Schwirrgesträuch, einen fahlen
Mondweg zu sehn, der heraufkam
an die seufzende Eiche, die Greisin, in ihrem
Wurzelgeflecht verging.
Über das Bruch sah er hin.
Jäh, undeutbar, Lichtschein
flog vorüber, diesen
Herzschlag lang ragte wüstes
Schaufelgeweih aus der Finsternis,
zottig, ein tränendes Haupt.
Unter die Hände gepreßt
Zet, unbenannt: die Schwärme,
gelb, die dem Curragh
folgten, tönende Wolken
über der See, die Bienen
folgten dem frommen Vater,
er rührte die Ruder, et sagte :
Ich werde tot sein im grünen Tal.
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,
traduit de l’allemand par Jean-Claude
Schneider, Atelier La Feugraie, 2005, p. 84-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d'ombres fleuves, le mont des juifs | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2016
Michel Butor, Histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire
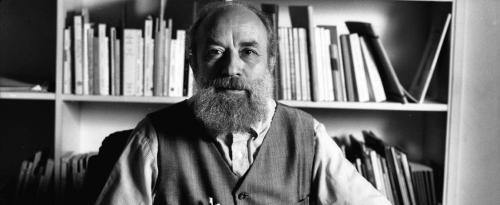
(en hommage à Michel Butor)
L’érotisme et la poésie
Dans les Paradis artificiels, Baudelaire tentera d emmener à la poésie en défendant les drogues contre la morale bourgeoise, pour les condamner ensuite en tant que substituts précaires et dangereux de cette drogue absolue qu’est la poésie, « seul miracle dont Dieu nous ait octroyé la licence ». Nous voyons ici se dessiner dans sa pensée une autre apologie qui prendrait un point de départ dont la « tentation » est plus universelle encore, entouré d’une aura de scandale plus vive : il mènerait à la poésie en se servant de l’érotisme comme appât, et comme figure à dépasser.
Dans cette perspective, le Choix de maximes consolantes sur l »amour, paru en mars 1846 dans le Corsaire-Satan, l’une des premières publications de notre auteur, texte encore marqué de frivolité journalistique, tiendrait une place comparable à celle de l’essai de 1851, Du vin et du haschisch comparés comme moyens de multiplier l’individualité.
Une des notes de Mon cœur mis à nu amorce le développement que je suggère :
« Plus l’homme cultive les arts, moins il bande.
Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l’esprit et la brute.
La brute seule bande bien, et la fouterie est le lyrisme du peuple. »
La « fouterie » se présente comme ersatz et reflet inférieur de l’acte poétique.
Michel Butor, Histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire, Gallimard, 1961, p. 70-71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel butor, histoire extraordinaire, essai sur un rêve de baudelaire, érotisme, drogue, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/08/2016
Lisa Robertson, Le temps
Vendredi

Vendredi
Nous nous reposons sur la cité ou de l’eau et des formes simulées dans un beau soir après les averses le ciel plein de spécimens de formes bizarres. Cette image présente le commencement d’une brume du soir. Nous nous reposons sur des événements violents ou des enchaînements d’incidents ou d’onguents de maquillage de pollen l’ornement mobile après le fait est entré montrant tapageur vigoureux et humide. De la partie du ciel une masse nuageuse. Nous nous reposons sur le spectacle chtonien prodigieux ou sur l’imbroglio satisfaisant dans l’inachèvement comme dans les brumes basses et rampantes. L’image est après les averses. Elle signifie célèbre éclatant et beau. Dans une belle soirée d’été. Tacite. Après les averses. […]
Lisa Robertson, Le temps, traduction de l’anglais (Canada) par Éric Suchère, NOUS, 2016, p. 52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa robertson, le temps, ciel, nuage, averse | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2016
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute
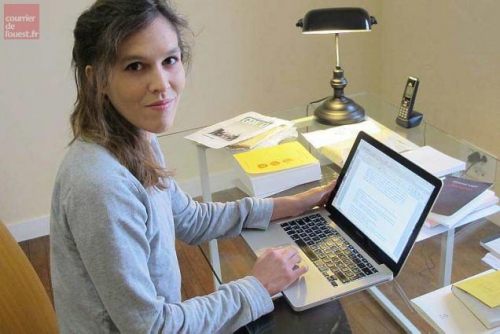
Café de la paix. Ici, tout va bien
le goût de rien, l’épée rentrée dans le thorax
j’ai la lèpre. Mais si, je vous jure : j’ai la lèpre
au point du jour, à point fermé le dimanche
je dors sous l’étendard, fait chaud là-dessous
Mon sommeil me murmure
« les mots sont importants »
on en discute avec les morts
jusqu’ici, tout va bien
Qu’es-ce que vous prendrez Mademoiselle ?
la nature est docile
cette façon délicate d’être soi-même
attentive aux gestes du détail
Je vis en rythmes économes
compte et recompte les boutons tombés du peignoir
j’ai été cette petite fille solitaire
la garder encore un peu près de moi
être pour elle la porte ouverte du château
enfermer ma jeunesse dans son cœur
une fois si vieille, peut-être
les retrouvailles rebattues
elles commencent ici pour nous
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute,
Lanskine, 2014, p. 64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, tout va bien, enfance, nostalgie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2016
Antonin Artaud, L'arbre
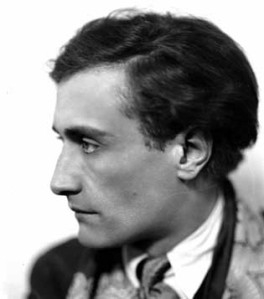
L’arbre
Cet arbre et son frémissement
forêt sombre d’appels,
de cris,
mange le cœur obscur de la nuit.
Vinaigre et lait, le ciel, la mer,
la masse épaisse du firmament,
tout conspire à ce tremblement,
qui gîte au cœur épais de l’ombre.
Un cœur qui crève, un astre dur
Qui se dédouble et fuse au ciel,
Le ciel limpide qui se fend
A l’appel du soleil sonnant,
Font le même bruit, font le même bruit,
Que la nuit et l’arbre au centre du vent.
Antonin Artaud, Œuvres complètes, I, *,
Gallimard, 1976, p. 254.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/08/2016
Ana Tot, Méca
qu’ils crèvent les artistes. Qu’ils crèvent les poètes. Que crèvent toutes les confréries, les confraternités, les corps abstraits et les conglomérats. Qu’ils crèvent comme crèvent les autres, les sans–étiquette, les animaux, les chiens, les hommes, les femmes, les corps, la chair, les plaisirs et les joies. Il n’y a pas de raisons, je n’en vois aucune, pour que les catégories survivent aux catégorisés, les voix aux sans voix, les grades aux sans grade, tous crevards, chacun perdant son souffle dans la déliquescence de ses tuyauteries, éponges, pompes, fibres et robinetteries propres. Qu’ils crèvent les égos, tous égos ! réunis, confits dans leurs conflits, dans leurs affinités subies. Que vivent les singularités irréductibles, les accidentés, les infirmités, les moignons sans but, les ulcères désintéressés, les tumeurs et les tares. Que crèvent les idées, les sottises, l’Intelligence et l’Esprit, les Lettres, l’Art, le Sport et la Poésie. Qu’ils crèvent. […] Que crève ce programme, si c’en est un, qu’il crève puisqu’il en est, qu’il crève avant d’être dit, avant d’être et d’avoir été, qu’il succombe sur place, qu’il pourrisse sur pied, qu’il crève dans l’œuf, il a fait son temps, il a vécu, qu’il crève, qu’il crève, qu’il
(crève)
Ana Tot, Méca, Le Cadran ligné, 2016, p. 68-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, méta, crever | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2016
Michel de M'Uzan, Les chiens des rois
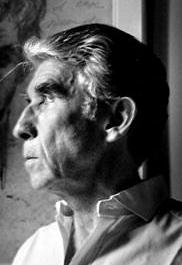
Le cerf-volant
Les hommes se sont écartés, ils parlent et se frappent les mains, s’interpellent et se répondent. Ils sont nombreux, ils ne voient pas l’enfant blond, tout seul sur la plage. Le cerf-volant est parti, l’enfant est resté. Le fil s’est brisé, l’enfant a tendu les bras. Le cerf-volant était blanc avec une croix jaune au milieu, il montait et personne ne bougeait. L’enfant criait, il voyait encore la tache claire qui fuyait, très haut dans le ciel, au-dessus des arbres, de la terre et de la mer. Le cerf-volant est parti et l’enfant s’est couché sur le sable mouillé. Les hommes se sont avancés et ne se sont pas arrêtés. Ils ont dépassé les pleurs, ils marchaient et le bruit des voix et des pas s’est mêlé au crissement de dix doigts sur le sable. Un vent froid a soufflé, l’enfant s’est levé et des mots étrangers lui sont montés aux lèvres.
Michel de M’Uzan, Les chiens des rois, collections Métamorphoses, Gallimard, 1954, p. 138-139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel de m'uzan, les chiens des rois, enfant, cerf-volant, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2016
Roger Giroux, Lieu-Je
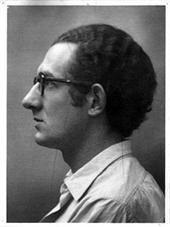
Il serait tellement plus facile de parler, de ne pas dire que je parle, de taire à la parole ses origines, son absence d’ici, de la laisser dans l’ignorance de ce lieu dont je parle, sachant qu’il n’y a rien à en savoir. Sachant que l’ignorance a quelque chose à voir avec lui (voir ?) mais je ne sais pas ce que c’est. Sachant que je ne sais pas de quoi je parle. Ne sachant pas cela. Mais il n’est plus possible de parler sachant cela. Et, ne le sachant pas je parle.
Roger Giroux, Lieu-Je, Éric Pesty éditeur, 2016, p. 15.
Lieu-Je, avait été publié avec Lettre (réédité également par Éric Pesty) en 1979, au Mercure de France, les deux textes réunis sous le titre L’arbre le temps.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, lieu-je, parole, savoir | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2016
James Sacré, Écrire à côté
![James-Sacre-Photo-Jeanne-Roux-2[1].jpg](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/02/01/3549790076.jpg)
Un restaurant dans Paris
Ce 3 décembre 1988
Les peupliers ne sont plus qu’un peu de gris léger
Sur la pierre ensoleillée des immeubles, quai d’Orléans
Quai de Bourbon. On voit maintenant mieux
Les taches de bleu que font les portes cochères dans les arcatures d’anciennes demeures.
On y a découpé des portes plus petites, avec au-dessus une ou deux fenêtres, même un balcon.
Une couleur d’un bleu comme ouvrier qui a
Un air de dimanche matin dans ce début d’après-midi. Plus loin
Voilà le restaurant du pont Louis-Philippe son blan cassé,
Ses tables enchaînées devant, et quelque chose d’endormi
Dans tout son intérieur : de l’indifférence ou comme une attente apaisée
Pendant que s’écrit
Ce 3 décembre léger dans les peupliers de Paris.
James Sacré, , dans Affaires d’écriture (2000), Tarabuste, 2016, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, écrire à côté, un restaurant dans paris | ![]() Facebook |
Facebook |





