21/06/2016
Christian Prigent, Les Amours Chino : recension
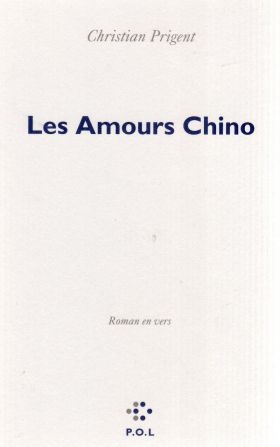
Une aventure de lecture
La lecture des Amours Chino est difficile et c’est bien une aventure de l’entreprendre, dans la mesure où l’on abandonne très vite l’idée de retrouver la logique à l’œuvre dans la quasi totalité des romans publiés. Ce qui apparaît rapidement, c’est « le mélange d’une élocution littéraire sophistiquée à des effets d’idiotie bouffonne »(1). Je m’attacherai à décrire cette « ruse rhétorique » (idem) par laquelle le texte échappe à la figuration, à l’ornement, au sens donné.
Le livre se présente, dans un avertissement en ouverture, comme continuant Les Enfances Chino
(2014) : défini comme une « dévalée d’adolescence à sénescence », il comprend des éléments biographiques, « Exclamation rétro-éberluée pas loin de la ligne d’arrivée : « Ah, nos amours ! » » (p. 9). C’est un roman en vers, ce qui aujourd’hui apparaît sans doute paradoxal à beaucoup de lecteurs. Les exemples en français non pas de romans en vers — on cite (toujours) Chêne et Chien de Queneau —, mais d’ensembles de vers avec pour matériau principal la biographie, ne sont pas rares ; au hasard : Une Vie ordinaire (Georges Perros), Marcher au charbon et la suite (William Cliff), Autobiographie au père absent (Jean-Luc Sarré).
Roman ? Les Amours Chino en conserve les caractères connus, avec des personnages (Chino, des femmes, divers comparses), une histoire (celle de Chino), des chapitres — 18, de longueur inégale — dont certains titres laissent prévoir une histoire (‘’Chino au bocage’’, ‘’Chino surpris par l’amour’’), d’autres un épisode de la vie en société (‘’Chino Mao’’) ou une réflexion sur un écrivain (‘’Chino lit Diderot’’). L’ensemble compte 285 poèmes toujours composés de 3 quatrains ; les vers ont majoritairement 11 ou 9 syllabes, souvent mêlés, quelques-uns de 7 syllabes, mais on lira aussi des vers de 10 ou 12 syllabes. Ils sont presque toujours rimés ou assonancés (dunes/légumes ; bombe/ombre), la rime étant parfois pour l’œil (botox/porno x ; skype/prototype) ou absente (passé/en/plage/image (58) ; thé/ras/pieds/graviers (90), etc.). Indications sommaires, plus intéressants sont divers éléments qui perturbent la lecture au point de la miner.
Commençons par le plus visible : on lit des enjambements tels que le mot en fin de vers se trouve coupé (impéti/Go ; l’a/Rtiste ; etc.), jusqu’à rendre la restitution orale difficile (il le v/Eut). La lecture fait apparaître la fonction quelquefois burlesque de ces coupures — je retiens un exemple : « Ah qu’alibi Madame soit la libi /Do que nulle image en pierre ido/Lâtrée » (112) ; on relèvera des dizaines de jeux analogues avec les sons, comme « on/Ne voit pas c’est con mais qu’on sait là » (231), leur compréhension n’étant pas toujours immédiate : « conden/S & fendu » (64). Le mot tronqué peut former avec son complément un calembour : « ébulli/Sillons » (85), « un petit mot char/Mant songe » (282) ; etc. ; il a aussi une fonction sémantique forte, comme le montre l’usage du mot ‘’con’’.
Dans un poème du chapitre ‘’Chino Mao’’, où se succèdent des parodies de la pseudo formation reçue par les militants, la coupe du mot à la rime met en relief ce qu’était l’endoctrinement dans les groupes maoïstes français des années 1970 : « Camarade tu notais au logis mon / Progrès en idée mon top niveau de con/Science » (143). Mais ‘’con’’ est beaucoup plus souvent au sens de ‘’sexe féminin’’, partie d’un mot à la rime et en relation avec ‘’cul’’ : « cu/Lottes – con/Ciliante » (319). On relèvera plusieurs fois à la rime ‘’con’’ (= ‘’idiot’’ ou ‘’sexe’’), ‘’cul’’, et une série de mots relatifs au corps (féminin ou masculin) et à l’activité amoureuse : seins, toison, moniche, fente, sexe, déduit, queue, fesse, nue, couilles, bite, foutre, foutré, baiser, putain, (je) jouis, libido, cœur, amoureux, amour, je t’aime.
Il s’agit bien de trouver une forme en exploitant les possibilités des discours classiques. Ainsi, l’allitération et l’assonance, vantées par les manuels, peuvent être accumulées au point que les vers deviennent difficiles à lire : « …ou pas (plutôt pas) plus un pas plu/Tôt vita évitée nova zéro bo/Bo d’alibi de libido no/Sanglots d’émoi en gloire ni glu//etc. », 338. C’est pourquoi aussi des rimes en usage chez les Grands Rhétoriqueurs de la fin du xve siècle sont reprises, comme les rimes annexées qui veulent la reprise de la rime au début du vers suivant : « amères/Mères, acier/Scié, gravier/&, mer/Merdeuses, sur/Surfaces ; etc. (314). Sont également introduits de nombreux anagrammes (comme « rosies d’osiers », 53, « en outre troue », 114 ; etc.), un acrostiche (27), un oxymore (« astre énorme noir aveuglant », 91), des onomatopées (plic ploc, miam, zzz, crac, plouf, bzzz, etc.), des calligrammes (V pour le sexe féminin), des formes anciennes (onc, emmi, jà, sade (pour ‘’sexe féminin’’), etc.), un vocabulaire familier (grolle, deuze) ou régional (drache, s’achienner), des néologismes (inardeur), des élisions (audsus, d’poule), le remplacement d’un mot par un chiffre (« Lame 1 » se lisant ‘’la main’’).
Ce qui est également remarquable, quand on abandonne l’attention à la métrique, c’est l’abondance des références ou des allusions aux œuvres. Rien de nouveau chez Christian Prigent, certes, cependant dans ces courts poèmes l’intrusion de noms, de citations (avec ou, le plus souvent, sans nom d’auteur) et de fragments plus ou moins reconnaissables, accentue le caractère polyphonique de l’ensemble ; à la pluralité des jeux dans la langue se mêle la pluralité des voix venues d’autres livres, d’autres langues, d’autres moments de l’Histoire. Cela commence par le titre même, Les Amours Chino (comme Les Enfances Chino), qui calque la syntaxe du Moyen Âge — voir Les Enfances Ogier, Les Enfances Vivien, etc. —, syntaxe conservée dans Hôtel-Dieu. Le Moyen Âge est également présent avec l’allusion à l’épisode du « sein de Guinier » et de « Caradoc au Gros-Bras » (35), pour le moins sibylline quand on ignore un petit roman qui continue le Perceval de Chrétien de Troyes. Résumons : un serpent s’est enroulé autour du bras de Caradoc, Guinier présente son sein au serpent qui le mord, le frère de la jeune fille lui coupe le bout du sein en voulant tuer le serpent, bout qui sera remplacé par la bosse d’or d’un bouclier… Cette histoire apparaît à propos du séjour de Rousseau à Venise et de sa relation à La Zulietta : « Je m’aperçus qu’elle avait un téton borgne » (Confessions), soit chez Prigent « un pneu raplapla côté ro/Ploplo » (34).
Il n’y a aucune homogénéité temporelle dans la mosaïque des voix introduites, de Virgile à Baudelaire, de Heine à Beckett, de Rubens à Giacometti, de Hölderlin à Proust, de Corrège à Jarry, du texte (de Clemens Brentano) d’un lied de Brahms à une citation de Joyce…, et cette homogénéité est explicitement refusée par le fait que les langues se mêlent : le français, l’allemand, l’anglais, l’italien, le grec, le latin, le japonais. Rimbaud donne un titre, « 1958, « en cette jeune Oise » » (53) et une parodie : « Si j’ai du goût c’est pas pour la terre/(dinn ! dinn ! dinn !) ni pour les pierres » (37), où l’on reconnaît ‘’Alchimie du verbe’’ ; « Et l’unique cordeau des trompettes marines » d’Apollinaire est adapté en « fin des lunatiques corps/D’eau des trempettes marines » (183). Chino lit Diderot(2) et écrit en reprenant des fragments de lettres à Sophie Volland, et emprunte ailleurs aux lettres de Sade ; dans (1987, imitation), in memoriam G[eorges] B[ataille], la variation à partir des mots ‘’tombe’’ (= tombe et tomber) et ‘’robe’’ provient d’une phrase de Bataille(3) : « Je pense comme une fille enlève sa robe. » Ne pas oublier que Prigent se cite, reprenant Étude de nu, et qu’à côté d’une allusion à Jaufré Rudel ou à la Dame du Lac, il donne le titre d’une chanson (« Cry baby cry ») des Beattles et le nom de groupes punk (Clara Vénus, Siouxsie).
Ces relevés pourraient laisser penser que Les Amours Chino est un étrange magma de voix discordantes, ce qui oblige à lire deux ou trois fois bien des poèmes. On peut répondre que « la dimension de l’illisibilité est intrinsèque à ce type de rapport particulier à la langue et au réel qu’on appelle littérature »(1). Ce roman est une forme « plutilingue, selon le mot de Bakhtine, pour que quelque chose du réel, impossible à restituer, soit perçu, quelque chose que Christian Prigent nomme, comme Beckett, l’« innommable » ». On peut répondre aussi que cette langue sans cesse en mouvement dans laquelle sont écrits les poèmes est, toujours, jubilatoire.
Pour conclure, si l’on isole des fragments de ces Amours Chino, s’esquisse quelque chose de la manière dont Christian Prigent vit le réel, même si « maudit/Soit ce dégoulinement de soi » (175). Je retiens un regard souvent désabusé sur lui-même et la société contemporaine — « la vie ça pue » (281), « la nature pue » (289), et le sentiment de la mort, de la décomposition toujours proche : « rien à dire qui dure » (289), « tout est vou/É aux ruines jeunes béton » (323). Je retiens aussi les très nombreuses occurrences de ‘’bleu’’ (et dérivés), dans Les Amours Chino couleur ambiguë, positive et négative, « Car le blues du cul cinglé est bleu (couleur/De la douceur buée-de-ciel de la douleur) » (231).
—————————————————————————————————————
- Dans Silo, sur le site des éditions P. O. L , où Christian Prigent reprend des essais et des entretiens publiés dans des revues et des volumes collectifs.
- Prigent a publié Suite Diderot (Ficelle, 2011)
- Georges Bataille, L’expérience intérieure, Gallimard, 1954, p. 216.
Christian Prigent, Les Amours Chino, Roman en vers, P.O.L, 2016, 350 p., 15 €. Cette note de lecture a paru sur Sitaudis le 5 juin 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2016
Raymond Queneau, Pour un art poétique

Un train qui siffle dans la nuit
C’est un sujet de poésie
Un train qui siffle en Bohême
C’est là le sujet de poème
Un train qui siffle mélod’
Ieusemet c’est pour une ode
Un train qui siffle comme un sansonnet
C’est bien un sujet de sonnet
Et un train qui siffle comme un hérisson
Ça fait tout un poème épique
Seul un train sifflant dans la nuit
Fait un sujet de poésie
Raymond Queneau, Pour un art poétique, dans
Si tu t’imagines, Le point du jour/Gallimard, 1952,
- 251.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond quean, pour un art poétique, si tu t'imagines, train, poème ode, chanson | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2016
Paul Claudel, Connaissance de l'Est

Heures dans le jardin
Il est des gens dont les yeux tout seuls sont sensibles à la lumière ; et même qu’est, pour la plupart, le soleil, qu’une lanterne gratuite à la clarté de quoi commodément chacun exécute les œuvres de son état, l’écrivain conduisant sa plume et l’agriculteur ses bœufs. Mais moi, j’absorbe la lumière par les yeux et par les oreilles, par la bouche et par le nez, et par tous les pores de la peau. Comme un poisson, j’y trempe et je l’ingurgite. De même que les feux du matin et de l’après-midi mûrissent, dit-on, comme des grappes de raisin encore, le vin dans sa bouteille qu’on leur expose, le soleil pénètre mon sang et désopile ma cervelle. Jouissons de cette heure tranquille et cuisante. Je suis comme l’algue dans le courant que son pied seul amarre, sa densité égalant l’eau, et comme ce palmier d’Australie, touffe là-haut sur un long mât juchée de grandes ailes battantes, qui, toute traversée de l’or du soir, ploie, roule, rebondit dessus de l’envergure et du balan de ses vastes fonds élastiques.
[…]
Paul Claudel, Connaissance de l’Est [1900], Poésie/Gallimard, 1974, p. 132-133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance d l'est, heures dans le jardin, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2016
Jean-Paul Michel, Générosité de l'ellipse, dans L'Étrangère

Générosité de l’ellipse (Du fragment)
1
La légitimité du fragment se soutient de l’impossibilité de « tout dire ».
« Tout dire » supposerait que se puisse dire le tout. On peut craindre que cette condition préjudicielle ne soit pas offerte de droit à nos langues. Un pur désir de la totalité du vrai pourrait seulement ouvrir, en cela, devant le sujet de ce désir, carrière à des travaux inachevables. Il y a de l’impossibilité à dire.
Nos facultés de dire tiennent aux puissances de symbolisation du langage, augmentées de la ressource des compositions d’effets sensibles qui sont la matière de nos arts. Ces opérations paradoxales donnent un bord désirable à nos mondes. Les bienfaits qu’elles prodiguent aux mortels sont une provende sans prix. Aussi bien, l’incessante « chasse » de ces figures laisse un reste.
Ce reste parle à notre mélancolie.
Il est immense.
Jean-Paul Michel, Générosité de l’ellipse, dans L’Étrangère, n° 35-36, 2014.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, générosité de l'ellipse, du fragment, tout dire, le vrai, mélancolie, l'étrangère | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2016
Yves di Manno, Embuscade, dans Koshkonong

Embuscade
o, i flottants
: nuit d’Afrique sur
l’étendue de la
campagne sillonnée
de wagons indécis
disque rouge trouant
le ciel juste au-dessus
de la ligne des arbres
: lances érigées par
centaines immuables
inventant leurs
tribus face au néant
vert dans le noir
: masse unanime
: ciel absent
(l’assaut est sans
doute imminent
Yves di Manno, ‘’Embuscade’’, dans
Koshkonong, n° 9, hiver 2015, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di mann, embuscade, koshkonong, afrique, ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2016
Christian Prigent, Les Amours Chino

Chino lit Diderot
(Adieu)
Adieu ma tendre amie adieu bonsoir eh
Bien adieu adieu adieu mon amie &
Adieu ah ! adieu âmes célestes eh bien
Adieu les jolies promenades adieu vingt
Fois ma bonne amie ! courage ! & adieu oui
Adieu non à demain adieu je l’ai dit
Mille fois adieu ai-je assez bavardé ?
Adieu, que désiré-je ? à moi ! adieu, eh !
Adieu à moi à mon secours adieu oui
Adieu pour la troisième fois hélas si
Je l’ai dit adieu mais qui m’échauffa c’est
Vous oui : réponse sur le champ s’il vous plaît
Christian Prigent, Les Amours Chino, P.O.L,
2016, p. 213.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les amours chino, diderot, adieu | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2016
Emil Cioran, De l'inconvénient d'être né
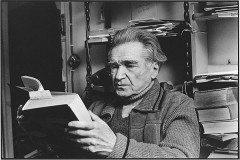
Il fut un temps où le temps n’était pas encore… Le refus de la naissance n’est rien d’autre que la nostalgie de ce temps d’avant le temps.
L’appesantissement sur la naissance n’est rien d’autre que le goût de l’insoluble poussé jusqu’à l’insanité.
Dans les longues nuits des cavernes, des Hamlet en quantité devaient monologuer sans cesse, car il est permis de supposer que l’apogée du tourment métaphysique se situe bien avant cette fadeur universelle, consécutive à l’avènement de la Philosophie.
Se lever, faire sa toilette et puis attendre quelque variété imprévue de cafard ou d’effroi.
Je donnerais l’univers entier et tout Shakespeare, pour un brin d’ataraxie.
On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu’on n’oserait confier à personne.
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Idées/Gallimard, 1973, p. 25, 26, 29, 30, 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emil cioran, de l’inconvénient d’être né, naissance, hamlet, philosophie, absurde | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2016
Emil Cioran, Syllogismes de l'amertume
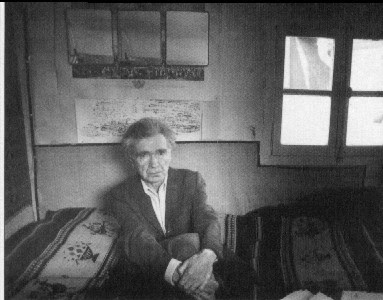
Le public se précipite sur les auteurs dits « humains » ; il sait qu’il n’a rien à en craindre : arrêtés, comme lui, à mi-chemin, ils lui proposeront un arrangement avec l’Impossible, une vision cohérente du Chaos.
Point de salut, sinon dans l’imitation du silence. Mais notre loquacité est prénatale. Race de phraseurs, de spermatozoïdes verbeux, nous sommes chimiquement liés au Mot.
Il est incroyable que la perspective d’avoir un biographe n’ait fait renoncer personne à avoir une vie.
Presque toutes les œuvres sont faites avec des éclairs d’imitation, avec des frissons appris et des extases pillées.
Cette espèce de malaise lorsqu’on essaie d’imaginer la vie quotidienne des grands esprits… Vers deux heures de l’après-midi, que pouvait bien faire Socrate ?
Emil Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées/Gallimard, 1976, p. 19, 21, 23, 25, 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, chaos, impossible, silence, malaise | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2016
E. E. Cummings, No Thanks

à l’amour sois (un peu)
Plus attentif
Qu’à tout
tiens-le seulement peut-être
À peine moins
(étant au-delà d’ô combien)
serré que
Rie, souviens t’en par de fréquentes
Angoisses (imagine
Son moindre jamais avec ta meilleure
mémoire) donne entière à chaque
Toujours en liberté
(Ose jusqu’à une fleur,
comprenant outre mesure le soleil
Ouvre quel millième pourquoi et
découvre le rire)
E. E. Cummings, No Thanks, traduit et
présenté par Jacques Demarcq, NOUS,
2011, p. 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e.e. cummings, no thanks, jacques demarcq, amour, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2016
Ana Tot, méca
je suis dupe. Mon regard a beau pivoter à cent quatre-vingt degrés de gauche à droite de bas en haut je suis dupe. Je ne sens pas que je suis dupe. Si je pouvais sentir la duperie dont je suis l’objet je ne serais pas dupe. Je ne sais pas que je suis dupe. Si je pouvais savoir la duperie dont je suis l’objet je ne serais pas dupe. Non seulement j’ignore ce qui me dupe mais j’ignore même si je le suis. Dupe. Je suis dupe. Simplement je suis dupe. Si je pouvais savoir, savoir simplement que je suis dupe sans pour autant évidemment savoir d’où vient la duperie ni ce qu’elle est, il va sans dire, sous peine d’y mettre un terme, et sans pour autant cesser d’être dupe, ah, si seulement ! je pourrais jouir alors d’être dupe. Mais je suis dupe et c’est à peine si une vague et vaine caresse de satisfaction
(m’effleure)
Ana Tot, méca, Le Cadran ligné, 2016, p. 11.
Le Cadran ligné, éditions fondées par Laurent Albarracin :
Le Mayne, 19700, Saint-Clément
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, méta, dupe, questions, doute, le cadran ligné | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2016
Jean Genet, La Parade
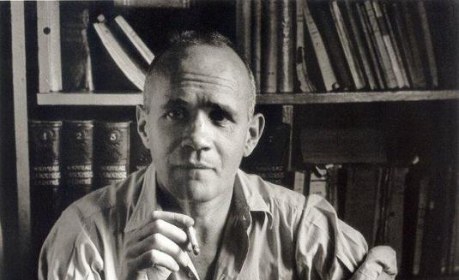
La Parade
Silence, il faut veiller ce soir
Chacun prendre à ses meutes garde,
Et ne s’allonger ni s’asseoir
De la mort la noire cocarde
Piquer son cœur et l'en fleurir
D’un baiser que le sang colore,
Il faut veiller se retenir
Aux cordages clairs de l’aurore.
Enfant charmant haut est la tour
Où d’un pied de neige tu montes.
Dans la ronce de tes atours
Penchant les roses de la honte.
On chante dans la cour de l’Est
Le silence éveille les hommes.
Silence coupé d’ombre et c’est
De fiers enculés que nous sommes.
Silence encor il faut veiller
Le Bourreau ignore la fête
Quand le ciel sur ton oreiller
Par les cheveux prendra ta tête.
Jean Genet, La Parade, dans Le condamné
à mort, L’enfant criminel, L’Arbalète,
1966, p. 69-70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, la parade, silence, veille, rose, bourreau | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2016
Claude Dourguin, Points de feu
Mars sur sa fin : l’orge est sorti de terre, la grande parcelle a changé de couleur imperceptiblement (je l’ai sous les yeux, au sens propre puisqu’elle s’étend à quelques mètres en contrebas, chaque jour), brun roux puis strié à peine, irrégulièrement selon le sol, de vert pâle, puis quadrillé de franches bandes vertes. Les tiges ont à peine quelques centimètres mais cela suffit : désormais chaque matin une bande de chevreuils — deux adultes et trois jeunes — prennent leur petit déjeuner en même temps que moi. Souvent ils renouvellent l’opération le soir, tôt vers six heures, six heures et demie. Ils broutent en tranquillité, nonchalants comme s’ils savouraient les jeunes pousses succulentes, tendres à coup sûr, et, sans doute, le font-ils — quelle raison de les croire dénués de goût ?
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : printemps, claude dourguin, points de feu, orge, chevreuil, goût | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2016
Bashô, Seigneur ermite

Espérant le chant du coucou,
j’entends les cris
du marchand de légumes verts
L’automne est venu —
sur l’oreiller
le vent me salue
Sous une couverture de gelée,
un enfant abandonné
sur un matelas de vent
Ah ! le printemps, le printemps,
que le printemps est grand !
et ainsi de suite
Les pierres semblent fanées
et même l’eau s’est tarie —
l’hiver à son comble
Bashô, Seigneur ermite, édition bilingue
par Makoto Kemmoku et Dominique
Chipot, La Table ronde, 2012, p. 64,
66, 69, 77, 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basha, seigneur ermite, saisons, printemps, hiver, automne, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2016
Henri Thomas, Nul désordre

L’interrogé
— Où, tes poèmes futurs ?
— Derrière le mur.
— Où le vois-tu ce rempart ?
— Partout. Nulle part.
— Et toi-même, où donc tu perches ?
— C’est ce que je cherche.
Henri Thomas, Nul désordre, dans
Poésies, Poésie/Gallimard, 1970, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, nul désordre, question, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2016
Ghérasim Luca La Paupière philosophale : recension
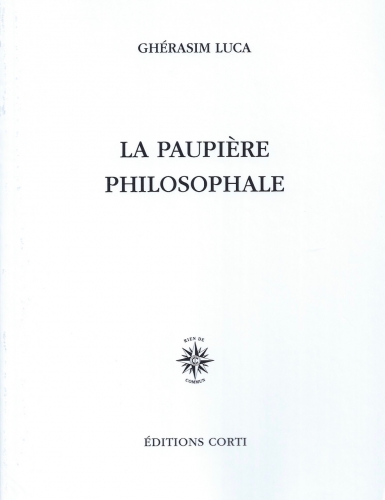
Un numéro de la revue Europe consacré en grande partie à Ghérasim Luca paraît en même temps que La paupière philosophale : c’est une somme sur ce poète trop méconnu et nous y reviendrons. La prière d’insérer précise que le recueil de courts poèmes publié par les éditions Corti a été écrit en 1947, la même année que Passionnément, qu’il faut relire — mais peut-on se passer de relire Le chant de la carpe, La proie s’ombre, ou d’écouter Ghérasim Luca dire Comment s’en sortir sans sortir ? Pour l’instant, nous découvrons comment l’on peut écrire à propos de pierres précieuses.
Le livre est partagé en 10 courts ensembles, le premier non pas sur une paupière — il n’y a que des yeux ouverts sur le monde des mots —, mais amorçant la suite consacrée aux pierres, l’opale, l’onyx, le lapis-lazuli, etc. Ghérasim Luca les décrit à sa façon, en considérant que ce sont des mots : il s’agit de décomposer chaque nom et de composer d’autres mots à partir de là. ‘’Opale’’ contient le son ‘’o’’, qui peut donc prendre la forme écrite ‘’eau’’, ‘‘au’’ ; ‘’pale’’ se décompose en ‘’pal’’, ‘’al(e)’’, ‘’pa’’, ‘’p’’, et l’on peut encore ajouter ‘’op’’. Tous ces éléments phoniques ou graphiques, fragments de ‘’opale’’, sont assemblés de diverses manières de sorte que le lecteur puisse reconnaître (entendre ou lire) ‘’opale’’, ou un des éléments du nom. Ainsi dans le second poème pour cette pierre :
L’eau palpe le poulpe
Mais le hâle le pèle
Après la reprise du mot (« L’eau pal[pe] »), Ghérasim Luca introduit une variation de la suite ‘’al’’, et ‘’pal’’ devient ‘’poul’’, puis ‘’pèl’’ — ‘’poulpe’’ apparu dan le premier poème formé d’une série avec des mots de construction ‘’p + voyelle’’. Ces manipulations aboutissent à de mini récits souvent pleins d’humour et toujours évoquant un univers étrange ; la syntaxe étant respectée, on cherche assez spontanément à savoir « ce que ça veut dire ». Ça veut dire que défaire les mots (prononcés, écrits) et en agencer les éléments dans un autre ordre, aboutit à proposer des associations insoupçonnées.
Prenons la turquoise. Avec un principe de décomposition analogue, le mot offre ‘’tu’’, ‘’tur’’, ‘quoi’’, ‘’qu + voyelle’’, ‘’q’’, ‘’oi’’, donc ‘’oua’’, ‘’oa’’. Tous éléments à partir desquels se bâtit un poème nonsensique :
Sur le turf oiseux d’un tutu / Turlututus et turluttes / Sont disposés en quinconce
Trois-quarts en ouate pour les oiseaux / Trousse-queue en quartz pour les oasis
Le lecteur prendra plaisir à suivre les transformations opérées avec les mots onyx, lapis-lazuli, saphir, chrysophrase, améthyste, rubis et émeraude — ce dernier contient ‘’mer’’, donc ‘’mère’’, et ‘’raude’’, d’où avec changement de consonne ‘’raube’’, et Gérasim Luca écrit alors : « Elle [= l’émeraude] est comme la mère d’une robe ». Il prendra plaisir parce que l’on entre aisément dans cet univers qui, certes, se dérobe au sens, mais s’offre généreusement à l’imaginaire de chacun.
Ghérasim Luca, La Paupière philosophale, Corti, 2016, 80 p. ,14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 mai 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, jeu de mots, non-sens | ![]() Facebook |
Facebook |





