21/05/2016
Pierre Reverdy, Le Cadran quadrillé

Si on osait entrer
Derrière la porte sans vitres deux têtes s’encadrent avec une douce grimace amicale.
Et par l’autre porte entr’ouverte, celle qui les protège la nuit, on voit les rayons où s’alignant les livres, où se réfugient les rires et les mots des veillées sous la lampe, sous la garde d’un drapeau tricolore et d’un pantin menaçant qui n’a qu’un bras.
Et tout se meurt en attendant la nuit, la vie des lumières et de leurs rêves.
Pierre Reverdy, Le cadran quadrillé, dans Œuvres complètes, I, édition Étienne-Alain Hubert, Flammarion, 2010, p. 842.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la cadran quadrillé, nuit, livre, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2016
Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois

Pendaison de crémaillère
En octobre je m’en allais grappiller aux marais de la rivière, et m’en revenais avec des récoltes plus précieuses en beauté et parfum qu’en nourriture. Là aussi j’admirai, si je ne les cueillis pas, les canneberges, ces petits gemmes de cire, pendants d’oreille de l’herbe des marais, sorte de perles rouges, que d’un vilain râteau le fermier arrache, laissant le marais lisse en un grincement de dents, les mesurant sans plus au boisseau, au dollar, vendant ainsi la dépouille des prés à Boston ou à New York ; destinées à la confiture, à satisfaire là-bas les goûts des amants de la Nature. Ainsi les bouchers rôtissent les langues de bison à même l’herbe des prairies, insoucieux de la plante déchirée et pantelante. Le fruit brillant de l’épine-vinette était pareillement de la nourriture pour mes yeux seuls ; mais j’amassai une petite provision de pommes sauvages pour en faire des pommes cuites, celles qu’avaient dédaignées le propriétaire et les touristes. Lorsque les châtaignes furent mûres, j’en mis de côté un demi-boisseau pour l’hiver. C’était fort amusant, en cette saison, de courir les bois de châtaigniers alors sans limites […] un sac sur l’épaule, et dans la main un bâton pour ouvrir les bogues, car je n’attendais pas toujours la gelée, parmi le bruissement des feuilles, les reproches à haute voix des écureuils rouges et des geais.
[…]
Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, traduction L .Fabulet, Gallimard, 1967 [1922], p. 237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2016
Virginia Woolf, Journal d'un écrivain

Lundi 13 septembre 1925, peut-être
C’est une honte. Il est dix heures du matin, et j’écris ceci au lit, dans la petite chambre qui donne sur le jardin. Le soleil est déjà haut. Les feuilles de la vigne sont d’un vert transparent, et celles du pommier si luisantes que, tandis que je prenais mon petit déjeuner, j’inventais une petite histoire sur un homme qui écrivit un poème, les comparant je crois à des diamants, et les toiles d’araignées (qui apparaissent et disparaissent de façon si surprenante) à ceci ou cela. Ce qui m’amena à penser à Marvell et à ce qu’il écrit sur la vie à la campagne, et de là à Herrick et à cette idée que leur œuvre dépendait pour une grande part, et par réaction, des plaisirs de la ville. Mais j’ai oublié les faits. J’écris cela, d’une part pour mettre à l’épreuve le pauvre paquet de nerfs noués sur ma nuque (tiendront-ils ? céderont-ils, comme ils l’ont fait si souvent, car je suis toujours amphibie, moitié couchée moitié levée ?) d’autre part pour apaiser ma démangeaison d’écrire. C’est à la fois un grand soulagement et une malédiction.
Virginia Woolf, Journal d’un écrivain I, traduction Germaine Beaumont, Éditions du Rocher, 1977
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d'un écrivain, écrire, soulagement, malédiction | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2016
Hervé Guibert, Mes parents

Je rentre plus tôt du lycée, un professeur est absent. Ma mère est toujours à la maison pour être là quand nous rentrons. Je frappe comme d’habitude des coups contre la porte et l’on ne me répond pas ; je ne m’inquiète pas longtemps, mon souci se transforme vite en malaise, en incompréhensible suspicion. On a reconnu mes coups et leur succède maintenant non l’ouverture de la porte mais le bruit confus d’un trouble, d’un déménagement qui s’astreint à ne pas le faire paraître. C’est long : il faut remettre en place des meubles ou je ne sais quoi. Je ne sais quoi : je ne sais comment interpréter ces murmures mais je sens immédiatement qu’il va me falloir les interpréter, et que cette interprétation m’amènera à une découverte capitale. Par un échange de voix ma mère me fait attendre un peu plus. Le chien-de-garde est mis ; on ne le met que la nuit, contre les voleurs. Son bruit de chaine inaccoutumé à une telle heure aggrave, me semble-t-il, la situation. Ma mère m’ouvre : mon père est là, planté bêtement dans le salon qui est aussi leur chambre, et que je dois traverser pour atteindre la mienne. Sans défaillir et sans parler, pour aller déposer mon cartable, je traverse effectivement cette chambre ; je remarque que le dessus de lit rose orangé, d’un lignage que je peux suivre du doigt lorsqu’il m’arrive de m’asseoir dessus, n’est pas défait ; mais un regard affolé de ma mère désignant quelque chose à mon père, avant même que j’aie pu le remarquer, et le lui faisant empoigner et dissimuler dans un coffret de la vitrine me dit que je devrai bientôt aller m’enquérir de la réalité de cet objet.
[…]
Hervé Guibert, Mes parents, Gallimard, 1986, p. 67-68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé guibert, mes parents, scène primitive | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2016
Ludovic Degroote, Pensée des morts

Photo Michel Durigneux
notes, fragments, poèmes, bouts de tout, mais en serrant les dents comme un crâne, bien serrer les dents pour lâcher le moins, le moins le mieux, on a beau penser à sa santé, trop de forme vous tue
sales petits morts qui ont laissé des mots partout.
comment tirer une forme non tronquée d’un tel état de décomposition, d’où que forme libre si forme libre possible en cas de non tronqueriez ou non décomposition de soi-même
ils en sont venus aux vers
Ludovic Degroote, Pensée des morts, Tarabuste, 2002, p. 45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensée des morts, écriture, forme, mots, vers | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2016
Jaromír Typlt, Fragment B 101

Fragment B 101
Deux bulles d’air comme enseigne
Gribouillées à la craie
Sur le crépi tout près de l’entrée :
Ici vit le délire.
Souriant il viendra vers moi le jour même où prendra sa folie.
Après quelques pas le sourire s’en ira,
de ma vie je n’ai vu personne aussi vite s’assombrir,
s’effondrer de sa face, s’oublier,
et figer son regard en lâchant tout à vau-l’eau
et des yeux d’effroi ébahis observer
combien ça augmente
augmente sans retenue.
Avant qu’une voix ne le brouille
en appelant son nom . Depuis la mort de sa mère
Franrisck vit seul dans la maison.
Par un couloir il me conduira
opinant à tout ce que je dis,
son pantalon trop lâche lui glissera des hanches
jusqu’en bas, vers l’aine toute noire
que d’un regard légèrement interdit
je devinerai
avant qu’il remonte sa culotte.
Plus tard je comprendrai où j’ai mis les pieds.
Chez lui tout est ordinaire, conduite et réponses.
Sauf le reste sans doute :
d’avoir pénétré dans sa maison sens dessus-dessous, sortons des affaires, taillons,
avant de nous asseoir devant un café
et de rigoler de nos blagues. Il fera semblant de tout approuver,
très volontiers,
trop,
mais avec un agacement perçant çà et là.
[…]
Jaromir Typlt, Fragments B 101, traduit du tchèque par Denis
Molcanov, dans NUNC, n° 38, février 2016, p. 113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaromir typet, fragment b 101, nunc, folie, désordre | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2016
Marina Tsvétaïéva, Tentative de jalousie

Poème pour Ossip Mandelstam
Tu rejettes la tête en arrière —
Et puis que tu es fier et hâbleur.
Quel joyeux compagnon jusqu’à moi
A conduit ce mois de février !
Cliquetant de pièces de monnaie
Et lentement soulevant la poussière,
Comme des étrangers triomphants
Nous allons par la ville natale.
De qui sont les mains délicates
Qui ont, beauté, touché tes cils,
Quand, comment, par qui et combien
Tes lèvres ont-elles été baisées —
Je m’en moque. Mon esprit avide
A surmonté ce rêve-ci.
Et toi c’est le garçon divin,
Petit de dix ans, que j’estime.
Nous resterons au bord du fleuve,
Où trempent les perles des réverbères,
Je te mènerai jusqu’à la place —
Témoin des tsars adolescents.
Siffle ton mal de jeune garçon,
Serre ton cœur au creux de ta main.
— Toi, flegmatique et frénétique,
Toi, mon émancipé, — pardon !
18 février 1916
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de
Tentative de jalousie, traductions de Pierre Léon
et Ève Malleret, Poésie / Gallimard, 1999, 97-98.
Le sixième numéro de la revue annuelle Place de la Sorbonne, animée par Laurent Fourcaut, sera présenté à la Maison de la Poésie de Paris le 17 mai, à 19h30.
Outre un entretien avec l’éditeur Antoine Jaccottet, le sommaire offre des inédits en langue française, de poètes confirmés (William Cliff, Pierre Dhainaut, Jacques Demarcq, etc.) ou non (Ariel Spiegler, Christine Guinard, Minh-Triet Pham, etc.), et des traductions de poètes d’Argentine, de l’Équateur, de Slovénie, d’Allemagne, d’Autriche. D’autres rubriques — poème commenté, prose accompagnant un tableau, des lectures, etc.) — complètent ce très riche numéro.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, tentative de jalousie, osait mandelstam, souvenir, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
13/05/2016
Ghérasim Luca, La Paupière philosophale
Pour saluer la publication aux éditions Corti de La Paupière philosophale et la sortie du dernier numéro de la revue Europe, coordonné par Serge Martin et consacré à Ghérasim Luca :

Bien au-delà du peu
la peau et l’épée
lapent
l’eau ailée
du petit pire
Toupie d’une peur idéale
épi à pas de pou
appât
ou pâle pet de pétale
*
La vie dupe la fille du vite
Tapis doux
où les fées filent
les feux muets
d’un rien de doute
L’effet est fête
faute hâte
écho et cause
Ghérasim Luca, La Paupière philosophale,
Corti, 2016, p. 9, 10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, jeux de langue | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2016
Georges Perros, Papiers collés, III

Ces artistes qui se refusent à connaître l’œuvre de leurs contemporains par craintes d’être influencés, c’est un peu comme si un homme ne voulait voir aucune femme par crainte de tromper la sienne.
La réponse n’est pas hors du texte ou dans le texte. Elle est le texte.
Écrire, pouvoir écrire, c’est, d’une certaine manière, se venger. Remettre l’éternité en marche. Ou tenter d’éliminer le futur.
Le drame : on se fait des idées. La poésie, c’est le contraire. Poésie de nulle part de n’importe où de partout.
Georges Perros, Papiers collés, III, Gallimard, ‘’L’Imaginaire’’, 1994, p. 90, 95, 104, 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, iii ; artiste, œuvre, texte, écrire, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2016
Georges Perros, Poèmes bleus

Je te propose ce fugitif compagnonnage
Entre le chien et le loup
De l’aboiement crépusculaire
Je te demande de m’aider
À extraire de nos solitudes jumelles
Un peu de cette magie
Grâce à laquelle se renouvelle le bail
Se rafraîchissent nos tristes idées
Qui sont comme pierres dans un désert sans oasis
Stupidement debout contre le mur du néant
Comme lorsqu’on attend quelqu’un
Qui ne viendra pas
Qui ne viendra plus
Le rendez-vous n’aura pas lieu
Les pierres de Carnac sont comme ces idées
Muettes comme l’éternité
Justes bonnes à attirer ceux qui veulent savoir tout
Par le biais de qui ne sait rien
Ô l’Histoire belle paresse,
Mais vivre en est une autre, histoire,
Rempli d’épines, le chemin,
Et n’ignore-t-on pas encore
L’étrange énigme d’ici-bas ?
Georges Perros, Poèmes bleus, Gallimard,
‘’Le Chemin’’, 1962, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, poèmes bleus, solitude, néant, attente, carnac, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2016
Georges Perros, Papiers collés

Vivre sans arrêt avec une personne, du matin au soir, au bout de huit jours on la déteste. Mais vivre avec soi-même ! Alors on part en voyage, on dédaigne de prendre une valise qui nous rappellerait… Et on arrive dans une chambre d’hôtel où la première chose entrevue est un miroir. (Inutile de le casser.)
J’aime quand j’ai bu un peu. J’épouse la terre plus aisément. Je tourne un peu. Je suis à jeun quant à elle. Cet état de demi-ébriété me ravit. Comme un coma de juste mesure. Celui-là même que j’ai vainement cherché avec les êtres, que je n’espère plus trouver qu’avec moi-même, un jour de musique privilégiée, musique d’accompagnement qui m’adoptera pour thème.
Georges Perros, Papier collés, Gallimard, 1960, p. 37, 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, vivre, boire, rencontre | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2016
Tristan Corbière, La Cigale et le Poète, dans Les Amours jaunes
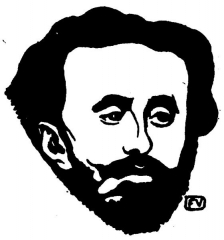
Corbière par Félix Valloton
À Marcelle
La Cigale et le Poète
Le poète ayant chanté,
Déchanté,
Vit sa Muse, presque bue,
Rouler en bas de sa nue
De carton, sur des lambeaux
De papiers et d’oripeaux.
Il alla coller sa mine
Aux carreaux de sa voisine,
Pour lui peindre ses regrets
D’avoir fait — Oh ! pas exprès —
Son honteux monstre de livre !...
— « Mais vous étiez donc bien ivre ?
— Ivre de vous !...Est-ce mal ?
— Écrivain public banal !
Qui pouvait si bien le dire…
Et, si bien ne pas l’écrire !
— J’y pensais, en revenant…
On n’est pas parfait, Marcelle…
— Oh ! c’est tout comme, dit-elle,
Si vous chantiez maintenant ! »
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
dans Charles Cros, T. C., Œuvres complètes,
Pléiade / Gallimard, 1970, p. 853.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, la cigale et le poète, les amours jaunes, muse | ![]() Facebook |
Facebook |
07/05/2016
Guillaume Apollinaire, Le Guetteur mélancolique
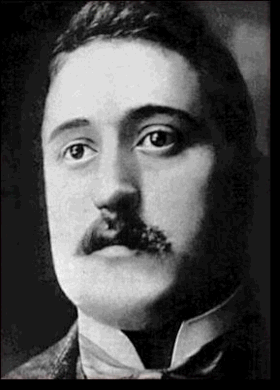
La nudité des fleurs c’est leur couleur charnelle
Qui palpite et s’émeut comme un sexe femelle
Et les fleurs sans parfum sont vêtues par pudeur
Elles prévoient qu’on veut violer leur odeur
La nudité du ciel est voilée par des ailes
D’oiseaux planant d’attente émue d’amour et d’heur
La nudité des lacs frissonne aux demoiselles
Baisant d’élytres bleus leur écumeuse ardeur
La nudité des mers je l’attife de voiles
Qu’elles déchireront en gestes de rafale
Pour dévoiler au stupre aimé d’elles leurs corps
Au stupre des noyés raidis d’amour encore
Pour violer la mer vierge douce et surprise
De la rumeur des flots et des lèvres éprises
Guillaume Apollinaire, Le Guetteur mélancolique, dans
Œuvres poétiques, édition M. Adéma et M. Décaudin,
Pléiade / Gallimard, 1965, p. 574.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, le guetteur mélancolique, nudité, fleur, ciel, mer, violer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/05/2016
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Il battait
(Hommage à Dino Campana)
Il battait le nom (il le battait
Précisément, comme
On bat de la monnaie) et la frappe
(mais celle-ci battait
obstinément), le sens
(la valeur) dans le vent
(dans le souffle de pandémonium
sur Oregina) heurté
se perdait dans la mer
d’aluminium — avec la morte
fumée de la cheminée
de la citerne, dont l’éclair
ferme qui, ferme, secouait
la tôle — que, encore,
lui, battait
obstinément (et battait) (comme
on bat une médaille) dans le nom
vide qui se perdait
au vent que, Lui, battait.
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre,
traduction Philippe Di Meo , Atelier
La Feugraie, 2002, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio caproni, le mur de la terre, dino campana, vent, battre, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/05/2016
Paul Valéry, Littérature
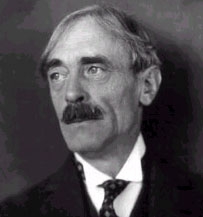
Littérature
Si l’on se représentait toutes les recherches que suppose la création ou l’adoption d’une forme, on ne l’opposerait jamais bêtement au fond.
Quand l’ouvrage a paru, son interprétation par l’auteur n’a pas plus de valeur que toute autre par qui que ce soit.
Ce qui plaît beaucoup a les caractères statistiques. Des qualités moyennes.
Dire qu’on a inventé la « nature » et même « la vie » ! On les a inventées plusieurs fois et de plusieurs façons…
Tout revient comme les jupes et les chapeaux.
Le nouveau n’a d’attraits irrésistibles que pour les esprits qui demandent au simple changement leur excitation maxima.
Paul Valéry, Œuvres, II, édition établie par Jean Hytier, Pléiade / Gallimard, 1960, p. 554, 557, 559, 560, 561.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, forme, fond, plaire, nouveau | ![]() Facebook |
Facebook |





