24/11/2024
Sanda Voïca, L'ère de santé : recension
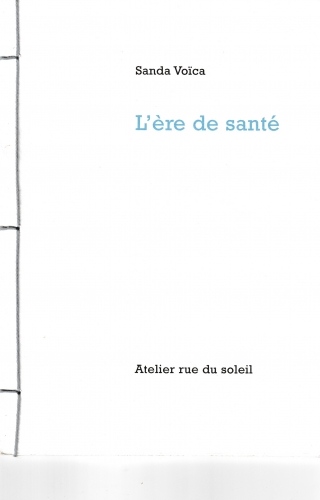
Beaucoup de poèmes aujourd’hui ont pour contenu les faits de la vie de l’auteur / l’auteure, les petits ou grands désagréments, les petits ou grands plaisirs, parfois aussi les changements du ciel, des arbres, de la ville. Cette écriture du contenu des jours suppose que le lecteur sera comme devant un miroir — ce que je vis tu le reconnaîtras comme tien. Rien de moins sûr. Les trente-cinq poèmes de Sanda Voïca, en vers non comptés et non rimés, quelques-uns en strophes, explorent un peu ce qui n’est généralement pas dit, des sentiments et des gestes intimes. Ils sont numérotés et une date suit le dernier vers, l’essentiel écrit en mai 2022, quelques-uns en juin (l’un écrit les 5 et 7 juin), le dernier sans date. La concentration sur une période relativement brève explique l’unité de l’ensemble, mais aussi la récurrence des thèmes.
Pour l’individu, le désir est toujours présent, toujours renaissant et gouverne la manière de vivre parce qu’il est en accord avec « le monde en marche ». Il est à l’origine de la métamorphose constitutive de la personne, au point que le patronyme lui-même change, et Voïca devient « VoYca : Voÿca ». L’auteure se donne explicitement présente dans le "je", forgeant un adjectif à partir de son nom (« pensées (…) voïciennes »). Avec le masque mis à mal du "je", elle est constamment en recherche d’elle-même, avec son corps et avec les mots. Le premier poème rapporte une scène de masturbation, mais le geste qui la provoque est immédiatement associé à la mort de quelqu’un, « Frotte le corps / frotte la tombe », et ce lien, répété, semble acquis dans le dernier vers : « l’harmonie a été dite ». Le motif est repris en lien avec la nature ; c’est l’image de l’épanouissement des nuages, qui fleurissent, celle de l’étendue des nuances colorées, et enfin la disparition des limites du corps devenu « sans contours » dans la jouissance. Jouissance universelle, et la connaît aussi celui qui, dans les traditions religieuses, est supposé créateur de tout, Dieu, qui « rempli de testicules (…) jouit en (comme) une femme ».
Les dessins de l’auteure et ceux de maîtres sont regardés pour ce qu’ils ont d’apaisant, ils rassurent comme espaces qui excluent d’autres regards, comme sont rassurantes les activités qui comblent les jours. Elle éprouve un sentiment analogue devant les icônes, l’église étant un lieu à part, hors lieu comme dans la maison les combles, habituellement non habitables. Il y a une balance constante entre ce qui connote la vie — le corps jouissant, le nombre 1, la terre — et ce qui évoque la mort ou le retrait — la tombe, l’icône, le zéro. Cependant, le côté de la vie l’emporte avec les équivalences corps/terre et langue/terre (« la terre des mots »). Corps et esprit ne font qu’un (« mon cerveau-ventre »), c’est pourquoi écriture et dessin participent à la jouissance, le "je" entier vivant dans toute activité « l’extase qui fait bouger l’univers », littéralement (ex-tasis) ce qui fait sortir de soi et s’exprime alors ce qui était ignoré auparavant.
Pour Sanda Voïca, les mots et le monde sont équivalents ; sans les mots le monde n’existerait pas, ils ne permettent pas seulement les échanges, ils donnent vie à la personne (« Je nais de ces mots »), disent la présence comme ils disent la fin (« les mots diront la nuit »). Sans doute y a-t-il souvent dans ces poèmes les traces d’une douleur que seule la joie de l’amour peut laisser au second plan ; l’amour et les mots qui le disent sont toujours une approbation de ce qui est, ils forment pour Sanda Voïca l’espace même de la vie, effaçant tout ce qui l’encombre. Il y a quelque chose de revigorant dans cette manière de Journal où l’amour est maître des mots, donc des jours.
Sanda Voïca, L’ère de santé, Atelier rue du soleil, 40 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 octobre 2024.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, l'ère de santé : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2024
Sanda Voïca, L'ère de santé

« Élaboration des poèmes » : je lis et j’entends :
labourer — la terre des mots,
des planches irrégulières de mon potager
ou des mottes de terre :
la même chose.
Mais qui laboure encore aujourd’hui ?
Et si oui — la Terre est vaste ! —
Quelle terre ?
Que labourer autre que la terre et les propos ?
Gros sillon
l’autre jour
que ma joie
voire la jouissance
a infligé/induit au monde
— à l’intermondes — !
Sillon large, charnel,
chair jaune et lumineuse,
palpitante,
plaie rendue d’un plaisir reçu.
Sillon où glisser,
avancer ou pas.
Marcher
dans mon extase.
(sans date)
Sanda Voïca, L’ère de santé,
Atelier rue du soleil, 2024, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, l'ère de santé, jouissance, extase | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2024
Sanda Voïca, L'ère de santé

S’auto-prier
L’index
appuyé sur mes lèvres
humides vibrantes
est sans pourquoi :
sous l’explosion de joie
il s’en-chair-e
encore plus.
Frotter le corps,
frotter la tombe
avec le même tissu
— rideau en dentelle —
jusqu’au blanc.
Une couleur
en profondeur
en hauteur
jusqu’au trou blanc :
l’harmonie a été dite.
Dimanche, le 1 mai 2022
Sanda Voïca, L’ère de santé, Atelier rue
du soleil, 2024, p. 1.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, l'ère de santé, s'auto-pries | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2022
Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre : recension
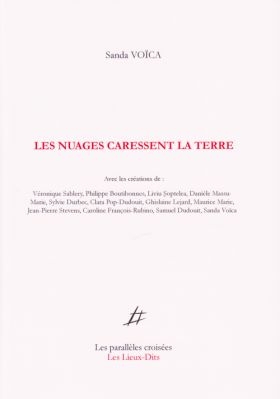
Sauf un, daté de 2018, les poèmes en vers libres du recueil ont été écrits en 2015, l’année de la disparition à vingt et un ans de Clara, la fille de Sanda Voïca, et l’année suivante. Il ne s’agit pas de poèmes pour "sortir" de la douleur, bien plutôt d’une tentative d’écrire un vide impossible à combler. On ne peut pas ne pas penser au vers, certes ressassé, de Lamartine, dans "L’isolement", à propos alors de la femme aimée décédée « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Écrire, sans aucun doute, n’écarte pas la douleur — aucun poème ne peut l’annihiler —, mais constitue un lieu de mémoire indépendant de la tombe où Sanda Voïca a planté un hibiscus rouge qui, notamment, symbolise l’amour et la féminité.
Clara avait offert à sa mère une rose blanche pour son anniversaire, rose qui, contrairement à la rose rouge de son père adoptif, est restée longtemps fraîche dans le vase, comme si la jeune femme avait eu le don de la maintenir dans son premier état ; à partir de ce fait, l’auteure fait comme si sa fille avait les caractéristiques d’une sainte et, de cette manière, lui donne une possible éternité. Ailleurs, elle se réjouit que Clara soit devenue « étrangère » à tous en disparaissant ; devenue autre, elle se serait ainsi « rapprochée (...) de son essence ». Ce sont là des essais, le temps d’un poème, de penser autrement la mort de celle dont elle écrit maintenant : « la moitié de mon corps s’est perdue ». Clara avait-elle des dispositions au-delà de la nature humaine ? non, elle est « Partie, tout simplement », et désormais sans lieu, elle est « aux cieux / ou ailleurs — nulle part ? / ou (...) n’es[t] plus du tout ».
Il y eut d’abord pour l’auteure, au moment de la disparition, l’impossibilité de toute parole organisée ; toute expression ne pouvait être que rejet du réel pour le moins mis à distance puisque toute stabilité était évanouie, « J’ai parlé, parlé, crié, / Dit, redit, maudit, médit ». Entre l’hier et l’aujourd’hui quelque chose s’était rompu qui empêchait de vivre une continuité ; Sanda Voïca évoque « Une fêlure / Une fissure » dans le monde, proche ou non, au point que les jours lui semblaient alors tous « Rebuts et remâchage », que le temps « pass[ait] sans passer », qu’être encore là était seulement preuve de son « inexistence ». Cependant, écrire « ce qui gémit sans cesse / sans qu’on l’entende » éloigne progressivement la violence sans nom qui lui avait été faite ; on peut aussi évoquer avec la même fonction le collage de Sanda Voïca qui ferme le livre, où deux figures féminines se font face, collage titre « Avec Clara (Dialogue) ».
On suit ces lents mouvements de refus de la résignation, de retour avec les autres, sans que l’inacceptable soit accepté. Ce qui ravive la douleur de la perte, c’est de penser à tout ce que Clara ne connaîtra pas, aussi bien « l’extase sous les tilleuls en fleur » que la poésie de Mihai Eminescu, le grand poète romantique roumain. L’absente redevient d’ailleurs fortement présente quand sa tête, dans une vision difficile à supporter, semble flotter dans l’air, elle l’est encore bien plus sur les photos où rien ne peut effacer son sourire qui, chaque fois, fait l’effet de « coups de lance » tant il renvoie à ce qui jamais ne sera plus. Ce qui est très peu supportable dans la vie quotidienne qui continue et contre quoi on ne peut pas toujours réagir, c’est la sottise ou l’indifférence devant une douleur qui ne peut s’estomper ; une tante en guise de consolation assure que Clara est au paradis, celui-ci ne sait parler que de lui et prétend qu’il ne faut vivre, comme lui, que les « bons moments ».
Comment retrouver ne serait-ce qu’un semblant d’équilibre ? En se réhabituant à vivre ce qui fait la vie de tous, la pluie, le jour et la nuit, en relisant Apollinaire, en rêvant de devenir arbre, en pensant aussi que l’écriture contribue à maintenir le souvenir de Clara, « Mon récit, ici — voudrait rendre sa substance, sa chair, ses yeux, ses cheveux » — garder donc plus qu’une trace pour pouvoir, à nouveau « Respirer et regarder : / Le monde est dans l’œil qui vit ». On n’oubliera pas les nombreuses œuvres aux techniques et aux supports variés (dessins, encres, collages, aquarelle, acrylique, etc.) qui accompagnent les textes, elles font de l’ensemble un tombeau poétique, elles ont sans aucun doute aidé l’auteure à ne plus considérer que la vie était « Sueur et larmes ». C’est pourquoi on lit parmi les derniers vers une annonce d’autres livres, « Le ciel, mon miroir, / Les mots, mon ciel. / L’écritoire — ma terre. »
Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre, Les Lieux-Dits, 2022, 90 p., 18 €, Avec des œuvres de P. Boutibonnes, S. Dudouit, S. Durbec, C. François-Rubino, G. Lejard, M. Marie, D. Massu-Marie, C. Pop-Dudouit, V. Sablery, L. Soptelea, J-P. Stevens, Sanda Voïca. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 septembre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, les nuages caressent la terre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/11/2018
Sanda Voïca, Trajectoire déroutée : recension
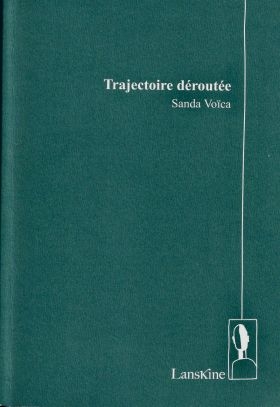
Quand l’être aimé disparaît à jamais, rien ne comble l’absence, les mots de deuil ne peuvent que dire le vide qui s’est créé, la douleur de la perte. Ici, la "trajectoire déroutée" est celle d’une jeune femme à qui est dédié le livre, la fille de l’auteure, décédée à 21 ans en 2015. Le livre d’un bout à l’autre dit la souffrance éprouvée, impossible à apaiser parce que pour toujours la fille disparue est devenue « inatteignable ».
L’absence — le mot revient plusieurs fois — est d’autant plus difficile à supporter que le visage de la jeune fille est sans cesse présent, que la vie passée avec elle n’a pas à être oubliée ; la faille entre aujourd’hui et hier, entre présence et absence, ne peut être comblée et tout essai de reconstruire un ordre acceptable échoue : « Que faire de la fille disparue ? / Je la mets ci, / Je la mets là, / Jamais à la bonne place. », « Sans place. Sans endroit. » À la fille s’est substitué le vide, ainsi l’escarpolette au « fer rouillé » se balance-t-elle sans personne, jusqu’à ce que la narratrice s’y installe. Ainsi le temps météorologique n’est plus perceptible qui ne renvoie plus à des activités partagées, à des projets, « Il n’y a plus qu’une saison, / celle de son absence », et la succession même du jour et de la nuit est remise en question puisque « Le soleil roule / sur la rue étroite, la nuit ». Au désordre du temps et de l’espace répond celui du corps.
Tout se passe comme si les repères les plus courants de l’existence s’étaient dissous, à commencer par la conscience du corps et de ce qui lui est proche. La perte de l’Autre provoque la perte de soi et, dans l’imagination, le corps change de forme (« mon corps gonfle »), n’habite plus l’espace, devient « baudruche géante / errante ». Gigantisme de la paume qui se fait alors protectrice de la nuit, gigantisme du corps entier et le monde alors est « en bas », modification des doigts, bientôt « sourds et aveugles », ou métamorphose en insecte (« Mes élytres frémissent »). En même temps, l’environnement perd ses caractéristiques familières, des algues rouges apparaissent dans le jardin et les pierres du jardin prennent l’aspect de pierres tombales. Le seul souvenir de la disparue suffit à tout désorganiser, il ravive sans cesse la douleur et empêche le retour à un état d’équilibre — « je me défais en morceaux », dit la narratrice quand l’image de sa fille ressurgit. En outre rien, dans ce monde qui s’est déréglé, n’accueille la douleur, « Chemin ou serpent / La même menace ». Une esquisse de mise à l’écart de la disparition, avec l’emploi de « la fille », « la jeune fille », est difficile à maintenir, et Sanda Voïca écrit, dans la dernière partie du livre, « Ma fille — elle mon talon ».
Il n’y a pas ici incapacité à éloigner le désordre, mais accepter le fait de vivre « Un monde d’avant et d’après / toute mort » exige en premier lieu de « sortir du jour où la fille revient, / sortir de sa nuit qui est la mort ». Cela peut-il se faire par l’écriture ? Le lecteur peut toujours le penser, qui tourne les pages, mais si le livre publié tient sans doute à distance pour son auteure le drame vécu, il ne l’annule pas : au cours de son élaboration, « la douleur ronge / les crayons / les feuilles / mon clavier », et il faut lentement redonner de la chair aux « mots évidés ». Cela est d’autant plus difficile que la mort de la fille a suscité le souvenir de paradis perdus, des caresses anciennes, images de l’enfance elle aussi disparue, images de la neige ou d’une alouette — tout ce qui surgit que l’on croyait complètement dans l’oubli.
Chaque page écrite est certainement une « fenêtre / vers une vallée » et Trajectoire déroutée, qu’il faut lire comme un long poème fragmenté, est à sa manière un chant de vie ; « J’ai vu le noir se répandre », écrit Sanda Voïca, mais elle a su écarter par l’écriture ce que cela a de négatif.
Sanda Voïca, Trajectoire déroutée, Lanskine, 80 p., 14 €.Cette note a été publiée par Sitaudis le 5 octobre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, trajectoire déroutée, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2018
Sanda Voïca, Trajectoire détournée

On vit en immortels,
On meurt en mortels.
L’urgence de ce qui m’a toujours accueillie :
mon propre lit
mon propre livre ;
Mais je
flotte
plane
vacille
erre
m’absente
de ces mots mêmes.
Comment réinventer les mots évidés ?
Chaque jour un peu plus vers
l’espace inédit, mien,
qui se crée et augmente,
autour du tronc de mon tulipier,
entre les branches qui s’en éloignent.
J’enveloppe
et m’éloigne du tronc
d’un savoureux arbre :
les guêpes en raffolent.
Sanda Voïca, Trajectoire déroutée, Lanskine, 2018, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, trajectoire déroutée, vivre, mourir, espace, mots | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2016
Sanda Voïca, Épopopoèmémés

Ouvre les yeux
Ouvre les yeux pour — je ne sais plus : c’était hier déjà
Et je me cache de plus en plus vite les raisons d’ouvrir les yeux
Ouvre les yeux — on me disait hier matin, entre sommeil et réveil.
Ouvre le tiroir et regarde, surtout : on me le disait. Qui donc ?
Et j’ai ouvert un large tiroir plein de livres, où le premier à voir et à ouvrir,
[posé couché à côté de quelques autres.
C’était mon livre : un livre que je reconnaissais sans reconnaître —
Je l’avais écrit moi, en effet, mais sa couverture bleu-blanchâtre était inédite.
Et ce n’est pas un rêve : l’interprétation d’un rêve, peut-être, mais en direct,
devant mes yeux ouverts, devant ce tiroir ouvert, et surtout dans ma vie
toujours ouverte, béante.
Je n’ai pas fini mon poème hier — le poème du jour s’arrête ici — écrit
aujourd’hui, mais c’est le poème d’hier. D’hier matin.
Le 13e en rang, le 13e diffus, le 13e en cours d’empoisonner les autres.
Celui d’aujourd’hui surtout.
Le 14edéjà commencé sur le papier — pas encore tapé : en retard de mes
poèmes.
J'ouvre une autre page word, ici.
J’ouvre. Et je ferme aussi celui-ci.
Fermeture-éclair : comme celui d’un sac de couchage, pour un camping à jamais
ajourné, mais dont profite mon chat :
Je lui ai fait prendre un bain, et pour qu’il ne s’enrhume pas, je l’ai mis dedans,
bébé sage, soulagé de sa crasse tignasse,
il ose à peine sortir son nez.
Cette fois je ferme la boutique, le numéro 14 m’attend.
Comme une femme dans un bordel, qui est attendue. Au boulot !
Sanda Voïca, Épopopoèmémés, éditions Impeccables, 2015, p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, Épopopoèmémés, poème, écriture, rêve, chat | ![]() Facebook |
Facebook |





