05/01/2026
Jean-Marc Sourdillon, L'unique réponse
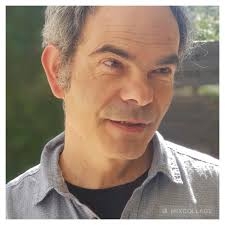
Dans la forêt
L’attente de quelque chose. La Toussaint.
Ciel très bleu. Une buse plane.
La cime des arbres est jaune citron,
la base
perdue dans l’ombre.
Les feuilles pleuvent dans e silence de l’après-midi.
Grand lac suspendu de la lumière.
Les glands, es châtaignes sont à terre.
Quelque chose de froid et d’invisible est dans l’air,
le noyau d’une rivière. On est debout quelque part
dans son courant immobile
de l’eau jusqu’à la taille.
Une voix aulmoin appelle :
« ohé, revenez ! »
Jean-Marc Sourdillon, L’unique réponse, Gallimard,
2020, p. 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean-marc sourdillon, l'unique réponse, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2022
Jean-Loup Trassard, L'érosion intérieure

Et la forêt massive resserre sur eux son étreinte.
Forêt habitée d’oiseaux invisible, grinçante du cri des pies et des branches qui s’usent.
Et dont le sol n’est pas ma terre mais léger, souple, parfois incertain, fait de feuilles entassées longuement, désagrégées, d’humus dont le niveau monte à l’assaut des troncs. Passe la folle procession, le tapis des chiens haletants, les chevaux à la robe mouillée, les trompes à embouchure d’argent. Elle se déroule toute sur le même chemin, en suivant les invisibles méandres de l’odeur, elle s’éloigne, s’enfonce dans la forêt couveuse de corbeaux.
Jean-Loup Trassard, L’érosion intérieure, Gallimard, 1968, p. 142-143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l’érosion intérieure, forêt, chasse à courre | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2020
Pierre-Albert Jourdan, Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt !
Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phrase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts pour fragments, forêt, pilier | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2019
Virgile, Le souci de la terre
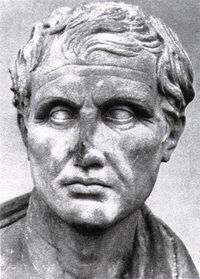
La terre ouverte par le croc de la bêche donne assez d’humidité, et par le soc, des fruits lourds
Nourrir ainsi l’olive grasse, si chère à la paix
Les arbres fruitiers aussi, ils sentent s’affirmer la vigueur d e leur tronc puissant, ils se tendent vigoureusement vers les étoiles, sans besoin de notre aide
Et c’est toujours la forêt qui se charge de fruits
Les bois sauvages qui rougissent de baies de sang
Les troupeaux dévorent les cytises
Les hautes forêts fournissent des torches et alimentent les feux de la nuit pour répandre la lumière
Oh les hommes hésitent à planter des arbres et à en prendre soin
Virgile, Le souci de la terre, traduction du latin Frédéric Boyer, Gallimard, 2019, p. 138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virgile, le souci de la terre, frédéric boyer, fruit, forêt, arbre, planter | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2019
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt !
Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts pour une édition revue et augmentée de fragments, forêt, maison | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2018
Georg Trakl, Œuvres complètes, Le silence

Silence
Au-dessus des forêts scintille, blême,
La lune qui nous fait rêver,
Le saule au bord de l’étang sombre
Pleure sans bruit dans la nuit.
Un cœur s’éteint — et doucement
Les brouillards affluent et montent —
Silence, silence !
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduction
Marc Petit et Jean-Claude Schneider,
Gallimard, 1972, p. 306.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Trakl, Georg | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakt, le silence, brouillard, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2018
Leslie Harrison, Pantoum pour une marche dans les bois

PANTOUM POUR UNE MARCHE DANS LES BOIS
La rime désigne toute répétition accompagnée de différence :
auditive, grammaticale, rhétorique…
Allen Grossman
Tout rime. Prenez une forêt peuplée d’arbres –
des milliers (tous différents, et pourtant confondus
en une foule), des rochers innombrables, une multitude d’abeilles
dans le chicot d’un arbre mort. Je marche, je passe devant eux
par milliers. Toutes les différences sont confondues :
si nombreuses, si semblables. Elles riment, et pourtant
tiennent ensemble, chicot planté dans le sens, le laissant
se répéter, sans fin. Les différences, si minimes,
sont semblables. Le rythme de la marche
suit les contours de la montée, et le cœur
répète – sans fin. Timide, son petit
bégaiement se fixe sur un rythme calme. Ce motif
suit la cadence de la montée. Le cœur
s’accorde avec le souffle. Les yeux refusent toute différence,
se fixent, en rythme avec le calme bégaiement
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent,
s’accordent avec le corps pour refuser toutes les distances.
Je me souviens de la foule innombrable et désordonnée
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent
comme des géants – autoréférentiels, dénués de sens.
Je me souviens de la foule désordonnée des bois,
De la lourde grâce de cet autre mystérieux,
Comme de géants, autoréférentiels, tout leur sens
Caché dans la différence. Nous traversons la vie
dans la foule, innombrables, un millier d’abeilles
se cachant, cachées. Dans nos vies,
rien ne rime. Et nous confondons les arbres
entre eux, avec du bois, avec des bancs.
Leslie Harrison, “Pantoum for a Walk in the Woods”,
in Poetry, juin 2002, traduit de l’anglais (USA) par
Guillaume Condello, dans Catastrophes, n° 2, novembre 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leslie harrison, pantoum pour une marche dans les bois, rime, rythme, forêt, abeille, cadence, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2017
Franz Kafka, Derniers cahiers
Je m’étais complètement perdu dans une forêt. Perdu d’une manière incompréhensible, car peu de temps auparavant encore j’avais marché non pas sur un chemin mais à proximité d’un chemin, qui m’était toujours resté visible. Mais maintenant j’étais perdu, le chemin avait disparu, toutes les tentatives de le retrouver avaient échoué. Je m’assis sur une souche d’arbre et je voulus réfléchir à ma situation, mais j’étais distrait, je pensais toujours à autre chose qu’à l’essentiel, j’échappais aux soucis par le rêve. Alors je fus cerné par les riches buissons de myrtilles, j’en cueillis quelques-unes et les mangeai.
Franz Kafka, Derniers cahiers, traduction Robert Kahn, NOUS, 2017, p. 136-137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, derniers cahiers, traduction robert kahn, forêt, chemin, être perdu | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2017
Antonio Rodriguez, Après l'union
ee rêve revient par la marche, pas à pas parmi les ronces mêlées se décompose la suite empêtrée, la tuyauterie sylvestre enfouit une trachée ouverte, parle, la terre livre un chemin de mains brunes, parle, le rythme des pieds qui fondent au sol et déambulent sur une foule, « le siècle », j’ai écrit cela dans un carnet, était-ce en piétinant un corps, une branche, me reviennent les tombes proches de la chapelle, enfants nous nous dissimulions pour ne pas être attrapés, cache-cache se finissant derrière des stèles, et toujours montait ce trouble de les piétiner, je titube à présent, subitement irrité par ces barbelés, des ronces accrochées aux mollets, pointes retirées délicatement, réitérées une à une, c’étaient des ombres
Antonio Rodriguez, Après l’union, Tarabuste, 2017, p. 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio rodriguez, après l’union, rêve, forêt, enfance, cimetière, barbelés | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2016
Franz Kafka, Lettres à Otla

À Otla et Josef David Matliary, juin 1921
Chère Otla,
Voilà déjà longtemps que je ne t’ai pas écrit, quand je vais bien, dans la forêt, au milieu du silence total avec les oiseaux, le ruisseau et le vent, je me tais moi aussi, et quand je suis désespéré, dans la villa, sur le balcon, dans la forêt détruite par le bruit, je ne peux pas écrire parce que ma lettre est lue aussi par les parents. Ce dernier cas est malheureusement le plus fréquent, mais le premier se produit également, ainsi par exemple les deux derniers après-midi, aujourd’hui ce n’est plus tout à fait cela ; mais je ne m’en étonne pas, il n’y a pas dans le monde autant de silence qu’il m’en faut, d’où il suit qu’on ne devrait pas se permettre d’avoir besoin de tant de silence. Mais qu’on puisse l’avoir ici quelquefois, bien que tout soit déjà comble et qu’à partir du 1er le comble sera probablement encore comblé (les gens logent dans les cabines de bains, dans n’importe quel cagibi, et moi j’ai une belle chambre avec balcon) — de cela je suis extrêmement reconnaissant et c’est l’une des raisons pour lesquelles jusqu’ici je n’ai pas bougé. En ce moment par exemple, il est à peu près 7 heures du soir, je suis allongé sur ma chaise longue à l’entrée d’une cabane à trois pans de mur avec 2 couvertures, fourrure et coussin, devant la cabane s’étend une prairie (...) toute jaune, blanche, mauve de fleurs que je connais et d’autres que je ne connais pas, derrière la cabane le ruisseau passe en murmurant.
Franz Kafka, Lettres à Otla et à la famille, traduction de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1978, p. 132-133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à otla, silence, forêt, fleurs | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2015
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979

Contes et nouvelles
37
Il n’allait jamais bien loin.
Il avait découvert à l’orée de la forêt
Cette cabane abandonnée
Et il y revenait très vite,
Quand il avait de quoi
Pour quelques jours.
Sans doute n’y avait-il que là
Un arrêt, c’est presque sûr, du soleil
À la tombée du jour, un bon moment,
Comme pour le regarder,
Alors qu’il était
Sur le seuil de la cabane
À savourer, solitaire,
Son gros morceau de pain
Et son vin rouge.
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979,
Gallimard, 1980, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène guillevic, autres, poèmes, solitaire, cabane, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2015
Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Première neige
En route. Silence blanc.
Sous les sabots sonne un galop.
Dans les prés seuls batifolent
des volées de corbeaux gris.
Envoûtée par quelque fée
la forêt somnole en rêvant.
e dirait-on pas le sapin
natté de tresse blanche.
Courbé comme une petite vieille
appuyée sur un bâton.
À la cime du houppier
un pivert martèle le tronc.
Le cheval caracole — vaste, l'espace !
La neige étale son châle de flocons.
Sans fin, la route fuit
comme un ruban à l'infini.
(1914)
Sergueï Essenine, Journal d'un poète, traduit
du russe, présenté et annoté par Christiane
Pighetti, éditions de la Différence, 2014, p. 49.

noyers en décembre
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d'un poète, première neige, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2014
Dante, La Divine comédie, L'Enfer, traduction de Jacqueline Risset

En hommage à Jacqueline Risset
1936-4 septembre 2014
un extrait de sa traduction de Dante
Chant I
Au milieu du chemin de notre vie
je me retrouvai par une forêt obscure
car la voie droite était perdue.
Ah dire ce qu'elle était est chose dure
cette forêt féroce et âpre et forte
qui ranime la peut dans la pensée !
Elle est si amère que mort l'est à peine plus ;
mais pour parler du bien que j'y trouvai,
je dirai des autres choses que j'y ai vues.
Je ne sais pas bien redire comment j'y entrai,
tant j'étais plein de sommeil en ce point
où j'abandonnai la vraie vie.
Mais quand je fus venu au pied d'une colline
où finissait cette vallée
qui m'avait pénétré le cœur de peur,
je regardai en haut et je vis ses épaules
vêtues déjà par les rayons de la planète
qui mène chacun droit par tous sentiers.
Alors la peur se tint un peu tranquille,
qui dans le lac du cœur m'avait duré
la nuit que je passai si plein de peine.
[...]
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura !
Tant' è amara e poco è piu morte ;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.
Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
tant' era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonnai.
Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,
la dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto,
guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m'era durata
la notte ch'i' passai con tanta pieta.
Dante, La Divine comédie, L'Enfer, traduction et
notes de Jacqueline Risset, GF-Flammarion,
1992, p. 25 et 24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, la divine comédie, l'enfer, jacqueline risset, chemin de la vie, forêt, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2014
Ghérasim Luca, L'extrême-occidentale

La forêt
Les hommes qui incarnent la forêt et les femmes qui, renversées, la réfléchissent, se partagent les deux côtés du miroir Celui-ci est la terre même, surface horizontale, coupant la scène en deux parties égales, vers laquelle convergent, perpendiculaires, des hommes et des femmes dont les pieds se touchent par la plante.
« À ce contact, c(est comme un fluide ailé et rampant, alliage indicible d'essor, liant et brûlure, qui gagne rapidement les chevilles, les jambes jusqu'à la taille, frôle les doigts dans lesquels finalement il s'enfonce jusqu'aux poignets, remonte le long et des bras et ne dépasse pas les épaules qu'on dirait agitées de violents battements d'ailes tandis que les autres parties du corps ne cessent de jaillir, de s'accrocher, de perdre haleine...»
Cet envol aérien et souterrain qui tente de porter les deux séries de personnages vers l'extrême haut et vers l'extrême bas, comme aux confins d'un territoire unique, enferme troncs et racines dans une équation à deux inconnues dont la résolution sera donnée et refusée à la fois par un grand X surgissant au milieu de la scène et que l'acrobatique étreinte d'un couple amoureux calligraphie devant nous dans l'espace, afin de rendre sinon déchiffrable du moins couramment lisible la terrifiante écriture de notre passage sur la terre.
[...]
Ghérasim Luca, L'extrême-occidentale, éditions Corti, 2013, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, l'extrême-occidentale, homme femme, forêt, miroir, terre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2014
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons
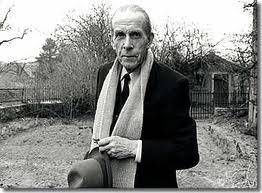
Le bois-gentil
Un petit arbuste aux lisières des forêts, aux pentes des ravins, parmi les broussailles des clairières, dans les jeunes plantations de hêtres et de sapins. Mais pour le promeneur d'avant-printemps, qui se repose sur la souche humide et ronde, couleur d'orange, des fûts fraîchement sciés, ce n'est tout d'abord qu'une gorgée d'odeur aussi puissante qu'un appel. Il se retourne : là, parmi le réseau de ramilles, à la hauteur de son genou, ces deux ou trois taches roses, d'un rose vineux, le bois-gentil en fleur ! Qu'il défasse délicatement les branches enchevêtrées, qu'il se penche sur l'arbrisseau sans en tirer à lui les tiges, car un geste brusque ferait choir les fleurs rangées en épi lâche, par petits bouquets irréguliers à même l'écorce lisse d'un gris touché de beige. Chacune, à l'extrémité d'une gorge tubulaire, épanouit une croix de quatre pétales charnus, modelés dans une cire grenue et translucide, dont les étamines aiguisent le rose, au centre de la croix, d'un imperceptible pointillé d'or. Et de chacune coule goutte à goutte ce parfum épais et sucré comme un miel où chancelante encore de l'interminable hiver s'englue irrésistiblement la pensée.
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons, La Dogana, 2003, p. 29-30.
On appelle aussi cet arbrisseau Bois-joli, Daphné.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, les fleurs et les saisons, bois-gentl, daphné, forêt, arbuste, parfum, rose | ![]() Facebook |
Facebook |







