17/06/2015
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière

L’encre des signes
Ignorant de ma fin et de mon commencement, j’écris aveuglément
pour apprendre de l’encre des signes
ce qui ordonne et croise
la trame des images et la chaîne des mots
j’écris pour que la blancheur irrévocable
qui ajoure et cerne les mots saisis par l’encre
se souvienne du souffle qui les assemble
en les mêlant à l’air qui me traverse.
Je veux qu’entraîné par la nappe de silence
qui sourd et s’étend quand la page se détache de moi
soient abolis regrets, désirs, attente
et que, même fragment, l’écrit s’achève
dans le deuil blanc qui le suit, alors
je serai libre, écrire serait naître.
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière, La Lettre volée, 2014,
p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre burgart, gris lumière, l'encre des signes, écrire, naître | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2015
Rose Ausländer, Été aveugle

Roméo et Juliette à Central Park
Roméo et Juliette
à Central Park
ne disent mot de leur parents
à l’autre bout du monde
où le saule pleureur
pleure
non
Juliette et Roméo
deux flammes vertes
dans l’herbe
embrassées par
l’air de juin
à même le cœur
Danse d’autos
yeux d’écureuil et
le jeu qui tourne
en boucle
Devant les visages à dollars
flottant
des nuages de souffle
parfums de juin
le globe vert
au jeu de la fleur qu’on effeuille
Roméo et Juliette
immortels
sous les trembles
éclairs rouges sur les cils
soleil vert à l’oreille
les lèvres de Roméo
les cheveux de Juliette
le globe tourne
autour du oui vert
autour du oui rouge
autour de l’herbe souffle coupé
Rose Ausländer, Été aveugle, traduction
de Michel Vallois, Héros limite, 2015,
p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, Été aveugle, roméo et juliette à central park | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2015
Sanda Voïca, Exils de mon exil

La conquête impossible
Sur ce bateau vaguant pour la première fois
Qu’on me mette dans son ventre bas,
d’où je guetterai le jour de l’an.
Ma vie est une fête.
Mais ceux que je ne connais pas
ont-ils les mêmes fêtes, le même calendrier ?
Leur année a-t-elle la même durée que la mienne ?
Comment conquérir et aimer un peuple
qui n’arrive pas au bout de l’année ?
Comment remplir le temps qui n’existe pas ?
De mon coin j’enverrai des signes :
La vie est une fête ; d’un jour, d’un an,
mais de ma longueur,
une étendue impossible pour les autres.
On n’est jamais conquérant
Mais on est toujours aimant
en avalant le temps.
Voilà ce que je vous dis,
mais ce que je ne peux pas vous dire
c’est d’où je vous parle :
C’est quoi cette boule mouvante, visqueuse,
mélange de lumière et matière,
qui me garde au chaud,
qui me pousse à écrire ?
Assise tantôt dedans, tantôt dessus.
Ne croyez surtout pas qu’avec ces détails
je vous ai tout dit.
Sanda Voïca, Exils de mon exil, Passages d’encre,
2015, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda coïca, exils de mon exil, conqiête impossible, temps, signe, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2015
Marlene Dumas, Art et protitution ; une Europe unie

Art et prostitution
Si la Prostituée est une personne
qui a pour profession
de satisfaire de le désir de diverses personnes
pour des raisons de gain économique,
où un implication émotionnelle peut
ou non être présente —
Alors elle ne me semble pas très éloignée
de ma définition de l’artiste.
En général les artistes aiment faire semblant.
En général les artistes font semblant d’aimer
plus qu’ils ne peuvent porter.
Ils désirent le désir de tous
tout en ne désirant personne.
Une Europe unie
Je n’ai jamais pensé rester
Je suppose que c’est ce qu’elle disent toutes.
C’était ma première fois dans un peep-show
aussi quand la fille m’a regardée
je lui ai dit, « je ne fais que regarder », et elle m’a répondu
« C’est comme àa que j’ai commencé ici moi aussi ».
Marlene Dumas, traduit de l’anglais par Martin Richet, dans Koshkonong, n7, Printemps 2015, p. 18 et 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marlene dumas, art et protitution ; une europe unie, artiste, peep-show | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2015
Antonio Porta, Les rapports
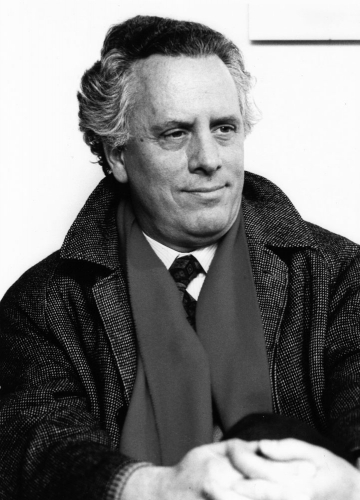
Que peut-on justifier ?
à Edoardo Sanguineti
I
Prends garde à ce mois de juin vénéneux, privé de racines et de
fourmis, ce discours n’a aucun sens, plus, tout le monde
le sait, si vous voulez savoir quelque chose des origines de la vie,
elle n’est pas d’origine, du monde, s’en moque, plus,
ce mois de juin n’est pas né, sachez-le, cessez de penser
à l’argent et choisissez, entre l’histoire et le drame ou
la tragédie, la vérité, je crois, et les faits tels quels, si
il n’y a pas de lieu, où l’on est né, ni la maison, personne
ne sait où c’est, et ainsi ne m’écoutez pas et je vous dis de
lui couper les bras, ce sera extraordinaire, qu’ils se libèrent
les grands seins, et mâchez, jusqu’au bout, dedans
la société et ses légendes, petites et grandes lèvres, dans
le parc qu’il s’invente, dans les buissons, pour enflammer le pénis,
où l’on court, au sens métaphorique, car en réalité
je suis à bout de souffle.
[...]
Antonio Porta, Les rapports, traduit de l’italien par Caroline Zekri, préface d’Alessandro De Francesco, postface de Judith Balso, NOUS, 2015, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porta, les rapports, juin, origine, vérité, société | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2015
Albane Prouvost, meurs ressuscite

dans la maison glacée
où je ne suis pas autorisée
combien de cerisiers
acceptent de revenir
accepte poirier
ici je commence ici
les pommiers sont des sorbiers
accepte
un pommier accepte-t-il
puis sauvagement il accepte
accepte poirier
accepte puisque tu acceptes
les poiriers sont tous bons
ainsi accepte
cher compatible tu me manques tu me manques tellement
pardonne aux poiriers, bon pardonne aux pommiers puisque c’est fait bon
pardonne aux jeunes glaciers
tu traînes comme un jeune pommier
parce que tu traînes toujours comme un jeune pommier
un jeune glacier est un jeune pommier
tu ne vas pas concurrencer la glace quand même
serait un jeune poirier un jeune cerisier serait un jeune pommier
en train de devenir pratique
j’ai besoin des pommiers
ou j’ai besoin des poiriers
ou j’ai besoin de leur pure capacité
un jeune glacier n’espère plus être un jeune pommier
[...]
Albane Prouvost, meurs ressuscite, P.O.L, 2915, p. 9-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albane prouvost, meurs ressuscite, maison, arbres, pommier, cerisier, poirier, glacier | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2015
Pascal Commère, Des laines qui éclairent

Seraient-ils perdus une fois encore les mots,
par la terre brune et collante qui entérine
en silence toute mort en juin comme une boule
de pluie sur tant d'herbe soudain qui verse, avec
dans la poitrine ce serrement, par les collines
presque en haut, quand la route espérée dans un virage
d'elle-même tourne et disparaît... Je reconnais
le menuisier qui rechignait au guingois des portes
cependant que vous gagnez en ce jour de l'été
la terre qui s'est tue, humide et qui parlait
dans votre voix soucieuse ; à chaque mot j'entends
le travers du roulis des phrases le tonnerre
d'un orage depuis longtemps blotti dans l'œuf, la coque
se fissure — sont-ce les rats qui remontent, ou le râle
des bêtes hébétées dans l'été, longtemps résonne,
comme les corde crissent, lente votre voix digne
par-dessus l'épaisse terre menuisée, les vignes
bourrues... Et sur mon épaule, posée, la douceur
ferme de votre main pèse sans appuyer.
Pascal Commère, De l'humilité du monde chez les bousiers (1996),
dans Des laines qui éclairent, Le temps qu'il fait, 2012, p. 211.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, des laines qui éclairent, mots, herbe, terre, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2015
Henri michaux, Nous deux encore

Nous deux encore
Air du feu, tu n’as pas su jouer.
Tu as jeté sur ma maison une toile noire. Qu’est-ce que cet opaque partout ? C’est l’opaque qui a bouché mon ciel. Qu’est-ce que ce silence partout ? C’est le silence qui a fait taire mon chante.
L’espoir, il m’eût suffi d’un ruisselet. Mais tu m’as tout pris. Le son qui vibre m’a été retiré.
Tu n’as pas su jouer. Tu as attrapé les cordes. Mais tu n’as pas su jouer. Tu as tout bousillé tout de suite. Tu as cassé le violon. Tu as jeté une flamme sur la peau de soie pour faire un affreux marais de sang.
Son bonheur riait dans son âme. Mais c’était tromperie. Ça n’a pas fait long rire.
Elle était dans un train roulant vers la mer. Elle était dans une fusée filant vers le roc. Elle s’élançait quoique immobile vers le serpent de feu qui allait la consumer. Et fut là tout à coup, saisissant la confiante, tandis qu’elle peignait sa chevelure, contemplant sa félicité dans la glace.
Et lorsqu’elle vit monter cette flamme sur elle, oh...
Dans l’instant la coupe lui a été arrachée. Ses mains n’ont plus rien tenu. Elle a vu qu’on la serrait dans un coin. Elle s’est arrêtée là-dessus comme sur un énorme sujet de méditation à résoudre avant tout. Deux secondes plus tard, deux secondes trop tard, elle fuyait vers la fenêtre, appelant au secours.
Toute la flamme alors l’a entourée.
[...]
Henri Michaux, Nous deux encore [1948], dans Œuvres complètes, II, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 149-150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, nous deux encore, feu, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2015
François Muir, L'infamie de la lumière

Jardins
Lumière, lumière blanche, pas à pas
Lente approche, éphémère confrontation
Ombres souriantes, corolles de rose
De près, terre foulée, lents écarts
Corps sans attache, repos loin du ciel
Escale, séjour d’îles en îles
Fleuve
Frôlements
Nu, nage isolée
Passage sur la terre
Insensible au feu, à ses ramifications
Feu qui ne s’allume, ni ne s’éteint
Tête à tête, celui qui veille, celui qui s’absente
Cendres
Coupure, flots de silence
Converti à l’Autre, aux états, aux états
Loin du tumulte, étrave impassible
Cendres sur la terre, cendres dans les os
Lumière dans la lumière, sans laisser de traces
François Muir, L’infamie de la lumière, La Lettre volée,
2015, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois muir, l'infamie de la lumière, jardin, fleuve, cendres | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2015
Caroline Sagot Duvauroux, 'j

[...]
Qui pleure-t-on ?
Y a-t-il un secours ?
Couper dans soi ?
Tu fut-il ?
Je n’est plus pour le savoir ?
Si tu n’est plus pour que je
Y a-t-il un autre destinataire du monde ?
Sans doute.
Pour qui sont ces serpents ?
Y a-t-il encore du blanc aux fleurs de camélia ?
Le lierre coule-t-il encore des parois ?
Le crime de défaire ?
Ne fait pas très bon, là
Faut-il refaire ces choses où je fut malhabile ?
La mort ? Je ne sais pas
Apprends-moi ce que je sais
pour que je reconnaisse
Où es-tu ? je ne peux me souvenir
Quelle contingence avec demain ?
Indigne de contingence ?
Dès aujourd’hui mais
demain ? qu’est-ce dire ?
Qui suis-je ? est-ce ? et pour qui sont ?
Rêvais-tu ?
Je n’étais pas là
Rêvais-tu pour carner le dogme ?
J’faut
sans la violence
Faudrait
mais sans la violence
Et dire encore merci ?
Tu ne seras pas là je n’étais pas là
Je ? là ? qu’est-ce ?
Nous n’étions qu’ici
Qui dans le feu tord une aurore ?
pour légender l’instant d’un incipit
au point du jour
Avant l’erreur point de jour au rideau
[...]
Caroline Sagot-Duvauroux, ’j, éditions Unes,
2015, p. 46-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j, deuil, identité, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne

Cahiers guenille
Il y a ces premiers cahiers, quatre ou cinq, que sans doute je détruirai. Parce qu’ils sont la trace d’une sorte de crise informe ; celle d’une affectivité qui sait mal reconnaître ce qu’elle découvre en son corps, qui veut s’en défaire (ou en sublimer le poids) tout en l’affirmant de façon désespérée, plutôt que de l’accepter dans un solide contentement d’être. Celle aussi d’un désir de penser sans s’en donner les moyens de le faire par des lectures autour desquelles il aurait fallu réfléchir, en écrivant vraiment au lieu de jeter sur ces cahiers des cris, des gestes de mots, comme de quelqu’un qui se serait noyé dans son vide incohérent.
Et me voilà parlant de ces cahiers, alors qu’en plus de les détruire je pourrais (je devrais peut-être) n’en rien dire ; si j’en parle maintenant n’est-ce pas que je leur accorde quelque importance persuadé que je suis que c’est là aussi que naît de leur magma brassé et rebrassé de façon répétitive durant quelques années, ce que sera une pratique longtemps continue du poèmes ? Pourtant quand je relis ces cahiers je n’y vois rien qui pourrait expliquer le désir d’écrire. D’ailleurs des poèmes (désespérément mièvres c’est vrai, mais beaucoup plus écrits que les pages de ces cahiers) j’en écrivais depuis bien avant ces années de quasi-ridicule crise d’adolescence.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli, suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l'œil de l'oubli, suivi de rougigogne, cahier guenille, écriture, adolescence | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2015
Jules Renard, Le petit bohémien

Le petit bohémien
En sortant de l’épicerie du village, avec une bouteille, il courut après des moutons que leur berger ramenait à la ferme. Il ne dit rien à ce berger qui avait la tête de plus que lui et n’aurait pas répondu, mais il suivit le troupeau et s’en occupa, de loin, comme un second berger.
Quand une brebis restait en arrière, c’était sa part : il pouvait la flatter, tremper ses doigts dans sa laine, lui parler en maître jusqu’à ce que le chien vint la reprendre.
À la porte de la bergerie, le petit bohémien fut sérieusement utile.
Les agneaux nouveaux-nés, qui n’avaient pas vu leur mère de la soirée, se précipitaient dehors, sous elles. Il les aida à retrouver chacun la sienne. Il en sépara deux qui s’obstinaient à donner des coups de tête au même ventre. Il en rattrapa un autre qui, joyeux d’être libre, oubliait de téter et bondissait imprudemment vers la mare.
Puis, pour sa récompense, le petit bohémien voulut pénétrer dans la bergerie. Il se croyait chez lui. Mais le berger lui ferma au nez le bas de la porte divisée en deux parties. Le petit bohémien posa à terre sa bouteille, se pendit à la porte basse, et regarda par-dessus. Ses yeux essayaient de percer l’ombre.
Il n’eut pas le temps de se fatiguer les poignets. Le berger, sa besogne terminée, ressortit, ferma cette fois la porte tout entière, le haut et le bas, au verrou, et s’en alla du côté de la soupe, avec son chien.
Le petit bohémien qui le suivait encore, le vit entrer dans la maison et s’asseoir près des autres domestiques, à la table commune. Il resta seul au milieu de la cour.
Personne ne faisait attention à lui, et la fermière ne se dérangea pas pour le chasser.
Il renifla fortement et revint à la bergerie coller son oreille à la porte. Les agneaux calmés se taisaient un à un. Il s’assura que le verrou extérieur était bien poussé, et par précaution chercha une grosse pierre afin de caler la porte. Cela fait, n’imaginant plus rien à faire, il reprit sa bouteille et se décida à quitter la ferme.
C’est à ce moment qu’il aperçut un monsieur sur la route. Il ôta ses sabots, mit ses mains dedans, et pieds nus, rattrapa vite le monsieur.
Il ne me dit pas bonjour.
[...]
Je parlai le premier et lui dis :
« Qu’est-ce qu’il y a de jaune dans ta bouteille «
— De l’huile et du vinaigre que j’ai achetés à l’épicerie.
— Pour mettre dans ta salade ?
— Dame ! pas dans ma soupe.
[...]
Jules Renard, Le Vigneron dans sa vigne, dans Œuvres I, textes établis par Léon Guichard, Pléiade / Gallimard, 1970, p. 820-821.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ules renard, le petit bohémien, berger, mouton, travail | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2015
Emmanuèle Jawad, Plans d'ensemble

histoires, frontière
les sols marqués de fragments courts, par endroits, le tracé suit la Spree
entre les plaques tombales, s’y insère, la mémoire d’une ligne
à la traversée, entre, reste de marbres et ciment, en place
zones d’herbe rase et chantiers ouverts, rouille commémorative
d’un pan vertical, tiges métalliques terminent la ligne de frontière
l’histoire par les sols entamés, tranchées entre les murs dédoublés, dans cet écart
terrain vague, ne subsiste qu’une vacance et la mémoire d’outre,
mémorial au lieu inscrit, dite l’armature seule, une élongation, un ressenti,
en marche, le cours, la ligne discontinue marque les anciens postes frontières,
radiation d’une clôture, vestiges en plans arrêtés
lavées, blanchies, dans l’effacement ténu peu à peu, les images,
il renverse l’ordonnancement des événements, de Berlin à Leipzig,
chute à un mouvement qui précède, foules d’amplitude, en surimpression, floues
Emmanuète Jawad, Plans d’ensemble, Propos2éditions, 2015, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuèle jawad, plans d'ensemble, frontière, ruine, histoire, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2015
Laurent Albarracin, Herbe pour herbe

[...]
Les ronces sont difficiles —
on dirait qu’elles sont en végétation
montées en épingles sur elles
leur peine à les extirper
De l’inextricable
on peut extraire l’inextricable —
ce sera toujours un fibreux
jus
L’herbe floute le sol — le hache
doucement — tant il est vrai
comme venu au tout proche
un peu du lointain horizon
Comme l’herbe d’herbe — oui
l’envahi est envahi d’envahi
et le tendre est le plus tendre
au plus dru du tendre
Pour soutenir le bleu du ciel
il n’y a que le bleu du ciel —
ce qui porte est soi-même porté —
l’allégresse est joie de joie
Les nuages sont gros
des plus fins traits
de la pluie — l’herbe est grise
d’herbe
Laurent Albarracin, Herbe pour herbe, Dernier
Télégramme, 2015, p. 51-53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, herbe pour herbe, sol, horizon, bleu du ciel, nuage | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2015
Pier Paolo Pasolini, La rage
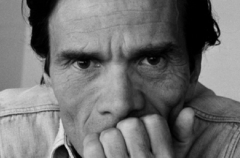
Série de photographies de femmes parées de bijoux au théâtre
La classe propriétaire de la richesse
Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,
qu’elle confond la nature et la richesse.
Si perdue dans le monde de la richesse
qu’elle confond l’histoire et la richesse.
Si touchée par la grâce de la richesse
qu’elle confond les lois et la richesse.
Si adoucie par la richesse
qu’elle attribue à Dieu l’idée de la richesse.
Pier Paolo Pasolini, La rage, traduit de l’italien par Patrizia
Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2014, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, théâtre, richesse, nature, histoire, loi | ![]() Facebook |
Facebook |





