15/11/2025
Verlaine, Maurice Denis, Sagesse (Fac-similé) : recension
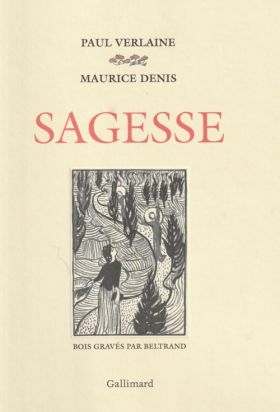
Sagesse n’est peut-être pas le recueil le plus lu de Verlaine, mais quelques poèmes en sont très connus comme, dans la troisième partie, "Le ciel est par-dessus le toit ", plusieurs fois mis en musique (notamment par Déodat de Séverac, Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn) et des versions folk, pop l’ont popularisé. Il est intéressant de relire aujourd’hui l’ensemble illustré qui, publié en 1880 à compte d’auteur et repris en 1889 chez Léon Vanier, est accompagné en 1911 de bois gravés de Maurice Denis, édité par le marchand de tableaux Ambroise Vollard. On passe d’un éditeur de livres de religion, la Société générale de librairie catholique à l’éditeur des écrivains dits "décadents" et des symbolistes. L’intérêt de ce fac-similé, qui précède une nouvelle édition des œuvres de Verlaine dans la Pléiade, tient au fait qu’il met sous les yeux des lecteurs un exemple remarquable de livre nabi.
Verlaine a écrit Sagesse après sa conversion, à partir d’août 1873, dans la prison de Mons, en Belgique où il purge une peine de deux ans pour avoir tiré sur Rimbaud en juillet. Publié en 1880, le livre suscite peu de critiques, toutes négatives ; cependant, Huysmans fait lire Sagesse à Jean des Esseintes, personnage principal de À rebours, publié en 1884. En effet, il reconnaît que Sagesse « caractérise (…) la sensibilité fin de siècle, mêlant ferveur religieuse inquiète et sensualité ardente et trouble ». Maurice Denis (1879-1943), lui, découvre très jeune les poèmes, en 1889 ; il s’y retrouve, séduit par le ton religieux, et pense rapidement à l’illustrer. Ses recherches graphiques aboutissent à un album qu’il offre à Lugné-Poe (né en 1869), co-créateur du Théâtre de l’œuvre, qui le fait circuler dans les salons et les ateliers. Parallèlement des expositions, des publications de ses dessins dans des revues donnent à Maurice Denis une assise dans le monde artistique où ses bois sont bien accueillis.
Cependant, quand Maurice Denis rencontre Verlaine en 1890, ils ne se comprennent pas ; l’écrivain reconnaît dans certaines illustrations des échos vifs de la vie alors que le peintre a donné à toutes une valeur symbolique. Par ailleurs, l’un et l’autre conçoivent de manière différente la sacralité ; Verlaine est venu, lentement, à la religion, c’est un converti qui n’a pas totalement abandonné ce qu’il était, alors que pour Maurice Denis la croyance en Dieu est de l’ordre de l’évidence, native. La rencontre, pourtant, est remarquable du point de vue esthétique ; il est visible que le « mélange de naïveté et de réflexivité en art est également un trait de la poésie de Verlaine, oscillant entre ingénuité feinte et extrême conscience du jeu littéraire ». L’accueil est positif dès 1892, notamment du côté des catholiques, où l’on note « l’orthodoxe mysticité » des gravures opposée au « dilettantisme religieux » qui règnerait alors.
Tout au long des années 1890 des gravures de Maurice Denis sont publiées et, en 1895, sept xylographies, en même temps qu’un appel à souscription pour une édition illustrée de Sagesse. Après la mort de Verlaine, le 8 janvier 1896, les choses se précipitent et plusieurs éditeurs sont sollicités, que le projet retient mais qui ne s’engagent pas. Il s’écoulera plus de quinze ans entre le début des négociations entre Maurice Denis et Ambroise Vollard et la publication, en 1911. Le galeriste voit l’intérêt des gravures et des estampes de peintres, il en expose en 1896, préparation à l’édition de livres d’artistes : le premier, Pierre Bonnard, illustre Parallèlement de Verlaine. Pour Sagesse, il fallait se libérer des droits détenus par les héritiers de Léon Vanier, le premier éditeur ; il fallait aussi modifier les dimensions des dessins de Maurice Denis. Le livre paraît au début de 1911 (achevé d’imprimer : août 1910) et il vient peut-être trop tard, à un moment où commence à se mettre en place « l’esprit nouveau » que défend superbement Apollinaire peu après. Il est certain que « D’une époque à l’autre, [le mouvement nabi] prolonge, comme en pointillé, la ligne d’une autre modernité possible, maintenant en partie refoulée ».
La restitution du fac-similé, outre qu’elle est une édition d’art, donne à lire Verlaine autrement. Pour "Le ciel est par-dessus le toit", par exemple, Maurice Denis a privilégié les connotations religieuses qui ne sont pas du tout dominantes dans ce poème : on retient « la cloche (…) tinte » (2ème strophe), comme élément de paysage (une église) — « Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là » (premier vers de la 3ème strophe) n’appelle pas d’illustration — ; il multiplie les croix et le paysage représenté est un cimetière. Qu’il interprète ou transforme le texte ne remet pas en cause la qualité esthétique des gravures et dessins de dimensions variées qui accompagnent les poèmes, placés en ouverture, embrassant le texte ou en cul-de-lampe. On appréciera les très nombreuses illustrations (dessins préparatoires, parfois tirés de carnets, lithographies et xylographies, détails) réunies dans les études qui suivent le fac-similé. On appréciera aussi la clarté de l’essai de deux responsables de l’édition qui complètent leur étude avec des notes lisibles, une bibliographie à propos de Sagesse, de Maurice Denis et sur le livre nabi.
Verlaine, fac-similé de Sagesse, illustrations de Maurice Denis, suivi de « L’invention du livre nabie », par Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau.Gallimard, collection « livre d’Art », 2025, 104 p. et LVI p.. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 27/10/2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, maurice denis, sagesse | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2025
verlaine, Sagesse
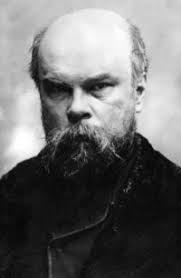
La tristesse, la langueur du corps humain
M’attendrissent, me fléchissent, m’apitoient,
Ah ! surtout quand des sommeils noirs le foudroient,
Uand des draps zèbrent la peau, foulent la main !
Et que mièvre sans la fièvre du demain,
Tiède encor du bain de sueur qui décroît,
Comme un oiseau qui grelotte sur un toit !
Et les pieds, toujours douloureux du chemin,
Et le sein, marqué d’un double coup de poing,
Et la bouche, une blessure rouge encor,
Et la chair frémissante, frêle décor,
Et les yeux, les pauvres yeux si beaux où point
La douleur de voir encore du fini…
Triste corps ! combien faible et combien puni !
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 86
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, sagesse, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2025
Paul Verlaine, Sagesse
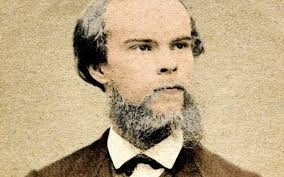
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
Vers les hommes grandes villes,
Ils ne m’ont pas trouvé malin.
À vingt ans un trouble nouveau
Sous le nom d’amoureuses flammes,
M’a fait trouver belles les femmes :
Elles ne m’ont pas trouvé beau.
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l’étant guère,
J’ai voulu mourir à la guerre :
La mort n’a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu’est-ce que je fais en ce monde ?
O vous tous ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, sagesse, orphelin | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2023
Paul Verlaine, L'espoir luit...
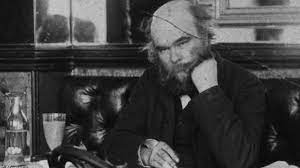
L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table ?
Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé,
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste,
Et je dorloterai les rêves de ta sieste,
Et tu chantonneras comme un enfant bercé.
Midi sonne. De grâce, écartez-vous, madame,
Il dort. C’est étonnant comme les pas de femme
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.
Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre.
Va, dors ! L’espoir luit comme un caillou dans un creux.
Ah, quand refleuriront les roses de septembre !
Paul Verlaine, Sagesse, dans Œuvres poétiques,
Bouquins/Robert Laffont, 2011, p. 203.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, ssgesse, espoir | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2020
Luis Cernuda (1902-1963), La Réalité et le Désir
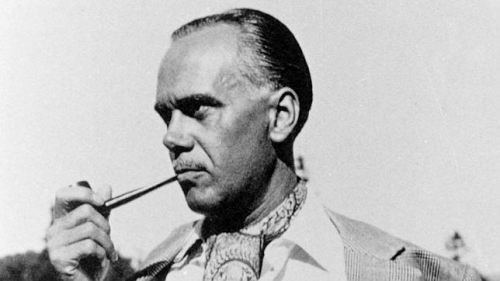
Birds in the night
Le gouvernement français, ou le gouvernement anglais peut-être ? apposa une
plaque
sur cette maison du 8 Great College Street, Camden Town, Londres,
où dans une chambre, Rimbaud et Verlaine, curieux couple,
ont véxu, bu, travaillé, forniqué,
pendant quelques courtes semaines orageuses.
À l’inauguration assistèrent sans doute l’ambassadeur, le maire,
tous ceux qui furent ennemis de Verlaine et Rimbaud quand ils
étaient vivants.
La maison, comme le quartier, est triste et pauvre,
de la tristesse sordide qui va toujours avec la pauvreté,
non de la tristesse funéraire de la richesse sans âme.
Lorsque tombe le soir, comme de leur temps,
sur le trottoir, dans l’air humide et gris, un piano mécanique
joue, et des habitants, au retour du travail,
les uns — les jeunes — dansent, les autres vont au café.
Courte fut l »’amitié singulière de Verlaine l’ivrogne
et de Rimbaud le voyou : ils avaient de longues disputes.
Mais nous pouvons penser que peut-être il y eut
un bon instant pour tous les dexu, du moins si chacun se rappelait
qu’ils avaient laissé derrière eux une mère insupportable et
une ennuyeuse épouse.
Mais la liberté n’est pas de ce monde, et les affranchis
en rupture avec tout, doivent la payer un prix fort.
[...]
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, traduction R. Marrant et A. Schulman, Gallimard, 1969, p. 151 et 153.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir, verlaine, rimbaud, londrès | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2015
Fernando Pessoa, Pour un "Cancioneiro"

Une pluie tombe du ciel gris
Qui n’a aucune raison d’être
Il n’est pas jusqu’à ma pensée
Où ne ruisselle de la pluie.
J’ai en moi plus grande tristesse
Que celle-là que je ressens
Je veux me la dire mais elle
A le poids de ce que je mens.
Car en vérité je ne sais
Si je suis triste ou pas triste,
Et légèrement la pluie tombe
(Car Verlaine y a consenti)
À l’intérieur de mon cœur.
Fernando Pessoa, Pour un « Cancioneiro »,
traduction Patrick Quillier, dans Œuvres
poétiques, Pléiade /Gallimard, 2003,
p. 737-738.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, pour un "cancioneiro", pluie, tristesse, verlaine, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2014
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud

E blanc
Scène 1
La mort couche dans mon lit elle a les dents blanches
Patauger dans la nuit appelle-t-on cela
Vivre O dans ma bouche l’ancolie amère
Des jours anciens mon vieux Verlaine rien ne sert
De pleurer au temps des souvenirs la partie
Est déjà perdue tu n’avais pas su le
Retenir il courait plus vite que le vent
Amants de la mort qu’attendiez-vous de la vie
Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être à ta lèvre
Dolente et non le chapelet à l’angélus
Ah l’ordre comme un petit serpent fourbe arrive
Toujours quad le clocher sonne douze au clair de
Lune le christ O vieille démangeaison
Pauvre lélian habité par un fantôme à
La jambe de bois l’autre en toi O moulin à
Prières
Scène 2
Que cherchais-tu en franchissant le saint-gothard
À demi enseveli dans la neige quelle
Porte par où t’enfuir encore et toujours
O toi l’ébloui sans sommeil dévoré par
Les mouches du rêve et que l’éclair divise à
Jamais hagard comme le faucon
Scène 3
Elle venait sans que j’y prenne garde à pas
De loup et ce cœur en moi s’usait peu à peu
À battre la chamade je ne l’avais pas
Reconnue tant son visage était pâle et
Ressemblait à s’y méprendre à la blanche nuit
Ses regards enjôleurs me grisaient doucement
O comme elle était tendre lorsqu’elle voulut
Me prendre par surprise au petit matin calme
J’aurais pu te quitter sans avoir baisé ta
Bouche tandis qu’à m’étreindre elle buvait mon
Sang O la camarde ma camarade attends
Encore un peu je n’ai pas fini d’inventer
Pour lui les mots du nouvel amour
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud,
Gallimard, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, une lecture de rimbaud, verlaine, mort, ciel, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2014
Guy Goffette, Un Manteau de fortune

Défense de Verlaine
Pauvre Lélian, mon vieux Verlaine, vil défroqué,
qu'ils disent, toute débauche et sale et laid comme
un cochon de Chine, et poivrot par-dessus et,
par-dessous la vase verte quoi ? quoi qui sonne
et qui reste à ton crédit ? une âme qui file
doux sous la laine et vague un peu dans les brouillards ?
mais cette âme-là, cachée sous le noir sourcil,
est d'un ange, ô fruste certes, louche et braillard
comme un arbre peint par la tempête d'un ange,
vous dis-je, qui se fiche bien du tiers et du
quart, pourvu que l'eau des yeux dans son vers se change
en un vin léger qui tremble quand on l'a bu,
tremble encre, tremble longuement, tremble et trouble
jusqu'au lit où, rivières, nous couchons nos vies
petites, blêmes, racornies et parfois doubles
aussi, moins exposées aux vents de toute envie
que toi, Verlaine, parmi les plumitifs et les
rassis, toi, vieil enfant rebelle à tout ce qui
pèse ou qui pose, boiteux à la route ailée
avec l'âme tendre à jamais dans son maquis.
I. Travaux d'aveugle
Ô bucheron assis dans l'ombre
que réveillait l'enfant des bois
près de Rambervilliers, tais-toi,
laisse chanter la voix sans nombre
de l'arbre couché dans ses feuilles.
Elle a comme une femme blonde
dans le sillage de ses pas
jeté le sel du rêve, elle a
cousu nos âmes vagabondes
à la voile bleu de son œil.
Et nous voici, tâchant dans l'ombre
avec des mots de rien des voix
perdues, et des touchers de soie
comme un marieur de décombres
dans tes dentelles, ô poésie.
Guy Goffette, Un Manteau de fortune, suivi de
L'adieu aux lisières et de Tombeau du Capricorne,
Préface de Jacques Réda, Poésie/Gallimard, 2014,
p. 71-72, 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, un manteau de fortune, verlaine, enfant, poésie, vin | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2012
Jacques Demarcq, Les Zozios
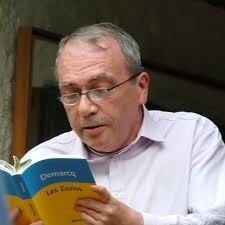
le verlaine
Carnamen caramba
Le ciel par-dessus toi ? que vois-je
de tes dessous monte à l'assaut
quand floue froutant sur le rivage
tu viens rincer l'œil du ruisseau
De dentelles te soudoient... nuages
dont l'air s'essouffle en cui-cui sots
léché partout d'émoi ; j'en nage
de tiédeur soûl — honte à l'oiseau
Qui s'émeut ; tant et plus que haut
tirant de ma queue la plume
s'y dresse un voli volume
de frais titillés pohumes
Dotée d'ailes de surcroît, l'image
de mes doigts fous compte aller où
— Vers l'aine ?
*
Oh merci mon cœur
ce bel ange au nid
qui se glisse et rit
berçant persifleur
ma mélancolie
Ce merle oui moqueur
pris de griverie
d'un mélange honni
perçant postérieure
la merde en colique
*
Le pipeau à Popol
pis que pitre il est fol
si l'artiste est l'Arthur
qui le sifflet cajole
Dans sa cage il carbure
et gazouille au gazole
si tenté qu'ailé vole
au verger d'envergure
Puis d'invertir les drôles
à l'attaque au lard dur
dans ma carne à la gnôle
et crie cuite le grill sur
Zizique avant toute
rose
le reste au lit n'est que rature
Jacques Demarcq, Les Zozios, éditions NOUS, 2008, p. 238-239.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, les zozios, verlaine | ![]() Facebook |
Facebook |





