27/09/2025
Charles Reznikoff, Holocauste

IV
GHETTOS
1
Au début il y avait deux ghettos à Varsovie :
un petit et l’autre grand,
et entre eux un pont.
Les Polonais doivent passer sous le pont et les Juifs dessus ;
et à côté, se trouvaient des gardes allemands pour voir si les Juifs ne se mêlaient pas aux Polonais.
Du fait des gardes allemands
tout Juif qui ne retirait pas son chapeau en signe de respect en traversant le pont
était abattu —
et beaucoup le furent —
et certains furent abattus sans aucune raison du tout.
2
Un vieil homme portait des morceaux de bois à brûler
pris dans une maison qui avait été détruite :
on n’avait donné aucun ordre contre ça —
et il faisait froid.
Un commandant S.S. le vit
et lui demanda où il avait pris ce bois,
et le vieil homme répondit que c’était dans une maison qui avait été détruite.
Mais le commandant sortit son pistolet,
le plaça sur la gorge du vieil homme
et l’abattit.
3
Un matin des soldats allemands et leurs officiers
entrèrent de force dans les maisons du quartier où les Juifs avaient été rassemblés,
en criant que tous les hommes devaient sortir ;
et les Allemands prirent tout dans les armoires et les placards.
Parmi les hommes se trouvait un vieil homme portant la robe — et le chapeau — de la secte pieuse des Juifs qu’on nomme les Hassidim.
Les Allemands lui mirent une poule dans les mains
et on lui dit de danser et de chanter ;
puis il dut faire semblant d’étrangler un soldat allemand
et cela fut photographié.
[…]
6
À trois heures un après-midi
une cinquantaine de Juifs étaient dans une cave.
Quelqu’un poussa le sac qui bouchait l’ouverture
et ils entendirent une voix :
« Sortez !
Sinon nous allons lancer une grenade. »
Les S.S. et la police allemande avec des bâtons dans les mains
se tenaient prêts
et se mirent à frapper ceux qui se trouvaient dans la cave.
Ceux qui en eurent la force
furent mis en file selon les ordres
et furent emmenés vers une place
et alignés sur un seul rang pour être abattus.
Au dernier moment
un autre groupe de S.S. arriva et demanda ce qui se passait.
Un de ceux qui étaient prêts à tirer répondit
qu’ils avaient sorti les Juifs d’une cave
et qu’ils s’apprêtaient à les abattre selon les ordres.
Le commandant du second groupe dit alors :
« C’est des Juifs gras.
Tous bons à faire du savon. »
Et ils emmenèrent les Juifs à un convoi
qui n’était pas encore parti pour un camp de la mort —
des wagons de marchandises russes sans marchepied —
et ils durent se hisser l’un l’autre dans les wagons.
Charles Reznikoff, Holocauste, traduit de l’américain et préfacé par Auxeméry, suivi d’un entretien avec Charles Reznikoff, Prétexte éditeur, 2007, p. 28-30 et 32-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, holocauste, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2021
Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse

Quand je déclare que je suis juif, il se produit ceci : à ces trois mots monosyllabiques apparaît dans l’air une minuscule boule blanche élastique, à peu près de la grosseur d’un pois, entre mon visage et celui de mon interlocuteur, et lui bondit dans la bouche. Là-dessus, cette bouche se ferme, une espèce de jalousie descend de la naissance des cheveux sur le visage, ce qui fait que la petite boule emprisonnée sautille à présent à l’intérieur entre jalousie et occiput en toupillant dans un va-et-vient continuel. Par l’effet de la gravitation, chaque ricochet s’y situe un soupçon plus bas que le précédent, la menue boule perd graduellement d’altitude et de latitude, par conséquent, elle baisse tout en toupillant toujours plus vite jusqu’à s’engager finalement dans le gosier où elle est alors avalée sans préjudice de son toupillement. À présent la jalousie se relève, se retire à sa place habituelle sous la boîte crânienne, la bouche s’ouvre et commence à parler, mais à aucun prix, sous aucun prétexte du phénomène qui vient de se dérouler.
Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse, traduction Raymond Barthes, Gallimard, 1971, p. 105-106.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian enzensberger, essai de quelque envergure sur la crasse, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2020
Johannes Bobrowski, Terre d'ombres fleuves

Récit
Rajla Gelblung
échappée à Varsovie
d’un transport parti du Ghetto,
la fille
a traversé des forêts,
avec une arme, la partisane
fut prise
à Brest-Litowsk,
portait une capote (de soldat polonais),
fut interrogée par des officiers
allemands, il y a
une photographie, les officiers sont
des personnes jeunes, aux uniformes impeccables,
aux visages irréprochables,
leur apparence
est exemplaire.
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,
traduction Jean-Claude Schneider, Atelier
La Feugraie, 2005, p. 137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d’ombres fleuves, récit, ghetto, juif, camp | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2019
Albert Cohen, Carnets, 1978

Elle chante, cette vois, et elle glorifie l’homme de nature qui est un pur animal et de proie, le fauve qui est noble et parfaite créature, un seigneur sans l’humilité née de la faiblesse. Elle chante cette voix attirante et souveraine des forêts, chante la louange des dominateurs, des intrépides et des brutaux. (…) Et cette voix de nature, de tant de poètes et de philosophes accompagnée, se rit de la justice, se rit de la pitié, se rit de la liberté, et elle chante, mélodieuse et convaincante, chante l’oppression de nature, l’inégalité de nature, la haine de nature, la tuerie de nature. (…)
Telle est la voix de la nature. Et, en vérité, lorsque les hommes de Hitler adoraient l’armée et la guerre, qu’adoraient-ils sinon les canines menaçantes du gorille debout, tout trapu et pattes tordues devant l’autre gorille ? Et lorsqu’ils chantaient leurs anciennes légendes et leurs ancêtres cornus, oui cornus, car il s’agit avant tout de ressembler à une bête et il est sans doute exquis de se déguiser en taureau, que chantaient-ils sinon un passé tout de nature, un passé animal dont ils avaient la nostalgie et par quoi ils étaient attirés. Et lorsqu’ils exaltaient la force et les exercices du corps et els nudités au soleil (…) qu’exaltaient-ils et que vantaient-ils sinon le retour à la grande singerie de la forêt préhistorique ? Et en vérité lorsqu’ils massacraient ou torturaient mes Juifs, ils punissaient le peuple ennemi, le peuple de la Loi et des prophètes, le peuple qui a voulu l’avénement de l’humain sur terre.
Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 138-139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, nature, culture, nazisme, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2019
Jean Bollack, Au jour le jour

X 1311
Primo Levi, lors de son deuxième retour à Auschwitz en 1982, s’exprime sur les négationnistes : « celui qui nie Auschwitz est celui-là même qui serait prêt à le recommencer ». Cette dernière phrase de son livre(1)est simple. On ne peut le dire mieux, ni plus justement.
1. Primo Levi, Rapport sur Auschwitz, présentation Philippe Mesnard, Kimé, 2005.J
Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F., 2013, p. 493.© Photo Tristan Hordé, 2006.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, juif, auschwitz, primo levi | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2018
Esther Tellermann, Première version du monde

C’était un temps philosophique, je suis je ne suis pas, un époque fascinée, un peu grasse, avec le souvenir des armes, canons contre la tempe, fosses enfin pleines, uniformes, chants d’oiseaux,
il y a des flaques qui coagulent la haine, et pourquoi ça se serait cicatrisé, non, dissocié dans les moindres parcelles, suis les sillons, la terre n’est pas oublieuse, il ait trop chaud désormais, ça dilate notre faiblesse en une légère déviation de la peur…
Certains ont encore les mains sur les pioches, ils creusent comme à la surface d’un liquide, certainement ils veulent enterrer leur ombre, la lèvre halète un gémissement, la soirée est trop chaude, les mots engloutis dans la fissure originelle.
Nous étions sans existence, sans dehors. C’était une répétition nostalgique de l’Europe, de sa dimension de néant, la durée suffocante de notre propre humiliation.
Vieux youpins, youpinasses, y’a pas qu’eux pour bouffer du salpêtre, vas-y prends ta ration, j’vais voir en bataillons humanitaires toutes les enflures du programme : échauffement des ongles, bûchers funéraires, camions de rustines pour réparer ça, t’as compris ? Visages fiévreux, tous les affranchis faut voir ça, ils s’affermissent dans les désastres, balance-leur le savon, les cigarettes, ça va passer leurs convictions, toute une vie près du fleuve, dans le bourdonnement des mouches…
Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, récit, passé, europe, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2017
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) comment a-t-on le droit d’apprendre à lire, à écrire, si la lecture et l’écriture conduisent à légitimer la mort de jeunes hommes valides, ni soldats, ni combattants, de femmes, d’enfants, de vieillards ? comment peut-on apprendre à lire, à écrire les alphabets de langues dans lesquelles ont été pensées et consignées, en toute légalité, des lois (en France, en Italie, en Allemagne) qui triaient les humains, séparant ceux qui étaient destinés à la vie de ceux qui devaient disparaître pour « raison de naissance » ?
Les mots formés par ces alphabets, la grammaire, la syntaxe de ces langues avaient autorisé, légitimé même, les mécanismes intellectuels et les rouages techniques de l’administration d’un génocide industriel. Non pas comme dans une guerre géopolitique, qui se déroule avec un début e tune fin, quand on tue des ennemis pour l’emporter dans un conflit, mais comme dans une extermination métaphysique, sans fin, hors du temps et de l’espace, où les actions résultent d’une haine inexpiable où la mort elle-même se dérobe aux mortels.
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, La librairie du xxe siècle, Seuil, 2017, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, langue, génocide, haine, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2016
Jean Bollack, Au jour le jour
En hommage à Jean Bollack (15 mars 1923-4 décembre 2012)

10 avril 2010
Nazis
X 2011, 8. VI. 2007
Beaucoup d’allemands devaient se dire au cours de la guerre, ou avant, que l’aventure nazie n’allait pas durer. S’ils n’ont pas pensé aux conséquences, c’est que la plupart, sinon tous, préféraient y croire, et profiter pour eux-mêmes de ce qu’ils considéraient encore comme un avantage et une promotion. L’ascension était plus personnelle et existentielle que sociale ou politique. Les dirigeants savaient la susciter.
Poésie
X 740
Les poèmes sont une seule lutte, requérant le droit à la différence ; tous les poètes sont « juifs » ; ils sont juifs positivement par l’indépendance, à savoir la non-appartenance. Ils revendiquent la liberté à l’endroit de toutes les traditions religieuses. Il y aurait comme une religion de la non-appartenance qui s’exprime le plus fortement dans le domaine de la grande poésie allemande.
Jean Bollack, Au jour le jour, PUF, 2013, p. 609 et 763.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, nazi, savoir, poésie, juif, appartenance | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2016
Julien Bosc, De la poussière sur vos cils : recension
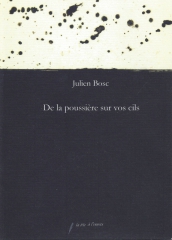
Les vers en exergue extraits de Dans la Conversation, recueil de Jacques Lèbre, orientent la lecture du livre : les corps gazés dans les camps de la mort ont été brûlés et « quelques-uns peuvent dire encore / [...] j’ai vu la fumée s’élever dans le ciel ». Le long ‘’poème prosé’’ de Julien Bosc n’est pas un récit, on y lit des « scories de l’innommable », les traces de ce que des témoins ont écrit, ce qui demeure pour nous de ce qu’ils ont vécu — « quelqu’un cette nuit écrit à partir d’une mémoire qui n’est pas la sienne ». Et d’abord un mur, mur de mémoire, « preuve » du passé et qui porte des noms : pour sa construction, sont énumérés tous les matériaux qui ont été utilisés au cours du temps en divers lieux pour bâtir un mur, marbre, pierre, banco, etc. Rien de tout cela ne convient, et à la question de sa matière une seule réponse : « — Telle la mémoire ? / — Tel le miroir sans tain de la souvenance oui. » Mais la parole sur ce qui fut semble impossible, il n’y aurait que « les mots creusés sur le vide », et cependant personne n’a, aujourd’hui, « le droit d’oublier ce que nous ne pouvons raconter ». C’est à partir de cette impossibilité qu’écrit Julien Bosc.
Ce qui peut être écrit l’est ici dans une forme particulière. Deux personnages, Lui et Elle, dialoguent dans divers lieux ; au début la nuit dans un pré, plus tard dans un hôpital pour la guérir de la folie née du souvenir de l’holocauste (« Elle perdit la raison »), puis dans un village « Entre la montagne et la mer ». Leurs échanges sont parfois accompagnés d’un commentaire et s’achèvent par un fragment en italique, introduit par le « Ô » du lyrisme et reprenant littéralement ou pour le sens ce qui précède. On pense à un livret d’opéra ou à une tragédie, avec dialogues, voix hors champ ou didascalies, intervention d’un chœur, et ce d’autant plus que les répliques sont toujours brèves, la syntaxe et le vocabulaire dépouillés, des fragments de dialogue répétés, la répétition se produisant aussi dans une réplique :
Jamais, jamais je n’ai pu, je n’ai pu jamais, jamais pu, jamais, mais malgré moi tout le temps, minute après minute, nuit et jour sans répit, ni rien, sans répit ni rien, ni rien pouvoir, rien pouvoir faire, rien pouvoir faire taire, à en devenir folle. Folle.
La folie naît du souvenir des camps de la mort, ceux de la ‘’solution finale’’, ce qu’explicite un seul échange :
— Votre nom est-il juif ?
— Oui.
— Êtes-vous juif ?
— Oui.
— Êtes-vous innocent ? Êtes-vous coupable ?
Réponse qui ne peut être entendue : une pierre « est-elle innocente ou est-elle coupable ? ».
La seule amorce de récit du livre est présentée comme un rêve par l’homme, elle décrit un lieu d’où l’on ne peut sortir, un couloir, où des chiens dévorent le visage et le nom, métaphore de l’identité à faire disparaître. Les images de destruction brutale abondent dès l’ouverture ; le dialogue évoque d’abord une porte et des fenêtres, pourtant il ne s’agit pas d’une maison, d’un refuge, la clef est perdue, une main broyée, les yeux aveugles, l’ordre même de la nature défait avec le « givre incandescent ». La poussière sur les cils ? non, ce sont les cendres qui retombent, et avant la mort ce sont les fils barbelés, la langue tranchée, le nom broyé, « les wagons de la mort et la folie dans les wagons ».
Que reste-t-il après « la nuit du retour sans retour » ? Le livre pourrait s’achever sur des questions comme celles-ci, « Quel témoin ? Le témoin du récit ? Quel récit ? » Il reste des noms, des noms inscrits sur un mur, dans la mémoire, et reste donc « le récit d’un mur ». Le hasard des publications a mis sur ma table le livre de Julien Bosc et un entretien de Philippe Beck, ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’(1) ; j’en détache pour conclure quelques lignes, qui disent aussi la nécessité pour la poésie d’écrire après les témoins : « Les proses de témoignage (le réel prosant et prosé) en disent toujours plus. C’est l’excès qui demande la poème, selon moi, et en réponse aux vers de Celan : « Niemand / zeugt für den / Zeugen. » (« Gloire de cendres », dans Renverse du souffle). « Nul / ne témoigne pour le / témoin. » Le poète ni le romancier ne témoignant à la place du témoin, et cela se dit en vers libres ; le « témoin » est rejeté après le deuxième vers — le suspens est catégorique. Mais le témoin n’est pas seul et sa prose est précédée, parlée déjà ; elle doit être continuée. »
——————————————————————————————
1. ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’, entretien de Philippe Beck avec Frédéric Detue, dans Europe, ‘’Témoigner en littérature’’, janvier-février 2016, p. 221-235. L’ensemble du numéro, dès l’introduction de Frédéric Detue et Charlotte Lacoste, est remarquable.
Julien Bosc, De la poussière sur vos cils, La tête à l'envers, 2015, 13, 50 €.
Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 février 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, de la poussière sur vos cils, jacques lèbre, shoah, folie, mémoire, témoin, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2015
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure — Le retour au livre

L’étranger
La coquetterie des choses
à paraître ce qu’elles sont
Le monde est une coterie
L’étranger a du mal à s’y faire entendre
On lui reproche gestes et langue
Et pour sa patiente courtoisie
récolte injures et menaces
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure, Poèmes
1943-1957, Gallimard, 1959, p. 265.
Chanson
Sur le bord de la route,
il y a des feuilles
si fatiguées d’être feuilles,
qu’elles sont tombées.
Sur le bord de la route,
il y a des Juifs
si fatigués d’être juifs,
Qu’ils sont tombés.
Balayez les feuilles.
Balayez les Juifs.
Les mêmes feuilles repoussent-elles au printemps ?
Y a-t-il un printemps pour les Juifs piétinés ?
Edmond Jabès, Le Livre des questions, III : Le retour au livre, Gallimard, 1965, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, le retour au livre, étranger, juif, feuille | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2015
Walter Benjamin, Rastelli raconte, traduction Philippe Jaccottet

Le souhait
Un soir, pour la fin du sabbat, les juifs étaient réunis dans une misérable auberge d’un village de Hasidim. C’étaient des gens du coin, à l’exception d’un individu que personne ne connaissait, un homme en haillons, particulièrement misérable, accroupi dans l’ombre du poêle, tout au fond de la salle. On avait parlé à bâtons rompus. Soudain, quelqu’un demanda quel souhait chacun ferait, si on lui en accordait un. L’un voulait de l’argent, l’autre un gendre, le troisième un établi neuf, et ainsi de suite.
Quand chacun eut opiné, il ne resta plus que le mendiant du coin du poêle. Celui-ci n’obtempéra aux questionneurs que de mauvaise grâce et non sans hésiter :
— Je voudrais être un roi très puissant, régnant sur une vaste contrée, et qu’une nuit, comme je dormirais dans mon palais, l’ennemi franchit la frontière et qu’avant les premières lueurs de l’aube ses cavaliers eussent atteint mon château sans rencontrer de résistance et que, brutalement tiré de mon lit, sans même le temps de passer un vêtement, j’eusse dû prendre la fuite, en chaise, traqué jour et nuit sans relâche par monts et vaux, forêts et collines, jusqu’à trouver refuge ici même, sur un banc, dans un coin de votre auberge. Tel est mon souhait.
Les autres se regardaient, interloqués.
— Et qu’en aurais-tu de plus ? demanda quelqu’un.
— Une chemise, répondit le mendiant.
Walter Benjamin, Rastelli raconte, traduction Philippe Jaccottet, Points / Seuil, 1987, p. 92-93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, rastelli raconte, traduction philippe jaccottet, juif, sabbat, souhait, rêve, mendiant | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2015
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduction Jean-Caude Schneider

Le chaos judaïque
Un jour, il arriva chez nous une personne qui nous était parfaitement étrangère, une jeune fille d’une quarantaine d’années, avec un petit chapeau rouge, un manteau pointu et de méchants yeux noirs. Prétextant qu’elle était originaire de la bourgade de Chavli, elle exigeait qu’on la mariât à Pétersbourg. Avant que nous ayons réussi à nous en débarrasser, elle avait passé une semaine à la maison. Parfois, des auteurs ambulants faisaient leur apparition ; c’étaient des gens barbus et aux longs vêtements, des philosophes talmudiques, des colporteurs de maximes et aphorismes de leur fabrication. Ils laissaient des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de méchantes épouses. Une ou deux fois dans ma vie, on me conduisit à la synagogue, comme s’il s’agissait d’un concert, après de longs préparatifs, c’est tout juste si l’on n’achetait pas un billet à un revendeur ; et ce que je voyais et entendais me faisait revenir dans une lourde hébétude. Il y a, à Pétersbourg, un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marie, là où gèlent les revendeurs de billets, derrière l’angle de la prison de Lithuanie, qui a brûlé pendant la révolution. Là, dans les rues du Commerce, on rencontre des enseignes juives, avec un bœuf et une vache, des femmes avec des cheveux postiches qui s’échappent de leur fichu et des vieillards plein d’expérience et d’amour pour les enfants, trottinant dans leur redingote tombant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux pointus et ses bulbes, comme un somptueux figuier étranger, se perd au milieu de pauvres bâtisses.
[...]
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit du russe et annoté par Édith Scherrer, préface de Nikita Struve, Christian Bourgois, 2006 [L’Âge d’homme, 1972], p. 47-48.
Le chaos judaïque
Un jour, une personne totalement inconnue s’est présentée chez nous, une jeune fille d’environ quarante ans à chapeau rouge, au menton pointu, l’œil noir et mauvais. prétextant être originaire du bourg de Chavli, elle exigeait qu’on lui trouve un mari à Péterbourg. Elle resta une semaine à la maison jusqu’à ce qu’on réussisse à s’en débarrasser. De temps à autre des écrivains itinérants s’arrêtaient chez nous : personnages barbus, à longues basques, philosophes talmudistes, colporteurs d’aphorismes et apophtegmes imprimés et rédigés par eux-mêmes. Ils laissaient en partant des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de mauvaises femmes. Une fois ou deux dans ma vie on m’emmena à la synagogue, non sans de longs préparatifs, comme pour un concert, tout juste si l’on n’avait pas acheté un billet chez des revendeurs ; après ce que j’y ai vu et entendu, j’en suis revenu l’esprit péniblement enfumé. Pétersbourg a un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marinski, là où les revendeurs de billets gèlent devant l’ange du château de Lituanie, la prison incendiée lors de la révolution. Là, dans les deux rues du Commerce, on tombe sur des enseignes juives, avec taureau et vache, sur des femmes dont les fichus laissent échapper des cheveux postiches, et sur des vieillards pleins d’expérience, affectueux avec les enfants, et qui trottinent dans leur redingote traînant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux coniques et ses coupoles en bulbe, son air d’exotique et fastueux figuier, s’était égarée entre de misérables bâtisses.
[...]
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit et présenté par Jean-Claude Schneider, éditions Le bruit du temps, 2012, p. 45-46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, le bruit du temps, traduction jean-caude schneider, juif, pérzesbourg, synagogue, enfance, mariage | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2014
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

Chanson du dernier enfant juif
Mon père est pendu à l’étoile,
ma mère glisse avec le fleuve,
ma mère luit
mon père est sourd,
dans la nuit qui me renie,
dans le jour qui me détruit.
La pierre est légère.
Le pain ressemble à l’oiseau
et je le regarde voler.
Le sang est sur mes joues.
Mes dents cherchent une bouche moins vide
dans la terre ou dans l’eau,
dans le feu.
Le monde est rouge.
Toutes les grilles sont des lances.
Les cavaliers morts galopent toujours
dans mon sommeil et dans mes yeux.
Sur le corps ravagé du jardin perdu
fleurit une rose, fleurit une main
de rose que je ne serrerai plus.
Les cavaliers de la mort m'emportent.
Je suis né pour les aimer.
Edmond Jabès, Chanson pour le repas de l’ogre, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 69.
Autour d’un mot comme autour d’une lampe. Impuissant à s’en défaire, condamné, insecte, à se laisser brûler. Jamais pour une idée mais pour un mot. L’idée cloue le poème au sol, crucifie le poète par les ailes. Il s’agit, pour vivre, de trouver d’autres sens au mot, de lui en proposer mille, les plus étranges, les plus audacieux, afin qu’éblouis, ses feux cessent d’être mortels. Et ce sont d’incessants envols et de vertigineuses chutes jusqu’à l’épuisement.
Parler de soi, c’est toujours embarrasser la poésie.
Il y a des êtres qui, leur vie durant, sont demeurés la tache d’encre au bout d’une phrase inachevée.
Un jour, la poésie donnera aux hommes son visage.
Le lecteur seul est réel.
La poésie est fille de la nuit. NOIRE. Pour la voir il faut ou braquer sur elle une lampe de poche — c’est pourquoi, figée dans sa surprise, elle apparaît à nombre de po ètes comme une statue — ou bien, fermer les yeux pour épouser la nuit. Invisible, puisque noire dans le noir, pour se manifester à vous, la poésie fera usage alors, de sa voix. Le poète se laissera fléchir par elle. Il ne s’étonnera plus lorsque, confiante, cette voix, pour lui, prendra la forme d’une main : il lui tendra les siennes.
Lorsque les hommes seront d’accord sur le sens de chaque mot, la poésie n’aura plus de raison d’être.
À l’approche du poème, aurore et crépuscule redeviennent la nuit, le commencement et le bout de la nuit. Le poète y jette alors son filet, comme le pêcheur à la mer, afin de saisir tout ce qui évolue dans l’invisible, ces myriades d’êtres incolores, sans souffle et sans poids, qui peuplent le silence. Il s’emparera, par surprise, d’un monde défendu dont il ignore les limites e tla puissance et surtout l’ empêchera, une fois pris de périr ; les êtres qui le composent, comme les poissons, préférant la mort à la perte de leur royaume.
Hanté par chaque ombre perpétuée indéfiniment, il déchire un rideau de velours, paupière du secret.
La poésie n’a qu’un amour : La poésie.
Edmond Jabès, Les mots tracent, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 156, 157, 158, 158, 159, 163, 164, 165, 165.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, enfant, juif, poésie, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |





