20/08/2015
Edward Estlin Cummings, Paris

plus
pâle
que tous les pourquois
tapis
entre tes omoplates découvertes. — Voici
venir un solide gaillard en sarrau
de l’autre côté de la fenêtre, touchant les becs
de gaz un à un de sa canne
magique (au bout de laquelle une boule
de feu bouillonne enthousiaste)
vois
là et là ça explose
silencieux en crocus d’éclats. (Cela fait bien assez
de vie pour toi. Je comprends. Une fois
encore...) glissant
un peu plus bas ; embrasse-moi de ton corps soudain
incurvant de complètes questions chaudes
Edward Estlin Cummings, Paris, traduit de l’anglais et présenté par
Jacques Demarcq, Seghers, 2014, p. 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, paris, jacques demarcq, magie, feu, baiser | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2015
Cummings, font 5
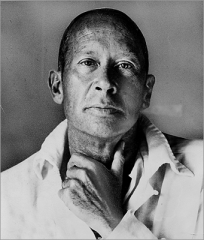
en dépit de tout
ce qui respire et bouge, puisque le Destin
(de ses très longues mains blanches
arrangeant chaque pli)
lissera entièrement nos esprits
— quand de quitter ma chambre
je me retourne, et (me penchant
dans le matin) j’embrasse
cet oreiller, chérie
où nos têtes ont vécu, ont été
Cummings, font 5, traduction et postface
de Jacques Demarcq, 2011, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, font 5, destin, chambre, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2015
Cummings, 95 poèmes
72

je veux bien que la vie
ne vaille de mourir, si
(et quand) les roses se plaignant
que leurs beautés sont vaines
mais pour l’espèce humaine
juger toute mauvaise graine
une rose, les roses (j’en suis
sûr) aussitôt sourient
Cummings, 95 poèmes, traduit
et présenté par Jacques Demarcq,
Points/Seuil, 2006, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, 95 poèmes, vie, mourir, rose, beauté | ![]() Facebook |
Facebook |
17/08/2015
Cummings, No Thanks

10
petit homme
(à tout allure
pris d’une énorme
inquiétude)
halte arrête oublie du calme
attends
(petit enfant
qui as tenté
qui as échoué
qui a pleuré)
couche-toi bravement
et dors
grande pluie
grande neige
grande lune
grand soleil
(pénètrent
en nous)
Cummings, No Thanks, NOUS,
traduit et présenté par Jacques
Demarcq, 2011, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, no thanks, homme, enfant, oubli, échec, sommeil | ![]() Facebook |
Facebook |
16/08/2015
JUles Renard, Journal

Formules pour accuser réception des livres :
— Voilà un livre qui est bien à vous, cher ami, et je suis heureux de vous le dire.
— Merci ! J’emporte votre livre à la campagne. Je le lirai sous les arbres, au bord de l’eau, dans un décor digne de lui.
Il n’y a aucune différence entre la perle vraie et la perle fausse. Le difficile, c’est d’avoir l’air désolé quand on casse ou qu’on perd la perle fausse.
L’homme vraiment libre est celui qui sait refuser une invitation à dîner, sans donner de prétexte.
Lis toutes les biographies des grands morts, et tu aimeras la vie.
Comme on serait meilleur, sans la crainte d’être dupe !
Jules Renard, Journal, texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard 1961, p. 292, 294, 300, 302, 313
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, livre, perle, liberté, biographie, tromperie | ![]() Facebook |
Facebook |
15/08/2015
Murasaki-Shikibu, Poèmes

D’un homme qui, las d’avoir frappé ma porte, s’en était retourné, le lendemain, au matin :
Fût-ce sur les bords
de la mer occidentale
balayée des vents
a-t-on jamais vu la grève
aux vagues inaccessibles ?
En réponse à ces reproches :
Retournée chez elle
peut-être comprendra-t-elle
qu’elle s’est lancée
à l’assaut d’un rude écueil
la frivole vaguelette
Au retour de l’an, comme l’on me demandait si ma porte était désormais ouverte :
De qui rossignol
a-t-il donc en ce printemps
hanté la demeure
pour ainsi se présenter
au logis voilé de brume
Murasaki-Shikibu, Poèmes, traduction du japonais par René Sieffert, P. O. F, 1986, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : murasaki-shikibu, poèmes, mer, printemps, rossignol | ![]() Facebook |
Facebook |
14/08/2015
Eugène Sawitzkaya, Fraudeur

Les champs secs ou le parc brumeux.
Il a toujours aimé l’eau mais adore le grattement du chaume contre ses chaussures, l’odeur et le chant des tuyaux de paille dorée. D’un côté la croupe argileuse, de l’autre le limon d’une rivière er de son affluent. Entre deux fossés, remblais de terre herbeuse, un chemin creux ancien comme le village dont il s’éloigne. Entre deux haies d’ifs, une allée vers le château qu’il laisse pour demain, pour plus tard. Plus tard les jeunes filles aux jambes nues sur la pelouse descendant vers l’étang. Aujourd’hui, préfère l’ornière au fond de laquelle se tapit le lièvre au poil clair quand le vent du nord souffle transportant le vacarme d’un train de marchandises.
Un été torride, le parc ouvrait ses grilles et le garçon suivit le ruisseau d’eau pure et vit le poisson d’or nageant sur un fond de coquilles vides blanches comme nacre ou onyx. Ce poisson avait la forme et la délicatesse d’un pied d’enfant ; ses nageoires s’agitaient comme des voiles d’un mouvement régulier et souple. Le poisson nageait contre le courant, se déplaçait latéralement, se couchait sur le flanc, actif et lumineux
Eugène Sawitzkaya, Fraudeur, éditions de Minuit, 2015, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène sawitzkaya, fraudeur, eau champ, chemin, fille, lièvre, poisson | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2015
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

(1936)
23 avril 1934
Cette femme dont je suis amoureux et moi, nous suivons notre histoire dans une publication hebdomadaire illustrée destinée aux enfants. Chaque semaine, nous achetons un fascicule et, dans les petits blocs de textes comme dans la suite d’images qu’ils commentent, nous trouvons décrit tout ce que nous ferons.
8-9 mai 1934
Le même très jeune femme et moi, nous nous résentons dans une école, sans doute pour en devenir les élèves. C’est une villa avec jardin. On nous introduit dans une sorte de paillotte circulaire à toit conique (telle que j’en ai vu au Soudan) : chenil où des bêtes de toutes races sont couchées dans la paille. Un portier ( ?), probablement nègre, en uniforme et coiffé d’une casquette de marine, nous dit que c’est là que nous habiterons. Nous devons coucher sous les chiens.
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 116 et 117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuits sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2015
Catherine Pozzi, Poèmes

Infusoire, infusoire,
Viens te poser sur ma main.
Tu me diras le chemin
De la gloire.
Sous le soleil illusoire
Du havre laboratoire,
Ha, dirige ta nageoire
Vers mon transparent destin.
Sois mon serin, mon carlin,
Mon béguin enfin bénin
Sois ma dernière victoire
Infusoire !
Catherine Pozzi, Poèmes, édition
Claire Paulhan et Lawrence Joseph,
Poésie/Gallimard, 2002, p. 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, poèmes, infusoire, main, gloire, destin, béguin | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2015
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau

Je n’ai pas honte de le dire : je ne veux pas que ma viande soit blanche. Je ne supporterais pas la moindre coloration interne. Tous ceux qui m’entourent ont beau faire les fiers-à-bras, les m’as-tu-vu, leur rêve secret, c’est l’immaculé de la chair. N’est-ce pas la seule façon de rendre hommage à nos maîtres ? Eux qui s’usent au travail pour nous permettre d’atteindre cette beauté : une viande blanche, ferme et légèrement rosée. Ce teint délicat fait ressortir la santé et la joie qui nous transportent. Comme le rose aux joues, si beau, si recherché sur le visage des petits d’homme. Moi, c’est dedans que je veux afficher cettesanté visible. La carnation du visage, nous la portons à même la chair, au plus profond. On nous désire pour cela. Il n’est pas facile de soutenir une telle constance. Un rien, le moindre faux pas alimentaire, et ce sont des jours d’efforts, de restriction avant de retrouver un visage de lait. Certains humains arrivent à une blancheur égale à la nôtre, mais est-ce vraiment naturel ?
Jean-Louis Giovannoni, Journal d’un veau, roman intérieur, éditions Léo Scheer, 2005, p. 23-24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, journal d'un veau, blancheur, chair, santé | ![]() Facebook |
Facebook |
10/08/2015
Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort

On attend
depuis le premier jour
qu’on nous touche
le centre
Certains
ont voulu venir
mais n’ont pas été loin
Nous ne sommes peut-être pas
assez élastiques
*
On ne se croise pas
Chacun son enveloppe
*
Il ne faut pas croire
les animaux
différents de nous
Ils attendent
qu’on leur mette les mains dedans
Il fait noir
au milieu de la viande
*
On ne caresse jamais
l’intérieur d’un corps
*
On pense
que quelqu’un viendra pour aider
à nous retenir
C’est une erreur
Le corps se sectionne dans le corps
Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort,
éditions Unes, 1991, p. 9-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, garder le mort, attente, viande, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2015
Guillevic, Accorder - Être un arbre

Être un arbre
Être un arbre
J’en ai vu
Me signifier
Qu’ils refusaient,
Me prenaient à témoin
De leur insurrection.
Ce n’est pas quand je le désire
Que je suis arbre,
Mais quand l’arbre,
À son heure,
Décide
Que je suis son double
Et jamais
Je ne me suis récusé
Non, je ne me dégagerai pas
Des racines
Je vis
Comme si toutes les racines
Passaient par moi,
Me nourrissant
D’une partie de cette sève
Qu’il leur faut composer.
Guillevic, Accorder, poèmes, 1933-1996,
édition établie par Lucie Albertine Guillevic,
Gallimard, 2013, p. 71-72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, accorder, être un arbre, racines | ![]() Facebook |
Facebook |
07/08/2015
Eugenio Montale, Derniers poèmes - Ce qui en reste (s'il en reste)

Ce qui en reste (s’il en reste)
la vieille servante illettrée
et barbue enterrée Dieu sait où
pouvait lire mon nom et le sien
comme des idéogrammes
peut-être ne pouvait-elle se reconnaître
pas même dans une glace
mais elle gardait l’œil sur moi
tout en ne sachant de la vie rien
elle en savait bien plus que nous
dans la vie ce que l’on gagne
d’un côté on le perd de l’autre
Dieu sait pourquoi je me la rappelle
plus que tout et que tous
si elle entrait maintenant dans ma chambre
elle aurait cent trente ans et je crierais d’effroi.
(20 mars 1976)
Eugenio Montale, Derniers poèmes, Poésies VI, traduction de Patrice Dyerval Angelini, Gallimard, 1988, p. 103.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugenio montale, derniers poèmes, servante, idéogramme, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
06/08/2015
André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre
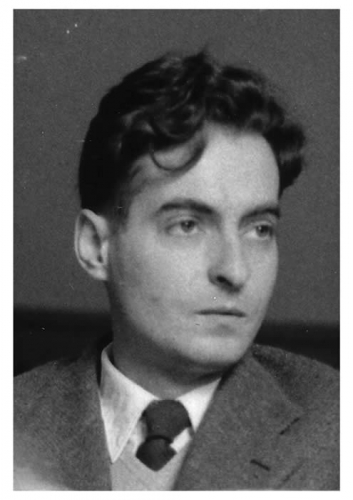
[...]
où le pas est encore plus rare qu’ici, on aura ramassé dans le désert un biface déposé là, où il sera tombé, depuis quelques milliers d’années : la face tournée au dehors, polie, lustrée par le vent. l’autre, au sol, qu’elle n’a pas quitté, mat et sans lustre. puis, venue jusqu’à la table du paléontologue qui alors en aura parlé.
rien alors, dans ces carnets, qui n’ai été noté dehors, alors que du dehors très peu en soit rendu compte. mais dehors, comme sortir de soi d’abord sans projet — dehors sans projet, comme retour au silence antérieur lorsque j’avance, qui sera porteur de la parole inattendue qui sera, par éclats, trouvée sans être attendue. je porte jusqu’au dehors la pensée qui sans le dehors ne serait pas apparue — de moi comme en provenance de ce dehors — éclats de voix, éclats de vent — par instants, et avec l’instant qui ne se soutient pas je ne suis pas le seul à ne pas la soutenir, et je la retrouve, elle l’insoutenable, à travers l’épaisseur silencieuse ou bruyante de tout ce qui lui est réfractaire, et qui engourdit jusqu’à l’absence.
André du Bouchet, "Je suis sur les traces d’un autre", dans Europe, "André du Bouchet", n°986-987, juin-juillet 2011, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, je suis sur les traces d'un autre, biface, dehors, absence, insoutenable | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2015
Jean-Philippe Salabreuil, L'inespéré

Au corps perdu de la beauté
Ô dans l’obscur délice de l’issue
Vers toi qu’est-ce qui soudain m’illuminait
D’une brûlure graciée lorsque je sus
Qu’il est au-delà du suffocant ressaut de neige
Dans l’être le feu d’un monde qui se leva ?
Mais regarde une fois encore (et tu vas
Te fermer bientôt sur l’or de la vie
Comme l’œil noir de l’eau) mes yeux sont dans la mort !
Je te vois n’ai-je su te ravir à toi ravie
Déjà que tu étais d’une aile blanche au corps
Perdu de la beauté au creux de la terre
Et ne t’aimerai plus jamais en ce monde clair ?
À moi fermée ! ne me regarde plus demeure
Une porte d’or close au fond des cieux meurs
Heureuse de m’aimer mourir de moi aimée
(Je te veille en ta nuit veille à mes jours mais
Ne te sois pas rouverte aux neiges de l’oubli
Quand je te rejoignais te rouvrir accomplie)
Et dans le blanc délire de l’essor
Et moi de ces lys en démence vers elle
Était un ange d’or qui parmi le réel
Voluptueux et noir a brillé comme l’aurore
Éclairant de ses dons les panneaux condamnés !
J’allais dans les feux de la voûte où sont nés
Les visages dorés du rêve (ils montent
Leurs yeux clos dans la gloire éternelle mais
Jamais s’éveilleront-ils ?) dans les anneaux du monstre
Où l’âme a reconnu la crypte du secret !
Qu’est-ce alors qu’il n’y eut plus que moi parmi
Les régions neigeuses de l’étoile ennemie ?
Alors à l’extrême le mur éternel blanc
Chanta comprenant une porte qui chante
Et s’ouvre dans le noir à l’état de soleil
(Une flamme s’élevait qui fut toi) merveille
Que ce feu dans le froid de la mort quand nous
Fûmes ce feu à l’astre où les âmes renouent !
Jean-Philippe Salabreuil, L’inespéré, Le Chemin, Gallimard,
1969, p. 91-92.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean philippe salabreuil, l'inespéré, au corps perdu de la beauté | ![]() Facebook |
Facebook |





