14/03/2014
Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres

Chanson
Qui n'a vu monter ce rire
comme du fond du jardin
la lune encore peu sûre ?
Qui n'a vu s'ouvrir la porte
au bout de l'allée de pluie ?
(Ah ! qui entre dans cette ombre
ne l'oublie pas de sitôt !)
Les bras merveilleux de l'herbe
et ses ruisselants cheveux,
la flamme du bois mouillé
tirant rougeur et soupirs...
(Qui s'enfonce dans cette ombre
ne l'oubliera de sa vie !)
Qui n'a vu monter ce rire...
Mais toujours vers nous tourné,
on ne peut qu'appréhender
sa face d'ombre et de larmes.
Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres, préface de Fabio Pusterla, édition établie par José-Flore Rappy, Pléiade /Gallimard, 2014, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, l'ignorant, jardin, ombre, herbe, tire, larme | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone (5)

pareil
bruit pareil déplaçable
à contrecoup de réponse à musique forçant débris
et si question solaire à partir de ce que je
à toutes n'entendre que voyage émergé
si muet le bleu entrer à peine le comput de l'horizon
vertical assez
rouge diffuse parfois le terroir partant le bruit
les jambes sur entende de toutes façon je
à quoi bon enfin
salée silence et ne
s'échafauder que ceci angoisse reconnue pareil
ceci angoisse
*
que ne dira
et ceci que ne dira ni gravier ni décrire
soi-même la substitution à soi du rebours de ce qui cria
avale aux vagues rebond
qu'élastique bêche écume souvent replier le sac
proche en proche éclabousser
manger rien
parler rien oui
que paroles parler gommer manger
au bout du retour en rien
miette de la mienne desserré de ses jambes nul
entrevoir son ventre ombre sa bouche jamais
son ombre sa
Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 185 et 192.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, pareil, mer, vagues, ombre, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone (4)

Rue Raymond-Queneau
On a convoqué les mots
Dans la rue Raymond-Queneau
Mots de bruit, mots de silence
Mots de toute la France
Il envahissent les rues
De Paris, ses avenues
Les verbes ouvrent la marche
De la langue patriarche
Ensuite les substantifs
Aidés de leurs adhjectifs
Les pronoms, les relatifs
Et les autres supplétifs...
Ah ! voici les mots d'amour
Ils accourent des faubourgs
Les rimes font ribambelle
Dans la rue de la Chapelle
D'autres viennent à dada
Par la rue Tristan Tzara
Cerains traînent qui sont lents
Encor place Mac Orlan
Un s'écrie « Attendez-moi ! »
Attardé rue Marx-Dormoy
Enfin les voilà en masse
Ils s'alignent dans l'espace
Ils composent sans problème
Cent Mille Milliards de Pouèmes
*
Soixante-dix vers d'amour à la corne de brume
Appel,
1 où la poitrine s'étonne d'être en flammes
2 où la dame montre un visage sombre et fermé
3 où les beaux jours trahisseurs regardent doucement
4 où la langue s'enlace à la langue dans le baiser
5 où la chambre est du ciel décorée
6 où la joie d'amour engage la bouche les yeux le cœur les sens
7 où le message court vers la douce dame jouissante
8 où mis à mort il répondra comme mort
9 où celui qui aime est plus muet que Perceval
10 où la dame fait bouclier de son manteau bleu
11 où nue il la contemple contre la lumière de la lampe
12 où nue et dépouillée elle tremble sous lui
13 où les feuilles font couette couverture
14 où bras l'entourent l'enserrée
15 où de soif mourir au bord de la fontaine
[...]
Jacques Roubaud, "Vingt partitions parisiennes, II", et "Hommages, II", Octogone, 2014, p. 177-178 et 246.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, raymond queneau, vers d'amour, répétition | ![]() Facebook |
Facebook |
11/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone (3)

La rue
Je descendais cette rue qui était droite, inclinée de soleil, entre des automobiles d'une lenteur imprécise. Descendant cette rue j'avais la sensation du passé, d'un loin passé, d'une autre rue. Je ne parvenais pas à m'y revenir. Pas en personne, pas en image de soi, défenestrées : en certitude revenir, seulement en certitude. Dans le passé d'une autre rue quand je serais, je saurais. Mais comment ?
Cette rue-là qui n'était pas cette rue-ci, comment redeviendrait-elle présente, comment m'allait-elle se présenter, cependant que je marchais, poursuivi par le soleil, par le scintillement des arbres, les courbés de poussière ? Il y avait trois chiens jaunes, une bicyclette, une boulangerie. Rue sans rue, aux maisons sans maisons, aux toits sans toits, comment la rue du passé se rapprochant, si je parvenais à lui faire faire ce mouvement vers moi, me pourrait-elle paraitre, là, maintenant, passée ? Cependant je m'efforçais de susciter en moi un tel étonnement.
Une rue d'autrefois annonçait, future, sa présence étrange. Elle viendrait. Elle serait du passé venant à moi. C'est elle qui effectuerait ce mouvement. Et ce qu'elle me donnerait à voir, aussi proche fût-il, se déclarerait comme d'ailleurs. Pae quel signe ? une étiquette ? une voix ?
La rue du passé était au bout d'un chemin, coupé de stations : à chaque station sur le chemin de la recollection, une image. À chaque image son nombre, le nombre du passé. Dix, vingt, trente stations sur le chemin. Mais aucune certitude d'aboutit. Aucune. Sinon qu'elle serait la station ultime. Et qu'elle ne le serait qu'au moment où, par l'effort de remémoration, je me serais placé, d'un seul coup, devant la pénultième image. Alors, le passé serait, immédiat.
La pénultième image était, aussi, celle d'une rue. Ce n'était ni celle de la rue que je descendais maintenant, ni celle que j'avais descendue autrefois, qui ressemblait à la première ou ne lui ressemblait pas, mais tendait vers moi son appel. Je connus que c'était elle, celle d'avant. Rue liquide, sombre ; les mêmes arbres ; d'autres. Mais au moment même où je le sus, je cessai de le savoir.
Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 287-288.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, la rue, rêve, passé, oubli, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone (2)
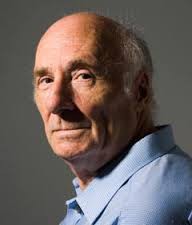
Souvenir de Jean Tardieu
« Je vous ramène ? » dit-il, courtois, avec attention,
Ma réponse, qu'il n'aurait pu saisir, plus sourd
Que le proverbial pot, et moi, sans recours,
Devant tant d'amabilité (comment m'y prendre
Pour décliner l'invitation, puisque répondre
Il ne pourrait ?), je me glissai, faisant bon cœur
Contre fortune (regrettant que la minceur
De mes vingt ans ne soit plus qu'un souvenir tendre)
Dans la voiture à peine plus grosse que lui,
Et nous voilà partis dans la rue sous la pluie
Épaisse. L'essuie-glace immobile, il parlait,
Tourné vers moi, laissant le moteur nous conduire
À ma porte. Je vis s'éloigner son sourire.
Me saluant de la main, affectueux, muet
Il brûla le feu rouge et disparut.
Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois
prose, Gallimard, 2014, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, jean tardieu, souvenir, rue, pluie | ![]() Facebook |
Facebook |
09/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone
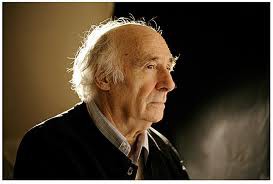
Entrecimamen
Dans les branches les plus hautes de grands arbres, des pins, des sapins, cèdres, mélèzes, sous le vent fort mais régulier, qui n'est pas le vent de tempête qui choque, entrechoque, embarrasse, punit, arrache, déracine, mais le beau grand vent constant, pressant, pressé des provinces méditerranéennes, le "cers" du Minervois, des Corbières, l'accouru des l'océan sous les Pyrénées aux tempes minces, sous la noire Montagne Noire, par le seuil de Naurouze, étroit comme la taille de la reine Guenièvre, ou bien le mistral de Provence dévalant des Alpes vers le Rhône, "Rozer", son féal, son chevalier-fleuve, tombant aussi des Cévennes rêches, le "Maïstre" chanté par Guilhem Faidit, le maître absolu des vents, se précipitant vers Arles aux arènes ventées, lançant sur les Saintes-Maries ses taureaux invisibles, le "cers", le mistral qui poussent et bousculent et secouent et mêlent les nuages ou les chassent des hauteurs lavées du ciel, qui décident de leur course vers la mer, qui dans la mer en grand chambardement saisissent, frappent les vagues, les verdissent, les secouent, les fusillent de sable, de galets, de coquillages, de bois fossiles, de débris de naufrages, galions espagnols, galères barbaresques, trirèmes grecques, carthaginoises, phéniciennes, de racines d'iris, de thyms et lavandes, de coques d'amande, d'aiguilles trempées de résine, d'écumes meringuées, bouclées, mouvantes à creux bleus, qui croisent et recroisent en surface des baies, des golfes, des criques, levant les ondes, las undas del mar, dispersant reflets, flèches lumineuses, étincelles, dans les très hautes branches de tels arbres, à ma vue, des années, toujours du même point, sur les oreillers à la tête du lit de cuivre à la Tuilerie, dans les carreaux de la fenêtre grattée en même temps par le grenadier qui s'interposait par intermittence, j'ai regardé, j'ai absorbé de contemplations nombreuses concentrées ou rêveuses les réactions des branches ainsi agrippées et empoignées par un poing presque solide d'airs, l'emmêlement de feuilles, de brindilles [...]
Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, arbres, vents, troubadour | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2014
Guillevic, Accorder

Pour Jean Tardieu
J'ai pour toi sur ma table un objet rond et lourd,
Un assez gros caillou pour qu'on le nomme pierre,
Ramassé l'an dernier près d'une sablière,
Couleur de longue pluie ainsi qu'était ce jour.
Je veux savoir de lui si je suis son recours,
Mais il répond toujours de façon outrancière,
Comme s'il refusait le temps et la lumière,
Comme un qui voit le centre te boude l'alentour,
Qui n'aurait pas besoin de se trouver soi-même
Et de chercher plus loin qu'on l'accepte ou qu'on l'aime,
Qui n'aurait le besoin, plutôt, de rien chercher.
Nous toujours à l'affût, toujours sur le qui-vive,
Nous qui rêvons de vivre une heure de rocher,
Cherchons dans le caillou la paix des perspectives.
28 décembre 1958
Guillevic, Accorder, édition établie et postfacée par Lucie Albertini-Guillevic, Gallimard, 2013, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, accorder, jean tardieu, caillou, temps, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2014
Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635), Le Mespris de la vie et consolation contre la mort

Pense combien de tems, pauvre homme miserable,
Il y a que tu bois, manges, veilles, et dors,
Dors, manges, veilles, bois, et destors et retors,
De ce mesme fuseau le filet variable ;
En fin de tant de maus la charge insupportable,
Qui sur toy chacque jour descharge ses effors,
Et ta satieté de tant vivre en ce cors
Te feront desirer la mort inevitable.
C'est peu de cas de vivre, un tel bien est permis
Egalement à tout, jusqu'aus moindres fourmis
Qui vivent en commun dessous la terre espaisse,
Mais delaisser la vie en resolution,
Et mourir gouverneur de son affection,
C'est là le plus haut point de l'humaine sagesse
Jean-Baptiste Chassignet, Le Mespris de la vie et consolation contre la mort, édition critique par H. J. Lope, Droz, 1967.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste chassignet, le mespris de la vie et consolation contre la mort, vie, maux | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2014
Henri-Pierre Roché, Don Juan et...

Don Juan et La Louchon
Ah ! dit la femme du sergent qui passait par là, c'est cette petite traînée de Louchon que vous attendez ce soir ,
« Hein, vous n'avez qu'à siffler et elle vient se coucher come une vraie petite chienne !»
« Non, Madame, ce n'est pas ainsi ! Je l'attends et je ne sais pas si elle viendra.»
« Si elle vient, ce n'est pas sûr d'avance qu'il arrivera ce que vous pensez. »
« Et si cela arrive, c'est une grande grâce qu'elle me fera. »
Don juan et Florine
Sa nuque brillait dans la fête, et ses tempes étaient fines.
Don Juan la pria, l'emmena dans le bosquet, sauta en selle et l'invita à monter avec lui son beau cheval.
Yeux baissés, souriante, elle se laissa placer entre ses bras.
Le cheval partit d'un doux galop, contourna une pelouse du parc, et bientôt piqua vers la forêt.
Pâmée, « Ah, pourquoi, murmura-t-elle, les hommes m'aiment-ils ? »
Don Juan ralentit son cheval. Il y avait devant eux un tas de feuilles mortes. Quand ils passèrent à côté, sans la regarder, il la poussa dedans.
Et il continua vers la forêt.
Henri-Pierre Roché, Don Juan et..., André Dimanche, 1994, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri-pierre roché, don juan et..., respect, vanité | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2014
Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard, textes retrouvés

L'homme quittera
II. Fuite
Les jours passent comme des nuages
et leur ombre sur la terre.
Le mobilier ne change guère,
vergers de prunes bleues ou jaunes,
noyers bruns à forte odeur,
tendres mousses sur la roche,
envols d'oiseaux qu'interrompt
le froid. Mais les parents
que nous venions voir se sont
enfuis à notre approche.
XI. Brume
Brume sur les champs.
L'amour de toi.
Tu ne te dédis pas,
tu ne t'éloignes que peu.
Je n'entends qu'à peine
les morts derrière toi.
Je vois dans la brume
luire tes cheveux.
Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés
1947-2004, édition de Jacques Réda, préface
de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2013, p. 85-86, 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, textes retrouvés, réda, le clézio, fuite, brume, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
04/03/2014
Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard

Nos pas se posent...
Nos pas se posent
sur les pierres qui dorment dans le sol
sur les cheminements des fourmis
Que de paroles dans notre tête
leur danse et l'arrière-goût
de toutes les choses entendues
Mais pas de langage à la bouche
Nos pas seuls
leurs crissements sur les brindilles
leur poussière
Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés 1947-2004, édition de Jacques Réda, préface de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2012, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, jacques réda, pierre, parole, poussière | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2014
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
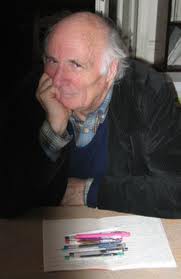
Chant I
Strophe première
Du terminus saint-Lazare
à l'arrêt Havre-Haussmann
L'autobus vingt et neuf, départ de saint-lazare
Comme la ligne vingt
Ce n'est pas par hazare
Les lignes dont le nom commence par un deux
Partent toutes
Partaient
Des lazaréens lieux
À moins que dépecée un jour par un caprisse
De la èr-a-té-pé quelqu'un ne finisse
Ailleurs : ainsi le vingt et deux à l'opéra
Célèbre par son chic et par ses petits ra
Ce haut lieu musical où des milliers se prèsse
Tels des touristes zen partance vers la grèsse
Pour entendre don juan, falstaff ou turandot
Avec plus de ferveur qu'en attendant godot
De mauroy disait quidam dedans la poste
Confondant avec la rue où fidèle au poste
La donzelle chanté' par brassens opérai
Le recrutement d'un client bien argentai
J'insère ici deux vers que je vous donne en primes
Afin de respecter l'alternance des rimes
Dans un film de clouzot autre confusi-on
Analogue on entend
Belle précisi-on
"On ne badine pas avec l'amour" d'alfrède
De musset
Admirez !
[...]
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, éditions
Attila, 2012, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ode à la ligne 29 des autobus parisiens, alexandrin, rime, récit, couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
02/03/2014
Pierre Bergounioux, Obazine

Lorsqu'il m'a pris fantaisie de chercher, à la bibliothèque municipale de la sous-préfecture natale, les livres qui se rapporteraient à la contrée à ses habitants et, pourquoi pas, à la bibliothèque elle-même, qui était un endroit très étrange, je ne les ai pas trouvés. J'ai supposé que des titres trompeurs, comme Le Rouge et le noir, par exemple, en dissimulaient le contenu effectif ou que j'avais mal cherché. C'est plus tard, à la réflexion, que j'ai compris. Ils étaient restés dans l'encrier.
L'expérience de la lecture présentait, pour ce qui nous concernait, un caractère essentiellement contradictoire et, par suite, très déconcertant. Les livres parlaient invariablement d'endroits où l'on n'avait jamais mis les pieds, de gens différents avec d'autres vues, un autre langage tandis qu'il n'y était jamais fait mention des lieux familiers, de leurs occupants.
Ou bien les personnages n'avaient d'existence que sur le papier ou bien ils avaient un répondant palpable quelque part, au loin, et c'est pour cette raison que l'univers exigu, terne, somnolent qui nous était alloué, n'apparaissait jamais dans l'espace sacralisé compris entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. Aux complications du romanesque, qu'on finit par débrouiller, s'ajoutait une incertitude irréductible, qui était de savoir si les ambitions, les procédés, les réflexions que l'amour prêtait aux protagonistes du récit étaient le fruit de sa seule imagination ou s'ils étaient gagés sur une réalité aussi tangible que la nôtre. Auquel cas, pour parodier amèrement Hamlet, il y avait infiniment plus de choses au ciel et sur la terre que dans toute notre philosophie.
Pierre Bergounioux, Obazine, Le lieu de l'archive, supplément à la lettre de l'IMEC, 2013, p. 10-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, obazine, bibliothèque, livre, imagination, hamlet | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2014
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
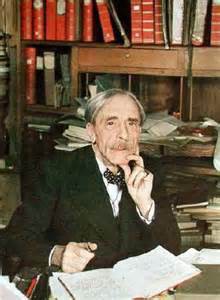
Poésie
C'est une plaisanterie usée de dire que le poète exprime ses douleurs, ses grandeurs et ses aspirations dans ses vers. Cela n'est vrai que de poètes vulgaires comme Musset — Encore...
Il est trop clair que le vers installe un autre monde que celui des affaires personnelles d'un poète, lesquelles n'intéressent pas directement l'universel.
Il est vrai que sa tournure d'esprit, ses humeurs dominent ses mouvements internes, et l'excitent de telle ou telel façon, mais indirectement par rapport à la poésie.
L'art est précisément tel qu'il rend les tourments imaginaires indiscernables des réels. Il n'y a besoin que d'une force très faible pour remuer des masses énormes quand des machines sont interposées. Un enfant fait sauter une montagne en pressant un bouton. L'accumulateur est langage. Toute l'attention du vrai artiste est portée sur la manœuvre des représentations et des émotions, bien plus que sur leur potentiel. C'est en tant qu'elles sont manœuvrables qu'il les connaît e tles sollicite. Le minimum de présence et d'intensité actuelles et le maximum d'obéissance et d'intensité probables chez le lecteur, sont liés.
Paul Valéry, Cahiers, II, édition établie, présentée et annotée par Judith Robinson, Pléiade / Gallimard, 1974, p. 1094.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, inspiration, émotion, universel | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2014
Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour

La convocation
Ici
On convoque.
Ici
Enfin la multitude
Se tient.
Combien sont serrés
Dans les rangs
Dans la meute.
Silence
Et cris figés
Dedans.
Incapables de monter...
Surface.
Bord ultime
Avant poussées
Et déferlement.
Tout ce silence
Bruissant sous la clôture.
Couvercle dessus
Pour empêcher.
Transpire
Bouge
Dois tenir
Parmi.
Objets aussi
Sont multitudes
À l'orée
Sans mouvement.
Lieu ferme.
Bouche avec corps
Chiffons.
Ne dois pas
Ne dois pas.
Peuple du devant
En lisière.
Respire
Une fois sur deux.
Pour eux
Soustraits
Hors souffle.
Sous cette peau tendue.
Qui contient
Et retient.
Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour,
éditions Unes, 2013, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, issue de retour, la convocation, silence, peau, objet | ![]() Facebook |
Facebook |





