04/03/2014
Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard

Nos pas se posent...
Nos pas se posent
sur les pierres qui dorment dans le sol
sur les cheminements des fourmis
Que de paroles dans notre tête
leur danse et l'arrière-goût
de toutes les choses entendues
Mais pas de langage à la bouche
Nos pas seuls
leurs crissements sur les brindilles
leur poussière
Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés 1947-2004, édition de Jacques Réda, préface de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2012, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, jacques réda, pierre, parole, poussière | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2014
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
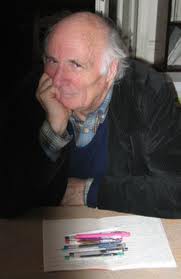
Chant I
Strophe première
Du terminus saint-Lazare
à l'arrêt Havre-Haussmann
L'autobus vingt et neuf, départ de saint-lazare
Comme la ligne vingt
Ce n'est pas par hazare
Les lignes dont le nom commence par un deux
Partent toutes
Partaient
Des lazaréens lieux
À moins que dépecée un jour par un caprisse
De la èr-a-té-pé quelqu'un ne finisse
Ailleurs : ainsi le vingt et deux à l'opéra
Célèbre par son chic et par ses petits ra
Ce haut lieu musical où des milliers se prèsse
Tels des touristes zen partance vers la grèsse
Pour entendre don juan, falstaff ou turandot
Avec plus de ferveur qu'en attendant godot
De mauroy disait quidam dedans la poste
Confondant avec la rue où fidèle au poste
La donzelle chanté' par brassens opérai
Le recrutement d'un client bien argentai
J'insère ici deux vers que je vous donne en primes
Afin de respecter l'alternance des rimes
Dans un film de clouzot autre confusi-on
Analogue on entend
Belle précisi-on
"On ne badine pas avec l'amour" d'alfrède
De musset
Admirez !
[...]
Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, éditions
Attila, 2012, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ode à la ligne 29 des autobus parisiens, alexandrin, rime, récit, couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
02/03/2014
Pierre Bergounioux, Obazine

Lorsqu'il m'a pris fantaisie de chercher, à la bibliothèque municipale de la sous-préfecture natale, les livres qui se rapporteraient à la contrée à ses habitants et, pourquoi pas, à la bibliothèque elle-même, qui était un endroit très étrange, je ne les ai pas trouvés. J'ai supposé que des titres trompeurs, comme Le Rouge et le noir, par exemple, en dissimulaient le contenu effectif ou que j'avais mal cherché. C'est plus tard, à la réflexion, que j'ai compris. Ils étaient restés dans l'encrier.
L'expérience de la lecture présentait, pour ce qui nous concernait, un caractère essentiellement contradictoire et, par suite, très déconcertant. Les livres parlaient invariablement d'endroits où l'on n'avait jamais mis les pieds, de gens différents avec d'autres vues, un autre langage tandis qu'il n'y était jamais fait mention des lieux familiers, de leurs occupants.
Ou bien les personnages n'avaient d'existence que sur le papier ou bien ils avaient un répondant palpable quelque part, au loin, et c'est pour cette raison que l'univers exigu, terne, somnolent qui nous était alloué, n'apparaissait jamais dans l'espace sacralisé compris entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. Aux complications du romanesque, qu'on finit par débrouiller, s'ajoutait une incertitude irréductible, qui était de savoir si les ambitions, les procédés, les réflexions que l'amour prêtait aux protagonistes du récit étaient le fruit de sa seule imagination ou s'ils étaient gagés sur une réalité aussi tangible que la nôtre. Auquel cas, pour parodier amèrement Hamlet, il y avait infiniment plus de choses au ciel et sur la terre que dans toute notre philosophie.
Pierre Bergounioux, Obazine, Le lieu de l'archive, supplément à la lettre de l'IMEC, 2013, p. 10-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, obazine, bibliothèque, livre, imagination, hamlet | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2014
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
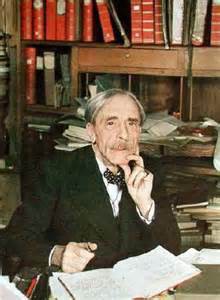
Poésie
C'est une plaisanterie usée de dire que le poète exprime ses douleurs, ses grandeurs et ses aspirations dans ses vers. Cela n'est vrai que de poètes vulgaires comme Musset — Encore...
Il est trop clair que le vers installe un autre monde que celui des affaires personnelles d'un poète, lesquelles n'intéressent pas directement l'universel.
Il est vrai que sa tournure d'esprit, ses humeurs dominent ses mouvements internes, et l'excitent de telle ou telel façon, mais indirectement par rapport à la poésie.
L'art est précisément tel qu'il rend les tourments imaginaires indiscernables des réels. Il n'y a besoin que d'une force très faible pour remuer des masses énormes quand des machines sont interposées. Un enfant fait sauter une montagne en pressant un bouton. L'accumulateur est langage. Toute l'attention du vrai artiste est portée sur la manœuvre des représentations et des émotions, bien plus que sur leur potentiel. C'est en tant qu'elles sont manœuvrables qu'il les connaît e tles sollicite. Le minimum de présence et d'intensité actuelles et le maximum d'obéissance et d'intensité probables chez le lecteur, sont liés.
Paul Valéry, Cahiers, II, édition établie, présentée et annotée par Judith Robinson, Pléiade / Gallimard, 1974, p. 1094.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, inspiration, émotion, universel | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2014
Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour

La convocation
Ici
On convoque.
Ici
Enfin la multitude
Se tient.
Combien sont serrés
Dans les rangs
Dans la meute.
Silence
Et cris figés
Dedans.
Incapables de monter...
Surface.
Bord ultime
Avant poussées
Et déferlement.
Tout ce silence
Bruissant sous la clôture.
Couvercle dessus
Pour empêcher.
Transpire
Bouge
Dois tenir
Parmi.
Objets aussi
Sont multitudes
À l'orée
Sans mouvement.
Lieu ferme.
Bouche avec corps
Chiffons.
Ne dois pas
Ne dois pas.
Peuple du devant
En lisière.
Respire
Une fois sur deux.
Pour eux
Soustraits
Hors souffle.
Sous cette peau tendue.
Qui contient
Et retient.
Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour,
éditions Unes, 2013, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, issue de retour, la convocation, silence, peau, objet | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2014
Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Les amours

Les amours
XXIII
Il est vray, mon amour estoit sujet au change,
Avant que j'eusse appris d'aimer solidement,
Mais si je n'eusse veu cest astre consumant,
Je n'aurois point encor acquis ceste loüange.
Ore je voy combien c'est une humeur estrange
De vivre, mais mourir, parmy le changement,
Et que l'amour luy mesme en gronde tellement
Qu'il est certain qu'en fin, quoy qu'il tarde, il s'en vange.
Si tu prens un chemin apres tant de destours,
Un bord apres l'orage, et puis reprens ton cours,
En l'orage, aux destours, s'il survient le naufrage
Ou l'erreur, on dira que tu l'as merité.
Si l'amour n'est point feint, il aura le courage
De ne changer non plus que fait la verité.
Jean de Sponde, Œuvres littéraires, introduction et notes par Alan Boase, Droz, 1978, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, les amours, orage, changement, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2014
Paul de Roux, Entrevoir , préface de Guy Goffette
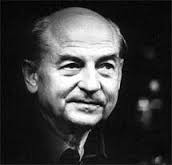
Verger abandonné
La mousse du vieux poirier
patiente et douce murmure :
« Ne bougez pas »
et la solidité du bois
du bon vieux tronc
est douceur aussi
et sûr appui.
Stèle pour un corbeau
Lui aussi menait sa vie, ce corbeau
dont je n'ai vu que le cadavre efflanqué
les plumes noires collées à la terre gluante
sous la frondaison des châtaigniers en fleurs
— c'était en mai. Ce matin de septembre
parmi les premières bogues chues
je ne retrouve pas une plume.
Mais tandis que je bats les feuilles mortes, soudain
dans le bois de la Montagne de Reims
un croassement s'élève, comme en écho
à ma rêverie mélancolique.
Paul de Roux, Entrevoir suivi de Le front contre la vitre et de La halte obscure, préface de Guy Goffette, Poésie / Gallimard, 2014, p. 98, 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, entrevoir, guy goffette, verger, corbeau, mélancolie, rêverie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/02/2014
Paul de Roux, Au jour le jour, Carnets 2000-2005 (2)
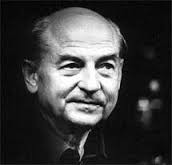
L'amour d'un jardin, d'une maison à restaurer, d'un palimpseste à déchiffrer. Voilà ce qui unit. On ne partage que le travail.
Tout se résume en cela : l'insatisfaction de soi-même.
Alors que l'on n'a que trop tendance à attribuer à autrui la responsabilité de son état. Toute doctrine qui exalte la liberté et la responsabilité de la personne est, de ce point de vue, excellente.
Plus un art est grand, moins on peut en voir de pièces. On s'aperçoit soudain que tel tableau, telle sculpture dit tout ce que l'on était susceptible d'entendre à l'instant et il ne reste plus qu'à s'éloigner pour ne pas être indigne de nouvelles rencontres.
Jour et nuit
Grande balançoire, ces ondulations,
terre s'étendant en vergers, moissons,
terre levée en buttes et bosquets
à l'horizon qui bleuit, se recueille
sous quelques pâles nuages,
langue ancienne dont nous avons oublié l'alphabet
tracé ici avec une touffe d'herbe, un poirier,
terre ancrée dans les étoiles, révélées
si t'éveille la hulotte.
Paul de Roux, Au jour le jour, Carnets 2000-2005, édition établie par Gilles Ortlieb, Le bruit du temps, 2014, p. 131, 148, 161, 190.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, au jour le jour, carnets, travail, insatisfaction, palimpseste, art | ![]() Facebook |
Facebook |
24/02/2014
Paul de Roux, Au jour le jour 5, Carnets 2000-2005
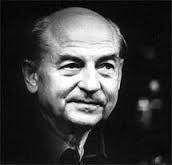
Le sentiment de la nature, de son "étrangeté" est peut-être le degré le plus bas de la perception du non-humain, de la perception de puissances qui ne relèvent pas de l'espèce humaine. Oui, c'est peut-être quelque chose de très primaire, mais c'est du moins quelque chose qui vous arrache à la toute puissance de nos sociétés humaines, faisant craquer les bornes d'un univers artificiellement clos, tel celui de la "ville tentaculaire".
Je me suis dit soudain que le Louvre était mes sentiers, mes bois, mes montagnes perdus. Ce n'est pas que l'esprit, c'est aussi, tout autant, la chair du monde que je retrouve ici fugitivement.
Je brouille le monde en moi. Le chaos intérieur donne un reflet chaotique du monde. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sens rien. La perte est immense. Et comme était modeste, la provende que je faisais à travers champs ! Quelques piécettes de l'incalculable fortune proposée. Aujourd'hui cependant, seule leur réminiscence conserve un certain éclat dans la besace du passé. La lumière, le vent, ce qui ne se stocke pas, ne s'emporte pas dans la poche, cela seul peut-être s'accorde à quelque chose de très intime, en un point où cœur, sens, esprit coïncident, se confondent.
Paul de Roux, Au jour le jour 5, Carnets 2000-2005, Le bruit du temps, 2014, p. 48, 56, 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, au jour le jour 5, carnets 2000-2005, nature, chaos, monde, passé, le louvre | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2014
Raymond Queneau, L'instant fatal, dans Œuvres complètes,I

Je crains pas ça tellment
Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles
et la mort de mon nez et celle de mes os
Je crains pas ça tellment moi cette moustiquaille
qu'on baptise Raymond d'un père dit Queneau
Je crains pas ça tellment où va la bouquinaille
la quais les cabinets la poussière et l'ennui
Je crains pas ça tellment moi qui tant écrivaille
et distille la mort en quelques poésies
Je crains pas ça tellment La nuit se coule douce
entre les bords teigneux des paupières des morts
Elle est douce la nuit caresse d'une rousse
le miel des méridiens des pôles sud et nord
Je crains pas cette nuit Je crains pas le sommeil
absolu Ça doit être aussi lourd que le plomb
aussi sec que la lave aussi noir que le ciel
aussi sourd qu'un mendiant bêlant au coin d'un pont
Je crains bien le malheur le deuil et la souffrance
et l'angoisse et la guigne et l'excès de l'absence
Je crains l'abîme obèse où gît la maladie
et le temps et l'espace et les torts de l'esprit
Mais je crains pas tellment ce lugubre imbécile
qui viendra me cueillir au bout de son curdent
lorsque vaincu j'aurai d'un œil vague et placide
cédé tout mon courage aux rongeurs du présent
Un jour je chanterai Ulysse ou bien Achille
Énée ou bien Didon Quichotte ou bien Pansa
Un jour je chanterai le bonheur des tranquilles
les plaisirs de la pêche ou la paix des villas
Aujourd'hui bien lassé par l'heure qui s'enroule
tournant comme un bourrin tout autour du cadran
permettez mille excuz à ce crâne — une boule —
de susurrer plaintif la chanson du néant
Raymond Queneau, L'instant fatal, dans Œuvres complètes,
I, édition établie par Claude Debon, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, l'instant fatal, mort, nuit, sommeil, deuil, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2014
Raymond Queneau, Chansons,

Chansons
I
Il y a des gens qui s' cass'nt la tête
Parc' qu'ils voudraient gagner d'l'argent
Beaucoup d'argent
Ils cherch'nt partout des recettes
Pour dev'nir rich's immédiatement
Et copieusement
Ou bien ils travaill'nt tout' leur vie
Ou bien ils préfèr'nt êt' bandits
De grand chemin
Tout ça c'est bien trop compliqué :
Pour êtr' célèbre et honoré
Y a qu'un moyen
Faites comme moi
Dev'nez champion
C'est si facile
Et c'est si bon
Ah quel plaisir d'être champion
On n'a qu'à se mettr' sur les rangs
Pour écraser les concurrents
Ah quel bonheur d'être champion
Même un champion de trottinette
Tout l'monde accourt pour lui fair' fête
Ah quelle joie d'être un champion
C'est si facile et c'est si bon.
*
Une vie sans toi
Une vie sans toi
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dir' la pluie
Tout au long des mois
Ça veut dir' l'ennui
Ça veut dir' le pire
Ça veut dir' tout ça
Et encore tout ça
Ça veut dir' la neige
Au mois de juillet
Ça veut dir' la fleur
Mourant sur la branche
Ça veut dire l'oiseau
Crevant en plein ciel
Ça veut dir' tout ça
Et encore tout ça
Ça veut dir' tout ça
Ne pas te revoir
Si jamais la vie
Voulait t'éloigner
À toujours de moi
Comme serait gris
Comme serait noir
Un monde sans toi
Raymond Queneau, Chansons, dans Œuvres
complètes, I, édition établie par Claude
Debon, Pléiade / Gallimard,1989, p. 972 et 969.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, chansons, champion, argent, une vie sans toi, ennui | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2014
Étienne de la Boétie, Œuvres complètes, Sonnets

Sonnets
X
Ores je te veux faire un solennel serment,
Non serment qui m'oblige à t'aimer davantage,
Car meshuy je ne puis ; mais un vrai tesmoignage
À ceux qui me liront, que j'aime loyaument.
C'est pour vrai, je vivrai, je mourrai en t'aimant.
Je jure le hault ciel, du grand Dieu l'héritage,
Je jure encor l'enfer, de Pluton le partage,
Où les parjurs auront quelque jour leur tourment ;
Je jure Cupidon, le Dieu pour qui j'endure ;
Son arc, ses traicts, ses yeux & sa trousse je jure :
Je n'aurois jamais fait : je veux bien jurer mieux,
J'en jure par la force & pouvoir de tes yeux,
Je jure ta grandeur, ta douceur & ta grace,
Et ton esprit, l'honneur de cette terre basse.
Étienne de la Boétie, Œuvres complètes, II, introduction, bibliographie et notes de Louis Desgraves, Conseil général de la Dordogne / William Blake ans Co, 1991, p. 120.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne de la boétie, Œuvres complètes, sonnet, poème d'amour, cupidon, serment | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2014
Henri Droguet, Variations saisonnières, dans PO&SIE

À perte
C'est un soir et le temps
qui court Dame souris
trotte et chicote
à la maison du nouveau mort
étendu dans la chambre
plus ou moins noire où sphinx
(tête idoine) et bombyx
cernent la lampe et demain
seront miettes et poudres
déjà l'enfant perdu
court au jardin sauvage
ça sent le frai la laine et l'argile
le vent revient de loin
un ange passe
13 août 2007
Voyures
Quoi s'éloignait là ? disais-tu
le vent fouettard à son branle
qui tombait dans l'éparse grâce de la mer
le soleil entre l'ombre et l'ombre
tout feu tout flamme déboulé
dans un panier de nuages
la neige à venir et l'herbe à Robert
un improbable accès aux replis des collines
les menues semences
l'eau douce à la saulaie
les grandes nuits lointaines
C'est ça le vrai jour et l'aboi neuf
ça râpe et ça rit
ça rabote
2 mai 2008
Henri Droguet, Variations saisonnières, dans PO&SIE
n°136, 2ème trimestre 2011, p. 41 et 48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri droguet, variations saisonnières, dans po&sie, soir, papillon, vent, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2014
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq

Histoire de la perdrix
Prologue
Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu'ils séparent. Elles deviennent visibles, visibles et nues, comme elles ne le sont pas elles-mêmes. Visibles après le bain. Issues de l'ombre positive d ela langue, de l'implacable et lumineux glissement de sa négativité.
Cette ombre pour respirer. Cette ombre pour plonger.
Survie phrasique jusque dans l'extrême nuance opaque du poème. Lecture sans le moindre émouvante - ou bien molle, injuste, sans le moindre tranchant.
Voici la découpe où je vis : l'emporte pièce, autant de bandes, brunes jaunes. Adorable limaille.
Et vivable vraiment la présence due aux mots ; sans eux on n'échapperait pas à la chaotique filature du temps ni à la puissance de l'instant laissé à lui-même — seuls les animaux y excellent.
Pierre parmi les pierres. Foin dans le foin, j'écris le maquillage de la perdrix.
Je déracine et brandis son théâtre d'un bloc. Sa brûlure n'est pas extatique, mais douloureuse comme la totalité.
Une précipitation d'apparence.
Une explosion de perdrix pierreuse.
Le théâtre est clos ; à l'intérieur, la ressemblance est infinie.
[...]
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57-58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, cinq, perdrix, mot, ombre, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
18/02/2014
François Rannou, Rapt

D'amour si longtemps tu
se resserre
aux quatre coins
enfoncée dans
l'os
d'amour si longtemps tu ne sais où la lumière te mord
(il y a là une femme qui aimait
son rire sa façon de disparaître
du lit après l'amour pour écrire)
[...]
*
14 stelles
ailleurs
sous les phrases la
ligne de
sable chardons dans
l'herbe
clairsemée raide courte
le chant de marie
qu'on encule
sous la lune blanche
Bretagne intérieure
moteur lancinant des
des moissons la
nuit on n'
entend
plus la route
il reste
les
« mottes tuées »
François Rannou, Rapt, La Termitière / La Nerthe,
2013, p. 29, 75-76.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois rannou, rapt, d'amour si longtemps tu, ailleurs, bretagne, moisson, femme | ![]() Facebook |
Facebook |





