29/06/2014
Aragon, La Grande Gaîté [1929]

Art poétique
On me demande avec insistance
Pourquoi de temps en temps je vais à
La ligne
C'est pour une raison
Véritablement indigne
D'être cou
Chée par écrit
Les derniers jours
Les philosophes les artistes
Les crémiers les gens très bien
Sont tombés dans le précipice
Pas besoin d'enterrement
Plus de théories de peinture
Le monde en reste désolé
Heureusement que pour se distraire
On a la Radiophonie
Partie fine
Dans le coin où bouffent les évêques
Les notaires les maréchaux
On a écrit en lettres rouges
DÉGUSTATION D'HUÎTRES
Est-ce une allusion
On me fait remarquer que c'est pitoyable
Ce genre de plaisanterie
Et puis c'est mal foutu paraît-il
En tant que Poème
Car pour ce qui touche à la Poésie
On sait à quoi s'en tenir
Mais je n'ai pas fini de prendre en mauvaise part
Tout ce qui touche à la flicaille à la militairerie
Et plus particulièrement croa-croa aux curetages
Je n'ai pas assez le goût des alexandrins
Pour me le faire par-donner pan pan pan pan
Mais ici même si on ne sait d'où elle tombe
D'où tombe-t-elle d'ailleurs D'ailleurs
Il me plaît d'opposer à la clique des têtes à claques
Une femme très belle toute nue
Toute nue à ce oint que je n'en crois pas mes yeux
Bien que ce soit peut-être la millième fois
Que ce prodige s'offre à ma vue
Ma vue est à ses pieds
Son très humble serviteur
Aragon, La Grande Gaîté [1929], dans Œuvres poétiques
complètes, I, édition sous la direction d'Olivier Barbarant, Pléiade, Gallimard, 2007, p. 407, 408, 411-412.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaîté, olivier barbarant, art poétique, partie fine, derniers jours, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2014
Lewis Carroll, La Chasse au Snark, traduction Aragon

Crise première
L'atterrissage
L'endroit rêvé pour un Snark cria l'Homme à la Cloche
Qui débarquait l'équipage avec soin
Soutenant chaque homme à la crête des vagues
Par un doigt pris dans ses cheveux
L'endroit rêvé pour un Snark Ça fait deux fis que je le dis
C'en serait assez pour encourager l'équipage
L'endroit rêvé pour un Snark Ça fait trois fois que je le dis
Ce que je vous dis trois fois est vrai
L'équipage était au complet Il comprenait un Bottier
Un faiseur de Bonnets et Capuces
Un Avocat pour aplanir leurs différends
Et un Agent de Change pour faire valoir leurs biens
Un Champion de Billard dont l'habileté était immense
Il se peut bien qu'il ait gagné plus que son dû
Mais un Banquier engagé à prix d'or
Avait la garde de tout leur pécule
Il y avait aussi un Castor qui arpentait le pont
Quand il ne faisait pas de la dentelle sur l'avant
Et qui les avait souvent à en croire l'Homme à la Cloche
sauvés du désastre
Bien qu'aucun des marins ne sût comment
Il y en avait un réputé pour le nombre de choses
Qu'il avait oubliées en mettant le pied sur le navire
Son parapluie sa montre tous ses bijoux et bagues
Et les habits achetés pour l'expédition
Quarante deux malles qu'il avait Toutes soigneusement faites
Avec son nom en toutes lettres sur chacune
Mais comme il avait oublié de le dire
Elles étaient toutes restées sur la rive
[...]
Lewis Carroll, La Chasse au Snark, traduction Aragon, dans
Aragon, Œuvres poétiques complètes, I, édition sous la direction
d'Olivier Barbarant, Pléiade, Gallimard, 2007, p. 379-381.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, la chasse au snark, traduction aragon, mer, équipage, billard, castor, nom, oubi | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2014
Paul-Jean Toulet, Les contrerimes

Contrerimes
LXX
La vie est plus vaine une image
Que l'ombre sur le mur
Pourtant l'hiéroglyphe obscur
Qu'y trace ton passage
M'enchante, et ton rire pareil
Au vif éclat des armes ;
Et jusqu'à ces menteuses larmes
Qui miraient le soleil.
Mourir non plus n'est ombre vaine
La nuit, quand tu as peur,
N'écoute pas battre ton cœur :
C'est une étrange peine.
Paul-Jean Toulet, Les contrerimes, dans Œuvres
complètes, édition présentée et annotée par
Bernard Delvaille, "Bouquins", Robert Laffont,
1986, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul-jean toulet, les contrerimes, bernard delvaille, image, rire, larme, peine | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2014
Adrienne Rich (1929-2012), dans Olivier Apert, Une anthologie de la poésie féminine

D'une vieille maison en Amérique
16.
« De telles femmes sont dangereuses
pour l'ordre des choses »
et bien oui nous serons dangereuses
à nous-mêmes
avançant à tâtons parmi les épines du cauchemar
(datura s'enchevêtrant à une herbe simple)
car la ligne séparant
la lucidité des ténèbres
st encore à tracer
Isolement, le rêve
de la femme de la frontière
mettant en joue sa carabine derrière
la clôture de la ferme
piège encore notre vanité
— Une feuille suicidaire
s'étend sous le verre brûlant
de l'œil du soleil
La mort de toute femme me diminue.
From an old house in America
"Such women are dangerous
in the order of things"
and yes, we wille be dangerous
to ourselves
groping through spines of nightmare
(datura tangling with a simple herb)
because the line dividing
lucidity from darkness
is yet to be marked out
Isolation, the dream
of the frontier woman
levelling her rifle along
the homestead fence
still snares our pride
—a suicidal leaf
laid under the burning-glass
in the sun eye
Any woman death diminishes me.
Adrienne Rich (1929-2012), dans Olivier Apert, Une anthologie bilingue de la poésie féminine américaine du XXe siècle, Le Temps des Cerises, 2014, p. 183 et 182.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adrienne rich, olivier apert, anthologie, poésie féminine, amour, femme, abandon, fête | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2014
Muriel Rukeyser (1923-1980), dans Olivier Apert, Une anthologie bilingue

Mythe
Longtemps après, Œdipe, âgé et aveugle, cheminait.
Il flaira une odeur familière. C'était
la Sphinx. Œdipe dit, « Je voulais te poser une question.
Pourquoi n'ai-je pas reconnu ma mère ? » « Tu as donné la
mauvaise réponse », dit la Sphinx. « Mais cela rendait
pourtant
toute chose possible », dit Œdipe. « Non », dit-elle.
« Quand je demandai, Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin,
à deux le midi, à trois le soir, tu répondis
l'Homme. Tu n'as rien dit à propos de la femme. »
« Lorsque tu dis l'Homme », dit Œdipe, « tu entends aussi femme.
Chacun sait cela. » Elle dit, « c'est ce que
tu crois. »
Myth
Long afterward, Œdipus, old and blinded, walk the
roads. He smells a familiard smell. It was
the Sphinx. Œdipus said, "I want to ask one question.
Why didn't I recghnize my mother?" "You gave the
wrong answer" said the Sphnx. "But tat was what
made everything possible." said Œdipus. "No," she said.
"When I asked, What walks on four legs in the morning,
two at noon, and then three in the evening, you answered
Man. You din't say anything about woman."
"When you say Man" said dipus, ' you include women
too. Everyoneknow that. She said, 'That's what
you think."
Muriel Rukeyser, dans Olivier Apert, Une anthologie bilingue de la
poésie féminine américaine du XXe siècle, Le Temps des cerises, 2014,
p. 83 et 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : muriel rukeyser, olivier apert, mythe, mère, Œdipe, question, réponse, homme | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2014
Édith Boissonnas, L'embellie

Emporté
Un grand souffle et s'envolèrent les amitiés
Encombrantes, volèrent les livres suprêmes,
Tout ce qui retient et distrait fut sans pitié
Balayé en moi par un souffle de poème.
La nuit vint et je me sentais porté toujours,
La moindre brise était de plomb et combien lente.
Aucun repos où poussent, délicates plantes,
Les vanités folles, les échanges sucrés,
Que je voyais ailleurs partout et dans ma hâte
Parfois je piétinais d'un pas ivre, harassé,
Mais au couchant, de grandes ailes battent,
S'apaisent. Je me sens alors emprisonné.
Édith Boissonnas, L'embellie, Gallimard, 1966, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith boissonnas, l'embellie, amitié, poème, vanité, aile, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
23/06/2014
Édith Azam, On sait l'autre : recension

On n'interrompt pas la lecture de On sait l'autre, ce long poème récit, quand on l'a entreprise. De quoi s'agit-il ? Un narrateur dans sa maison un peu isolée rapporte, sous la forme du "on", ce qu'il fait et pense pendant à peu près vingt quatre heures ; il s'agit d'un homme, ce qui est explicite l'une des rares fois où le "on" est abandonné pour le "je" : « je suis maintenant si vieux ». Conditions de la tragédie classique réunies : unité de lieu, de temps et d'action — et il y a bien tragédie. Que sait-on du narrateur ? Rien de ses occupations dans la société ; il écrit sur des carnets et lit les poètes d'aujourd'hui (ou du moins leurs livres sont présents). Il boit beaucoup de vodka. Il déteste l'« autre » dont il entend les pas sur le gravier quand il approche. Qui est cet « autre » ?
Dès les premières pages, la menace de la venue de l'« autre », et non son approche réelle de la maison, conduit le narrateur à fermer la porte à clef et à faire disparaître les clefs : après l'échec d'une tentative de les faire fondre dans une casserole, elles sont jetées dans les toilettes et la chasse d'eau est tirée. Plus tard, l'essai de trouver les doubles n'aboutira pas. L'« autre » n'est pas là, mais pourrait venir, par exemple la nuit « avec sa hache, son coup de métal froid ». L'autre — l'autre corps — perçu comme violent, ne rentrera dans la maison que dans l'imagination du narrateur. Mais le risque de son intrusion conduit le narrateur à détruire tous ses carnets, sauf le dernier qu'il fixe avec du scotch sur sa poitrine, à abandonner le salon pour s'enfermer dans la chambre, puis à descendre dans la cave. L'« autre » est présent comme l'était le Horla de Maupassant et le narrateur le sait, ce qui ne change rien : « On meurt de trouille devant soi et aussi bien : que devant l'autre. On crève de peur oui, alors pour oublier l'angoisse, on s'exacerbe, on se débride : jusqu'à l'autre. »
Cet « autre » si redoutable, c'est n'importe qui susceptible d'approcher le corps du narrateur, de mettre alors en cause, par sa seule présence, l'existence même, « on ne veut surtout pas le connaître [...] il existe, et c'est bien suffisant pour violenter nos chairs. » Tout « autre » vole la vie, la violente, « On se vole tous les uns les autres, pour se remplir la bouche de tout ce dont on manque, tout ce qu'on ignore, pour être simplement : nommé. » Impossible d'échapper à ce qui définit l'humain, sinon pour des temps très brefs s'inventer une vie virtuelle. Éviter le contact avec autrui est possible, mais il est impossible de préserver sa pensée, on vit par et dans la langue — qui est à tous. La seule solution semble être le silence, c'est-à-dire la mort puisque, quoi que l'on fasse, on agira peu ou prou comme l'« autre ». On sait l'autre est bien un poème récit tragique : le narrateur n'a pas d'autre issue que disparaître s'il veut ne pas connaître la dépossession, reconnaître qu'il est comme l'« autre », ce qu'il refuse.
Ce qui peut sauver, provisoirement, c'est un emploi de la langue qui n'implique pas de relation de pouvoir, celui de la poésie. Le narrateur, dans la tentative d'échapper à la présence imaginée, donc possible, de l'« autre », entasse tous les livres de poésie de sa bibliothèque dans une grande valise, pour « sauver des livres, des paroles, de la sueur, du corps, du vivant. » Sueur et corps : dans la cave où le narrateur est descendu, les livres se métamorphosent et manifestent qu'ils sont vivants en saignant, et ce sang s'écoule de la valise, devenue elle aussi être vivant, blessée, et qu'il faut rassurer. La langue des poètes, le narrateur se l'assimile en cousant les pages des livres sur son corps, pour l'emporter en disparaissant : « On meurt auprès de ceux qui ont toujours été là, qui seront là toujours. »
Mais l'« autre » ? L'autre, invisible, a pris forme. Quand le récit commence, le narrateur mentionne trois chevaux, « trois chevalos » qui, dehors, hennissent ; ils réapparaissent à intervalles réguliers et se transforment : ils agissent progressivement comme des humains, jurent, ricanent, jouent à la roulette russe, aux fléchettes, mettent des masques, fument des cigares, massacrent un chien, traînent une femme par les cheveux... Leur métamorphose progressive a une fin : ils symbolisent la figure de l'autre, révélée quand la mort est proche : « l'autre [...] nous mate, à travers les yeux morts de trois chevaux minables. »
Il y a dans ce récit poème la connaissance de ce qu'est la difficulté de vivre, de se construire, d'avoir des repères alors que seule la "réussite sociale" prime. Il y a aussi une vraie maîtrise de la langue pour suivre un personnage blessé par la vie, au « vieux corps usé », enfermé dans sa peur des autres mais qui, au moment de mourir, exprime sa confiance en la poésie — en l'avenir :
« On meurt : on meurt, on est à terre. On écoute les poètes, on écoute leur voix, le temps qui passe par leur souffle, venus de tous pays, marchant vers nulle part, on entend le murmure du monde, la mémoire de l'oubli, un long chant lancinant, et qui s'élève : et nous rehausse. Ils sont tous là, assis par terre, le dos au mur, à faire un feu avec la vie. Ils sont là, tous, à faire des flammes avec leurs mains, mettre des braises dans leur bouche, et nous réchauffer le cœur. »
Édith Azam, On sait l'autre, P. O. L, 160 p., 12 €.
Note parue dans Sitaudis le 20 juin
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, on sait l'autre, on, cheval, corpd, peur, métamorphose, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2014
James Joyce, Finnegans Wake, traduction Philippe Lavergne

[...]
Mais qui vient par ici avec ce feu au bout d'une perche ? Celui qui rallume notre maigre torche, la lune. Apporte les ramours d'olive sur la boue des maisons et la paix aux tentes de Cèdre, Néomène ! Le banquet du tabernacle s'aproche. Shop-shup. Inisfail ! Tinckle Bell, Temple Bell ; ding ding disent les cloches du Temple. Sur un ton de synéglogue. Pour tous ceux d'esprit vif. Et la vieille sorcière qu'on damemnomme Couvrefeu siffle de son allée. Et hâtez-vous c'est l'heure pour les enfants de rentrer à la maison. Petits, petits enfants, rentrez chez vous dans vos chambres. Rentrez chez vous vivement, oui petits, petits, allez, quand le loup-garou est dehors. Ah, éloignons-nous, restons chez nous où la bûche dans son foyer brûle lentement !
L'obscurité tombe, (tint, tint) sur tout notre monde phénoménalement drôle. De l'autre côté la marée visite la berge du marais près de la borne de la route. Alvem marea ! Nous voici encircumenvelpeau d'obscurité. Hommes et bêtes ont froid. Il y a sur eux comme un souhait de n'être rien ni quoi que ce soit, ou seulement ce qui précède au pas de porte. Jardins zoologiques 8 Drr, deff, deucalion, pzz, appelle Pyrrha ! Ah où donc est notre épouse fondatrice, hautement honorable et salutaire . Le fou du logis est entré. Haha ! Hussard, où est-il ? À la maison, deux claires voix. Avec Nancy Hands. Tchitchi ! Le chien s'est enfui par les halliers. Oui hou ! Isegrim aux oreilles pendantes. Bon voyage !
[...]
James Joyce, Finnegans Wake, traduit de l'anglais et présenté par
Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, p. 263.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, finnegans wake, philippe lavergne, feu, sorcière, nuit, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2014
Jacques Sternberg (1923-2006), La géométrie dans l'impossible
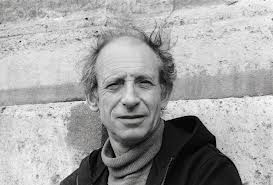
La disparition
Cela se passa très simplement, un soir vers six heures.
Il est difficile de savoir exactement comment le fait arriva, mais soudain le chiffre 2 disparut, il s'effaça du monde et coula on ne sait où, on ne saura jamais pourquoi.
Alors les mathématiques s'écroulèrent entraînant dans leur chute les évidences de l'algèbre, les comptes en banque s'effondrèrent dans la géométrie, la physique explosa dans la chimie et la géographie défonça les limites de l'orthographe.
Et c'en fut fait de tout, enfin, une fois pour toutes.
Le phénomène
Il est annoncé à l'extérieur de la baraque, mais sans précision. On laisse simplement entendre qu'il est monstrueux. Le chemin pour parvenir jusqu'à lui est long, étroit, mal éclairé, indiqué par haut-parleur.
Soudain le haut-parleur demande le silence. On arrive en effet dans une pièce plongée dans une obscurité totale.
Soudain, la lumière explose.
Et l'on se retrouve devant un miroir.
Jacques Sternberg, La géométrie dans l'impossible, Arcanes, 1953, p. 31, 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques sternberg, la géométrie dans l'impossible, disparition, fin, phénomène, monstre, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2014
Robert Creeley (1926-2005), Dire cela

Catulle, tu décoiffes
1
Mon amour — mon amour dit
qu'elle m'aime.
Et qu'elle n'aura jamais
un autre homme que moi.
Pourtant ce qu'une femme annonce
à un homme qui la jette
doit être écrit sur le vent et sur
l'eau vive.
2
Ma vieille dit c'est moi je suis le mieux,
elle dit personne ne le fait mieux que moi.
Mais que dit ma vieille quand je la jette, —
Mmmm, plutôt non que le mieux.
3
Ma vieille est une cinglée de moi,
elle me dit elle m'aime ne me quitte pas —
mais ce qu'une cinglée peut annoncer à un homme
est le mieux écrit sur le vent & l'eau & le sable.
4
Amour & argent & pilier de bar
mon homme passe pour un lascar
y rentre tard et c'est pas de mon lit
et maintenant qu'est-ce que je lui dis ?
5
Nous sommes fous mais nous sommes gais,
la vie est courte & la vie nous trouve, s'il te plaît,
c'est le moment ou jamais & c'est la fête,
rate pas le mieux, ou je te savonne la tête.
Robert Creeley, Dire cela, choix, présentation et
traduction de l'américain par Jean Daive, NOUS,
2014, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, femme, amour, lit, abandon, fête | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2014
Lou Raoul, Else avec elle

L'or Else
la campagne parfois ne dit pas un mot
et les voitures, toutes, s'éloignent
les animaux furtivement dans les taillis, tapis
puis le sifflement des rapaces nocturnes tout près, Else, de ton sommeil
parfois la campagne ne dit pas un mot
mais le matin, Else, tu regardes l'arbre du bout du champ, il vieillit aussi
mais tu rassembles des cailloux
des tas très petits c'est pas grand-chose ça ne pèse pas lourd
ou même c'est rien
mais toi tu vois, Else, leur or
l'or des cailloux
pour que ta vie te serve un peu
Lou Raoul, Else avec elle, éditions isabelle sauvage, 2012, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lou raoul, else avec elle, campagne, sommeil, caillou, arbre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2014
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi : recension

On remontera volontiers aux Héroïdes d'Ovide pour débuter la tradition des lettres d'amour adressées à un amant ou une maîtresse fictifs, et l'on sait qu'elles eurent de très nombreuses imitations, notamment à la Renaissance. Les Lettres-Poèmes publiés maintenant auraient été écrits par une jeune femme à Antoni Gaudi, le premier envoi daté du 2 mars 1924, suivi de 17 autres, le dernier du 27 avril 1927, donc après la mort de l'architecte catalan, le 10 juin 1926 à l'âge de 74 ans ; suivent deux fragments d'un journal poème écrit en 2000. Matthieu Gosztola aurait hérité d'un oncle une vieille maison en Espagne et l'un de ses premiers soins aurait été de visiter le grenier : il aurait trouvé, évidemment à l'écart, une malle contenant des lettres et, choisissant ce qui débordait l'intime, les aurait traduites. Traduction est toujours trahison : on reconnaît son écriture dans les poèmes en vers libres d'Antonia Maria Arellano, par ailleurs pianiste. Il n'a pas trouvé trace de cette mystérieuse épistolière qui aurait vécu plus que centenaire : on comprendra que, fictive, elle est prétexte pour son inventeur de reprendre des motifs qui lui sont familiers.
La relation à Gaudi, donc à l'architecture, est donnée d'emblée dans la première lettre : un "on" projette l'utopie de maisons ventres qui ressemblent singulièrement au ventre maternel : elles protègeraient « du danger que / représente / l'imprévisible avec lequel le dehors se confond », et leurs chambres, lieux clos, y seraient avant tout le lieu de l'intime, de l'amant et de l'amante. Affirmation lyrique par le biais d'un indéfini auquel, dès la seconde lettre, se substitue un "je". La fictive Antonia s'enthousiasme pour l'art de Gaudi, à la fois écriture de et dans l'espace, danse des éléments, musique, restitution d'une émotion qui transforme la vision du réel.
Histoire d'une rencontre rêvée entre Antonia et Antoni ? une lettre très courte annonce un rendez-vous, la suivante datée du surlendemain la rappelle, avec l'espoir d'une fusion, évoquée dans une autre lettre, « j'existe avec toi /et seulement / avec toi qui / m'existes / en t'exis- / tant », fusion qui donne lieu à des variations sur les deux prénoms, sur le corps des amants, « non pas mêlés, mais / réunis », et qui inscrit ces « passagers de l'évidence » dans une histoire de l'amour.
Mais la rencontre n'aurait pas eu de lendemain, ce qui n'empêche pas la jeune femme d'écrire : manière de journal au toujours absent, à qui elle s'adresse avec le "vous", puis le "tu". Vient sous sa plume le nom d'Orlando, allusion à l'histoire d'amour de l'Orlando furioso de l'Arioste, nom venu du rêve et lié à l'écriture. Le poème serait assemblage de ce qui est dispersé pour devenir harmonie, « fait de pièces de céramiques cassées, le / poème-trencadis »(1), non pas puzzle à reconstituer mais composition qui demeure toujours inattendue. C'est ce que dit autrement une lettre : dans un groupe qui parle, chaque voix est distincte mais leur ensemble forme « une unité / qui à aucun moment les fait / mourir en tant qu'individualités » ; ou le poème est à l'image de la mer dont on imagine saisir quelque chose en collant un coquillage à l'oreille, et l'on ne fait que saisir ce qui interrompt le silence.
Les premières pages du journal d'Antonia n'abandonnent pas Gaudi, toujours présent, « dans l'ignorance superbe de la mort ». Elle évoque un voyage en Inde, « tourbillon », un autre à Venise, « mirage », qui ne sont rien puisqu'ils ne permettent pas d'« être en lieu, comme l'on dit / être en vie », ce que lui apporte les créations de l'architecte. C'est par le dernier fragment du journal que le lecteur est certain du caractère fictionnel d'Antonia : âgée alors de 103 ans, elle lit Fleischer et reçoit des mails de Jean-Paul Michel, poète auquel la revue NU(e) vient de consacrer un numéro préparé par Gosztola..., et c'est par deux citations, dont l'une étendue de Michel que s'achèvent les lettres poèmes.
À partir du personnage d'Antonia, se mêlent l'hommage à un architecte, des variations sur l'écriture et la musique, une vision du couple — « Nous sommes deux, mais le même élan », écrit-elle à Gaudi —, les motifs du rêve et de l'enfance. Matthieu Gosztola continue aussi son approche singulière de la création, écrivant sa lecture d'une œuvre par la poésie comme il l'a fait dans des entretiens — imaginés — avec Lucian Freud en 2013.
—————————————————————————————
1. trencadis : littéralement "pique-assiette", technique de constitution de mosaïque (inventée par Gaudi) par récupération de morceaux de céramique, utilisée notamment dans le Parc Güell à Barcelone.
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi, éditions Abordo, 2014, 108 p., 12 €. Recension parue le 16 juin dans la revue numérique Sitaudis.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matthieu gosztola, lettres-poèmes, correspondance avec gaudi, journal, rêve, enfance, création, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2014
Édith Azam, On sait l'autre

On allume la radio mais sans penser au geste et sans même écouter ce qu'elle crache, la radio. On allume l'éclairage, on réchauffe le café, on écoute le frigo qui grince, aussi bien que nos os. Derrière le rideau, la fenêtre est fermée. Derrière la fenêtre trois chevaux, dos à dos : trois chevalos, trois os. On ferme les paupières, on dit : ça passera, on ne sait pas de quoi on parle mais on le dit : ça passera, que ça finira bien par passer, puis, dans l'arrière-cour une voiture démarre, elle roule bleue sur le chemin, s'enquille en jaune un peu plus loin, et dans : l'embouteillage. Ça passera, ça passe passe. Le café bout, ce n'est pas grave. Dans la tasse on verse de l'eau froide, on avale d'un trait. Une rasade une autre une : rasade. L'autre, on le voit de loin, il arrive bras ballants, on entend son pas lourd, son pas fait scrcsh sur le gravier. On le voit de loin, l'autre, il agace. Il nous agace de voir si loin. Voir jusqu'à lui, jusqu'à cet autre, c'est une anomalie : ça nous cloche. Voir l'autre de si loin, c'est anormal. Oui, c'est ça le mot à dire : A-NOR-MA. On le répète trois fois de suite, trois fois fois fois, trois, trois, on répète. Cela ne change rien aux choses, juste que la répétition permet une transition simultanée. On écoute la radio qui dit : Lisbeth. Lisbeth c'est joli, ça nous plaît, on ne sait pas pout quelle raison ça nous plaît, on le retient quelques secondes, dix par exemple, ensuite tout se déforme, on ne sait pas pourquoi non plus. C'est peut-être le corps entier qui se délite.
Édith Azam, On sait l'autre, P. O. L, 2014, p. 7-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, on sait l'autre, café, cheval, ça passe, anormal, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2014
Véronique Pittolo, Toute résurrection commence par les pieds

L'art catastrophique
Il y a des jours artistiques et des jours non artistiques.
Les jours ordinaires tu ne peux qu'observer le réel, sans plus,
ton cœur n'est pas soulevé. Quand tout va bien l'art est un surplus, une excroissance, une évasion futile. Les réflexions sur
le féminisme, on s'en fiche. Dans de tels moments, à quoi sert la
perruque de Marie-Madeleine ?
L'art ne répond plus à la question :
Qu'est-ce que l'art ?
Dans les situations de guerre, explosions, attentats, il sert à
peine à disposer des fleurs dans un vase, n'emballe plus, n'est
plus cosmétique.
Imaginez qu'un pot de fleurs vous tombe sur la tête, c'est un
désordre intéressant pour les yeux, le regard artistique aime ces anecdotes.
Depuis le 11 septembre, la guerre est devenue un enjeu majeur
libérant un grand nombre de pulsions. Les artistes veulent
reproduire la catastrophe, photographier les victimes, assembler
les horreurs avec du scotch.
Ils disent que c'est un monde nouveau, qu'il faut s'y habituer.
D'autres persistent à peindre avec une consistance de yaourt
des hommes à têtes de lapins, des barbies exagérées.
Véronique Pittolo, Toute résurrection commence par les pieds, éditions de l'Attente, 2012, p. 115.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : véronique pittolo, toute résurrection commence par les pieds, art, catastrophe, féminisme, 11 septembre | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2014
Ghérasim Luca, L'extrême-occidentale

La forêt
Les hommes qui incarnent la forêt et les femmes qui, renversées, la réfléchissent, se partagent les deux côtés du miroir Celui-ci est la terre même, surface horizontale, coupant la scène en deux parties égales, vers laquelle convergent, perpendiculaires, des hommes et des femmes dont les pieds se touchent par la plante.
« À ce contact, c(est comme un fluide ailé et rampant, alliage indicible d'essor, liant et brûlure, qui gagne rapidement les chevilles, les jambes jusqu'à la taille, frôle les doigts dans lesquels finalement il s'enfonce jusqu'aux poignets, remonte le long et des bras et ne dépasse pas les épaules qu'on dirait agitées de violents battements d'ailes tandis que les autres parties du corps ne cessent de jaillir, de s'accrocher, de perdre haleine...»
Cet envol aérien et souterrain qui tente de porter les deux séries de personnages vers l'extrême haut et vers l'extrême bas, comme aux confins d'un territoire unique, enferme troncs et racines dans une équation à deux inconnues dont la résolution sera donnée et refusée à la fois par un grand X surgissant au milieu de la scène et que l'acrobatique étreinte d'un couple amoureux calligraphie devant nous dans l'espace, afin de rendre sinon déchiffrable du moins couramment lisible la terrifiante écriture de notre passage sur la terre.
[...]
Ghérasim Luca, L'extrême-occidentale, éditions Corti, 2013, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, l'extrême-occidentale, homme femme, forêt, miroir, terre | ![]() Facebook |
Facebook |





