28/01/2014
Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti (2)
Je suis seul ; il fait froid ; il pleut sur le jardin ; la lumière tombe ; profondément, je suis bien.
Pluie régulière et pas fine, claquettes légères sur le plastique du toit. Je viens de raturer "heureux" parce que ce n'est pas l'adjectif approprié. Je suis neutre, c'est-à-dire en paix avec ce monde (non pas le monde) et avec moi (non pas les autres).
Aucun stoïcisme ou quelconque dépassement par je ne sais quelle vertu, aucun principe suivi d'une quelconque spiritualité lointaine. C'est parfaitement immédiat : un accord profond avec la pluie, le bout de mur gris, les arbres quasi nus, cette lumière pauvre juste. Juste ce moment : accord. Je vis avec ; je me dissous dedans. Je ne parle pas de bonheur, je parle d'être Le neutre, c'est de l'être pur.
Aucune sagesse. Vivre en tension, contradiction présente ou alternance d'angoisse et de calme. Être sage revient à être mort avant de mourir. Aucune envie de cela : je préfère de loin affronter mes peurs, mes joies... mon lot de vivre, souffrir inclus, car tout cela ne va pas sans mal. Mais pouvoir au moins me dire que je n'ai pas évité ma vie.
Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti, éditions centrifuges, 2013, p. 51.
Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, flaques, dessins de jean-michel marchetti, être bien, pluie, accord, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2014
Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti

Le plus important de ce que tu vis n'est pas forcément le plus important à écrire. L'essentiel; c'est ce que tu peux écrire de vivre. Parfois, seulement des miettes, mais au moins, cela, tu peux le faire.
Écrire s'enracine dans un certain nombre de hantises profondes. Même si l'œuvre bouge un peu, c'est toujours pour finalement retourner à ces quelques points d'ancrage qui font l'identité de l'auteur. En théorie, on peut écrire sur n'importe quoi. En pratique, on n'écrit que sur ce qu'il est nécessaire d'écrire. Le reste passe sous silence, ne retient pas la main, ne s'impose pas.
On devient poète sans aucune élection par une quelconque instance. Simplement, la vie. Et la poésie comme une quête d'élucidation, voire de réponse. On comprend plus tard, non pas trop tard, mais tard qu'il n'y a pas de réponse, et on en reste à ce qui nous fait vivre. En un sens, la poésie ne guérit pas, mais elle soigne, un peu. Un poète n'est pas Pasteur découvrant le vaccin contre la détresse.
Le plus étonnant peut-être dans écrire, c'est cette tension incessante, multiple, complexe, entre liberté et contrôle.
Tu veux écrire ? Mets-toi à ta table. Et on verra bien qui, de la table ou de toi, en aura marre le premier.
Antoine Emaz, Flaques, Encres de Jean-Michel Marchetti, éditions centrifuges, 2013, p. 9, 33, 41, 48, 52.
Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, dessins de jean-michel marchetti, flaques, écrire, poésie, vivre, hantise | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2014
Jean-Loup Trassard, Territoire

Une semaine avec Jean-Loup Trassard
Il pleut, les saisons empiètent les unes sur les autres, rarement répondent à ce qui est attendu d'elles, il fait sec de nouveau pour quelques jours, les murs sèchent, la cour sèche, il y a un affleurement pierreux juste au devant de l'ancienne étable. L'hiver entasse des génissons bourrus là-dedans, l'été ils sont hors, à l'herbage, l'étable vide, porte ouverte, des poules entrent. Le volet est sur une sorte de fenêtre, toujours fermée, à l'intérieur on a mis devant un râtelier contenant du foin. La peinture, brun presque orangé, s'est craquelée, le bois qu'elle couvre a vieilli sans bouger, sans autre fatigue qu'être battu par les pluies mouillé séché mouillé, années au long... Les planches sont aux deux bouts, haut et bas, comme rongées, et même sur leurs bords, ce qui les sépare les unes des autres, les disjoint. Un verrou de fer est poussé à fond vers la droite dans un anneau scellé au mur. On ne sait pas à quoi servirait d'ouvrir ce volet, mieux vaut que l'étable demeure ombreuse et que, plaqué contre le mur épais, il empêche la pluie le vent qui secouent chênes et toitures de pénétrer dans le creux garni de paille où les ventres se touchent. Donc le verrou n'est plus manœuvré. La poignée courbe reste en repos mais entre la barre (ronde rouillée) et le bois peint un goupillon pour les bouteilles, son manche, a été coincé tout de biais. La tige raide est constituée par une torsade très serrée de métal oxydé, gris à peu près, formant un petit anneau à son extrémité (celle qui descend plus bas que le verrou). Au-dessus se trouve la brosse, des poils blancs ordonnés par rangs successifs en forme de grappe, avec une sorte d'épi à la pointe.
Jean-Loup Trassard, Territoire, textes et photographies, Le temps qu'il fait, 1989, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, territoire, étable, poule, pluie, paille | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2014
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à main dans une ferme

Photographie Jean-Loup Trassard
Une semaine avec Jean-Loup Trassard
Cognée, haches & merlins
S'il ne faut ruer (c'est-à-dire jeter) le manche après la cognée, n a cette fois perdu pour ainsi dire le nom avant l'outil. Mais au mot de cognée, qui n'est plus dit, je n'oppose nulle dureté d'oreille tant il sait alentour étende les bois du Moyen Âge, la neige, appeler surtout l'idée d'un abattage des arbres par nécessité our se chauffer.
Durant la guerre fut retrouvé le lien direct entre un grincement d'arbres qui tombe et le crépitement du feu : le bois étant à peine sec il fallait le faire fumer sur les côtés de la cheminée. Seule excuse, un peu hâtive, au sacrifice de tel châtaignier-écusson (énorme tronc, feuillage rare, châtaignes précoces) que je regrette encore. J'ai vu tomber alors beaucoup de pieds, participant au jeu, évaluant l'entaille, tirant sue les cordes come pour un vêlage, fêtant la chose !
Aussi malgré les défrichements agricoles et l'exploitation aérée des forêts, parce que son bruit lointain dans les brumes fait mal (que dire alors du cri inquiétant de la tronçonneuse! ), j'écrirai bien : cognée, outil de destruction. Cette incisive emmanchée triomphe en une heure, deux peut-être, de la patience séculaire de tout arbre, met à bas le domaine du vent. C'est la plus grande des haches, maniable à deux mains. Le fer souvent en est long, étroit dans le corps, large au tranchant.
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à main dans une ferme, Le temps qu'il fait, 1981, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, inventaire des outils à main dans une ferme, cognée, bois, forêt, cheminée | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2014
Jean-Loup Trassard, Caloge

Une semaine avec Jean-Loup Trassard
Mer bientôt blonde sur ses orges, mer chevelue de seigles roux. Nous sommes là simplement pour voir. Pour marcher de façon précaire au bord d'une sphère sur son orbe. Et nous croyons que rien n'entame le regard de l'homme vers la mer.
Marée montante du blé vert, reflux des pailles qui laissent le chaume aride. Dans l'étendue de ciel béant les oiseaux n'ont pas coutume de se percher, ils nichent sur le sol, faute de branches passent en élévation, ou chutes, leur vie criante. Alouettes que leur chant maintient hautes, qui soudain tombent en deux ou trois paliers, et devant notre étrave le vol de l'œdicnème. D'entre les vagues céréales mûrissantes sort l'appel d'une caille, nous la nommons.
Sensible à cette respiration longue qui nous fait sur les champs monter descendre, à l'ample courbe qui jusqu'au lointain baisse relève les champs avec lenteur, nous allons sous la voile du ciel tendu, à chacun pour seule mâture sa verticalité, d'espace ivres.
Jean-Loup Trassard, Caloge, Le temps qu'il fait, 1991, p. 28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, caloge, blé, mer, oiseau, alouette | ![]() Facebook |
Facebook |
23/01/2014
Jean-Loup Trassard, Des cours d'eau peu considérables

Une semaine avec Jean-Loup Trassard
L'eau est si claire que le fond ensoleillé reçoit l'ombre non seulement des herbes ou des feuilles qu'elle soulève mais aussi des rides et des remous qui agitent la surface et contre quoi la lumière bute, il s'en forme à travers l'eau coulante de très légères ombres sur le sable ou la vase qui tapissent le lit, elles ondulent, dansent, sans un arrêt, changeantes. J'y vois même glisser de temps à autre l'ombre toute ronde d'une bulle juchée sur le courant.
Et dans le mouvement de l'eau, invisible celui des parcelles de terre qu'elle arrache, porte suspendues, abandonne. Un jour je ne serai plus sur sa rive, mais le ruisseau continuera — chansons, bulles, lumière liquide — droit en méandres alternés sur la ligne de son penchant, tantôt par bonds et à pleins bords, tantôt murmure sous l'herbe secret, comme il sort au bas de ces pages, d'avoir été dit inchangé (je le vois bien : l'encre le mime, ma plume ne l'a pas touché).
Debout, j'écoute le bruit que fait la plus petite eau sur la terre.
Entre un ruisseau et l'autre, des champs de silence entiers.
La plus longue prairie revêt, au plus ras, une vallée à peine creuse en surface de la planète, sol paisible d'un plissement, tandis que roulent les temps astronomiques. Autour, la floraison pâle des saules, sureaux, épines noires et poiriers, tout parfums, enfleuris de blanc. Des ramiers roucoulent çà et là une profondeur de campagne. Douce par ses draps de rosée, cette prairie est un berceau : mon âme s'y couche.
Le ruisseau ne cesse d'accourir à l'énigme qu'il pose.
Jean-Loup Trassard, Des cours d'eau peu considérables, Le Chemin, Gallimard, 1981, p. 120-121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, des cours d'eau peu considérables, ruisseau, prairie, éphémère | ![]() Facebook |
Facebook |
22/01/2014
Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur

Photographie d'Olivier Roller
Une semaine avec Jean-Loup Trassard
Du pain, très cuit, croûte de préférence, en telle quantité que le bouillon disparaisse, tout entier bu par les croûtes trempées, brunes ou noires, qu'il écrasait avec sa cuiller en bouillie épaisse, un morceau de beurre, un peu de crème fraîche : le régal de mon père, qu'il appelait panade. Quand il revenait d'un voyage d'affaires, deux trois jours, parfois moins, en Bretagne où il allait voir les maires, retraiter ses contrats, visiter les marchés emplis de coiffes et de paniers, de carrioles et de volailles, il se lavait et se couchait. Au lit, il se faisait servir une panade très chaude dans un bol de terre. Après mon bain j'avais dîné seul, on m'amenait à lui pour que je rentre dans le lit, qui n'était qu'à une place, pour assister à son repas. Nous étions serrés, j'entends la cuiller racler le bol de terre. Il est même arrivé que mon père me fasse goûter la panade, je trouvais le pain trop brûlé. Ensuite on lui apportait deux œufs à la coque qu'il mangeait avec pain et beurre, écrasant toujours la coquille quand elle était vidée. Il posait le plateau par terre et me racontait une histoire. Il inventait pour me faire rire des suites de péripéties semblables à celles qu'il avait aimées, étudiant à Paris, dans les films comiques, Max Linder, Laurel et Hardy, Charlot. C'est quinze ans plus tard, en voyant de tels film, que j'ai compris d'où venaient ses personnages sautillants, le gros bonhomme, l'échelle et le pot de peinture, le petit chien qui passe entre les jambes, le commis du pâtissier qui justement livre une pièce montée...
Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur, Gallimard, 1993, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l'espace antérieur, panade, enfance, comique, burlesque | ![]() Facebook |
Facebook |
21/01/2014
Jean-Loup Trassard, Ouailles

Photographie Olivier Roller
Une semaine avec Jean-Loup Trassard
Franchie l'Aigue Blanche au pont de bois, c'est d'abord un chemin de tracteurs dans les prés, l'herbe haute, grossière, très fleurie, mauvais foin. Puis, quand on bute sur les premiers arbres, un sentier tout de suite montant. À l'ombre mais ne voyant plus la montagne, l'éprouvant. Poussière, ou pierraille, ou aiguilles de pins, le sentier nous tire par lacets, contourne des effondrements, propose quelques variantes, brefs raccourcis, s'efface dans la traversée d'un torrent (tortueuse traînée de pierres grises, entassement de branches blanchies, peut-être un tronc entier, mais peu d'eau) et reprend de l'autre côté. Avant que d'arriver aux prairies on ne voit pas la montagne, on la ressent, dès les premiers pas. Caché sous des mètres de neige en hiver, le sentier ancien est sec maintenant, usé à nouveau d'une façon infime, terre, cailloux. C'est tout de suite, encore, de plus en plus, l'affrontement des jambes lasses, et capables pourtant, au phénomène de la montagne (de petite montagne, que j'aime parce qu'elle n'est pas, justement, une paroi pour l'alpinisme mais montagne pour les moutons, les arbres, les oiseaux). Muscles et tendons, pliement au genou, le fémur, de la tête, pilonnant son mortier iliaque, les jambes rythmées lentement mais tenaces hissent par l'inclinaison étroite du sentier le corps et quelques impédiments au flanc de la montagne. Et l'effort de chaque pas semble dérisoire par rapport à la masse de terre.
Jean-Loup Trassard, Ouailles, textes et photographies, Le temps qu'il fait 1991, p. 74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, ouailles, montagne, sentier, torrent | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2014
Jean-Loup Trassard, L'amitié des abeilles

Photo Olivier Roller
Une semaine avec Jean-Loup Trassard
À la maison, les portes sont barricadées par les toiles d'araignées, les verrous bloqués, les serrures sèches et mortes, la mâchoire fermée. Les vitres reflètent la nuit sans mon ombre, je pousse et tout grince comme dans la défaire de quelque mauvaise fée. J'entre parmi les souvenirs suspendus.
Il y a là comme une odeur d'absence. Et pourtant, quelque chose de léger, obstiné même, se tient devant moi, derrière aussi quand je m'avance. Nous avons vécu là et chaque objet transpire, distille infiniment notre ancienne présence. Nous avons attendu pendant de longues heures. Errant comme à l'intérieur de notre propre corps, ayant poussé dehors, pour un temps, tout le reste du monde. Pendant les jours de pluie, un parfum de cœur s'est mêlé dans le bois, dans le marbre peut-être... J'entre et tout se resserre... Les morceaux de la coquille se collent, ils savent sans rien dire que je ne suis pas un étranger. Je reviens, invisible, les parquets en craquant reconnaissent mes pas.
Jean-Loup Trassard, L'amitié des abeilles, Le temps qu'il fait, 1961, p. 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l'amitié des abeilles, la maison, araignée, silence, souvenir, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
19/01/2014
Albert Camus, Carnets II, janvier 1942-mars 1951

1942
Littérature. Se méfier de ce mot. Ne pas le prononcer trop vite. Si l'on ôtait la littérature chez les grands écrivains on ôterait ce qui probablement leur est le plus personnel. Littérature = nostalgie. L'homme supérieur de Nietzsche, l'abîme de Dostoïevski, l'acte gratuit de Gide, etc., etc.
Se persuader qu'une œuvre d'art est chose humaine et que le créateur n'a rien à attendre d'une "dictée" transcendante. La Chartreuse, Phèdre, Adolphe auraient pu être très différents — et non moins beaux. Cela dépendra de leur auteur — maître absolu.
Nostalgie de la vie des autres. C'est que, vue de l'extérieur, elle forme un tout. Tandis que la nôtre, vue de l'extérieur, paraît dispersée. Nous courons encore après une illusion d'unité.
Il ne couche pas avec une putain qui l'aborde et dont il a envie parce qu'il n'a qu'un billet de mille francs sur lui et qu'il n'ose pas lui demander la monnaie.
C'est quand tout fut couvert de neige que je m'aperçus que les portes et les fenêtres étaient bleues.
1943
Avoir la force de choisir ce qu'on préfère et de s'y tenir. Ou sinon il vaut mieux mourir.
On ne peut rien fonder sur l'amour : il est fuite, déchirement, instants merveilleux ou chute sans délai. Mais il n'est pas...
Albert Camus, Carnets II, janvier 1942-mars 1951, édition établie et annotée par Raymond Gay-Grunier, Folio, 2013, p. 36, 37, 40, 44, 61, 95, 122.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets ii, janvier 1942-mars 1951, littérature, œuvre, nostalgie, neige | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2014
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle (2)

[...]
(d'ici)
est-ce que le poème
peut dire`
le secret
— du grenier ?
est-ce que la question
— qui précède
est toujours
le poème ?
oui
parce que
c'est ainsi
oui
parce que
le poème s'écrit
avec les limites
qu'il franchit
le poème peut faire le rêve
le rêve peut faire le poème
je suis heureuse
ici
je suis malmenée
ici
je reconnais les choses
ici
— oubliées jetées enfouies
et celles-là
qui n'ont pas été
ici
est-ce toujours le poème ?
oui
d'abord accueille
la langue ta langue sa langue
fera le tri
après
voilà c'est fait
[...]
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle, Dessins de Yanna Andréadis, Héros-Limite, 2014, p. 162-163.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, terre sentinelle, dessins yanna andréadis, poème grenier, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
17/01/2014
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle

et maintenant je voyage de bête en bête partout
ici aussi, juste en face, derrière les grilles, de mon perchoir
le naturaliste a commencé sur le terrain
le naturaliste peut écrire des livres
mais c'est secondaire ;
on peut lui dédier une espèce
mais c'est secondaire ;
il peut entrer sur la toile
mais c'est secondaire
pour le naturaliste,
le sens de la vie
va de la terre à la vue
de la terre au toucher
de la terre à l'esprit
de la terre
à l'image
de la terre
j'ai d'abord fait tout le contraire, même face à la mer
pourtant, ma Mère disait : « par beau temps, ne reste pas [dedans»,
c'est vrai
j'ai connu la garenne de Saint-Martin-des-Champs
et les lapins au cul blanc
j'ai connu la mare aux têtards
et les métamorphoses
j'ai connu les rochers les algues
et la pêche aux bigorneaux
j'ai connu la forêt le petit bois mort
et la construction des cabanes
j'ai connu la plage à marée basse
et les cris des goélands
[...]
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle, Dessins Yanna
Andréadis, Héros-Limite, 2014, p. 137-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, terre sentinelle, nature, terre, plage roc | ![]() Facebook |
Facebook |
16/01/2014
Valérie Rouzeau, Neige rien

Conf
Lorsque vous relirez Tacite lorsque vous relirez
(Si on lisait d'abord si on lisait)
Nul n'ignore comme chacun sait
Nous ne reviendrons pas sur le célèbre chapitrou
(Si on venait déjà pour commencer)
Que tout le monde connaît
*
Manœuvres
À l'étroit les trois huit
Virés salaires de rien
Micheline Michelin
Paradis pour demain
Allez toi va-t-en vite
virée ç'a l'air de rien
Micheline Michelin
On te remercie bien
Valérie Rouzeau, Neige rien dans Pas revoir
suivi de Neige rien, La Table ronde, 2010,
p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, neige rien, tacite, travail, salaire | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2014
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes

Dans ce poème
le delta est surchargé
le carbone de l'antarctique
sera déjà épuisé
mes tasses jadis
avaient des anses
dans cet état où je ne peux voir de hérons
de porcs-épics ni non plus de petites taupes mortes sur le sentier
j'ai face à moi quelques lettres à remplir
je ne dois pas les écrire tout a déjà été écrit
chaque ligne chaque phrase le nom et son adjectif
mais il y a quand même des espaces qui seront remplis
des monogrammes de parafes par les archivistes dans notre dos
ce que je vois eux ne le voient pas
ce que je ne comprends pas eux le comprennent
en face il y a le retard non spécifié de la mort
du coin des rues des personnages
du désastre sur les bords
du rétroviseur
masse de marchandises graduée discontinue
qui glisse qui revient qu'on extrait
mais dans le livre des comptes : en croisant
les anciennes données et celles du millimètre
au fond de la courbe descendante
dans les tracés calculés par défaut
même mon sommeil incolore
le filet effrangé des destinations
prend la forme certaine, apaisée
d'un soulagement statistique
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes, à la suite de Lettres à la Réinsertion Culturelle du Chômeur, traduit de l'italien par Stéphane Bouquet,
NOUS, 2013, p. 77-78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea inglese, mes cahiers de poèmes, monde défait, mort, désastre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2014
Eugène Delacroix, Journal
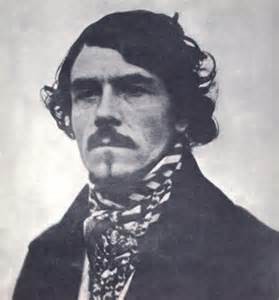
À l'occasion de l'exposition Delacroix en héritage, Autour de la collection d'Étienne Maureau-Nélaton (11 décembre 2013-17 mars 1014 - 6 rue de Furstenberg, 75006),
reprise d'une une note de lecture sur le Journal de Delacroix, publiée en 2009 dans la revue Europe :
Pourquoi commencer la rédaction d'un Journal quand on a 26 ans et que l'on se voue à la peinture ? Dès les première lignes écrites en 1822, Delacroix se fixait un objectif : « Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul ; je serai donc vrai, je l'espère ; j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. ». Le projet de se contrôler, de s'éloigner du monde extérieur pour réfléchir sur le moi, échouera relativement vite puisque la rédaction sera interrompue après trois années et ne sera reprise qu'en 1847. Ce n'est plus alors le même Delacroix qui prend des notes dans des carnets. Il a une œuvre de peintre derrière lui, il a voyagé notamment au Maroc et en Andalousie, il a beaucoup lu, il est devenu selon Baudelaire (Salon de 1846) un « grand artiste, érudit et penseur » et son souci n'est plus de s'interroger sur son identité. Baudelaire encore, rendant compte de l'exposition universelle de 1855, le définissait ainsi : « Il est essentiellement littéraire [...] par l'accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin, et par la dramatique gesticulation de toutes les forces spirituelles vers un point donné ». Ce lien établi entre le littéraire et le pictural est un des motifs récurrents du Journal.
Tourner autour de ce qui distingue la peinture de l'écriture répondait pour Delacroix au projet d'élaborer une écriture de peintre. Michèle Hannoosh analyse précisément en quoi il rompt avec les idées dominantes ; elle résume la théorisation faite au XVIIIe siècle par Lessing, pour qui la « temporalité de la littérature permet la narrativité, la causalité et donc l'unité » alors que la peinture, entière devant le spectateur, ne pourrait engendrer que des impressions confuses et sans ordre. Pour Delacroix, au contraire, le tableau donne en même temps la vue de la réalité et sa représentation expressive, ce qui provoque « une perception unie de la matière et de l'esprit », idée que souligne M. Hannoosh. Ces réflexions de Delacroix ont des rapports avec la manière dont il rédige son Journal. L'éditrice décrit les manuscrits comme un « document complexe, hybride, chaotique, labyrinthique » ; c'est que la construction du Journal donne au lecteur cette liberté qu'il a devant un tableau, sans suivre les règles d'un genre, règles vigoureusement rejetées dans tous les domaines : « Sur la ridicule délimitation des genres. Rétrécit l'esprit. L'homme qui ne fait que le trou d'une aiguille toute sa vie ».
Lisant le Journal, on se repère dans le temps grâce aux dates de rédaction, mais la chronologie est très souvent en défaut dans la mesure où Delacroix laisse parfois plusieurs jours entre ce qu'il a vécu et l'écriture, et introduit dans son texte des documents (listes d'adresses, coupures de journaux, billets de chemin de fer, etc.), traces de la vie quotidienne à côté de ses développements sur son travail de peintre, sur ses rencontres, sur les événements. En outre, il renvoie régulièrement à un autre endroit de ses carnets, n'hésite pas à modifier ce qui a été écrit plusieurs mois auparavant et à le commenter.
Ces pratiques brisent la narrativité et construisent une temporalité complexe ; éloignées de l'écriture habituelle du journal intime, elles aboutissent à multiplier les points de vue du lecteur, ce qui répond à l'idéal de Delacroix, qui notait qu'« Un homme d'esprit sain conçoit toutes les possibilités, sait se mettre, ou se met à son insu, à tous les points de vue ». Défendant sans cesse, à l'exemple de Montaigne, le caprice de la pensée, la nécessité de prendre en compte le caractère divers de l'esprit, il affirmait en moraliste « Il y a dix hommes dans un homme, et souvent ils se montrent dans la même heure ». En outre, la réécriture de notes font du passé un matériau qu'il est possible d'utiliser dans le présent. La chronologie devient relative, ce qui importe alors est de penser un temps souple, sujet à variation : la continuité temporelle — c'est-à-dire la croyance au progrès ou à la décadence — est exclue, et Delacroix affirme à diverses reprises « la nécessité du changement. Il faut changer : Nil in codem statu permanent ».
Ce point de vue implique que l'activité intellectuelle occupe une place importante. Certes, Delacroix vivait dans l'institution, fréquentait les cercles officiels, appartenait au Conseil municipal de Paris, mais il allait aussi au concert, à l'opéra, au théâtre, lisait ses contemporains, français (Baudelaire, Sand, Balzac) ou non (Dickens, Poe, Tourgueniev), recopiait des extraits, et il écrivait « Je me suis dit et ne puis assez me le redire pour mon repos et pour mon bonheur — l'un et l'autre sont une même chose — que je ne puis et ne dois vivre que par l'esprit ; la nourriture qu'il demande est plus nécessaire à ma vie que celle qu'il faut à mon corps. » Noter ses impressions, c'est en les approfondissant développer ses idées, non pas pour "inventer" du nouveau, mais pour comprendre comment les exprimer de manière nouvelle. Cette vie de l'esprit a parallèlement un autre rôle, souvent souligné dans le Journal, lutter contre l'ennui ; Delacroix vit dans le siècle du chemin de fer, qui réduit les distances et fait "gagner" du temps, ce qui ne change rien au sentiment d'ennui que beaucoup éprouvent. Ces lignes de 1854, « Nous marchons vers cet heureux temps qui aura supprimé l'espace, mais qui n'aura pas supprimé l'ennui », font écho à cet aveu de 1824, « Ce qui fait le tourment de mon âme, c'est la solitude ».
Écrire, c'est retenir ce qui est vite perdu, la mémoire ne pouvant tout emmagasiner ; un tri s'opère et la plus grande partie de ce qui est vécu, éprouvé, sombre dans l'oubli. Delacroix note à plusieurs reprises l'intérêt de pallier la faiblesse de la mémoire — « Il me semble que ces brimborions écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu'elle s'écoule ». Ne rien avoir noté, c'est n'avoir pas existé... C'est la mémoire du Journal qui établit une continuité en fixant ce qui est par nature éphémère, l'expérience du temps, notre « passage d'un moment ». Pour le lecteur d'aujourd'hui, le Journal de Delacroix ne fait pas que livrer le visage d'un peintre, il est aussi un tableau varié et complexe, sans doute partial et lacunaire (et intéressant pour cette raison), de la vie de la bourgeoisie et de milieux intellectuels au XIXe siècle. Il est aussi très souvent l'ouvrage d'un moraliste, sans complaisance pour lui-même et sans illusion sur ses contemporains ; même s'il devient plus mesuré avec l'âge, il ne varie guère dans le jugement noté en 1824 : « Le genre humain est une vilaine porcherie ».
Au Journal proprement dit, l'éditrice a ajouté une masse considérable de textes, qui donnent un éclairage indispensable pour la connaissance de Delacroix. Pendant la rupture d'un peu plus de vingt ans — interrompu en 1824, le Journal ne reprend qu'en 1847— sont écrites les pages du "Voyage au Maghreb et en Andalousie" et de très nombreux textes qui prolongent les réflexions du peintre : carnets et notes variées sur des peintres, des voyages, des lectures, des expositions, carnets et notes parallèles ensuite à la rédaction du journal jusqu'à la mort en 1863. Des pages de Pierre Andrieu, principal assistant de Delacroix et qui joua un rôle important dans la conservation du Journal, rapportent des propos du peintre. Outre les variantes du Journal (dont on connaît plusieurs copies), Michèle Hannoosh a préparé une série d'annexes qui font désormais de cette édition un grand ouvrage de référence, avec notamment un imposant répertoire biographique, un index des œuvres de Delacroix, un autre des noms de personnes, une bibliographie qui complète les indications données dans les notes. Les notes, quant à elles, abondantes et précises, apportent toutes les renseignements nécessaires à la compréhension d'une époque.
Eugène Delacroix, Journal, nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh, 2 tomes, José Corti, 2009.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène delacroix, journal, moraliste, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |






