01/05/2014
Jacques Prévert, Choses et autres

Mai 68
On ferme !
Cri du cœur des gardiens du musée homme usé
Cri du cœur à greffer
à rafistoler
Cri du cœur exténué
On ferme !
On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec
On ferme !
On verrouille l'espoir
On cloître les idées
On ferme !
O. R. T. F. bouclée !
Vérités séquestrées
Jeunesse bâillonnée
On ferme !
Et si la jeunesse ouvre la bouche
par la force des choses
par les forces de l'ordre
on la lui fait fermer
On ferme !
Mais la jeunesse à terre
matraquée piétinée
gazée et aveuglée
se relève pour forcer les grandes portes ouvertes
les portes d'un passé mensonger
périmé
On ouvre !
On ouvre sur la vie
la solidarité
et sur la liberté de la lucidité.
Jacques Prévert, Choses et autres, in Œuvres complètes, II,
édition établie et annotée par Danièle Gasiglia-Laster et
Arnaud Laster, Pléiade / Gallimard, 1996, p. 346.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, choses et autres, mai 68, jeunesse, répression, liberté | ![]() Facebook |
Facebook |
30/04/2014
Pierre-Alain Tâche, Retour de l'océan

Le troisième âge
Dès les premiers jours de printemps, l'île est au fait que l'invasion ne va désormais plus tarder.
Mais pour l'heure, et malgré la verdure, une vague tristesse étouffe un front de mer entier. Et, sur la promenade, où pavoise, en plein jour, l'éclairage public, on croise la voirie et des rentiers bien mis que tenaille en secret la peur de voir monter sur l'horizon la voile noire ou la barque à fond plat du passeur.
Parfois, la plage abrite un sphinx auquel il serait fou de donner la réponse. Il faut garder silence, éviter de mourir, attendre patiemment la migration de Pâques et ses volées d'enfants — hirondelles de mer, dont le troisième âge aime tant les rires et les cris perçants.
Pierre-Alain Tâche, Retour de l'océan, dans Conférence, printemps 2013, n° 36, p. 257.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-alain tâche, retour de l'océan, le troième âge, enfant, plage, printemps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2014
Philippe Jaccottet, Éléments d'un songe

À la longue plainte de la mer un feu répond
Elle a levé les yeux vers lui, c'est à peine si elle ose lui parler, faute de savoir s'y prendre ; c'est ainsi que rien n'est plus difficile, que chacun évite de trahir sa fierté et son secret. Pourtant elle se décide, parce qu'elle est trop lasse, parce que la conseille une grande douceur à la fin du jour : « Avons-nous vraiment perdu ce feu ? » dit-elle comme s'il était plus discret de parler par images. « Est-ce qu'il ne peut flamber qu'à condition d'être bref, et, en ce cas, comment ferons-nous ? » Elle pourrait se rappeler le nostalgique poème qui redit sans cesse : « Enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus ?...» Ainsi toute lumière semble-t-elle vouée à n'éclairer que le passé, par rapport ou grâce à une ombre présente. Ainsi le paradis recule-t-il, ne cesse-t-il de reculer, pour se situer enfin au commencement du temps, avant le commencement du temps. « Qu'allons-nous faire ? Je ne veux pas traîner dans la nostalgie. Et quels sont ces ennemis qui ne cessent de nous attaquer de toutes parts, qui essaient de nous détruire avant même que nous soyons morts ? Est-ce que la mort nous travaille dès le premier jour que nous sommes entrés avec un grand cri dans son empire ? Réponds-moi, et ne reste pas ainsi à sourire de ce sourire qui semble à personne n'être adressé ! La vie serait-elle impossible en dehors des solutions banales que nous avons toujours méprisées ? Fallait-il, aurait-il fallu plutôt que nous restions seuls et que nous refusions ces lois apparemment benoîtes, cruelles pourtant puisqu'elles semblent nous user et si promptement nous détruire ? »
Philippe Jaccottet, Éléments d'un songe, in Œuvres, édition établie par José-Flore Tappy, Pléiade / Gallimard, 2014, p. 282.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, Éléments d'un songe, plainte, question, nostalgie, vivre, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2014
Philippe Jaccottet, Exemples, dans Œuvres

L'habitant de Grignan
Parfois, un tel poids est sur nous que nous décidons de ne rien faire, et en particulier de ne rien écrire, qui ne l'allège, mais encore ne l'allège qu'à bon droit. Cela se peut-il en parlant simplement d'un lieu ? C'est la question que je me suis posé devant ce texte. Provisoirement, en tout cas, rien d'autre ne m'intéresse, et tant pis si je m'égare.
Il semblerait donc que je dispose d'une règle qui me permette de choisir entre le pire et le mieux, c'est-à-dire de quelque absolu ? Non ; mais comment s'expliquer ? C'est un peu comme si le mouvement de l'esprit vers une vérité pressentie révélait cette vérité, ou l'alimentait ; comme si nous devions une bonne fois partir, puisque quelque chose nous y pousse, et que la voie créât, ou plutôt découvrît le but. Marche difficile aux étapes dérobées.
En route donc encore une fois ! Je suis un marcheur voûté par ses doutes. Mais il arrive que des souffles bienheureux m'emportent.
Philippe Jaccottet, Exemples, dans Œuvres, édition établie par José-Flore Tappy, Pléiade, Gallimard, 2014, p. 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, exemples, dans Œuvres, écrire, leu, grignan | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2014
Thomas Bernhard, Sur les traces de la vérité
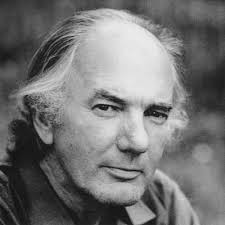
Manie de la persécution ?
Lorsqu'à Hainburg
j'eus soudainement faim,
j'allai dans une auberge
et je commandai,
revenant de Cracovie,
un rôti de porc aux boulettes des pommes de terre
et une pinte de bière.
En traversant la Slovaquie
mon ventre s'était vidé.
Je discutai avec le patron,
il disait, ces Juifs polonais,
ils auraient dû les tuer tous
sans exception.
C'était un nazi.
À Vienne j'allai à l'hôtel Ambassador
et je commandai un cognac,
un cognac de France naturellement,
un Martell par exemple, dis-je,
tout en discutant avec un peintre,
qui affirmait sans cesse au sujet de lui-même
qu'il était un artiste
et qu'il savait ce qu'était l'art,
alors que le reste du monde tout entier ignorait
ce qu'était l'art,
bientôt il s'avéra que
c'était un nazi.
À Linz j'allai au café Draxelmayer
boire un petit café au lait
et je parlai avec le maître d'hôtel
du match de football Rapid Vienne contre LASK Linz
et le chef de rang disait
les joueurs du Rapid, il faudrait tous les gazer,
aujourd'hui Hitler aurait encore plus de boulot
que de son vivant,
bref il s'est avéré très rapidement que
c'était un nazi.
À Salzbourg
j'ai croisé mon ancien professeur de religion,
qui m'a dit droit dans les yeux
que mes livres
et tout ce que j'avais pu écrire jusqu'à présent
étaient du rebut,
mais qu'aujourd'hui on pouvait publier n'importe quel rebut,
à une époque comme la nôtre,
qui était fondamentalement ordurière,
sous le Troisième Reich, disait-il,
je n'aurais pu faire publier aucun de mes livres,
et il souligna que j'étais un salopard,
un chien hypocrite,
puis il mordit dans son sandwich au saucisson,
arrangea sa soutane en tirant dessus des deux mains,
se leva et partit.
C'était un nazi.
D'Innsbruck j'ai reçu hier une carte postale
illustrée du petit toit d'or symbole de la ville,
et sur laquelle on lisait, sans plus d'explications :
Les gens comme toi devraient être gazés ! Tu ne paies rien pour attendre !
J'ai relu plusieurs fois la carte postale
et j'ai eu peur.
Thomas Bernhard, Sur les traces de la vérité, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, Arcades / Gallimard,
2011, p. 258-260.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur les traces de la vérité, nazi, art, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2014
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Quel destin se cache
sous mes paupières closes ?
Invente-t-il
une autre réalité du monde ?
Les séquences se suivent
d'après un ordre nouveau
Alertant le sans
orchestrant des apparences trompeuses
Des constellations défilent
devant mon écran intérieur
Des personnages apparaissent
formés de la matière de l'ombre
Jusqu'à ce que la nuit émigre
devant l'apparition du jour
*
Les chemins parcourus
étant sans mémoire
mes pas
ne se sont pas fixés
Je pars
je reviens
Je quitte la terre
pour me blottir sous elle
Je réapparais
éclairée
par quelques moments
de lumière
entre le néant et le néant
Anise Koltz, Galaxies intérieures, Arfuyen,
2013, p. 54, 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, destin, nuit, lumière, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2014
Paul Louis Rossi, Cose naturali, Natures inanimées

Vie tranquille
Sur une des parois de l'ensemble magdalénien de Marsoulas on aperçoit un visage humain de face : le nez de travers et les yeux presque ronds. Ainsi représenté il ressemble à celui que nous avions autrefois rencontré dans les couloirs du collège sur l'emplacement écaillé d'un ancien lavabo qui figurait à notre avis le visage d'un homme : le nez, les yeux, le rictus de la bouche. Et nous allions chaque jour lui rendre visite comme un rite que l'on accomplit à ces âges.
Pour moi le masque humain sera toujours un sujet d'étonnement. Quand j'y songe, j'ai de tous temps eu cette sorte de passion pour les masques : masques amers de la comédie, orbites creuses des masques africains, masques à transformation de la Colombie Britannique, dents pointues de ceux du théâtre de Java, regard aveugle des géants de l'île de Pâques Aussi loin que l'on découvre le geste de l'homme, il a tenté de se représenter parmi les outils, les dieux et les animaux familiers. Et ces masques, je ne les observe pas seulement, ce sont eux, souvent, qui viennent m'épier à leur tout, ils m'interrogent et me surveillent, me regardent autant que je les regarde.
[...]
Paul Louis Rossi, Cose naturali, Natures inanimées,
éditions Unes, 1991, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, cose naturali, natures inanimées, masque, visage, humain, regard | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2014
Paul Louis Rossi, Cose naturali, Natures inanimées

la vue
Une figue se
reflète dans
un
petit
miroir...
(Trompe l'œil)
Des bésicles maintenues
par un lacet
tendu
entre deux clous
(bois jaune et rose)
un Almanach
du « Messager Boiteux »
(der Königlich privilegierte
Colmarer Hinkende Bott)
(dans un parc)
Grand cratère baroque
grand rideau rouge derrière une colonne
s'ouvrant sur un fond d'arbres
Héron près d'une
touffe de pivoines
faisan argenté
Sur un vase
un perroquet
bleu
Paul Louis Rossi, Cose naturali, Natures inanimées,
éditions Unes, 1991, p. 104, 105, 36.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, cose naturali, natures inanimées, la vue, trompe-l'œil, parc, fleur | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2014
Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent : recension

On ne lit plus beaucoup les Latins (encore moins les Grecs !) et l'abandon accéléré de l'enseignement des langues anciennes — "à quoi ça sert ?" — ne fera qu'accroître le désintérêt pour des œuvres littéraires bien lointaines. Un colloque consacré en février 2011 aux relations entre poésie aujourd'hui et antiquité(1) avait cependant prouvé que les poètes contemporains lisaient de près, et même traduisaient les Anciens, les Latins notamment. Par ailleurs, avec d'autres, Christian Prigent avait donné une traduction du poème latin de Pascal Quignard, Inter aerias fagos(2) ; rien de surprenant à ce qu'il propose aujourd'hui un "recyclage" des épigrammes de Martial.
Une préface et une postface, sous les titres "Grande brute I, II" (Prigent reprend les mots de l'anglais Macaulay pour parler du poète latin) apportent tous les renseignements nécessaires à propos de Martial et du contenu des épigrammes traduites ici — la « comédie humaine » sur la scène. Elles expliquent aussi le projet : non pas donner une traduction savante (elle existe déjà) mais, en restant fidèle à l'esprit du texte, restituer quelque chose de l'« énergie jubilatoire » des poèmes. Donc, « l'enjeu est d'écriture, plus que d'érudition. Je recycle plus que je ne traduis (au temps de Marot et de Du Bellay, on parlait d'« imitation. » (259). Double recyclage : d'abord, on est au Iersiècle de notre ère, c'est-à-dire dans la fiction, et en même temps à notre époque, donc dans la narration (voir p. 259) ; ensuite, on passe de la prosodie latine classique à une prosodie française régulière, de manière à ce que « l'effet des cadences métrées [conserve] quelque chose de la vitalité du vers de Martial » (260-261) ; la rime, absente du vers latin, est introduite pour retrouver un peu de la « dynamique concrète » (264) du vers de Martial. Le détail des choix de Prigent rejoint ce qu'il écrit ailleurs à propos de ses propres pratiques du vers.
Martial ne prétend pas être un "grand" poète, et l'écrit : « Pas mal, assez moyen, souvent mauvais / Sont mes écrits : tout livre est ainsi fait » (I, 16), ce qui ne le conduit pas à s'ôter toute valeur : « Paraît qu'on me loue, paraît qu'on me lit » (VI, 60). Il entend surtout dans ses épigrammes dégonfler la poésie "sérieuse" et il le répète régulièrement sous des formes variées, « À d'autres l'art et les grands thèmes ! / Mon souffle à moi est plus discret » (IX, envoi), « (...) je préfère / Qu'on puisse me lire sans dictionnaire » (X, 21), etc. C'est dans ce projet que s'inscrit Prigent, à la suite de bien des devanciers, de Villon à Corbière, et c'est pourquoi il adapte le poète latin en refusant les tabous habituels sur le vocabulaire ; s'il laisse de côté maints épigrammes de flatterie ou trop liées à des circonstances aujourd'hui incompréhensibles sans notes développées, il donne à lire celles réputées obscènes, "oubliées" non seulement dans des éditions anciennes (celle de Constant Dubos en 1841, professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, par exemple) mais encore aujourd'hui (voir l'édition Poésie / Gallimard). Quand ce n'est pas au nom des bonnes mœurs et de l'usage du livre dans les lycées, on argue de l'absence de poésie dans les poèmes, les mots marqués comme "vulgaires", "triviaux" devant être exclus. Vieilles lanternes — Prigent traduit futuere, cunnum, mentula, merdas, etc. Un exemple : Cantasti male, dum fututa es, Aegle. / Iam cantas bene : basianda non es. (I, 94)(3) : « Du temps qu'on te foutait, ton chant était minable. / Si là tu chantes bien, c'est que plus n'es baisable. »
L'alexandrin utilisé ici avec quelque ironie, le "grand vers" français (le seul dans la version Dubos), est plutôt rare dans ce recyclage. Ce sont les vers de 8 et 10 syllabes les plus employés, mais selon les besoins rythmiques Prigent introduit ceux de 6 et 5 syllabes, parfois associés (IV, 12), de 11, 7 et 4 syllabes ; il emploie toutes les ressources du vers classique, y compris les licences graphiques (« Ça brûle encor plus, la faim du glouton », IV, 41), joue (rarement : le genre ne le nécessite pas) de l'enjambement au milieu d'un mot ( « Gaffe pourtant qu'il te la cou / Pe », II, 60). Le jeu des anachronismes marque sans ambiguïté le souci de s'attacher à l'esprit de l'épigramme et non à sa lettre ; ils sont donc très apparents (euros, II, 89 ; Quiès en boule, IV, 41 ; une colonne à la Daniel Buren, XI, 51, etc), et parfois très exactement dans le ton de Martial : « Tu fais des vers nuls mais mieux vaut en rire : / Ceux de Houellebecq, c'est encore pire » (II, 89), et collent à notre époque : Martial admet qu'il est connu, « Mais moins qu'un footeux plein de fric » (X, 21).
Conserver l'esprit de Martial, c'était dans l'adaptation rechercher la pointe et, autant que faire se peut, un équivalent au caractère satirique, traits propres à l'épigramme ; cela impliquait dans certains cas de ne conserver que le sens, tout en restituant l'ellipse et le rythme. Ainsi, pour cette épigramme (XII, 39) : Odi te, quia bellus es, Sabelle. / Res est putida bellus et Sabellus. / Bellum denique malo, quam Sabellum. / Tabescas utinam, Sabelle belle ! (littéralement : « Je te hais parce que tu es beau, Sabellus. / C'est une chose pourrie : beau et Sabellus. /Tout compte fait, je préfère quelqu'un de beau à Sabellus. / Puisses-tu te putréfier bellement, Sabellus »(4)), Prigent propose : « Tu es beau, mon gigolo ! / Et à gogo : c'est du beau ! / Beau à ce point-là : bobo ! / Et pour bientôt : Waterloo ? ». Pour la fidélité au texte et l'étude du latin, certes, on reprendra la traduction savante, en prose (tout en sachant que le vocabulaire de Martial est raboté), mais pour comprendre ce qu'était le caractère elliptique, condensé, joyeux et vif de la satire dans l'épigramme, on lira les recyclages de Prigent.
______________________________________________
(1) Voir Perrine Galand et Bénédicte Gorrillot (dir.), L’Empreinte gréco-latine dans la littérature contemporaine, Genève, Droz, 2015.
(2) Avec Pierre Alferi, Éric Clémens, Michel Deguy, Bénédicte Gorillot, Emmanuel Hocquard et Jude Stéfan, traduction de Pascal Quignard, Inter, Argol, 2011.
(3) Dans : www.thelatinlibrary.com/martial/html
(4) Traduction prise dans : Martial, Épigrammes, choisies, adaptées du latin et présentées par Domnique Noguez, Arléa, 2001, p 136. L'adaptation de Dominique Noguez conserve aussi l'esprit caustique de Martial.
Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent, P. O. L / Poche, 2014, 272 p., 9 €.
Note parue sur Sitaudis
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martiel, christian prigent, épigramme, traduction, recyclage | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2014
Maine de Biran, Journal intime (1792-1817)

C'est une chose singulière pour un homme réfléchi et qui s'étudie, de suivre les diverses modifications par lesquelles il passe. Dans un jour, dans une heure même, ces modifications sont quelquefois si opposées qu'on douterait si on est bien la même personne. Je conçois qu'à tel état du corps répond toujours tel état de l'âme, et que tout dans notre machine étant dans une fluctuation continuelle, il est impossible que nous restions un quart d 'heure dans la même situation absolue d'esprit. Aussi suis-je bien persuadé que ce que l'on appelle coups de la fortune contribue généralement beaucoup moins à notre mal-être, à notre inquiétude, que les dérangements insensibles (parce qu'ils ne sont pas accompagnés de douleurs) qu'éprouve par diverses causes notre frêle machine. Mais peu d'hommes s'étudient assez pour se convaincre de cette vérité. Lorsque le défaut d'équilibre des fluides et des solides les rend chagrins et mélancoliques, ils attribuent ce qu'ils éprouvent à des causes étrangères, et, parce que leur imagination montée sur le ton lugubre ne leur retrace que des objets affligeants, ils pensent que la cause de leur chagrin est dans les objets mêmes.
Maine de Biran, Journal intime (1792-1817), avec un avant-propos, une introduction et des notes de A. de la Valette-Monbrun, Plon, 1927, p. 56-57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maine de biran, journal intime, chagrin, mélancolie, corps, douleur, changement | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2014
John Taylor, La fontaine invisible

Tout en haut de la sombre vallée, au sortir des ombres, tu trouves enfin la source jaillissante, assourdissante de l'Arc : de l'eau bondissant en cascade, de l'eau froide, de l'eau existant pleinement ici, qui s'impose.
Cependant tu souhaites encore qu'elle vienne de quelque Ailleurs. Tu t'es efforcé de monter un chemin escarpé, faisant souvent halte. Arrivant enfin. Cela est vrai. Tu souhaites recevoir une reconnaissance, une récompense.
Le ruisseau périlleux surgit plus loin, comme une langue de feu blanche, de sous un glacier recouvert de terre et de roches brisées. Aucune glace d'un pur cristal bleu. Aucune profondeur insondable, aucune réflexion de lumière.
Après avoir jeté dans l'eau quelques éclats de schiste, après avoir regardé comment ils ricochent et coulent sous l'éphémère surface, tu songes à te risquer plus loin — sautant d'une pierre glissante à la prochaine. Tu ne peux être sûr de pouvoir revenir. Poser le pied sur l'autre rive signifie longer la falaise...
John Taylor, La fontaine invisible, traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise Daviet, Tarabuste, 2013, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, la fontaine invisible, source, ruisseau, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2014
James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ?

Mais parfois le sourire le pus vivant
Les deux jeunes mères navajos
Qui déjeunaient ce midi à la même table que nous
Sorte de hangar ouvert aux deux extrémités
Pour un peu de fraîcheur
Après la poussière et 38 degrés de chaleur...
Aux puces de Gallup, c'est tous les samedis
Les toujours mêmes stands je suppose, pacotille
Et choses plus ou moins utiles, chargements de bottes de foin
L'endroit pour des pneus neufs ou d'occasion,
Petites pierres de prières, peignes à tisser
Ou crottins de dinosaure pétrifiés...
Là avec chacune leur enfant, avec des rires
Façon d'être et d'éduquer les bambins
Une simplicité et franchise amicale
Le taco bientôt mangé, tout à l'heure
Elles finiront comme nous
De parcourir les deux longues allées du marché
Un pickup truck peut-être les ramènera
En quelque ferme isolée
Dans la campagne environnante ; dans l'au revoir
(Et demande aux enfants d'en dire un)
C'est l'aimable simplicité du monde
De tout le monde (la voilà qui se perd)
Qui nous est servie
[...]
James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ?, lavis de Colette Deblé, Æncrages & Co, 2014, np.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas, indienne, amitié, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2014
Jean-Luc Sarré, Bribes (Pages de carnet)

Faubourg. La résonance de ce terme est pour moi essentiellement parisienne ou du moins l'était encore jusqu'aujourd'hui. Un faubourg, contrairement au centre de la ville, ne devrait pas changer, tout au plus lentement évoluer, et par contrainte plus que par choix, l'époque laissant derrière elle son sillage de bouleversements (je n'ai pas reconnu, dans le dix-neuvième arrondissement, des rues qui m'étaient autrefois familières.) À Marseille, c'est de périphérie qu'il faudrait parler ; ça n'invite pas vraiment à musarder.
Je relis et renonce à recopier telle note grevée de maladresse ; pourtant je m'en souviens, rien ne semblait m'importer plus, quand je l'ai crayonnée, que ce qu'elle tentait d'appréhender.
Le cri de l'effraie légitime l'insomnie.
L'impression l'est souvent insupportable d'habiter depuis longtemps une interminable parenthèse. Quand ai-je bien pu l'ouvrir ? Il pourrait m'appartenir de la fermer mais je doute avoir un jour ce courage ou cette lâcheté.
Atelier cuisine, atelier macramé, atelier poterie, atelier poésie.
Jean-Luc Sarré, Bribes (Pages de carnet), dans La revue de belles-lettres, 2013, 2, p. 83, 84, 85, 86, 88.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, bribes (pages de carnet), faubourg, marseille, note, effraie, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2014
Issa, Sous le ciel de Shinano

pluies de printemps
réchappé des menus de fête
un canard chante
sous les cerisiers ce soir
aujourd'hui déjà
est bien loin
quiétude
au fond du lac
la cime des nuages
herbes échevelées
le froid se sent
rien qu'à vue d'œil
sur l'azur
tracer un caractère
— couchant d'automne
au soir
parlant avec la terre
les feuilles tombent
Issa, Sous le ciel de Shinano, choix et
traduction par Alain Gouvret et Nobuko
Imamura, Arfuyen, 1984, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : issa, sous le ciel de shinano, pluie, printemps, cerisier, azur, herbe, soir | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2014
Myrto Gondicas, dans Les Carnets d'eucharis

Et l'on veut vivre encore, les vieilles, et l'on
tourne le coin des rues avec au bord
des lèvres l'ombre d'un rire éclos sous
la frange peinte, acajou mauve ou noir vainqueur
des doutes des ans : si, sur
l'arête d'un trottoir, on bronche
bec ouvert sous le ciel clément, la fesse
ivre un peu, balancée rétive
(et la cheville, avec, se tord),
tel vieux souvenir alors émerge
et mord l'âme amollie : cassoulet, amour,
écho de voix pépiant au fond des cours où
dans une odeur de cèdre et de sésame
chaud, avec les cris du loto populaire,
pulse le cœur oublié d'un monde.
Myrto Gondicas, dans Les Carnets d'eucharis, n° 41, en ligne
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : myrto gondicas, carnets d'eucharis, vieillard, âge, ombre, souvenir, amour | ![]() Facebook |
Facebook |





