14/07/2014
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À l'Etna
Etna — j'ai monté le Vésuve...
Le Vésuve a beaucoup baissé :
J'étais plus chaud que son effluve,
Plus que sa crête hérissé...
— Toi que l'on compare à la femme...
— Pourquoi ? — Pour ton âge ? ou ton âme
De caillou cuit ?... — Ça fait rêver...
— Et tu t'en fais rire à crever !
— Tu ris jaune et tousses : sans doute,
Crachant un vieil amour malsain ;
La lave coule sous la croûte
De ton vieux cancer au sein.
— Couchons ensemble, Camarade !
Là — mon flanc sur ton flanc malade :
Nous sommes frères, par Vénus,
Volcan !...
Un peu moins... un peu plus...
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, édition établie
par Pierre-Olivier Walzer, dans Charles Cros,
Tristan Corbière, Œuvres complètes, Pléiade,
Gallimard, 1970, p. 784-785.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, etna, volcan, amour, maladie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2014
Antoine Emaz, Jours

2. 03. 08
la peur
la mémoire noire
on ne la rappelle pas
elle vient
quand elle veut
ou peut-être au signal
d'un ultra-son de vivre
elle remonte
on lui fait sa place
sans parler
on attend qu'elle reparte
par le premier train de nuit
le plus souvent
quand on l'entend venir
on commence par prendre un verre
et s'occuper de tout et rien
histoire
d'espérer qu'elle passera
à quelques pas
sans voir
on la sait bête
taupe
parfois ça marche
on ne la revoit plus
elle ne faisait que passer
elle a jeté son froid
rappelé assez que l'on était
poreux
[...]
Antoine Emaz, Jours, éditions En Forêt /
Verlag Im Wald, 2003, p. 109 et 111.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, peur, attente, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
12/07/2014
Guy Goffette, Éloge pour une cuisine de province

La visite de Rembrandt
La nuit a volé
son unique lampe à la cuisine
piégé dans la vitre
celui qui se tait
debout dans la tourbe des mots
Il brûle à feu très doux
l'obscure enveloppe du silence
(comme ces collines sous la cendre
réchauffent l'aube de leur mufle)
et pour la première fois peut-être
son visage d'ombre est toute la lumière
et parle pour lui seul
Guy Goffette, Éloge pour une cuisine de province,
postface de Jacques Borel, Champ Vallon, 1988, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, Éloge pour une cuisine de province, silence, ombre, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2014
Erich Fried, Le vivre mourir

Le vivre mourir
Je meurs toujours et sans cesse
et toujours à découvert
Je meurs toujours et toujours
et toujours ici
Je meurs toujours une fois
et toujours chaque fois
Je meurs continûment
Je meurs comme je vis
Parfois j’escalade la vie
et parfois je la dégringole
Parfois je dégringole la mort
et parfois je l’escalade
De quoi je meurs ?
De la haine
et de l’amour
de l’indifférence
de l’abondance
et de la misère
Du vide d’une nuit
du contenu d’un jour
de nous toujours une fois
et encore toujours d’eux
Je meurs de toi
et je meurs de moi
Je meurs de quelques croix
Je meurs dans un piège
Je meurs du travail
Je meurs du chemin
Je meurs du trop à faire
et du trop peu à faire
Je meurs aussi longtemps
que je ne suis pas mort
Qui dit
que je meurs ?
Jamais je ne meurs
bien au contraire je vis
Sterbeleben
Ich sterbe immerzu
und immeroffen
Ich sterbe immerfort
und immer hier
Ich sterbe immer einmal
und immer ein Mal
Ich sterbe immer wieder
Ich sterbe wie ich lebe
Ich lebe manchmal hinauf
und manchmal hinunter
Ich sterbe manchmal hinunter
und manchmal hinauf
Woran ich sterbe?
Am Haß
und an der Liebe
an der Gleichgültigkeit
an der Fülle
und an der Not
An der Leere einer Nacht
am Inhalt eines Tages
immer einmal an uns
und immer wieder an ihnen
Ich sterbe an dir
und ich sterbe an mir
Ich sterbe an einigen Kreuzen
Ich sterbe in einer Falle
Ich sterbe an der Arbeit
Ich sterbe am Weg
Ich sterbe am Zuvieltun
und am Zuwenigtun
Ich sterbe so lange
bis ich gestorben bin
Wer sagt
daß ich sterbe?
Ich sterbe nie
sondern lebe
Erich Fried, Sterbeleben, extrait de Es ist was es ist
(Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1983).
Traduction inédite de Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, le vivre mourir, haine, amour, indifférence | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2014
Andrea Zanzotto, Idiome

Des gens
Des gens — comme tant d'autres gens —
....................................................................
Peut-être est-ce ce pourquoi j'ai toujours peine
et mal voulu partir,
à cause du bienheureux sans-gêne d'une certaine vertu
bien à toi qui en non violence tisse
et retisse des quotidiennetés —
de par elle-même, elle donne tant d'autres biens
d'accueil et de douceur
réciproque, sans exclure la fermeté —
même si parmi de légères distractions
réciproques, indifférences croisées,
caillots de petites affaires et mafias —
et puis une petite volonté
poisseuse de ne pas regarder trop loin,
une bonhomie quelquefois somnolente
Pensant à de telles choses je me découvre
parfois complètement seul, je sens
que j'omets beaucoup, ne pouvant
ni ne sachant en dire davantage
mais ensuite je me libère,
avec un peu d'effroi, un peu de joie
qui //et je me coule dans la juste
existence, un parmi le grand nombre d'ici.
Je me libère : et je vois un papier qui va
vers le nord, dans le vent, vers la nuit.
Et parfois, m'éblouit un pré
derrière une vieille maison oublié,
solitaire, feignant l'indifférence ou
une légère ou une pâlichonne distraction
mais peut-être souffre-t-il, peut-être est-il seulement
un paradis
Genti
Gente — come tante altre genti —
............................................................
Forse è per questo che ho sempre stentato
e malvoluto partire,
per l'invadenza beata di una certa tua virtù
che in nonviolenza tesse
e ritesse quotidianità —
essa di per sé dona tanti altri beni
di accoglienza e dolcezza
reciproca, né esclude la fermezza —
pur se tra lievi distrazioni
reciproche, indifferenze incrociate
coaguli di minimi affari e mafie —
e poi una piccola appiccicosa
volontà di non guardar troppo lontano
una bonarietà qualche volta sonnolenta
Mi scopro talvolta del tutto solo
pensando a tali cose, sento di
omettere molto, di non poter
né saper dire di più,
ma poi mi libero,
con un po'di sgomento un po'di gioia
che //e mi adagio nel giusto
essere uno coi tanti di qui.
Mi libero : e vedo une carta che va
verso nord, nel vento, verso la notte.
E talvolta mi abbacina un prato
dimenticato dietro una casa antica,
solitario, che finge indifferenza o
lieve o smunta distrazione
ma forse soffre, forse è soltanto
un paradiso
Andrea Zanzotto, Idiome, traduit de l'italien, du dialecte
haut-trévisan (Vénétie) et présenté par Philippe Di Meo,
José Corti, 2006, p. 33 et 35, 32 et 34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, gens, quotidien, solitude, pré | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2014
Alain Veinstein, Scène tournante

À haute voix mon nom
impossible de le prononcer
Je me cache pour ne pas me faire prendre
J'ai l'impression que ses lettres vont être écartées
afin que son secret en soit extirpé
et jeté en pâture aux chiens,
sans aucune pitié.
Quelques lettres ici, tournent à la haine.
Chaque fois, aujourd'hui,
que je décline mon identité,
j'entends et aboiements
et voient des projecteurs lancer leurs poursuites
du haut de formes indistinctes
que je prends pour des miradors.
Alain Veinstein, Scène tournante, "Fictions & Cie",
Seuil, 2012, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, scène tournante, nom, camp d'extermination, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2014
Georg Trakl, Œuvres complètes

Nuit d'hiver
De la neige est tombée. Passé minuit, tu quittes, enivré de vin pourpre, le quartier sombre des hommes, la flamme rouge de leur foyer. Ô les ténèbres !
Gel noir. La terre est dure, l'air a un goût d'amertume. Tes étoiles se ferment en signes mauvais.
À pas pétrifiés, tu longes lourdement la voie, les yeux écarquillés, comme un soldat à l'assaut d'un rempart noir. Avanti !
Amères, neige et lune !
Un loup rouge qu'un ange étrangle. Tes jambes tintent en marchant comme de la glace bleue et un sourire plein de tristesse et d'orgueil a pétrifié ton visage et le front blêmit dans la volupté du gel ;
ou bien il se penche, muet, sur le sommeil d'une sentinelle qui s'est écroulée dans sa cabane de bois.
Gel et fumée. Un blanc linge d'étoiles brûlent les épaules qui supportent et les vautours de Dieu lacèrent ton cœur de métal.
Ô la colline de pierre. En silence fond, et oublié, le corps froid dans la neige d'argent.
Noir est le sommeil. L'oreille suit longtemps les sentiers des étoiles dans la glace.
Au réveil, les cloches sonnaient dans le village. Le jour rose entra, à pas d'argent, par la porte de l'est.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduites de l'allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 125.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, Œuvres complètes, nuit d'hiver, gel, sommeil, jour | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2014
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud

E blanc
Scène 1
La mort couche dans mon lit elle a les dents blanches
Patauger dans la nuit appelle-t-on cela
Vivre O dans ma bouche l’ancolie amère
Des jours anciens mon vieux Verlaine rien ne sert
De pleurer au temps des souvenirs la partie
Est déjà perdue tu n’avais pas su le
Retenir il courait plus vite que le vent
Amants de la mort qu’attendiez-vous de la vie
Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être à ta lèvre
Dolente et non le chapelet à l’angélus
Ah l’ordre comme un petit serpent fourbe arrive
Toujours quad le clocher sonne douze au clair de
Lune le christ O vieille démangeaison
Pauvre lélian habité par un fantôme à
La jambe de bois l’autre en toi O moulin à
Prières
Scène 2
Que cherchais-tu en franchissant le saint-gothard
À demi enseveli dans la neige quelle
Porte par où t’enfuir encore et toujours
O toi l’ébloui sans sommeil dévoré par
Les mouches du rêve et que l’éclair divise à
Jamais hagard comme le faucon
Scène 3
Elle venait sans que j’y prenne garde à pas
De loup et ce cœur en moi s’usait peu à peu
À battre la chamade je ne l’avais pas
Reconnue tant son visage était pâle et
Ressemblait à s’y méprendre à la blanche nuit
Ses regards enjôleurs me grisaient doucement
O comme elle était tendre lorsqu’elle voulut
Me prendre par surprise au petit matin calme
J’aurais pu te quitter sans avoir baisé ta
Bouche tandis qu’à m’étreindre elle buvait mon
Sang O la camarde ma camarade attends
Encore un peu je n’ai pas fini d’inventer
Pour lui les mots du nouvel amour
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud,
Gallimard, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, une lecture de rimbaud, verlaine, mort, ciel, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
06/07/2014
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes II

Haïkaïs
L'aube — Chante l'alouette. —
Le ciel est un miroir d'argent
Qui reflète des violettes.
Le soleil en feu tombe dans la mer ;
des étincelles :
Les étoiles !!
Oh ! la pleine lune sur le cimetière.—
Noirs les ifs — Blanches les tombes —
Mais en dessous ?...
Les yeux du Chat :
Deux lunes jumelles
Dans la nuit.
La nuit. — L'ombre du grand noyer
est une tache d'encre aplatie
au velours bleu du ciel.
Vie d'un instant...
J'ai vu s'éteindre dans la nuit
L'éternité d'une étoile.
La cathédrale dans les brumes :
Un sphinx à deux têtes, accroupi
dans une jungle de rêve.
J'ai vu en songe
Des splendeurs exotiques de soleil
Matin gris. — Le ciel est une chape de plomb.
Morte la Déesse,
dansons en rond !!
Mais, mes rêves aussi sont morts...
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes II,
édition établie par Jean Bollery, avant-propos
de Pierre Minet, Gallimard, 1977, p. 127-128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes ii, haïkaï, ciel, lune, chat, rêve, étoile, soleil | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2014
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia
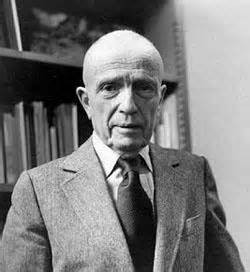
À main droite
ma manie de manipuler,
démantibuler,
désaxer et malaxer les mots,
pour moi mamelles immémoriales,
que je tète en ahanant.
Murmure barbare, en ma Babel,
tu me tiens saoul sous ta tutelle
et, bavard balourd, je balbutie.
À main gauche, mes machins,
mes zinzins,
mes zizanies,
les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,
mes singeries, momeries et moraleries.
Ô gagâchis qu'agacé j'ai sagacement jaugé et tout de go gommé,
jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis ?
Au milieu
le mal mou qui me moud,
me moud,
me lime, m'annule,
m'humilie
et que, miel amer, je mettrais méli-mélo à mille lieues mijoter,
mariner,
macérer.
N'a-t-il dit que ce monde dément demande un démenti,
le démon qui m'enmantèle, m'enmêle et me démantèle.
*
Qu'est-ce que, pratiquement, je poursuis ?
— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je suis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille, comme toute autre, à une île où les conditions d'existence ne cessent d'empirer — serait mon vade-mecum de naufragé, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d'outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n'aurai pas le cœur d'apporter le catégorique remède).
... Ou plutôt ce qui me fascine, c'est moins le résultat, et le secours qu'en principe j'en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n'est tout compte fait qu'un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au dehors de moi, quoi d'autre que ce hobby pourrait m'empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia, Gallimard, 1981, p. 176-177 et 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d'olympia, jeux de mots, allitération, consonance, bricolage | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2014
Roger Laporte, Fugue, biographie
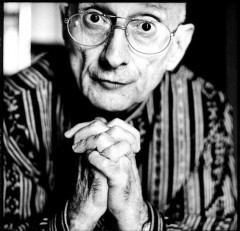
[...] Lorsque je me relis en vue d'écrire, je ne vois pas le texte tel qu'il est, dans ce qu'il dit, mais j'essaie plutôt de repérer les éléments qui s'ouvrent sur un texte à écrire. Encore qu'une telle lecture appartienne quelque peu à la divination, elle ne possède point le pouvoir magique d'animer tout le texte déjà écrit d'un mouvement irrésistible qui m'entraînerait à écrire avec facilité la suite de l'ouvrage, et en effet la liaison de la lecture, de l'écrit et du texte à écrire s'accomplit de manière très inégale. Dire : « je me relis », ou : « je relis mon propre texte » : autant d'expressions imprudentes, car force m'est parfois de constater que certaines partie du texte me sont devenues si étrangères qu'elles n'ont plus aucun avenir. On ne peut jouer aux échecs pour la première fois de sa vie et en même temps, par le jeu même, rédiger le Traité du jeu : j'ai pourtant cru qu'une telle opération était possible en littérature ! Par la pensée je raye donc ce rêve fou, mais je sais bien qu'ainsi je n'anéantis pas ce que j'ai écrit, que je continue d'entretenir avec ce passé un rapport d'exclusion incapable de s'accomplir même si j'en viens s à écrire à l'encontre de pensées ou de projets dont j'avais fait ma demeure.
Roger Laporte, Fugue, biographie, "Le Chemin", Gallimard, 1970, . 44-45.
© Photo Olivier Roller
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger laporte, fugue, biographie, écrire, texte, relire, échecs, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2014
André Frénaud, Nul ne s’égare, précédé de Hæres

La vie comme elle tourne et par exemple
Ça va, ça tourne, c’est débrayé,
depuis toujours ça tourne mal.
Les parties nobles, les parties douces,
la matière grise,
les nouveaux-nés, les chevronnés, les charlatans,
les désolés, les acharnés, les ortolans,
les magiciens, les mécaniciens et les fortiches,
tout est égal et fait du vent.
Tout se dépose et sous la langue fait amertume.
Corps rechignés, amour rendu,
À roue qui tourne, éclats, fumées,
Cela donne soif, faut en convenir.
Ça vous complique et vous recuit.
Ça vous alarme, ça vous suffoque.
Tout se morfond et se déglingue et se raidit.
Se prend, s’enfonce. Vas-y. Va-t-en. La joie, la frime.
La folie calme et les grands cris. Ça prend confiance.
Ça va venir. Parties honteuses, le cœur ballant.
Rêverie pleine et la dent creuse.
Le corps brûlant. Ça reprend vie.
Ça va venir… T’émerveilla…
Ça va venir.
Tout est pour rien.
Tout vaut pour rire.
*
HÆRES
Il y a, au cœur du poème, derrière le poème, révélé par lui, un magma de multiples formes contraires, qui tournent, s’entrecroisent, se heurtent, veulent s’échapper… Et qui s’échappent, effectivement, en propos obscurs — ce sera le poème — sans ordre apparent, possiblement.
C’est de la réalité cachée de soi qu’il s’agit, et une discontinuité, une incohérence même, qui ne sont pas voulues, peuvent se comprendre comme étant exigées par l’objet qui se forme pour qu’il se forme précisément, celui-ci ne pouvant le faire autrement qu’à sans cesse tourner court et reprendre ailleurs, laissant percer quelque chose parfois d’un foyer incandescent, non maîtrisable, multiples traces reprises d’élan de l’Éros toujours insatisfait, irréductible.
André Frénaud, Nul ne s’égare, précédé de Hæres, préface d’Yves Bonnefoy, Poésie/Gallimard, 2006, p. 265-266 et 58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, nul ne s’égare, précédé de hæres, yves bonnefoy, vie, cœur, corps, poème, élan | ![]() Facebook |
Facebook |
02/07/2014
J. M. G. Le Clézio, L'inconnu sur la terre

On sait ce qu'il y a à l'intérieur des arbres; On ne le voit pas vraiment avec les yeux, mais on le sent. C'est là, devant moi, comme une armature raidie à l'intérieur du tronc. Les arbres sont immobiles, bien calmes, dans le vent, dans la lumière. Oui, ils sont ainsi. Et pourtant, on sent les flammes dures et brillantes qui sont à l'intérieur de leurs troncs. Jamais on n'a senti à ce point la force cruelle et obstinée de l'existence. Les arbres sont droits et solides. Partout, sur la terre sèche, brûlent les flammes solitaires. Elles sont dressées, debout, pareilles à des flammes, pareilles à des statues, et ces flammes brûlent, à la fois chaudes et froides, denses, faisceaux de lumière concentrée. Autour d'elles, l'espace est nu, vide, silencieux. Toute la vie organique est dans ces flammes qui brûlent sans vaciller.
J. M. G. Le Clézio, L'inconnu sur la terre, "Le Chemin", Gallimard, 1978, p. 102.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. m. g. le clézio, l'inconnu sur la terre, arbre, flamme, force, espace | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2014
Joseph Guglielmi, Chanson pour Guillevic

Chanson pour Guillevic
Tout poème
emblématique
Même la nuit de Carnac
Même le jour de Carnac
And the sea
the ruled page
d'une poussière pratique
Comme séparer
deux noms
deux couleurs
complémentaires
Et lynchage
poétique
ou tracer
un ciel de paille
L'eau nue
ruisseau de l'étreinte
argumente
une autre strophe
Une étoile
dans la bouche
jet blanc
dressé comme un fouet
Mouchoir de tête
brillant
au canular émotif
À la fièvre
sur mesure
aux adjectifs
adjectifs
Ville
sous le ciel
des villes
solitude
N'a cas d'astre
comme sous la jupe
assise
une corolle gainée
Ose dire
ouvrant le livre
sa frange
de prophétie
Joseph Guglielmi, dans Correspondances,
Art-Poésie-Littérature, "Cahier Guillevic",
L'Heur de Laon, 1993, p. 71-72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph guglielmi, chanson pour guillevic, poème, carnac, livre, nom, ville | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2014
Tchicaya U Tam'si, Notes de veille

Pourquoi n'est-elle pas venue
un soir me prendre au berceau
je n'avais qu'un lit de feuilles
Un rapt facile...
D'un peuple qui mendie son sang
qui dirait qu'il est à plaindre ?
Je manque d'ivresse pour comprendre ce qui est plausible.
Et pourtant le monde est tel qu'il apparaît à l'alouette : un miroir déformant.
C'est fatal je devais dormir encore quand le coq chantait.
Je descends des bâtards de Gengis Khan : je baisse la tête et souris de ce que la terre ne supporte plus aucun vertige.
Il suffirait d'être un Envoyé
et la raison d'être aurait
valeur de signe monétaire
ou de plus-value
J'ai mendié sur les chemins
l'envers de ce que le monde paraît
un pli à cette commissure.
[...]
Tchicaya U Tam'si, Notes de veille, dans J'étais nu pour le premier baiser de ma mère, Œuvres complètes, I, Gallimard, 2013, p. 561-562.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tchicaya u tam'si, notes de veille, naissance, comprendre, vertige, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |





