12/07/2021
Roger Gilbert-Lecomte, Rimbaud

Celui qui a vidé sa conscience de tous les images de notre faux monde qui n’est pas un vase clos peut attirer en lui, happées par la succion du vide, d’autres images venues hors de l’espace où l’on respire et du temps où le cœur bat, souvenirs immémoriaux ou prophéties fulgurantes, qu’il atteindra par une chasse d’angoisse froide. En un instant l’univers de son corps est mort pour lui : je n’ai jamais pu crfoire quand je fermais les yeux que tout restait en place. Je ferme les yeux. C’est la fin du monde. Il ouvre les yeux. Et quand tout fut détruit, tout était encore en place, mais l’éclairage avait changé. Quel silence, bon dieu, quel silence.
Roger Gilbert-Lecomte, Rimbaud, Lurlure, 2021, p.30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, rimbaud, image, souvenir, monde | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2020
Luis Cernuda (1902-1963), La Réalité et le Désir
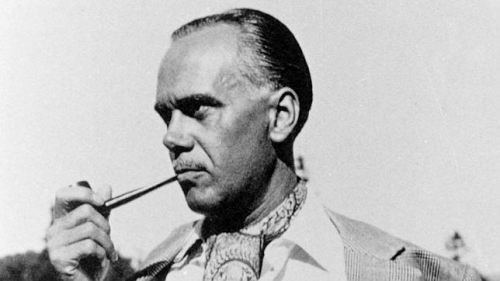
Birds in the night
Le gouvernement français, ou le gouvernement anglais peut-être ? apposa une
plaque
sur cette maison du 8 Great College Street, Camden Town, Londres,
où dans une chambre, Rimbaud et Verlaine, curieux couple,
ont véxu, bu, travaillé, forniqué,
pendant quelques courtes semaines orageuses.
À l’inauguration assistèrent sans doute l’ambassadeur, le maire,
tous ceux qui furent ennemis de Verlaine et Rimbaud quand ils
étaient vivants.
La maison, comme le quartier, est triste et pauvre,
de la tristesse sordide qui va toujours avec la pauvreté,
non de la tristesse funéraire de la richesse sans âme.
Lorsque tombe le soir, comme de leur temps,
sur le trottoir, dans l’air humide et gris, un piano mécanique
joue, et des habitants, au retour du travail,
les uns — les jeunes — dansent, les autres vont au café.
Courte fut l »’amitié singulière de Verlaine l’ivrogne
et de Rimbaud le voyou : ils avaient de longues disputes.
Mais nous pouvons penser que peut-être il y eut
un bon instant pour tous les dexu, du moins si chacun se rappelait
qu’ils avaient laissé derrière eux une mère insupportable et
une ennuyeuse épouse.
Mais la liberté n’est pas de ce monde, et les affranchis
en rupture avec tout, doivent la payer un prix fort.
[...]
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, traduction R. Marrant et A. Schulman, Gallimard, 1969, p. 151 et 153.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir, verlaine, rimbaud, londrès | ![]() Facebook |
Facebook |
18/07/2015
Jean-Paul Michel, Nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi

Les intentions ne suffisent pas. La poésie agit par des œuvres. Gauguin a été, en acte, davantage que Le Décadent. Rien ne ment comme les fausses communautés. On s’est mépris sur le sens de « La poésie doit être faite par tous, non par un ». L’effet touche chacun, le feu naît imperceptiblement dans une âme concrète, un corps singulier, des formes et un temps imprévisibles. Rien qui ne puisse être établi à la règle et au compas, fondé, démontré, prouvé même à des enfants de dix ans.
La poésie qui vaut est le point le plus haut de l’objectivité de la vérité : elle est, en acte, la dernière Justice. Sa solitude est une force qu’aucune machine ne pourra réduire. Le temps est venu de prendre au sérieux la sublime Préface à un livre futur. Hölderlin : « habiter en poète ». Rimbaud : « La charité est cette clef ».
Jean-Paul Michel, Nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi (Carnets de Pietranera), La Cabane, 2008, p. 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi, poésie, œuvre, vérité, hölderlin, rimbaud, gauguin | ![]() Facebook |
Facebook |
21/01/2015
Henri Thomas, La joie de cette vie
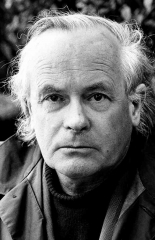
L’invisible chemin des longues plages, tout de suite effacé, regagne le temps. Marcher contre le vent, sans penser, tu reviens un peu sur l’enfance, les compagnons surprenants sont là, par instants, la longue vague, les oiseaux en équilibre sur l’eau qui monte et descend, l’horizon qui est après l’horizon, la myriade de débris, les témoins arrêtés des années…
Jeunes femmes vêtues d’un sac crevé, tenant aux épaules maigres, creuses, mais belles, par deux rubans en ficelle, et le haut du sac vient à mi-dos. Un slip en dessous, c’est parfait. « Je vous vois, mes filles, mes reines. » Il faudra décidément que je vérifie toutes mes citations de Rimbaud.
Les couleurs de la mer changent en une journée, les étendues vert clair, et celles plus sombres et l’air fraîchit, et les îlots jaunissent, s’intensifient. Des bandes brumeuses s’étirent sur l’horizon. L’esprit change, un autre esprit s’approche dans l’air, une balise gémit par intervalles.
Cette herbe déjà jaunie, en pente sur la mer, c’était ma place. J’y ai fait de bonnes lectures, et je descendais dans l’eau transparente. C’était une place pour moi, raisonnablement. Aujourd’hui, je n’y parviens plus, je ne l’ai même pas revue.
Même pas de pluie, qui rafraîchirait mon pauvre esprit et ses souvenirs, et ferait peut-être frissonner l’avenir.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 36 et 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, rimbaud, femme, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2014
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985 : recension

Un chantier poétique
« Il s'agit maintenant de tout reprendre, de tout recommencer » : c'est la dernière phrase de la "note bibliographique" donnée dans Terre ni ciel (Corti, 2014), qui rassemble des articles autour de la poésie et de l'écriture. Parallèlement, Champs "reprend", revisite deux livres anciens publiés sous ce titre en 1984 et 1987, et Yves di Manno les définit comme un « chantier poétique inaugural » (339), ce que le titre recouvre ; si l'on pense à l'emploi du mot "champ", il désigne un espace et, au figuré, un domaine : ici, les champs sont des espaces où viennent se réunir des moments de l'humanité, mais ce sont aussi des domaines, des lieux d'expérimentation de l'écriture. Je n'explorerai pas ces ensembles foisonnants, me limitant à quelques éléments.
Les mondes anciens sont présents, souvent évoqués, comme dans les épopées du Moyen Âge ou nombre de mythologies, à travers la violence qui a permis de les construire : il n'est guère nécessaire de préciser leurs noms tant ils se ressemblent, ce ne sont que corps à pendre, à écarteler, à ouvrir pour occuper les territoires. La violence des temps modernes est analogue : "Champ : : de massacre" s'ouvre sur "Kambuja", c'est-à-dire concerne l'histoire récente du Cambodge ; ce ne sont plus lances et épées qui défont les corps mais fusils et rafales (86). Il y a d'ailleurs tant de points communs entre passé et présent qu'ils sont souvent entrelacés.
Cependant, les « faces de pierre » qui demeurent du passé évoquent aussi des temps moins tragiques ; la stèle d'Ikhernofret est liée à l'apogée du Moyen empire égyptien, "Note de chevet" se rapporte à une période riche (la fin du Xe siècle) de l'histoire du Japon, quant au « roi lépreux », il s'agit de Baudouin IV, roi de Jérusalem à la fin du XIIe siècle ; etc. Une autre figure, plus présente dans Champs, est celle du Christ ; elle apparaît par l'idée de trahison dans les premières pages, « Ils seront douze à renier son / Nom », et, notamment, occupe l'essentiel des poèmes de la dernière partie du livre, encadrés par l'évocation de "Deux ombres", Orphée et Eurydice.
Dans cette histoire des hommes, pleine d'oppositions — guerres et paix, "Heurts" et "Havre" — se détachent les figures des créateurs, explicitement celle de Rimbaud, avec une citation et par allusion transparente : le titre (au pluriel chez Rimbaud) "Fête de la patience", est repris 4 fois (38, 116, 149, 254), liant les parties du livre. Il apparaît encore avec la reprise du mot "Parapets" (16), titre et dernier mot d'un poème, qui renvoie au "Bateau ivre", et dans « La main revient au papier, le corps à la / Charrue » (123), allusion au poème "Mauvais sang (« La main à plume vaut la main à charrue »). On reconnaît aussi, transformé, le dernier vers de "El Desdichado" de Nerval dans « [...] naquit ton cri / (saintes ou reines) / et dans l'eau blême / le soupir de / la fée », et la voile noire de Tristan et Iseut ; en est aussi issu l'épisode de l'épée entre les deux amants pour signifier la chasteté de la Vierge. Etc.
Ces quelques relevés visent à mettre en évidence des thèmes récurrents dans Champs, ceux de l'absence et de l'oubli, explicites dans un poème « in memoriam Jaufré Rudel », variation sur les amants « Heureux malheureux tour à tour » (32) et l'amor de lonh du troubadour. L'un des rares poèmes avec un "je" en scène commence ainsi : « Je cherche et demande l'oubli » (25), et le motif est régulièrement repris — « Aussi leur chant emmurait-il l'oubli » (87), « [...] d'autres disparurent / Oubliant leur nom » (108), etc. Mais Yves di Manno marque une distance vis-à-vis de ce motif lyrique, si présent soit-il (comme ceux du cri et de l'oiseau) :
... Regain. Si c'est mémoire morte, ou l'on
Nous oubliera. Et puis ? Le langage se tait, se
Suffit à lui-même. Aux parentés de mots (que
Dis-je !) nous préférons la loi d'un récit qui
N'a ni début ni fin — d'un récit sans action et sans
Protagonistes. Le mot. Le mot.[...] (126)
S'esquisse une poétique, qui invite à relire le livreautrement : il s'élabore en partie par la manipulation de mots. Par exemple, Yves di Manno construit le texte en utilisant les ressources de l'anagramme, complète « (mon, nom) », "renié" / "reine[s]", ou partielle ; je retiens un exemple parmi des dizaines : les titres (de 4 lettres) d'une série de poèmes, ont tous 3 lettres en commun : "élan", "aléa", "a lié", "féal", "fléau", "étal" (à partir duquel vient "alto"), seul "étau" ne suit pas la règle (p. 289 et sv.). Une autre transformation, très courante, consiste à engendrer un mot par soustraction, ou par addition, d'une lettre ("ombres" / "nombres", écrits" / "cris"), parfois d'une syllabe ("disciples" / "discipline"), par changement de voyelle ("jade" / "jadis") ou de consonne ("Eau forte" / "Eau morte"), par inversion des syllabes phoniques (« Déchiffré à l'envers : versant / est — s'en expliquer. Ou d'Anvers ») (133), etc.
Parallèlement, les formes strophiques et les types de vers sont des plus variés : on parcourt une partie de l'histoire du mètre en français. On lira les diverses possibilités d'écrire un sonnet, y compris en le commençant par les tercets ; On reconnaîtra à peu près tous les types de strophes, y compris le monostiche, et des associations de rimes chères aux Grands Rhétoriqueurs : la rime brisée — les mots à l'hémistiche riment aussi entre eux — ou le vers léonin — les deux hémistiches riment ensemble. On repèrera le jeu avec les licences anciennes pour obtenir le compte des syllabes ("encor", 2 fois). Etc. En outre, des coupes en fin de vers défont la lecture : « (trop lente us / ure des he /ures : des jo / urs) » (249) ou, à l'inverse, en suggèrent une autre : « des maisons / mor / tu / aires » (244).
Il faudrait encore relever la place des poètes américains dans le livre, qui auront tant d'importance par la suite, ou analyser la relation au lyrisme avec le statut du "je" et du "tu" — relation mise à distance dans « jerre / sachant / taimer » (246), ou... Foisonnement, oui, il fallait pour Yves di Manno tout essayer dans ces débuts, se reconstruire une histoire du vers tout autant que des ancêtres, moment nécessaire pour « l'ouverture d'un autre champ » (340).
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985, Poésie/Flammarion, 2014, 352 p., 20 €.
Recension publiée sur Sitaudis 21mars 2014
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes 1975-1985, mot, histoire, langue, rimbaud, nerval, jaufré rudel | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2013
Georges Didi-Huberman, Soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination)

Le poème comme don de mots-voyances
Séparément, sans doute, les mots sont aveugles. Mais certaines façons de les agencer, certaines tournures pour leur faire prendre position, certaines phrases en somme, sont capables de devenir voyances. Ce n'est pas le seul mot pan qui nous fait voir quelque chose dans la peinture de Vermeer depuis le texte de Marcel Proust, ce n'est pas le seul mot rigole qui nous fait voir quelque chose dans la peinture de Rembrandt depuis le texte de Jean Genet : mais la façon de montage rythmique de la langue que ces mots, aux bons moments, viennent scander. Ayant compris assez vite que regarder n'était pas simplement une affaire optique puisqu'on regarde aussi avec des phrases, j'ai construit toutes mes tentatives, toutes mes approches — historiques ou philosophiques — de l'image, à travers une heuristique de la langue descriptive et théorique, un jeu constant pour sortir des conventions littéraires où les discours sur l'art, depuis l'ekphrasis antique, se sont trop souvent enfermés.
J'ai donc lu et relu les lettres fameuses où Arthur Rimbaud, en 1871, dit et répète à l'envi qu'il s'agit en poésie de « trouver une langue [pour] être voyant. [...] se faire voyant. [...] se rendre voyant » et parvenir — « un jour, j'espère » — à ce qu'il nomme carrément une « poésie objective ». Pendant des années je n'ai pas commencé un seul de mes textes sans avoir relu préalablement quelque texte de Charles Baudelaire. Il ne s'agissait pas de citer des poèmes en exergue comme on met une cerise sur le gâteau de la pensée philosophique : il s'agissait de regarder une image avec les mots d'un poète que cette image me semblait particulièrement appeler. Ce que, vis-à-vis des usages différents qui ont cours dans l'histoire ou la critique d'art je n'ai pu que modestement nommer des "fables". Ainsi pour phraser mon regard des empreintes de cendre inventées par Claudio Parmiggiani, il m'a fallu "suivre de la langue" — comme on dit "suivre du regard" — des phrases trouvées dans Lucrèce (cet homme qui a eu l'audace unique en Occident d'exposer un système philosophique complet sous la forme d'un seul, fût-il gigantesque, poème).
Georges Didi-Huberman, "Soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination)", dans PO&SIE, n° 143, juin 2013, p. 154-155.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, "soulèvements poétiques (poésie, savoir, imagination), peinture, heuristique, rimbaud, baudelaire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2013
Jacques Réda, Les Ruines de Paris

Que se passe-t-il car des hurlements ricochent sur les façades, pas des cris de frayeur mais c'est avec prudence que plusieurs fenêtres se rallument, et que des silhouettes en chemise font bouger les rideaux. Et de nouveau ces provocations hurlées comme dans l'Iliade : je saisis le mot brocanteur. Ainsi peut-être Hector a humilié Achille, avant que l'autre en effet n'accroche ses armes comme à Biron. Retombant des hauteurs de l'épopée, je songe que le brocanteur qui vient parfois vers dix heures du matin a fait provisoirement fortune : alors il s'est offert comme tout le monde un tourisme à Bangkok, et le décalage horaire l'a mis sens dessus dessous. Mais il ne s'agit pas de brocante ni de bagarre d'ivrognes ou de héros. J'ouvre, je me penche et, en bas sur la place, je vois ces deux types qui se démènent et je comprends enfin pommes de terre. Eux qui le nez au vent m'ont repéré totu de suite me prennent à partie aussitôt : Quinze francs le sac de vingt-cinq kilos ! Je réponds que j'arrive. Ils se remettent à brailler et me citent en exemple à tout le quartier sourd, expectant. Je descendrais même si leur prix atteignait le double, ému comme si c'était Rimbaud fourgaunt de vieux remingtons. On traite vite, sans cérémonie. Il est jeune, maigre, avec une moustache noire, la voracité de la fatigue dans ses yeux creux. À moitié dans l'agriculture, à moitié dans la mécanique ; d'un lourd ciel usé qui dérive entre le trèfle et les moteurs.
— D'où venez-vous donc ?
— De Normandie.
— Mais pourquoi de si loin, et ce tintouin, si tard, ce système ?
— Parce qu'ils nous font tous chier.
On ne se regarde ensuite qu'une seconde, mais ça suffit. J'entends leur camion qui redémarre tandis que je hisse mon sac. Le matin les trouvera du côté de Bourg-Theroulde (qu'on prononce Boutroude) ou de Bayeux. Un peu de travers dans un fossé quand même ils s'assoupissent, la tête cassée contre la vitre ou roulée sur le volant, grise comme leurs patates, grise comme le point du jour et sa douceur d'anesthésie.
Jacques Réda, Les Ruines de Paris, "Le Chemin", Gallimard, 1977, p. 48-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, épopée, rimbaud, pommes de terre | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2013
Georges Bataille, L'expérience intérieure

Le dernier poème connu de Rimbaud n'est pas l'extrême. Si Rimbaud atteignit l'extrême, il n'en atteignit la communication que par le moyen de son désespoir : il supprima la communication possible, il n'écrivit plus de poèmes.
Le refus de communiquer est un moyen de communiquer plus hostile, mais le plus puissant ; s'il fut possible, c'est que Rimbaud se détourna. Pour ne plus communiquer, il renonça. Sinon c'est pour avoir renoncé qu'il cessa de communiquer. Personne ne saura si l'horreur (la faiblesse) ou la pudeur commanda le renoncement de Rimbaud. Il se peut que les bornes de l'horreur aient reculé (plus de Dieu). En tout cas, parler de faiblesse a peu de sens : Rimbaud maintint sa volonté d'extrême sur d'autres plans (celui surtout du renoncement). Il se peut qu'il ait renoncé faute d'avoir atteint — (l'extrême n'est pas désordre ou luxuriance), trop exigeant pour supporter, trop lucide pour ne pas voir. Il se peut qu'après avoir atteint, mais doutant que cela ait un sens ou même que cela ait eu lieu — comme l'état de celui qui atteint ne dure pas — il n'ait pu supporter le doute. Une recherche plus longue serait vaine, quand la volonté d'extrême ne s'arrête à rien (nous ne pouvons atteindre réellement).
Le moi n'importe en rien. Pour un lecteur, je suis l'être quelconque : nom, identité, historique n'y changent rien. Il (lecteur) est quelconque et je (auteur) le suis. Il et je sommes sans nom sortis du ... sans nom, pour ce ... sans nom comme sont pour le désert deux grains de sable, ou plutôt pour une mer deux vagues se perdant dans les vagues voisines. Le ... sans nom auquel appartient la « personnalité connue » du monde du etc., auquel elle appartient si totalement qu'elle l'ignore.
Georges Bataille, L'expérience intérieure, Gallimard, 1943, puis 1954, p. 69-70, et dans Œuvres complètes, V, Gallimard, 1973, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, l'expérience intérieure, rimbaud, l'extrême, le nom, le rien | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2012
Georges Perros, Papiers collés

Demander le sens d'un vers, c'est vouloir en savoir plus long que le poète lui-même. Le sens d'un vers, c'est et ce ne peut être que le vers lui-même. Le poète s'embarrasse, manque « d'esprit » si jamais il croit pouvoir signifier autrement que par la poésie. Et donne des regrets.
Ce qu'il y a de brutal et d'exemplaire chez Rimbaud, c'est qu'il rend la vie inutile. Inutilisable. Toute lecture, toute ambition intellectuelle, hors de question. Puisqu'un Rimbaud est possible, tout est vain. Il arrive et il parle. Et sa parole est un chant. Et ce chant implique tous les chants possibles. Et les annule. L'expérience, la durée, l'homme sont ici mis en déroute. Il renverse toutes les lois, en imposant la loi qui est et reste le haut fait d'être ce que l'on est. Il ne vit que par raccroc, il respire parce qu'il faut
bien. Et peu importe alors ce qu'il va faire de cette vie dérisoire. Sa poche d'ignorance, d'inspiration est préservée. Il rend à ce qu'on nomme la vie le suprême hommage, qui consiste à opérer comme si l'on n'avait que faire de ce qu'elle laisse espérer. Héritier milliardaire qui vivrait comme si ce trésor ne lui était de rien. Superbe mépris. Il rendra la cassette pleine, sans même s'être soucié d'en vérifier les richesses. Antiphilosophique extrême qui respecte aussi peu la mort que la vie. Il avance oreilles bouchées, lèvres closes, muet jusqu'au rire ; oui proprement angélique. Brûlant toutes ses cartes sans calcul, sans préméditation, sans plaisir. Il est ce qu'il est et fait ce qu'il fait. Le secret de Rimbaud, c'est l'évidence. Un rien de présence déplacée et c'en était fait. Il réussissait ou il échouait. Alors que son destin n'est pas qualifiable. Est le présent même.
Georges Perros, Papiers collés, Gallimard, 1960, p. 33, 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, rimbaud, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2012
Lecture de : Jean Ristat, Le théâtre du ciel, une lecture de Rimbaud.

Le théâtre du ciel est un livre singulier : il est construit en partant des deux premiers vers du sonnet des voyelles de Rimbaud, cités en exergue (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes), et en alternant pour chaque voyelle des transformations autour de sa forme (Entrées), puis des variations qui incluent la couleur (Scènes, parties divisées en tableaux). Mais un intermède rompt cet ordonnancement, consacré à une récriture en vers du Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Dans cet ensemble s’entrelacent des motifs que reconnaîtront les lecteurs de Ristat.
L’intermède, désignant une représentation entre les actes d’une pièce de théâtre, met ici en scène Otto Lidenbrock et son neveu le jeune Axel, tous deux venus du livre de Jules Verne, et un récitant. Les personnages, dans leur étrange parcours, traversent « le miroir / De l’espace et du temps par quoi toute chose se / Multiplie à l’infini en se répétant » ; c’est donner à cet endroit (il en est d’autres) du poème une image du livre entier : il s’est écrit en partie par l’intégration de divers matériaux non pas repris tels quels mais bougés. Le livre est ainsi comme « la machinerie du ciel » où les nuages se font, se défont et se recomposent sans cesse en figures nouvelles. C’est bien là un théâtre : « Dans les fossés du ciel [...] toutes les couleurs / s’échangent ».
Ce ciel sans cesse changeant (« Le ciel en bâillant laisse passer la lune entre / Ses babines blêmes ») est présent dans tout le livre, fil à suivre comme le sont les divers fragments issus de la mémoire — du « loup bleu de la mémoire ». Ainsi le souvenir de la grand-mère et de l’adolescent « lisant dans la cabane / Au fond du jardin ». Aux bribes du passé se mêlent, extraits aussi des « Forêts de la mémoire », des lambeaux des œuvres lues, modifiés (« Il n’aurait fallu qu’un moment de plus » (Aragon, Le Roman inachevé) devient « Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être »), des motifs de la grande tradition lyrique, du XVIe siècle (« Un jour viendra où mes vers seront ta couronne ») au romantisme, ici représenté par Chateaubriand (« Levez-vous, orages désirés » changé en « levez-vous vents désirés »). S’ajoutent certaines figures de la mythologie, si vivantes chez Ristat (1) ; interviennent le plus souvent les personnages nés « au milieu de l’archipel de mythologique mémoire » : Icare, Dionysos, Adonis, Médée, etc., à côté de « la mère isis au sexe de mygale » et de saint Sébastien.
Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments pris à Rimbaud ; vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », mots (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») et évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué, et de là le motif de l’homosexualité installé dès les premières pages :
Le poète porte un chapeau gris perle et boit
Goulûment du rhum dans la cale avec un jeune
Malfrat qui le consolera de vivre encore
C’est bien à partir de Rimbaud, lu et relu, qu’est organisé ce théâtre, labyrinthe et, aussi, ensemble de scènes emboîtées les unes dans les autres. Les Entrées forment une broderie évoquant les images des anciens abécédaires : l’A girafe, l’ « E trident de Neptune », « L’U fer à cheval », l’ « O ogre / Bouche ouverte », etc. La lettre, donc, dessine une figure et, parallèlement, les sons font le sens comme, par exemple, dans « O la camarde ma camarade » ou dans ces quatre vers anagrammatiques :
Ici le rital en ristat s’attriste à
La moquerie et ferraille comme un rasta
Tatoué tâte enfin rassis après la rixe
Un alexandrin circonflexe aux pieds tors
Pieds, ou plutôt syllabes torses, des alexandrins : ici et là on compte 11 ou 13 syllabes.
Chacune des Entrées tisse un récit qui se poursuit dans les Scènes : il se déroule alors en intégrant les couleurs des voyelles. Ainsi, le rouge du I est appelé dans la suite des scènes par : s’empourprent, couleur de sang, lèvres fardées, pieds rouges, boues rouges, pourpres tentures, rubis, incendie, peau cramoisie, bonnet rouge, Titien, feu. J'arrête là cette description d’un théâtre où la scène laisse découvrir les coulisses — elles sont alors une nouvelle scène —, où l’on traverse le miroir pour réapprendre, comme l’écrivait Rimbaud cité par Ristat, « la vie d’aventures qui existent dans les livres d’enfants ».
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud, Gallimard, 2009 ; 24, 90 €.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, rimbaud, le thâtre du ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2012
Vittorio Sereni, Étoile variable

Rimbaud
écrit sur un mur
Vienne un instant la morsure de son nom
la goutte qui exsude de son nom
écrit en lettres claires sur un mur brûlant.
Puis il me haïrait
l'homme au semelles de vent
pour y avoir cru.
Mais l'ombre renard ou rat qu'importe
habituée des mastabas
qui sans lien file dans notre regard
nous ignorant dans le jour qui décline...
Toi aussi tu l'as pensé.
Disparu. Faufilé dans sa maison
de cailloux de sable qui s'éboule
quand le désert recommence à vivre
il nous lance à nouveau ce nom en un long frisson.
Louxor, 1979
Rimbaud
scritto su un muro
Venga per un momento la fitta del suo nome
la goccia stillante dal suo nome
stilato in littere chiare su quel muro rovente.
Poi mi odierebbe
l'uomo dalle suole di vento
per averci creduto.
Ma l'ombra volpe o topo che sia
frequentatrice di mastabe
sfrecciante via del nostro sguardo
irrelata ignorandoci nella luce calante...
Anche tu l'hai pensato.
Sparito. Sgusciato nella sua casa
di sassi di sabbia franante
quando il deserto ricomincia a vivere
ci rilancia quel nome in un lungo brivido.
Luxor, 1979
Vittorio Sereni, Étoile variable [Stella variabile], éditon bilingue, traduit de l'italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, préface de Franco Fortini, 1987, p. 163 et 162.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorrio sereni, Étoile variable, rimbaud | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2011
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud

Ce livre de poèmes de Jean Ristat est un livre singulier : il est construit en partant des deux premiers vers du sonnet des voyelles de Rimbaud, cités en exergue (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes), alternant pour chaque voyelle des transformations autour de sa forme (Entrées) et des variations qui incluent la couleur (Scènes, parties divisées en tableaux). Un intermède rompt cet ordonnancement, consacré à une récriture en vers du Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Dans cet ensemble s’entrelacent des motifs que reconnaîtront les lecteurs de Ristat.
L’intermède, qui désigne une représentation entre les actes d’une pièce de théâtre, met ici en scène Otto Lidenbrock et son neveu le jeune Axel, tous deux sortis du livre de Jules Verne, et un récitant. Les personnages sont accompagnés dans leur étrange parcours, qui les conduit à traverser « le miroir / De l’espace et du temps par quoi toute chose se / Multiplie à l’infini en se répétant » ; cet endroit du poème (il en est d'autres) donne une image du livre entier : il est écrit en partie en intégrant divers matériaux, non pas repris tels quels mais "bougés". Le livre est ainsi comme « la machinerie du ciel » où se font, se défont et se recomposent sans cesse des figures nouvelles. C’est bien là un théâtre : « Dans les fossés du ciel [...] toutes les couleurs / s’échangent ».
Ce ciel sans cesse changeant (« Le ciel en bâillant laisse passer la lune entre / Ses babines blêmes ») est présent dans tout le livre, fil à suivre comme le sont les divers fragments issus de la mémoire, du « loup bleu de la mémoire ». Ainsi le souvenir de la grand-mère, celui de l’adolescent « lisant dans la cabane / Au fond du jardin ». Aux bribes du passé se mêlent, extraits aussi des « Forêts de la mémoire » : des lambeaux des œuvres lues, modifiés (« Il n’aurait fallu qu’un moment de plus » — Aragon, Le Roman inachevé — devient « Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être »), ou des motifs de la grande tradition lyrique, du XVIe siècle (« Un jour viendra où mes vers seront ta couronne ») au romantisme, ici représenté par Chateaubriand (« Levez-vous, orages désirés » changé en « levez-vous vents désirés »). S’ajoutent certaines figures de la mythologie, si vivantes chez Ristat (1) : interviennent le plus souvent les personnages nés « au milieu de l’archipel de mythologique mémoire », Icare, Dionysos, Adonis, Médée, etc., à côté de « la mère isis au sexe de mygale » et de saint Sébastien.
 Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments liés à Rimbaud : sa vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », des mots de ses poèmes (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), avec des transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») sans oublier une évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué et, de là, est installé le motif de l’homosexualité dès les premières pages :
Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments liés à Rimbaud : sa vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », des mots de ses poèmes (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), avec des transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») sans oublier une évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué et, de là, est installé le motif de l’homosexualité dès les premières pages :
Le poète porte un chapeau gris perle et boit
Goulûment du rhum dans la cale avec un jeune
Malfrat qui le consolera de vivre encore
C’est bien à partir de Rimbaud, lu et relu, qu’est organisé ce théâtre, labyrinthe et, aussi, ensemble de scènes emboîtées les unes dans les autres. Les Entrées forment une broderie évoquant les images des anciens abécédaires : l’A girafe, l’ « E trident de Neptune », « L’U fer à cheval », l’ « O ogre / Bouche ouverte », etc. La lettre, donc, dessine une figure et, parallèlement, les sons font le sens comme, par exemple, dans « O la camarde ma camarade » ou dans ces quatre vers anagrammatiques :
Ici le rital en ristat s’attriste à
La moquerie et ferraille comme un rasta
Tatoué tâte enfin rassis après la rixe
Un alexandrin circonflexe aux pieds tors
Pieds, ou plutôt syllabes torses, des alexandrins : ici et là on compte 11 ou 13 syllabes.
Chacune des Entrées tisse un récit qui se poursuit dans les Scènes : il se déroule alors en intégrant les couleurs des voyelles. Ainsi, le rouge du I est appelé dans la suite des scènes par : s’empourprent, couleur de sang, lèvres fardées, pieds rouges, boues rouges, pourpres tentures, rubis, incendie, peau cramoisie, bonnet rouge, Titien, feu. On arrête là cette description d’un théâtre où la scène laisse découvrir les coulisses — elles s'ouvrent alors sur une nouvelle scène —, où l’on traverse le miroir pour réapprendre, comme l’écrivait Rimbaud cité par Ristat, « la vie d’aventures qui existent dans les livres d’enfants ».
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud, Gallimard, 2009.
Publié dans Aragon Louis, Aragon Louis, RECENSIONS, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, rimbaud, rouge, jean ristat, le théâtre du ciel, rimbaud, rouge | ![]() Facebook |
Facebook |
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud

Ce livre de poèmes de Jean Ristat est un livre singulier : il est construit en partant des deux premiers vers du sonnet des voyelles de Rimbaud, cités en exergue (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes), alternant pour chaque voyelle des transformations autour de sa forme (Entrées) et des variations qui incluent la couleur (Scènes, parties divisées en tableaux). Un intermède rompt cet ordonnancement, consacré à une récriture en vers du Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Dans cet ensemble s’entrelacent des motifs que reconnaîtront les lecteurs de Ristat.
L’intermède, qui désigne une représentation entre les actes d’une pièce de théâtre, met ici en scène Otto Lidenbrock et son neveu le jeune Axel, tous deux sortis du livre de Jules Verne, et un récitant. Les personnages sont accompagnés dans leur étrange parcours, qui les conduit à traverser « le miroir / De l’espace et du temps par quoi toute chose se / Multiplie à l’infini en se répétant » ; cet endroit du poème (il en est d'autres) donne une image du livre entier : il est écrit en partie en intégrant divers matériaux, non pas repris tels quels mais "bougés". Le livre est ainsi comme « la machinerie du ciel » où se font, se défont et se recomposent sans cesse des figures nouvelles. C’est bien là un théâtre : « Dans les fossés du ciel [...] toutes les couleurs / s’échangent ».
Ce ciel sans cesse changeant (« Le ciel en bâillant laisse passer la lune entre / Ses babines blêmes ») est présent dans tout le livre, fil à suivre comme le sont les divers fragments issus de la mémoire, du « loup bleu de la mémoire ». Ainsi le souvenir de la grand-mère, celui de l’adolescent « lisant dans la cabane / Au fond du jardin ». Aux bribes du passé se mêlent, extraits aussi des « Forêts de la mémoire » : des lambeaux des œuvres lues, modifiés (« Il n’aurait fallu qu’un moment de plus » — Aragon, Le Roman inachevé — devient « Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être »), ou des motifs de la grande tradition lyrique, du XVIe siècle (« Un jour viendra où mes vers seront ta couronne ») au romantisme, ici représenté par Chateaubriand (« Levez-vous, orages désirés » changé en « levez-vous vents désirés »). S’ajoutent certaines figures de la mythologie, si vivantes chez Ristat (1) : interviennent le plus souvent les personnages nés « au milieu de l’archipel de mythologique mémoire », Icare, Dionysos, Adonis, Médée, etc., à côté de « la mère isis au sexe de mygale » et de saint Sébastien.
 Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments liés à Rimbaud : sa vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », des mots de ses poèmes (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), avec des transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») sans oublier une évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué et, de là, est installé le motif de l’homosexualité dès les premières pages :
Dans le complexe, et presque toujours très allusif, entrelacement des références, dominent les éléments liés à Rimbaud : sa vie (« À marseille sur ton lit d’hôpital », des mots de ses poèmes (« bave », qui rappelle « Mon triste cœur bave à la poupe »), avec des transformations (« l’enfer n’a pas de saison ») sans oublier une évocation rapide de l’énigmatique Hortense. Le personnage de Verlaine-Lélian est aussi convoqué et, de là, est installé le motif de l’homosexualité dès les premières pages :
Le poète porte un chapeau gris perle et boit
Goulûment du rhum dans la cale avec un jeune
Malfrat qui le consolera de vivre encore
C’est bien à partir de Rimbaud, lu et relu, qu’est organisé ce théâtre, labyrinthe et, aussi, ensemble de scènes emboîtées les unes dans les autres. Les Entrées forment une broderie évoquant les images des anciens abécédaires : l’A girafe, l’ « E trident de Neptune », « L’U fer à cheval », l’ « O ogre / Bouche ouverte », etc. La lettre, donc, dessine une figure et, parallèlement, les sons font le sens comme, par exemple, dans « O la camarde ma camarade » ou dans ces quatre vers anagrammatiques :
Ici le rital en ristat s’attriste à
La moquerie et ferraille comme un rasta
Tatoué tâte enfin rassis après la rixe
Un alexandrin circonflexe aux pieds tors
Pieds, ou plutôt syllabes torses, des alexandrins : ici et là on compte 11 ou 13 syllabes.
Chacune des Entrées tisse un récit qui se poursuit dans les Scènes : il se déroule alors en intégrant les couleurs des voyelles. Ainsi, le rouge du I est appelé dans la suite des scènes par : s’empourprent, couleur de sang, lèvres fardées, pieds rouges, boues rouges, pourpres tentures, rubis, incendie, peau cramoisie, bonnet rouge, Titien, feu. On arrête là cette description d’un théâtre où la scène laisse découvrir les coulisses — elles s'ouvrent alors sur une nouvelle scène —, où l’on traverse le miroir pour réapprendre, comme l’écrivait Rimbaud cité par Ristat, « la vie d’aventures qui existent dans les livres d’enfants ».
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud, Gallimard, 2009.
Publié dans Aragon Louis, Aragon Louis, RECENSIONS, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, rimbaud, rouge, jean ristat, le théâtre du ciel, rimbaud, rouge | ![]() Facebook |
Facebook |





