13/01/2014
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot

Comment pourrais-je devenir poète ?
Comment pourrais-je écrire en rimes ?
Un jour vous m'avez dit : « Ce souhait-là lui-même
Participe du sublime ».
Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas
Avec votre « plus tard » ! »
Le vieil homme sourit de le voir,
D'entendre sa sortie soudaine ;
Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur
Avec enthousiasme ;
Et songea : « Il n'y a rien en lui
De tiède ni d'irrésolu.
« Et prétendriez-vous devenir poète
Avant d'être allé à l'école ?
Et bien ! Je n'aurais jamais cru
Que vous fussiez un sot aussi parfait.
Tout d'abord apprenez à être spasmodique —
Règle très simple.
Vous commencez par écrire une phrase ;
Ensuite vous la hachez menu ;
Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort
Strictement au petit bonheur :
L'ordre des mots
Est tout à fait indifférent.
Si vous voulez faire impression,
Rappelez-vous ce que je dis :
Ces qualités abstraites commencent
Toujours par des capitales :
Le Vrai, le Bien, le Beau —
Voilà les choses qui paient !
Ensuite, lorsque vous décrivez
Une forme, une couleur ou un son,
N'exposez pas l'affaire clairement,
Mais glissez-la dans une allusion ;
Et apprenez à regarder toute chose
Avec une sorte de strabisme mental.
« Par exemple, si je veux, Monsieur,
Parler de pâtés de mouton,
Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons
Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »
« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase
Conviendra parfaitement.
Quatrièmement, il y a des épithètes
Qui vont avec n'importe quel mot —
Tout comme la Sauce Harvey Reading
Avec poisson, viande ou volaille —
Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,
Sont spécialement recommandables. »
« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il
Si je les utilise en masse —
Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las
Vers une étrange et solitaire pompe » ? »
« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,
Sauter sur de pareilles conclusions.
De telles épithètes, comme le poivre,
Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,
Et, si vous en usez avec ménagement,
Elles aiguisent l'appétit :
Par contre, si vous en mettez trop,
Vous gâtez l'affaire complètement.
Enfin, pour ce qui est de la composition :
Votre lecteur, il faut le lui montrer,
Doit prendre les renseignements qu'on lui donne
Et ne compter sur aucune
Divulgation prématurée des tendances
Et desseins de votre poème.
Donc, pour éprouver sa patience —
Savoir ce qu'il peut supporter —
Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,
Et assurez-vous, en tout cas,
Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,
D'une obscurité compacte.
Fixez d'abord les limites
Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :
Puis complétez, avec du "remplissage"
(Demandez à quelque ami) :
Votre grande STROPHE-À-SENSATION,
Vous la placez vers la fin. »
« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,
Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?
Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,
Entendu ce mot employé de la sorte :
Ayez la bonté d'en citer une seule,
« Exempli gratia ». »
Et le vieil homme, regardant tristement
À travers la pelouse du jardin,
Où çà et là une goutte de rosée
Étincelait encore dans l'aube
Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",
Et voyez le "Colleen Bawn".
Le mot est dû à Boucicault —
La théorie est sienne ;
Au point où la vie devient un spasme,
Et l'Histoire un Sifflement :
Si cela n'est pas de la Sensation
Je ne sais pas ce que c'est.
Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie
Aura perdu son présent éclat — »
« Et alors », ajouta son petit-fils,
« Nous publierons ça, n'est-ce pas :
Couverture verte — lettres dorées au dos —
En in-douze ! »
Et le vieil homme sourit fièrement
De voir l'ardent garçon
Se ruer follement sur son encre et sa plume
Et son papier buvard —
Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication
Son visage devient grave et triste.
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, traduit par henri parisot, devenir poère | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2014
Paul Celan, Pavot et mémoire,

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Louange du lointain
À la source de tes yeux
vivent les filets des pêcheurs d'eaux folles.
À la source de tes yeux
la mer tient sa promesse.
Je jette là
un cœur qui a vécu parmi les hommes,
jette bas mes vêtements et l'éclat d'un serment :
Plus noir dans le noir je suis plus nu.
Infidèle seulement je suis fidèle.
Je suis tu quand je suis je.
À la source de tes yeux
je suis emporté et je rêve de rapine.
Un filet a pêché un filet :
nous nous séparons enlacés.
À la source de tes yeux
un pendu étrangle sa corde.
Lob der Ferne
Im Quell deiner Augen
leben die Garne der Fischer der Irrsee.
Im Quell deiner Augen
hält das Meer sein Versprechen.
Hier werf ich,
ein Herz, das gewellt unter Menschen,
die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures :
Schwärzer im Schwarz, bin ich nackter.
Abtrünnig esrt bin ich treu.
Ich bin du, wenn ich ich bin.
Im Quell deiner Augen
treib ich und träume von Raub.
Ein Garn fing ein Garn ein :
wir scheiden umschlungen.
Im Quell deiner Augen
erwürgt ein Gehenkter den Strang.
Paul Celan, Pavot et mémoire, traduction de Valérie
Briet, Christian Bourgois, 1987, p. 69 et 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, pavot et mémoire, amour, yeux, toi, promesse | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2014
Paul Celan, Poèmes, traduction de John E. Jackson

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Psaume
Personne ne nous pétrira plus de terre et d'argile,
personne ne conjurera notre poudre.
Personne.
Loué sois-tu, Personne.
Par amour de toi nous
voulons fleurir.
Vers
Toi.
Un rien
étions-nous, sommes-nous, resterons-
nous, fleurissant :
la rose de Rien, la
rose de Personne.
Avec
le style clair d'âme,
l'étamine ciel-désert,
la corolle rouge
du mot-pourpre que nous chantions
par-dessus, ô par-dessus
l'épine.
Psalm
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend :
die Nichts-, die
Niemandsrose
Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.
Paul Celan, Poèmes, traduction de John E. Jackson,
éditions Unes, 1987, p. 37 et 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, poèmes, traduction de john e. jackson, personne, rose, rouge | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2014
Paul Celan, Voix /Stimmen, traduction Martine Broda

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Voix venues du chemin d'orties :
Viens à nous sur les mains.
Qui est seul avec la lampe,
pour y lire, n'a que sa main.
Stimmen vom Nesselweg her :
Komm auf den Händen zu uns.
Wer mit der Lampe allein ist,
hat nur die Hand, draus zu lessen.
Paul Celan, Voix /Stimmen, traduction
Martine Broda, Lettres de Casse,
1984, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, voix stimmen, traduction martine broda, ortie, lampe, main | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2014
Paul Celan, Partie de neige

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan,
À ton ombre, à ton
ombre toute mal-sonnée aussi,
j'ai donné sa chance.
elle, elle aussi
je l'ai lapidée à coups de moi-même,
moi le droit-ombré, droit
sonné —
étoile à six branches
à laquelle tu as
adonné ton silence.
aujourd'hui
adonne ce silence où tu veux,
catapultant du sous-sacralisé par l'époque,
depuis longtemps, moi aussi, dans la rue,
je sors, pour n'accueillir aucun cœur,
jusque chez moi dans le pierreux-
multiple.
Deinem, aux deinem
fehldurchläuteten Schatten
gab ich die Chance.
ihn, auch ihn
besteinigt ich mit mir
Gradgeschattetern, Grad-
geläutetem — ein
Schsstern,
dem du dich hinschwiegst,
heute
schweig dich, wohin du magst,
Zeitunterheligtes schleudernd,
längst, auch ich, auf der Straße,
tret ich, kein Herz zu empfangen,
zu mir ins Steinig-Viele
hinaus.
Paul Celan, Partie de neige, édition bilingue,
traduit de l'allemand et annoté par Jean-Pierre
Lefebvre, Seuil, 2007, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, partie de neige, étoile, amour, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2014
Paul Celan, Poèmes, traduction André du Bouchet

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Parler, la grille
Œil-le-rond entre les ferrures.
Paupières, cillant,
qui rames amont,
élargis ce regard.
Iris, nageur, rogue et sans rêve :
le ciel, cœur gris, n'est pas loin.
Déclive, à ce bec du métal,
l'écharde charbonne.
Où la lumière tire,
tu devines l'âme.
(Si j'étais semblable à toi. Toi-même, à moi.
Ne sommes-nous pas debout
dans un même alizé ?
Nous sommes étrangers.)
Les dalles. Dessus,
entreserrées, l'une et l'autre
flaques gris-cœur :
deux fois
se taire plein la bouche.
*
Sprachgitter
Augenrund zwischen den Stäben
Flimmertier Lid
rudert nach oben,
gibt einen Blick frei.
Iris, Schwimmerin, traumlos und trüb :
der Himmel, herzgrau, muss nah sein.
Schräg, in der eisernen Tülle,
der blakende Span.
Am Lichtsinn
errätst du die Seele.
(Wär ich wie du. Wärst du wie ich.
Standen wir nicht
unter einem Passat ?
Wir sind Fremde.)
Die Fliesen. Darauf,
dicht beieinander, die beiden
herzgrauen Lachen
zwei
Mundwoll Schweigen.
Paul Celan, Poèmes, traduits par André du
Bouchet, Clivages, 1978, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, parler, la grille, andré du bouchet, toi, regard | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2014
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par Martine Broda

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Mon
âme inclinée vers toi
t'entend
orager,
dans le creux de ton cou mon étoile
apprend comme on sombre
et devient vraie,
des doigts, je la tire au dehors —
viens, entends-toi avec elle,
encore aujourd'hui.
Meine
dir zugewinkelte Seele
hört dich
gewittern,
in deiner Halsgrube lernt
mein Stern, wie man wegsackt
und wahr wird,
ich fingre ihn wieder heraus —
komm, besprich dich mit ihm,
noch heute.
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par
Martine Broda, Clivages, 1985, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, enclos du temps, traduit par martine broda, amour, étoile | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2014
Henri Thomas, Poésies, préface de Jacques Brenner
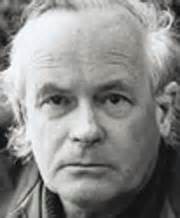
Chauve-souris
La fadeur qui s’en va de la femme endormie
me poursuit vaguement, inquiétant ma vie.
Ce début de poème exprime une tristesse
si confuse qu’un rien la changerait en liesse.
Pourquoi liesse, pourquoi tristesse, pourquoi
ne pas rester tranquille et fort et sûr de soi ?
Un rameau monte de la plaine du sommeil,
c’est le jour, ébloui de renaître pareil.
M’envoler dans ce monde à l’énorme ramure,
aigle ou petit oiseau, quelle belle aventure !
Hélas, chauve-souris de cette voûte obscure,
je dors, alors que s’ensoleille la nature.
L’homme divers, comme un miroir qui bougerait
me fait peur, et la femme aux humides attraits
m’emmène au loin au pays des faibles cris,
des mensonges, et des fatigues de midi.
Le jour s’éteint, salut, crépuscule banal,
il est temps de glisser vers le monde infernal.
Henri Thomas, Poésies, préface de Jacques Brenner, Poésie / Gallimard, 1970, p. 161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, poésies, préface de jacques brenner, chauve-souris, femme, mensonge, tristesse | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2014
Samuel Beckett, Cap au pire
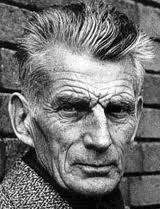
Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’à plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore.
Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit.
Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D’où sortir. Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là encore. Sans bouger.
Tout jadis. Jamais rien d’autre. D’essayé. De raté. N’importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.
D’abord le corps. Non. D’abord le lieu. Non. D’abord les deux. Tantôt l’un ou l’autre. Tantôt l’autre ou l’un. Dégoûté de l’un essayer l’autre. Dégoûté de l’autre retour au dégoût de l’un. Encore et encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’au dégoût des deux. Vomir et partir. Là où ni l’un ni l’autre. Jusqu’au dégoût de là. Vomir et revenir. Le corps encore. Où nul. Le lieu encore. Où nul. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore plus mal encore. Jusqu’à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour de bon. Là où ni l’un ni l’autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes pour de bon.
Samuel Beckett, Cap au pire, traduit de l’anglais par Édith Fournier, éditions de Minuit, 1991, p. 7-9.
*
On. Say on. Be said on. Somehow on. Till nohow on. Said nohow on.
Say for be said . Missaid. From now say for be missaid.
Say a body. Where none. No mind. Where none. That at least. A place. Where none. For the body. To be in. Move in. Out of. Back into. No. No out. No back. Only in. Stay in. On in. Still.
All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
First the body. No. First the place. No. First both. Now either. Now the other. Sick of the either try the other. Sick of it back sick of the either. So on. Somehow on. Till sick of both. Throw up and go. Where neither. Till sick of there. Throw up and back. The body again. Where none. The place again. Where none. Try again. Fail again. Better again. Or better worse. Fail worse again. Still worse again. Till sick for good. Throw up for good. Go for good. Where neither for good. Good and all.
Samuel Beckett, Worstward Ho, London, John Calder, 1983, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, cap au pire, corps, dire, dégoût | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2014
Pierre Jean Jouve, Danse des morts

Pour "commémorer" la boucherie de 1914-1918 (4)
Cadavres
La Mort
Mes cadavres, mes cadavres !
Rampe, ta chair à demi morte,
Combattants d'hier,
Sur ce terrain-là.
Le reconnais-tu ?
Tu y courus, bête sauvage.
— Et regarde :
Cadavres, cadavres !
Des horizons et des marées !
Pacifiés, déchiquetés, les vieux, les jeunes,
Épaisseurs sur épaisseurs dans la terre cadavéreuse,
Brassés par la pluie,
Arrachés par celui qui passe,
Et labourés, et retournés,
Chaque jours par les obus tenaces,
Morts que la mort tue, fusille, crève et fait éclater
Encore !
Ceux de six mois, ceux de deux jours,
Et des terrains morts qui reviennent à l'air ;
Le compagnon qui rigolait la veille :
« T'en fais pas »,
Le voilà,
Torse planté en terre, et la tête penchée,
Avec le ver de ses lèvres entre ses joues,
Te regardant, d'un regard clair !
Restes séchés
Sur les plateaux, pendus aux réseaux de fer.
Par un seul jet de mitrailleuse, hachés ;
Des têtes noires, grouillant de vers,
Fémurs, dents pointues et képis,
Dans un bitume de terre paisible
Qui dévore...
Et les moins anciens, avec leurs rats sous eux,
Et les neufs, figures vertes, puanteur...
Pierre Jean Jouve, Danse des morts [1917], dans Œuvre I,
édition établie par Jean Starobinski, Mercure de
France, 1987, p. 1591-1592.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, danse des morts, cadavres, boue, puanteur | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2014
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir

Ode
Un Corbeau devant moi croasse,
Une ombre offusque mes regards,
Deux belettes et deux renards
Traversent l’endroit où je passe :
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal,
J’entends craqueter le tonnerre,
Un esprit se présente à moi,
J’ois Charon qui m’appelle à soi,
Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source,
Un bœuf gravit sur un clocher,
Le sang coule de ce rocher,
Un aspic s’accouple d’une ourse,
Sur le haut d’une vieille tour
Un serpent déchire un vautour,
Le feu brûle dedans la glace,
Le Soleil est devenu noir,
Je vois la Lune qui va choir,
Cet arbre est sorti de sa place.

Le monde renversé
Sonnet
L’autre jour inspiré d’une divine flamme,
J’entrai dedans un temple, où tout religieux
Examinant de près mes actes vicieux,
Un repentir profond fit soupirer mon âme.
Tandis qu’à mon secours tous les Dieux je réclame,
Je vois venir Phyllis : quand j’aperçus ses yeux
Je m’écriai tout haut : ce sont ici mes Dieux,
Ce temple, et cet Autel appartient à ma Dame.
Le Dieux injuriés de ce crime d’amour
Conspirent par vengeance à me ravir le jour ;
Mais que sans plus tarder leur flamme me confonde.
Ô mort, quand tu voudras je suis prêt à partir ;
Car je suis assuré que je mourrai martyr,
Pour avoir adoré le plus bel œil du monde.
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir, Œuvres choisies, édition présentée et établie par Jean-Pierre Chauveau, Poésie / Gallimard, 2002, p. 88 et 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, après m’avoir fait tant mourir, sonnet, le monde renversé, amour, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2014
Maurice Genevoix, La ferveur du souvenir

Pour "commémorer" la boucherie de 1914 (3)
J'ai parlé de quelques souvenirs [...]. Souvenirs du front d'abord, et plus précisément d'un secteur, l'un de ces secteurs circonscrits que l'on se voyait attribué comme par un tirage au sort. J'en sais un où mon régiment, après un hiver dans la boue, a connu deux mois de carnages à peu près ininterrompus1, où le "tour" des relevés, impitoyablement, à des intervalles fatidiques, a ramené les mêmes hommes dans les mêmes tranchées bouleversées, refaites, redémolies encore, de relève en relève, regorgeant de morts plus nombreux, tous connus, tous fraternels, peu à peu pourrissants sous nos yeux, à nos côtés, mais toujours reconnaissables. Et je retrouverais, sans contraindre beaucoup ma mémoire, le mouvement, l'accent, les termes mêmes des lettres que j'écrivais alors, m'indignant de cette "méconnaissance" de l'homme aux prises avec les réalités du combat, qui conduisait le haut commandement à de pareilles aberrations.
C'était comme s'il eût retiré à chaque vivant sa dernière chance, prononcé un verdict de condamnation sans appel. À quoi bon ce sursaut d'espoir, cette ivresse de respirer encore qui saisissait chaque survivant au sortir de chaque bataille, si c'était pour se voir ramené à date fixe, inexorablement, vers la même boue, les mêmes cadavres, les mêmes batteries exactement pointées, réglées, le même massacre en quelque sorte familier, qui resserrait, précisait, multipliait et renouvelait ses coups de manière à n'épargner personne ? À la longue, qui eût pu y tenir, réprimer jusqu'au bout en soi-même les sursauts de la bête vivante, et qui savait ?
Maurice Genevoix, La ferveur du souvenir, La Table ronde, 2013, p. 112-113.
1.Les Éparges, entre janvier et avril 1915.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice genevoix, la ferveur du souvenir, guerre de1914, les éparges, tranchée, massacre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2014
Jacques Prévert, La pluie et le beau temps

Étranges étrangers
Étranges étrangers
Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
hommes des pays loin
cobayes des colonies
doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d'Italie
Boumians de la porte Saint-Ouen
Apatrides d'Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
au beau milieu des rues
embauchés débauchés
manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais, du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou du cap Finisterre
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir d ela vôtre
la liberté des autres
Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d'une petite mer
où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte à cigares
et quelques bouts de fil de fer
tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet
Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d'or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd'hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez
Jacques Prévert, La pluie et le beau temps, Gallimard,
1955, p. 29-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, la pluie et le beau temps, étranges étrangers, colonies, rejet | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2013
Maurice Genevoix, Paul Dupuy, Correspondance

Maurice Genevoix en 1914
Pour "commémorer" la boucherie de 14-18...(2)
Maurice Genevoix à Paul Dupuy, 17 avril [1915]
[...] Nous avons souffert autant que les autres. Ce qui fut le plus dur de l'épreuve, ce qui a fait que nos soldats sont vraiment héroïques, c'est la boue. La boue dans laquelle nous avons vécu pendant les mois d'hiver, la boue que les premiers soleils avaient séchée, la boue qui avait réapparu la veille de notre attaque, plus épaisse et collante que jamais, on eût dit que nous nous retrouvions nous-mêmes, fangeux des pieds à la tête, à l'heure où nous devions nous battre, les cartouches terreuses, des fusils dont le mécanisme englué ne fonctionnait plus, les hommes pissaient dessus pour les rendre utilisables. Nous avons perdu deux fois des tranchées prises, parce qu'il nous était impossible d'arrêter les Boches par le feu. Ils arrivaient à vingt mètres sans être inquiétés, lançaient des grenades et tiraient sur tout homme qui se montrait, jusqu'à ce que la position devînt intenable. Quand ils s'y étaient réinstallés, les nôtres contre-attaquaient.
Le 3, le 4 avril nous étions déjà dans les tranchées, tous les hommes en ligne de nuit ; ils se sont reposés un peu dans la journée du 4 : c'est tout. Le 4 au soir, ils étaient tous là-haut. Ils y sont tous restés de la boue jusqu'aux cuisses, jusqu'au milieu de la nuit du 10 au 11.
Et continuellement des obus pleuvaient ; et le canon revolver de Combes démolissait les parapets de la tranchée, qu'inlassablement nous refaisions avec des sacs à terre. Par crises, les gros arrivaient, éclatant avec un fracas énorme et projetant des masses de terre, jusqu'à trente mètres de haut. Il en tombait cent, deux cents, qui ne faisaient rien qu'ensevelir quelques hommes sous la boue des parapets ; et puis tout d'un coup il y en avait un qui trouvait la tranchée, et qui éclatait en plein dedans : alors c'était des plaintes et des hurlements, quelques hommes qui se sauvaient , la face rouge de sang clair et jaune de boue liquide, ou du rouge encore dégoulinant au bout des doigts, éclatant en taches vermeilles en plein dans la croûte terrestre des capotes. Et tout autour de l'entonnoir calciné, empli encore de fumée noire et puante, il y avait des cadavres déchiquetés, un tronc sans membre et sans tête qui palpitait, un homme accroupi qui râlait en vomissant des glaires rouges par la bouche et par le nez, le crâne fendu bavant de la cervelle rose, un autre assis au fond du trou qu'il s'était creusé, face sans souffrance, incroyablement pâle et la pipe aux dents encore. Et tout les autres attendaient, tous les autres restaient là, les deux jambes prises dans ce ruisseau lourd, profond et glacé, sentant leurs pieds peu à peu s'engourdir et mourir.
Maurice Genevoix, Paul Dupuy, Correspondance, 28 août 1914-30 avril 1915, La Table ronde, 2013, p. 259-261.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice genevoix, paul dupuy, correspondance, guerre de 1914, tranchée, boucherie, boue | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2013
Patrick Beurard-Valdoye, La fugue inachevée

Pour "commémorer" la boucherie de 14-18...
Menoncourt samedi 1er août 1814 — Marcel à ses parents (Morvillars (Terr. de Belfort)
C'est avec une grande peine que je vous écris peut-être ces derniers mots nous sommes en troisième ligne en cantonnement d'alerte à Menoncourt nous sommes partis le vendredi 31 juillet à 8 heures du soir en tenue de guerre pour Menoncourt à 5 kilomètres de la frontière nous avons avec nous 120 cartouches ici le pays est tout sens dessus dessous nous avons fauché blé pommes de terre etc. pour faire des tranchées pour nous retrancher ici les femmes pleurent car elles ont reçu l'ordre de quitter le village j'espère qu'Albert et Amédée sont partis aussi pour faire leur devoir aujourd'hui samedi nous avons entendu l'ordre de mobilisation générale peut-être demain nous partirons au feu un aéroplane est venu ce soir atterrir à Menoncourt faire une reconnaissance je ne pensais guerre que dimanche la situation en viendrait à ce point-ci je termine ma lettre en vous embrassant bien tous
votre fils qui fera son devoir Marcel
Menoncourt lundi 3 août 1814 - Marcel à ses parents
Je crois que nous sommes encore à Menoncourt pour deux jours nous pousserons peut-être plus avant c'est un pays à peu près ruiné les vergers arbres fruitiers sont en grande partie coupés ainsi que les blés pommes de terre etc. nous avons fait des fosses pour nous abriter pour tirer nous coupons aussi les lisières de bois dans le pays on ne peut plus rien trouver aucune boisson tout a été nettoyé en deux jours Je voudrais bien que vous me disiez si Albert et Amédée sont partis et où ils sont dans le village on a tambouriné hier que tout homme valide de 16 à 60 ans devait se rendre à Belfort pour faire des travaux de défense dites-moi si le Papa est parti ainsi que nos chevaux [...]
Un commandant du 35' s'est suicidé il s'était trop rapproché de la frontière avec son bataillon le Général lui a ordonné de reculer il a refusé et s'est suicidé.
Bonjour à tous.
Patrick Beurard-Valdoye, La fugue inachevée, éditions Al Dante/Niok, éditions Léo Scheer, 2004, p. 176 et 179.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick beurard-valdoye, la fugue inachevée, lettre, tranchée, camp, guerre 1914 | ![]() Facebook |
Facebook |





