18/11/2013
Aragon, La Grande Gaîté

Poème à crier dans les ruines
Tous deux crachons tous deux
Sur ce que nous avons aimé
Sur ce que nous avons aimé tous deux
Si tu veux car ceci tous deux
Est bien un air de valse et j'imagine
Ce qui passe entre nous de sombre et d'inégalable
Comme un dialogue de miroirs abandonnés
À la consigne quelque part Foligno peut-être
Ou l'Auvergne la Bourboule
Certains noms sont chargés d'un tonnerre lointain
Veux-tu crachons tous deux sur ces pays immenses
Où se promènent de petites automobiles de louage
Veux-tu car il faut que quelque chose encore
Quelque chose
Nous réunisse veux-tu crachons
Tous deux c'est une valse
Une espèce de sanglot commode
Crachons crachons de petites automobiles
Crachons c'est la consigne
Une valse de miroirs
Un dialogue nulle part
Écoute ces pays immenses où le vent
Pleure sur ce que nous avons aimé
L'un d'eux est un cheval qui s'accoude à la terre
L'autre un mort agitant un linge l'autre
La trace de tes pas Je me souviens d'un village désert
À l'épaule d'une montagne brûlée
Je me souviens de ton épaule
Je me souviens de ton coude
Je me souviens de ton linge
Je me souviens de tes pas
Je me souviens d'une ville où il n'y a pas de cheval
Je me souviens de ton regard qui a brûlé
Mon cœur désert un mort Mazeppa qu'un cheval
Emporta devant moi comme ce jour dans la montagne
L'ivresse précipitait ma course à travers les chênes martyrs
Qui saignaient prophétiquement tandis
Que le jour faiblissait sur des camions bleus
Je me souviens de tant de choses
De tant de soirs
De tant de chambres
De tant de marches
De tant de colères
De tant de haltes dans des lieux nuls
Où s'éveillait pourtant l'esprit du mystère pareil
Au cri d'un enfant aveugle dans une gare frontière
Je me souviens
[...]
Aragon, La Grande Gaîté (1929), dans Œuvres poétiques complètes I,
édition dirigée par Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 2007, p. 446-447.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaîté, souvenir, dialogue, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2013
Gertrude Stein, Lève bas-ventre
Gertrude Stein par Francis Picabia
II.
Baise mes lèvres. Elle les a baisées.
Baise mes lèvres à nouveau. Elle les a baisées à nouveau.
Baise mes lèvres encore et encore et encore à nouveau et elle les a [baisées encore et encore et en corps à nous vaut.
J'ai des plumes.
De grands poissons.
Penses-tu à des abricots. Nous les trouvons très beaux. Ce n'est pas [seulement leur couleur c'est leur noyau qui nous charme. Nous y [trouvons une différence.
Lève bas-ventre est si étrange.
Je suis venue pour en parler.
Un choix de raisins secs bon leurs raisins les raisins sont bons.
Différence ton nom.
Questionne et jardine.
Il pleut. N'en parle pas.
Mon bébé est chou tout rose. Je veux lui dire une chose.
Chandelles de cire. Nous avons acheté beau cou beaucoup de [chandelles de cire. Certaines sont décorée. Personne ne les a [allumées.
Je ne fais pas mention des roses.
Exactement.
Questionne et beurre.
Je trouve le beurre très bon.
L'Éve bas-ventre est si douce.
Lève bas-ventre grassement.
N'est-ce pas que cela t'étonne.
Tu me désirais intensément.
Dis-le à nouveau.
Fraise.
Lève transporte bas-ventre.
Lève douceur bas-ventre.
Chante jusqu'à moi dis-je.
Certaines sont des épouses pas des héros.
Lève bas-ventre simplement.
Chante jusqu'à moi dis-je.
Lève bas-ventre. Un réfléchi.
[...]
Gertrude Stein, Lève bas-ventre, traduction de Christophe
Lamiot Enos, éditions Corti, 2013, p. 28-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, lève bas-ventre, baiser, fruit, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2013
Antonin Artaud, LesTarahumaras

Le rite du Peyotl chez les Tarahumaras
Comme je l'ai déjà dit ce sont les prêtres du Tutuguri qui m'ont ouvert la route de Ciguri comme quelques jours auparavant le Maître de toutes les choses m'avait ouvert la route du Tutuguri. Le Maître de toutes les choses est celui qui commande aux relations extérieures entre les hommes : l' amitié, la pitié, l'aumône, la fidélité, la piété, la générosité, le travail. Son pouvoir s'arrête à la porte de ce qu'ici en Europe nous entendons par métaphysique ou théologie, mais il va beaucoup plus loin dans le domaine de la conscience interne que celui de n'importe quel chef politique européen. Nul au Mexique ne peut être initié, c'est-à-dire recevoir l'onction des prêtres du soleil et la frappe immersive et réagrégatrice de ceux du Ciguri, qui est un rite d'anéantissement, s'il n'a été auparavant touché par le glaive du vieux chef Indien qui commande à la paix et à la guerre, à la Justice, au Mariage et à l'Amour. Il a, paraît-il, en mains les forces qui commandent au hommes de s'aimer ou qui les affolent, alors que les prêtres du Tutuguri font se lever avec leur bouche l'Esprit qui les produit et les dispose dans l'Infini où il faut que l'Âme les cueille et les reclasse dans son moi. L'action des prêtres du Soleil cerne toute l'âme et s'arrête aux limites du moi personnel où le Maitre de toutes les choses vient en cueillir le retentissement. Et c'est là que le vieux chef mexicain m'a frappé afin de m'ouvrir de nouveau la conscience, car pour comprendre le Soleil j'étais mal né ; et puis c'est l'ordre hiérarchique des choses qui veut qu'après être passé par le TOUT, c'est-à-dire le multiple, qui est les choses, on en revienne au simple de l'un, qui est le Tutuguri ou le Soleil, pour ensuite se dissoudre et ressusciter par le moyen de cette opération de réassimilation ténébreuse qui est comprise dans le Ciguri, comme un Mythe de reprise, puis d'extermination, et enfin de résolution dans le crible de l'expropriation suprême, ainsi que ne cessent de le crier et de l'affirmer leurs prêtres dans leur Danse de toute la Nuit. Car elle occupe la nuit entière, du couchant à l'aurore, mais elle prend toute la nuit et la ramasse comme on prend tout le jus d'un fruit jusqu'à la source de la vie. Et l'extirpation de propriétés va jusqu'à dieu et l'outrepasse ; car dieu, et surtout dieu, ne peut prendre ce qui dans le moi est authentiquement le soi-même si fort que celui-ci ait l'imbécillité de s'abandonner.
Antonin Artaud, LesTarahumaras, L'Arbalète, 1963, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2013
Philippe Beck, Chants populaires

Chaque poème ou chant populaire s'inspire ici d'un conte "noté" par les Grimm. (Avertissement, p. 7)
27. Technique
La force de l'homme est le point.
Celui-là sur le banc
fut un homme.
Celui-ci sur le banc continue.
Il devient ce qu'il est.
Qui est un homme ?
Bête se demande. Elle dit parfois : « Voilà un homme ».
Ou : « Voici »
Elle va sur lui. Droit devant.
Il prend un bâton et souffle dans le dur.
Il souffle autour.
Les braises sont
au visage de la bête.
Des pierres qui brillent.
Des pierres combatives.
Comme foudre mariée à grêle.
Bête sent qu'il y a une idée
dans le souffle. L cause
étonnement.
Et l'arrêt en plein vol.
En plein air.
Bête allée à Technicité.
En passant.
Elle vient bouche ouverte et tombée
(coquillage)
pays de violence et d'invention.
Silence et inauguration
dans la bête.
Avant les jeux.
Elle commence la vertu commune.
Et les tissus de vertu.
D'après « Le Loup et l'Homme »
Philippe Beck, Chants populaires, Flammarion,
2007, p. 85-86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, chants populaires, bête, homme, technique | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2013
Philippe Beck, Élégies Hé

46
à Yves di Manno
Les soupirs vigoureux
sont pleins d'idéalités refusées.
Comédier, c'est-à-dire pleurer
et raisonner,
permet l'élégie qui apprend.
À moitié tragédier et élégier,
ou lier les deux verbes
par l'observation des cris idéalisés,
c'est-à-dire enseigner.
Double satirisation
de l'élan idyllique.
Satirisation mouillée,
et s. bien séchée ensuite.
Alors, les personnages romantiques,
les p.,
sont des éventails au soleil.
L'air est plein de Cendre de la Dispersion.
Nous la respirons.
Les signes d'âpreté sont dans le front.
Bise vérifie
le camaïeu délicieux.
Philippe Beck, Élégies Hé, Théâtre typographique,
2005, p. 60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, Élégies hé, enseigner, satire, romantique | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2013
Philippe Beck, Poésies didactiques

27. Recension
La recension
qui est un acte de courage
involontaire souvent
est un complément du livre
qui est un acte etc.
Beaucoup d'ouvrages
n'ont pas besoin d'articles ;
mais il faut qu'ils apparaissent
dans la société civile. On les
diffuse.
Ils contiennent déjà
la recension,
et les notes, cachées
visibles, ou
gigognes,
raisonnent
serrées, des ostentations.
Elles renferment (ouvrent
au dedans de la bouche
qui ne peut pas se taire)
des expériences
que résume la littérature.
Car l'expérience
a envie d'un ton.
Les recensions devraient
avoir toujours un ton.
(Un flambeau de mélèze
a ses recensions
pareil.)
Le ton est atmosphérique.
Au soleil.
Philippe Beck, Poésies didactiques, Théâtre
typographique, 2001, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, poésies didactiques, livre, diffusion | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2013
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Pour un art poétique
Prenez un mot prenez-en deux
faites les cuir (1) comme des œufs
prenez un petit bot de sens
puis un grand morceau d'innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et puis mettez les voiles
où voulez-vous en venir ?
À écrire
Vraiment ? à écrire ?
(1) "cuir" pour le compte des syllabes
*
Encore l'art po
C'est mon po — c'est mon po — mon poème
Que je veux — que je veux — éditer
Ah je l'ai — ah je l'ai — ah je l'aime
Mon popo — mon popo — mon pommier
Oui mon po — oui mon po — mon poème
C'est à pro — c'est à propos — d'un pommier
Car je l'ai — car je l'ai — car je l'aime
Mon popo — mon popo — mon pommier
Il donn' des — il donn' des — des poèmes
Mon popo — mon popo — mon pommier
C'est pour ça — c'est pour ça — que je l'aime
La popo— la popomme — au pommier
Je la sucre — et j'y mets — de la crème
Sur la po — la popomme — au pommier
Et ça vaut — ça vaut bien — le poème
Que je vais — que je vais — éditer
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,
dans Œuvres complètes I, édition établie par
Claude Debon, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1989, p. 270-271.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond quenau, le chien à la mandoline, art poétique, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2013
Raymond Queneau, Le chien à la mandoline — L'instant fatal

Les dimanches haïs favorisent
la poésie
Que faire en ce jour plein de nuages ?
Le marché aux puces est si loin
Je pourrais essayer la nage
Et m'aller coucher dans le foin
Cécile a mis ses grands gants noirs
Pour se rendre à la messe noire
Adolphe a mis ses souliers blancs
Pour monter sur l'éléphant blanc
Que faire en ce jour plein de nuages ?
La mairie est sans doute fermée
On se promène plein de rage
Sur le boulevard encombré
Madeleine a vu dans un coin
Une réserve de bananes
Elle s'empiffre à rendre l'âme
Onésiphore est son copain
Que faire en ce jour plein de nuages ?
Écrire un poème peut-être
Cela présente l'avantage
De cultiver les belles-lettres
*
Tant de sueur humaine
Tant de sueur humaine
tant de sang gâté
tant de mains usées
tant de chaînes
tant de dents brisées
tant de haines
tant d'yeux éberlués
tant de faridondaines
tant de turlutaines
tant de curés
tant de guerres et tant de paix
tant de diplomates et tant de capitaines
tant de rois et tant de reines
tant d'as et tant de valets
tant de pleurs tant de regrets
tant de malheurs et tant de peines
tant de vies à perdre haleine
tant de roues et tant de gibets
tant de supplices délectés
tant de roues et tant de gibets
tant de vies à perdre haleine
tant de malheurs et tant de peines
tant de pleurs tant de regrets
tans d'as et tant de valets
tant de rois et tant de reines
tant de diplomates et tant de capitaines
tant de guerres et tant de paix
tant de curés
tant de turlutaines
tant de faridondaines
tant d'yeux éberlués
tant de haines
tant de dents brisées
tant de chaînes
tant de mains usées
tans de sang gâté
tant de sueur humaine
Raymond Queneau, Œuvres complètes I, édition
établie par Claude Debon, Bibliothèque de la
Pléiade, Gallimard, 1989, p. 271(Le chien
à la mandoline), 136-137 (L'instant fatal).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, l'instant fatal, dimanche, poème, sueur humaine | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2013
Paul Éluard, La rose publique

Passer le temps
Un enfant grimpe à l'homme
Qui dit jeune dit seul
Comme une page blanche
Puisque tout a la forme de la nouveauté
Un enfant retentit du cri commun aux solitaires
Engagés douloureusement
Sur de longues artères d'ombre
Il prend soin de crier
Mais son œil est pareil à cette bouche de froid
[qu'on n'entend pas exploser
Pareil à cette bombe de larmes qu'on ne voit
[pas couler
Pluie espérée pluie en puissance
Grande pluie meurtrière
Des blés cassants comme des cruches
Sur mes colères
J'ignore toujours mon destin
Fillette aux seins de soie
Ai-je vieilli
Midi minuit
je m'endors je m'éveille
En caressant tout doucement
Une bonne loutre vertueuse
Qui résiste à tous les poisons.
Paul Éluard, La rose publique, dans Œuvres I, édition
établie et annotée par Marcelle Dumas et Lucien
Scheler, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968,
p. 434-435.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, la rose publique, enfance, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2013
Robert Desnos, Sirène Anémone, dans Domaine public

Sirène Anémone
Qui donc pourrait me voir
Moi la flamme étrangère
L'anémone du soir
Fleurit sous mes fougères
Ô fougères mes mains
Hors l'armure brisée
Sur le bord des chemins
En ordre sont dressées
Et la nuit s'exagère
Au brasier de la rouille
Tandis que les fougères
Vont aux écrins de houille
L'anémone des cieux
Fleurit sur mes parterres
Fleurit encore aux yeux
À l'ombre des paupières
Anémone des nuits
Qui plonge ses racines
Dans l'eau creuse des puits
Aux ténèbres des mines
Poseraient-ils leurs pieds
Sur le chemin sonore
Où se niche l'acier
Aux ailes de phosphore
Verraient-ils les mineurs
Constellés d'anthracite
Paraître l'astre en fleur
Dans un ciel en faillite
En cet astre qui luit
S'incarne la sirène
L'anémone des nuits
Fleurit sur son domaine
Alors que s'ébranlaient avec des cris d'orage
Les puissances Vertige au verger des éclairs
La sirène dardée à la proue d'un sillage
Vers la lune chanta la romance de fer
[...]
Robert Desnos, Sirène Anémone, dans Domaine public,
"Le Point du jour", Gallimard, 1953, p. 155-156.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, sirène anémone, dans domaine public, fleur, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2013
Albert Camus, Carnets I, mars 1935-février 1942

mars 1936
Si le temps coule si vite, c'est qu'on n'y répand pas de points de repères. Ainsi de la lune au zénith et à l'horizon. C'est pourquoi ces années de jeunesse sont si longues parce que si pleines, années de vieillesse si courtes parce que déjà constituées. Remarquer par exemple qu'il est presque impossible de regarder une aiguille tourner cinq minutes sur un cadran tant la chose est longue et exaspérante.
mai 1936
Et les voilà qui meuglent : je suis immoraliste.
Traduction : j'ai besoin de me donner une morale. Avoue-le donc, imbécile. Moi aussi.
Intellectuel ? Oui. Et ne jamais renier. Intellectuel = celui qui se dédouble. Ça me plaît. Je suis content d'être les deux. "Si ça peut s'unir ?" Question pratique. Il faut s'y mettre. "Je méprise l'intelligence" signifie en réalité : je ne peux supporter mes doutes".
avril 1937
Le besoin d'avoir raison, marque d'esprit vulgaire.
juin 1937
Combat tragique du monde souffrant. Futilité du problème de l'immortalité. Ce qui nous intéresse, c'est notre destinée, oui. Mais non pas "après, "avant".
Albert Camus, Carnets I, mai 1935-février 1942, Folio / Gallimard, 2013 [1962], p. 24, 33, 33, 39, 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets i, temps, morale, intellectuel, immortalité | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2013
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se mheurt [sic]
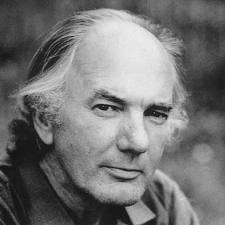
(...) Tant que nous avons vécu chez nos parents, nous étions en réalité enfermés dans deux cachots, et lorsque l'un de nous croyait être enfermé dans le cachot le plus terrible des deux, l'autre avait tôt fait de le détromper en rapportant que le sien était bien plus terrible. Les maisons familiales sont toujours des cachots, rares sont ceux qui parviennent à s'en évader, lui dis-je, la majorité, c'est-à-dire quelque chose comme quatre-vingt-dix-huit pour cent, je pense, reste enfermée à vie dans ce cachot, où elle est minée jusqu'à l'anéantissement, jusqu'à mourir entre ses murs. Mais moi, je me suis évadé, lui dis-je, à l'âge de seize ans je me suis évadé de ce cachot, et depuis je suis en fuite. Ses parents m'avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être cruels, tandis que, réciproquement, les miens lui avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être atroces. Lorsque nous nous retrouvions à mi-chemin entre nos maisons parentales, lui dis-je, sur le banc à l'ombre de l'if, je ne sais plus si tu t'en souviens, nous parlions chaque fois de nos cachots familiaux et de l'impossibilité d'y échapper, nous échafaudions des plans, uniquement pour les rejeter aussitôt comme totalement chimériques, sans cesse nous évoquions le renforcement continu du mécanisme répressif de nos parents, contre lequel il n'y avait aucun remède.
[...]
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se meurt, récits, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, Gallimard, p. 11-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, retrouvailles, goethe se mheurt, parent, haine | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2013
Emmanuel Laugier, ltmw

XX
La douceur du voir est allongement
aux bras que tu passes
rien ne s'ajoute
le ça le calme de la citerne
le velours des feuilles du plaqueminier
n'y sont que subalterne idée de repos
*
XXI
letters to my wife virevoltent
sur un torse nu
de quelques branches basses consolées
*
XXII
émi en contre-plongée fait son cinéma
en plans rapprochés
doucement sa tête tourne
léger est l'ovale qui perce ses lèvres
dans le presque abandon
et si je me laisse voir
autant que elle me serre
entre ses jambes hautes
ne cesse de jouer satie pour nous qui passons
*
XXIII
je reviens aux lèvres d'émi
descriptif pas imaginable de l'enchanteur
elle regarde bras ouverts en v
mais que me dit-elle vraiment : de ses deux lèvres
ouvertes l'à peine sourire
ne parle pas
ainsi le ravin d'herbe verte se couche
il faut courir avant tout et rouler dans le revoir
d'un « verbe à cheval »
Emmanuel Laugier, ltmw, NOUS, 2013, p. 28-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, ltmw, lettres à ma femme, satie, "verbe à cheval" (mandelstam) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2013
Christine Caillon, Kikie Crêvecœur, Autobiographie en arbres

Bernini, Apollon et Daphné
il y a la taille mince du cyprès
les glands du chêne
noirs
gommeux
la peau de Daphné avant le laurier
me paradis perdu — paraît-il —
un jardin
il y a la fleur de grenadier
la gouge rouge
qui éclate et défigure comme
un vœu —
on peut toujours rêver
il y a le grenadier — toujours lui
comme un champ de coquelicots
en plein ciel
mais la pointe assassine
par-delà le bois de promesse
j'entends les bancs les charpentes,
les feuilles, ma feuille — les forêts d'allées de bois
il y a la pierre pour soulever le sol — voir
sentir — griffer —
entailler l'arbre
pour faire du temps autre chose que du vent
l'idée d'arbre commence par la forme
pour la comprendre
il faut la couvrir d'empreintes, la sentir,
le nez à la place des mains
il faut humer son regard
c'est la seule façon
jusqu'où sommes nous capables de ne pas
voir
Christine Caillon, Kikie Crêvecœur, Autobiographie
en arbres, préface de Jean-Louis Giovannoni, La
Pierre d'Alun, 2013, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine caillon, kikie crêvecœur, autobiographie en arbres, jean-louis govannoni, cyprès, chêne, grenadier | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2013
Henri Michaux, Connaissance par les gouffres

I. Comment agissent les drogues
Les drogues nous ennuient avec leur paradis.
Qu'elles nous donnent plutôt un peu de savoir.
Nous ne sommes pas un siècle à paradis.
Toute drogue modifie vos appuis. L'appui que vous preniez sur vos sens, l'appui que vos sens prenaient sur le monde, l'appui que vous preniez sur votre impression générale. Ils cèdent. Une vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tut bizarre, une complexe, continuelle redistribution de la sensibilité. Vous sentez moins ici et davantage là. Où « ici» ? Où « là » ? Dans des dizaines d'« ici», dans des dizaines de « là », que vous ne vous connaissiez pas, que vous ne reconnaissez pas. Zones obscures qui étaient claires. Zones légères qui étaient lourdes. Ce n'est plus à vous que vous aboutissez, et la réalité, les objets mêmes, perdent leur asse et leur raideur, cessent d'opposer une résistance sérieuse à l'omniprésente mobilité transformatrice.
Des abandons paraissent, de petits (la drogue vous chatouille d'abandons), de grands aussi. Certains s'y plaisent. Paradis, c'est-à-dire abandon. Vous subissez de multiples, de différentes invitations à lâcher... Voilà ce que les drogues fortes ont en commun et aussi que c'est toujours le cerveau qui prend les coups, qui observe ses coulisses, ses ficelles, qui joue petit et grand jeu, et qui, ensuite, prend du recul, un singulier recul.
Henri Michaux, Connaissance par les gouffres (1967), dans Œvvres poétiques, III, édition établie par Raymond Bellour et Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 3.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, connaissance par les gouffres, drogue, paradis | ![]() Facebook |
Facebook |






