17/09/2013
Guido Ceronetti, Une poignée d'apparences

Le bon hôtel
«Vous avez une chambre ? » Une chambre La question paraît complètement absurde puisqu'un hôtel est fait de chambres et ne vend que des chambres. Mais, souvent, la réponse déconcertante de l'endroit fait uniquement de chambres est « Nous n'avons pas de chambres. » Le sous-entendu permanent : de chambres libres, supprime l'absurdité. La liberté de la chambre, peut-être, est tue à cause de son inconvenance.
La recherche d'une chambre libre — vide d'habitants visibles et cependant magiquement préparée pour les recevoir — force les clients à une espèce d'intimité désagréable avec l'inconnu qui sous un pompeux reliquaire de clés numérotées représente les chambres libres et occupées de l'hôtel. Il ne vous défend rien, il est même là pour vous permettre tout, mais tout, bonheurs misérables et repos dépend de son jugement préliminaire, de son autorisation muette. La gêne serait grande s'il ne s'agissait d'un cérémonial, d'un rapport irréel, figé dans une impassibilité bureaucratique, et cependant légèrement voluptueux, car il donne accès à une obscurité, à un risque.
Remplir la fiche, comme c'est l'usage hors d'Italie, ou remettre une pièce d'identité, sont des actes de reddition capitaux au Soupçon universel afin de pouvoir prendre possession de la chambre désirée. Un anarchiste belge me racontait sa fureur quand, arrivé à Barcelone en 1936 pour faire la révolution, le concierge de l'hôtel lui demanda, glacial, son passeport : « Un passeport ? en Espagne ? Le voici mon passeport : la carte des Organisations. » Mais la religion des passeports n'avait pas été brûlée vive le 19 juillet : à l'hôtel, son temple et son repaire, elle se riait des révolutions.
Guido Ceronetti, Une poignée d'apparences, traduction André Maugé, Albin Michel, 1988, p. 56-57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guido ceronetti, une poignée d'apparences, le bon hôtel, passeport | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2013
Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu'un qui lit à haute voix, ce n'est ps la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t'arrêter, ou survoler les phrases : c'est toi qui décides du rythme. Quand c'est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va trop vite ou trop lentement.
Si, en plus, le lecteur traduit, il s'ensuit une zone de flottement, d'hésitation autour des mots, une marge d'incertitude et d'improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu'il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose qui existe et qui n'existe pas, une chose que tu n'arrives pas à toucher.
Qui plus est, le professeur Uzzi-Tuzzi s'était engagé dans sa traduction comme s'il n'était pas bien sûr de l'enchaînement des mots les uns avec les autres, revenant sur chaque période pour en remettre en place des mèches syntaxiques, tripotant les phrases jusqu'à ce qu'elles soient complètement froissées, les chiffonnant, les rafistolant, s'arrêtant sur chaque vocable pour en expliquer les usages idiomatiques et connotations, s'accompagnant de gestes enveloppants comme pour m'inviter à me contenter d'équivalences approximatives, s'interrompant pour énoncer règles grammaticales, dérivations étymologiques et citations des classiques. Et puis, lorsque tu t'es enfin convaincu que la philologie et l'érudition tiennent plus à cœur au professeur que le déroulement du récit, tu constates que c'est tout le contraire : l'enveloppe universitaire n'est là que pour protéger ce que le récit dit et ne dit pas, son souffle intérieur toujours sur le point de se disperser au contact de l'air.
Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, traduction Danielle Sallenave et François Wahl, Seuil, 1981.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, lecture, récit | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2013
Umberto Saba, Couleur du temps

Le ghetto de Trieste
Vers 1860, le ghetto de Trieste était encore dans la floraison de ses dégoutantes origines. Mis depuis un demi siècle au même niveau que les autres citoyens, affranchis de gabelles particulières et de traitements spécifiques humiliants, les Juifs nés ou émigrés dans la ville franche n'avaient pas tous appris à vaincre une méfiance congénitale à mêler leur vie quotidienne à celle des "goy" qu'ils redoutaient (et donc détestaient). Cette aversion, qui n'était pas religieuse, et que, nulle part où elle existe, le baptême n'efface, car elle est enracinée en eux par des millénaires de persécutions et de quarantaines, retenait même quelques familles, assez aisées pour habiter une maison neuve dans une rue nouvelle, dans la "citadelle" où leurs vieux parents avaient exercé et exerçaient le métier de brocanteur, puisant dans leurs capharnaüms pittoresques, leur force. Les maisons neuves, construites comme un excellent investissement de capitaux pour riches veuves, et ceux qui craignaient de plus grands risques, étaient, c'est vrai, le rêve de beaucoup : mais, après les avoir acquises pour spéculer, les nouveaux propriétaires continuaient, en ce qui les concernait, à habiter dans ce ghetto bien-aimé, à leurs yeux empli d'intimités et de souvenirs. En vertu de la tradition et par la force d'inertie d'une habitude mentale devenue, comme une quelconque idée fixe, un poids plus difficile à décharger qu'à porter.
Umberto Saba, Couleur du temps, traduction René de Ceccatti, Rivages, 1989, p. 139-140.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, couleur du temps, ghetto juif, trieste | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2013
Tommaso Landolfi, La femme de Gogol et autre récits

La femme de Gogol
Au moment que se présente à moi le problème embrouillé de la femme de Nicolas Vassiliévitch, je suis pris d'hésitation. Ai-je le droit de révéler ce qui n'est connu de personne, ce que mon inoubliable ami lui-même (et il avait ses bonnes raisons) voulait cacher à tout le monde, ce qui, dis-je, ne saurait donner matière qu'aux plus perfides et balourdes interprétations — sans compter que cela va peut-être offenser des foisons d'âmes cléricalement et sordidement hypocrites, et quelque âme vraiment pure aussi, pourquoi pas, à condition qu'il s'en trouve encore une ? Ai-je le droit par ailleurs, de révéler une chose devant laquelle mon propre jugement recule, quand il ne prend pas, de façon plus ou moins avouée, le parti de la réprobation ? Comme biographe, cependant, mes devoirs sont précis. Je crois que tout renseignement sur le cas d'un homme si extraordinaire devrait être précieux tant aux générations futures qu'à la nôtre, et je ne voudrais pas confier à un jugement frivole, autrement dit masquer, ce qui n'a pas la moindre chance d'être sainement jugé avant la fin des temps. En vérité, nous permettrons-nous de condamner, nous autres ? Serait-ce donc qu'il nous fut donné de connaître les nécessités intimes et encore les fins d'utilité générale et supérieure auxquelles répondaient les actions de tels hommes extraordinaires, qui ont eu la mésaventure de nous paraître vils ? Certes non, car à ces natures privilégiées nous n'avons jamais rien compris. « C'est vrai, disait un grand homme, je fais pipi moi aussi, mais pour toute autre raison ! »
[...]
Tommaso Landolfi, La femme de Gogol et autre récits, présentés par André Pieyre de Mandiargues (traducteur de cette nouvelle), Gallimard, 1969, p. 17-18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tommaso landolfi, la femme de gogol et autre récits | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2013
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves)

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à une vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), jean-baptiste para, fantastique, humour, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2013
Primo Levi, À une heure incertaine

12 juillet 1980
Prends patience, ma femme, ma femme fatiguée,
Prends patience à l'égard des choses de ce monde,
Et de tes compagnons de route, dont je suis,
Dès lors qu'il t'est échu de m'avoir en partage.
Accepte, au bout de tant d'années, ces quelques vers grincheux,
Pour l'accomplissement de ton anniversaire.
Prends patience, ma femme impatiente,
Toi, broyée, macérée, écorchée,
Et qui t'écorches un peu toi-même chaque jour
Pour que la chair à vif te fasse un peu plus mal.
Il n'est plus temps de vivre seuls.
Accepte, s'il te plaît, là, ces quatorze vers,
C'est ma façon bourrue de te dire chérie,
Et que je ne saurais, sans toi, rester au monde.
Primo Levi, À une heure incertaine, traduction Louis Bonalumi, préface de Jorge Semprun, "Arcades", Gallimard, 1997, p. 60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : primo levi, À une heure incertaine, femme, anniversaire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2013
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Au feu, à l'étang, le visage couleur de la nuit,
odeur de la journée, le visage d'innocente,
de pourpre fleur, de garçon livide, de porc
blanc, de poisson roi, de sale enfant,
qui criait, au feu, à l'étang, au sumac,
à la saveur des baies et des tiges,
la morte répandue, la rose éparpillée, la salie,
tout au feu, à l'étang, les draps, les nuages autour
de la cheminée, même le héros, le premier parleur
au baiser, le premier loup qui dort, au feu,
à l'étang, au parfum.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit, p. 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, feu, eau, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2013
Émile Verhaeren, Poèmes [Les Soirs - les Débâcles - Les Flambeaux noirs]
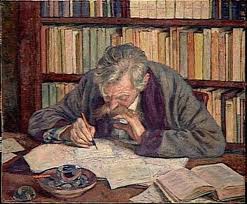
Les villes
Odeurs de suifs, crasses de peaux, marcs de bitumes !
Tel qu'un grand souvenir lourd de rêves, debout
Dans la fumée énorme et jaune, dans les brumes
Et dans le soir, la ville inextricable bout
Et coule, ainsi que des reptiles noirs, ses rues
Noires, autour des ponts, des docks et des hangars,
Comme des gestes fous et des masques hagards
— Batailles d'ombres et d'or — bougent dans les ténèbres.
Un colossal bruit d'eau roule, les nuits, les jours,
Roulent les lents retours et les départs funèbres
De la mer vers la mer et des voiles toujours
Vers les voiles, tandis que d'immenses usines
Indomptables, avec marteaux cassant du fer,
Avec cycles d'acier virant leur gélasines,
Tordent au bord des quais — tels des membres de chair
Écartelés sur des crochets et sur des roues —
Leurs lanières de peine et leurs volants d'ennui,
Au loin, de longs tunnels fumeux, au loin, des boues
Et des gueules d'égout engloutissant la nuit ;
Quand strident tout à coup de cri, stride et s'éraille :
Les trains, voici les trains broyant les ponts,
Les trains qui sont battant le rail et la ferraille,
Qui vont et vont mangés par les sous-sols profonds
Et revomis, là-bas, vers les gares lointaines,
Les trains, là-bas, les trains tumultueux — partis.
Émile Verhaeren, Poèmes [Les Soirs - les Débâcles, Les Flambeaux noirs], Mercure de France, 1920, p. 171-172.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, poèmes, la nuit, les trains, les villes | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2013
William Cliff, Écrasez-le

Chômer
Depuis un mois j'étais chômeur :
j'ai dû m'inscrire rue du Boulet
me présenter rue de l'Escalier
enfin pointer rue Sainte-Catherine.
Pendant un mois j'ai fait la file
sans saluer nombre pédés
qui comme moi ne foutent rien
et vont pointer :
ça suffit à leurs besoins personnels
leur chope au Carroussel
le manger à Sarma
le shampooing du samedi
et le rimmel éventuel.
Certains vieux clous voulaient me tripoter
tout en faisant la file
puis ils disaient merci à l'employée
en reprenant leur carte cachetée.
J'avais l'impression d'être galeux
cherchais de la mystique en amour
(et c'est très mauvais signe).
À quoi je passais mon temps tout le jour ?
Aérer mon grabat et besogner dans ma cuisine.
Mais aujourd'hui on me rappelle à ma fonction sociale
et de nouveau je suis un vrai un pur
je peux dire merde à mes amours sentimentales
et comme un mat dresser mon membre vers l'azur.
William Cliff, Écrasez-le, Gallimard, 1976, p. 89-90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, Écrasez-le, chômer | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2013
Jean-Pierre Verheggen, Pubères, Putains - Porches, Porchers - Stabat mater

Porches, Porchers
I.
Nous détestions les fermes.
Les fermiers.
Replets.
Satisfaits.
Les métayers et leurs ouvriers.
Saisonniers.
Dupés.
Exploités.
Leurs aoûterons.
Leurs tâcherons.
Leurs souillons.
Leur promiscuité.
Acceptée.
Entérinée.
Avalisée.
II.
Nous détestions leurs messiers.
Leurs palefreniers ou valets.
Laquais.
Laids.
Envoyés valdinguer.
Étriller ou faucher.
Aider les faucheurs armés.
Arnachés ou épongés.
Irrelevés.
III.
Nous détestions les travailleurs des champs tout entiers.
Puants.
Infamants.
Paysans.
Les peaussiers.
Plaigneurs.
Quémandeurs.
Les taupiers.
Les faneurs.
Suants. Gagneurs.
Les échardonneurs.
Les échenilleurs.
Les soigneurs attitrés.
Bousés. Bouseux.
Beaucoup trop courageux.
[...]
Jean-Pierre Verheggen, Pubères, Putains - Porches,
Porchers - Stabat mater, Labor, 1991, p. 13 à 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre verheggen, pubères, putains -, porches, porchers - stabat mater, détester | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2013
Norge, Le stupéfait

JE
à Pierre Chabert
Je, c'est qui, c'est moi, c'est eux...
Un épi seul sur sa tige,
C'est vous et c'est eux qui fondent
Dans mille horizons douteux.
Je, c'est amour ou c'est Dieu
Et tout ce qu'il y a d'ange
Dans JE !
Sable et ciel, mais quel vertige
Si tous le JE tout en feu
Si JE,
JE moi seul ou JE nous deux
Si JE
Si JE n'est personne au monde !
*
JE PULLULE
Je grouille, je fuse, j'abonde,
J'éclos, je germe, je racine,
Je ponds, j'envahis, je reponds.
Je me double et puis me décuple
Je suis ici, je suis partout,
Dedans, dehors et au milieu
Dans le sac et dans le liquide
Comme je suis au fond du fer,
Du bois, de l'air et de la chair.
J'ai beau m'annuler, inutile :
Je reviens toujours par-delà,
Je serpente et je papillonne,
J'enfante, fourmille et crustace,
Je me fourre dans toute race,
Pullule, fermente et m'empêtre.
Le néant n e veut pas de moi
Et je lutte à mort avec la
Difficulté de ne pas être.
Norge, Le stupéfait, Gallimard, 1988, p. 35 et 40.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, le stupéfait, je, être, se situer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2013
Nougé, Fragments

La Messagère
(paroles de femme sur petit fond d'orchestre)
Je suis belle
on me l'a dit
je suis laide
on me l'a dit
mais ce n'est pas pour vous
que je le suis
Messieurs Mesdames
N'essayez pas sous cette robe
qui pourrait être de n'importe quelle
couleur
de prévoir les points sensibles d'un
corps qui n'est pas pour vous
ni sous le fard de mes lèvres
le moyen d'une bouche qui
restera pour toujours
et pour moi-même
un secret
ni le sens des reflets de mes yeux
qui seront pour vous
pour toujours
des yeux vides
Nougé, Fragments, éditions Labor, p. 139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nougé, fragments, la messagère, beauté, laideur, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2013
Michel Deguy, Donnant donnant

L'amour est plus fort que la mort disiez-vous
Mais la vie est plus forte que l'amour et
L'indifférence plus forte que la vie — La vie
Mienne ou tienne et nôtre en quelque manière
Est ensemble la seule séquence de métamorphoses
(Le néoténique se mue en héros à sexe
Plus tard en ventru chauve pourrissant comme un dieu)
Et bains-douches au Léthé tous les mois
Et un vieillard muet en nous depuis longtemps
Survit sans douleur au charnier des enfants
40° Ouest 60° Nord
Michel Deguy, Donnant donnant, "Le Chemin", Gallimard, 1981, p. 28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, donnant donnant, l'amour, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2013
Antoine Emaz, De l'air

Rentrée (28.08.04)
la pluie grise moite orage devant
et puis plus rien comme si
ça s'effondrait dedans laissait
comme du sol nu raviné battu
peu à glaner dans cette fatigue
état sans poids attente
et la tête cherche une prise
pour la main
du sable rapporté sous les doigts
la mer maintenant son bruit
loin de ressac et d'écume
dans un entre-deux d'être
un vague
pluie sans sel
glycine dans l'eau trempée
fin de l'orage
tout s'égoutte
Antoine Emaz, De l'air, Le dé bleu,
2000, p. 48.
© photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de l'air, rentrée, pluie, glycine | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2013
Samuel Beckett, Le monde et le pantalon

Le client : Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en six mois.
Le tailleur : Mais monsieur, regardez le monde, et regardez mon pantalon.
Pour commencer, parlons d'autre chose, parlons de doutes anciens, tombés dans l'oubli, ou résorbés dans des choix qui n'en ont cure, dans ce qu'il est convenu d'appeler des chefs-d'œuvre, des navets et des œuvres de mérite.
Doutez d'amateur, bien entendu, d'amateur bien sage, tel que les peintres le rêvent, qui arrive les bras ballants et les bras ballants s'en va, la tête lourde de ce qu'il a cru entrevoir. Quelle rigolade les soucis de l'exécutant, à côté des affres de l'amateur, que notre iconographie de quatre sous a gavé de dates, des périodes, d'écoles, d'influences, et qui sait distinguer, tellement il est sage, entre une gouache et une aquarelle, et qui de temps en temps croit deviner ce qu'il aime, tout en gardant l'esprit ouvert. Car il s'imagine e pauvre, que rien de ce qui ets peinture ne doit lui rester étranger.
Ne parlons pas de la critique proprement dite. La meilleure, celle d'un Fromentin, d'un Grohmann, d'u MacGreevy, d'un Sauerlandt, c'est de l'Amiel. Des hystérotomies à la truelle. Et comment en serait-il autrement ? Peuvent-ils seulement citer ? [...]
Avec les mots on ne fait que se raconter. Eux-mêmes les lexicographes se déboutonnent. Rt jusque dans le confessionnal on se trahit.
Ne pourrait-on attenter à la pudeur ailleurs que sur ces surfaces peintes presque toujours avec amour et souvent avec soin, et qui elles-mêmes sont des aveux ? Il semble que non. Les copulations contre nature sont très cotées, parmi les amateurs du beau et du rare. Il n'y a qu'à s'incliner devant le savoir-vivre.
Achevé, tout neuf, le tableau est lç, un non-sens. Car ce n'est encore qu'un tableau, il ne vit encore que de la vie des lignes et des couleurs, ne s'est offert qu'à son auteur. Rendez-vous compte de sa situation. Il attend, qu'on le sorte de là. Il attend les yeux, les yeux qui, pendant des siècles, car c'est un tableau d'avenir, vont le charger, le noircir, de la seule vie qui compte, celle des bipèdes sans plumes. Il finira par en crever. Peu importe. On le rafistolera. On le rabibochera. On lui cachera le sexe et on lui soutiendra la gorge. On lui foutra un gigot à la place de la fesse, comme on l'a fait pour la Vénus de Giorgione à Dresde. Il connaîtra les caves et les plafonds. On li tombera dessus avec des parapluies et des crachats, comme on l'a fait pour le Lurçat à Dublin. Si c'est une fresque de cinq mètres de haut sur vingt-cinq de large, on l'enfermera dans une serre à tomates, ayant préalablement eu le soin d'en aviser les couleurs avec de l'acide azotique, comme on l'a fait pour le Triomphe de César de Mantegna à Hampton Court. Chaque fois que les Allemands n'auront pas le temps de le déménager, il se transformera en champignon dans un garage abandonné. Si c'est un Judith Leyster, on le donnera à Hals. Si c'est un Giorgione et qu'il soit trop tôt pour le donner encore au Titien, on le donnera à Dosso Dossi (Hanovre). Monsieur Berenson s'expliquera dessus. Il aura vécu, et répandu de la joie.
Samuel Beckett, Le monde et le pantalon, éditions de Minuit, 1989, p.7-8 et 9-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, le monde et le pantalon, tableau, création, critique | ![]() Facebook |
Facebook |





