17/01/2014
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle

et maintenant je voyage de bête en bête partout
ici aussi, juste en face, derrière les grilles, de mon perchoir
le naturaliste a commencé sur le terrain
le naturaliste peut écrire des livres
mais c'est secondaire ;
on peut lui dédier une espèce
mais c'est secondaire ;
il peut entrer sur la toile
mais c'est secondaire
pour le naturaliste,
le sens de la vie
va de la terre à la vue
de la terre au toucher
de la terre à l'esprit
de la terre
à l'image
de la terre
j'ai d'abord fait tout le contraire, même face à la mer
pourtant, ma Mère disait : « par beau temps, ne reste pas [dedans»,
c'est vrai
j'ai connu la garenne de Saint-Martin-des-Champs
et les lapins au cul blanc
j'ai connu la mare aux têtards
et les métamorphoses
j'ai connu les rochers les algues
et la pêche aux bigorneaux
j'ai connu la forêt le petit bois mort
et la construction des cabanes
j'ai connu la plage à marée basse
et les cris des goélands
[...]
Fabienne Raphoz, Terre sentinelle, Dessins Yanna
Andréadis, Héros-Limite, 2014, p. 137-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, terre sentinelle, nature, terre, plage roc | ![]() Facebook |
Facebook |
16/01/2014
Valérie Rouzeau, Neige rien

Conf
Lorsque vous relirez Tacite lorsque vous relirez
(Si on lisait d'abord si on lisait)
Nul n'ignore comme chacun sait
Nous ne reviendrons pas sur le célèbre chapitrou
(Si on venait déjà pour commencer)
Que tout le monde connaît
*
Manœuvres
À l'étroit les trois huit
Virés salaires de rien
Micheline Michelin
Paradis pour demain
Allez toi va-t-en vite
virée ç'a l'air de rien
Micheline Michelin
On te remercie bien
Valérie Rouzeau, Neige rien dans Pas revoir
suivi de Neige rien, La Table ronde, 2010,
p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, neige rien, tacite, travail, salaire | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2014
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes

Dans ce poème
le delta est surchargé
le carbone de l'antarctique
sera déjà épuisé
mes tasses jadis
avaient des anses
dans cet état où je ne peux voir de hérons
de porcs-épics ni non plus de petites taupes mortes sur le sentier
j'ai face à moi quelques lettres à remplir
je ne dois pas les écrire tout a déjà été écrit
chaque ligne chaque phrase le nom et son adjectif
mais il y a quand même des espaces qui seront remplis
des monogrammes de parafes par les archivistes dans notre dos
ce que je vois eux ne le voient pas
ce que je ne comprends pas eux le comprennent
en face il y a le retard non spécifié de la mort
du coin des rues des personnages
du désastre sur les bords
du rétroviseur
masse de marchandises graduée discontinue
qui glisse qui revient qu'on extrait
mais dans le livre des comptes : en croisant
les anciennes données et celles du millimètre
au fond de la courbe descendante
dans les tracés calculés par défaut
même mon sommeil incolore
le filet effrangé des destinations
prend la forme certaine, apaisée
d'un soulagement statistique
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes, à la suite de Lettres à la Réinsertion Culturelle du Chômeur, traduit de l'italien par Stéphane Bouquet,
NOUS, 2013, p. 77-78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea inglese, mes cahiers de poèmes, monde défait, mort, désastre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2014
Eugène Delacroix, Journal
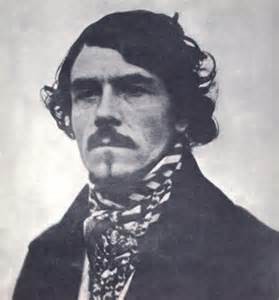
À l'occasion de l'exposition Delacroix en héritage, Autour de la collection d'Étienne Maureau-Nélaton (11 décembre 2013-17 mars 1014 - 6 rue de Furstenberg, 75006),
reprise d'une une note de lecture sur le Journal de Delacroix, publiée en 2009 dans la revue Europe :
Pourquoi commencer la rédaction d'un Journal quand on a 26 ans et que l'on se voue à la peinture ? Dès les première lignes écrites en 1822, Delacroix se fixait un objectif : « Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul ; je serai donc vrai, je l'espère ; j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. ». Le projet de se contrôler, de s'éloigner du monde extérieur pour réfléchir sur le moi, échouera relativement vite puisque la rédaction sera interrompue après trois années et ne sera reprise qu'en 1847. Ce n'est plus alors le même Delacroix qui prend des notes dans des carnets. Il a une œuvre de peintre derrière lui, il a voyagé notamment au Maroc et en Andalousie, il a beaucoup lu, il est devenu selon Baudelaire (Salon de 1846) un « grand artiste, érudit et penseur » et son souci n'est plus de s'interroger sur son identité. Baudelaire encore, rendant compte de l'exposition universelle de 1855, le définissait ainsi : « Il est essentiellement littéraire [...] par l'accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin, et par la dramatique gesticulation de toutes les forces spirituelles vers un point donné ». Ce lien établi entre le littéraire et le pictural est un des motifs récurrents du Journal.
Tourner autour de ce qui distingue la peinture de l'écriture répondait pour Delacroix au projet d'élaborer une écriture de peintre. Michèle Hannoosh analyse précisément en quoi il rompt avec les idées dominantes ; elle résume la théorisation faite au XVIIIe siècle par Lessing, pour qui la « temporalité de la littérature permet la narrativité, la causalité et donc l'unité » alors que la peinture, entière devant le spectateur, ne pourrait engendrer que des impressions confuses et sans ordre. Pour Delacroix, au contraire, le tableau donne en même temps la vue de la réalité et sa représentation expressive, ce qui provoque « une perception unie de la matière et de l'esprit », idée que souligne M. Hannoosh. Ces réflexions de Delacroix ont des rapports avec la manière dont il rédige son Journal. L'éditrice décrit les manuscrits comme un « document complexe, hybride, chaotique, labyrinthique » ; c'est que la construction du Journal donne au lecteur cette liberté qu'il a devant un tableau, sans suivre les règles d'un genre, règles vigoureusement rejetées dans tous les domaines : « Sur la ridicule délimitation des genres. Rétrécit l'esprit. L'homme qui ne fait que le trou d'une aiguille toute sa vie ».
Lisant le Journal, on se repère dans le temps grâce aux dates de rédaction, mais la chronologie est très souvent en défaut dans la mesure où Delacroix laisse parfois plusieurs jours entre ce qu'il a vécu et l'écriture, et introduit dans son texte des documents (listes d'adresses, coupures de journaux, billets de chemin de fer, etc.), traces de la vie quotidienne à côté de ses développements sur son travail de peintre, sur ses rencontres, sur les événements. En outre, il renvoie régulièrement à un autre endroit de ses carnets, n'hésite pas à modifier ce qui a été écrit plusieurs mois auparavant et à le commenter.
Ces pratiques brisent la narrativité et construisent une temporalité complexe ; éloignées de l'écriture habituelle du journal intime, elles aboutissent à multiplier les points de vue du lecteur, ce qui répond à l'idéal de Delacroix, qui notait qu'« Un homme d'esprit sain conçoit toutes les possibilités, sait se mettre, ou se met à son insu, à tous les points de vue ». Défendant sans cesse, à l'exemple de Montaigne, le caprice de la pensée, la nécessité de prendre en compte le caractère divers de l'esprit, il affirmait en moraliste « Il y a dix hommes dans un homme, et souvent ils se montrent dans la même heure ». En outre, la réécriture de notes font du passé un matériau qu'il est possible d'utiliser dans le présent. La chronologie devient relative, ce qui importe alors est de penser un temps souple, sujet à variation : la continuité temporelle — c'est-à-dire la croyance au progrès ou à la décadence — est exclue, et Delacroix affirme à diverses reprises « la nécessité du changement. Il faut changer : Nil in codem statu permanent ».
Ce point de vue implique que l'activité intellectuelle occupe une place importante. Certes, Delacroix vivait dans l'institution, fréquentait les cercles officiels, appartenait au Conseil municipal de Paris, mais il allait aussi au concert, à l'opéra, au théâtre, lisait ses contemporains, français (Baudelaire, Sand, Balzac) ou non (Dickens, Poe, Tourgueniev), recopiait des extraits, et il écrivait « Je me suis dit et ne puis assez me le redire pour mon repos et pour mon bonheur — l'un et l'autre sont une même chose — que je ne puis et ne dois vivre que par l'esprit ; la nourriture qu'il demande est plus nécessaire à ma vie que celle qu'il faut à mon corps. » Noter ses impressions, c'est en les approfondissant développer ses idées, non pas pour "inventer" du nouveau, mais pour comprendre comment les exprimer de manière nouvelle. Cette vie de l'esprit a parallèlement un autre rôle, souvent souligné dans le Journal, lutter contre l'ennui ; Delacroix vit dans le siècle du chemin de fer, qui réduit les distances et fait "gagner" du temps, ce qui ne change rien au sentiment d'ennui que beaucoup éprouvent. Ces lignes de 1854, « Nous marchons vers cet heureux temps qui aura supprimé l'espace, mais qui n'aura pas supprimé l'ennui », font écho à cet aveu de 1824, « Ce qui fait le tourment de mon âme, c'est la solitude ».
Écrire, c'est retenir ce qui est vite perdu, la mémoire ne pouvant tout emmagasiner ; un tri s'opère et la plus grande partie de ce qui est vécu, éprouvé, sombre dans l'oubli. Delacroix note à plusieurs reprises l'intérêt de pallier la faiblesse de la mémoire — « Il me semble que ces brimborions écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu'elle s'écoule ». Ne rien avoir noté, c'est n'avoir pas existé... C'est la mémoire du Journal qui établit une continuité en fixant ce qui est par nature éphémère, l'expérience du temps, notre « passage d'un moment ». Pour le lecteur d'aujourd'hui, le Journal de Delacroix ne fait pas que livrer le visage d'un peintre, il est aussi un tableau varié et complexe, sans doute partial et lacunaire (et intéressant pour cette raison), de la vie de la bourgeoisie et de milieux intellectuels au XIXe siècle. Il est aussi très souvent l'ouvrage d'un moraliste, sans complaisance pour lui-même et sans illusion sur ses contemporains ; même s'il devient plus mesuré avec l'âge, il ne varie guère dans le jugement noté en 1824 : « Le genre humain est une vilaine porcherie ».
Au Journal proprement dit, l'éditrice a ajouté une masse considérable de textes, qui donnent un éclairage indispensable pour la connaissance de Delacroix. Pendant la rupture d'un peu plus de vingt ans — interrompu en 1824, le Journal ne reprend qu'en 1847— sont écrites les pages du "Voyage au Maghreb et en Andalousie" et de très nombreux textes qui prolongent les réflexions du peintre : carnets et notes variées sur des peintres, des voyages, des lectures, des expositions, carnets et notes parallèles ensuite à la rédaction du journal jusqu'à la mort en 1863. Des pages de Pierre Andrieu, principal assistant de Delacroix et qui joua un rôle important dans la conservation du Journal, rapportent des propos du peintre. Outre les variantes du Journal (dont on connaît plusieurs copies), Michèle Hannoosh a préparé une série d'annexes qui font désormais de cette édition un grand ouvrage de référence, avec notamment un imposant répertoire biographique, un index des œuvres de Delacroix, un autre des noms de personnes, une bibliographie qui complète les indications données dans les notes. Les notes, quant à elles, abondantes et précises, apportent toutes les renseignements nécessaires à la compréhension d'une époque.
Eugène Delacroix, Journal, nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh, 2 tomes, José Corti, 2009.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène delacroix, journal, moraliste, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2014
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot

Comment pourrais-je devenir poète ?
Comment pourrais-je écrire en rimes ?
Un jour vous m'avez dit : « Ce souhait-là lui-même
Participe du sublime ».
Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas
Avec votre « plus tard » ! »
Le vieil homme sourit de le voir,
D'entendre sa sortie soudaine ;
Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur
Avec enthousiasme ;
Et songea : « Il n'y a rien en lui
De tiède ni d'irrésolu.
« Et prétendriez-vous devenir poète
Avant d'être allé à l'école ?
Et bien ! Je n'aurais jamais cru
Que vous fussiez un sot aussi parfait.
Tout d'abord apprenez à être spasmodique —
Règle très simple.
Vous commencez par écrire une phrase ;
Ensuite vous la hachez menu ;
Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort
Strictement au petit bonheur :
L'ordre des mots
Est tout à fait indifférent.
Si vous voulez faire impression,
Rappelez-vous ce que je dis :
Ces qualités abstraites commencent
Toujours par des capitales :
Le Vrai, le Bien, le Beau —
Voilà les choses qui paient !
Ensuite, lorsque vous décrivez
Une forme, une couleur ou un son,
N'exposez pas l'affaire clairement,
Mais glissez-la dans une allusion ;
Et apprenez à regarder toute chose
Avec une sorte de strabisme mental.
« Par exemple, si je veux, Monsieur,
Parler de pâtés de mouton,
Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons
Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »
« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase
Conviendra parfaitement.
Quatrièmement, il y a des épithètes
Qui vont avec n'importe quel mot —
Tout comme la Sauce Harvey Reading
Avec poisson, viande ou volaille —
Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,
Sont spécialement recommandables. »
« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il
Si je les utilise en masse —
Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las
Vers une étrange et solitaire pompe » ? »
« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,
Sauter sur de pareilles conclusions.
De telles épithètes, comme le poivre,
Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,
Et, si vous en usez avec ménagement,
Elles aiguisent l'appétit :
Par contre, si vous en mettez trop,
Vous gâtez l'affaire complètement.
Enfin, pour ce qui est de la composition :
Votre lecteur, il faut le lui montrer,
Doit prendre les renseignements qu'on lui donne
Et ne compter sur aucune
Divulgation prématurée des tendances
Et desseins de votre poème.
Donc, pour éprouver sa patience —
Savoir ce qu'il peut supporter —
Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,
Et assurez-vous, en tout cas,
Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,
D'une obscurité compacte.
Fixez d'abord les limites
Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :
Puis complétez, avec du "remplissage"
(Demandez à quelque ami) :
Votre grande STROPHE-À-SENSATION,
Vous la placez vers la fin. »
« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,
Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?
Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,
Entendu ce mot employé de la sorte :
Ayez la bonté d'en citer une seule,
« Exempli gratia ». »
Et le vieil homme, regardant tristement
À travers la pelouse du jardin,
Où çà et là une goutte de rosée
Étincelait encore dans l'aube
Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",
Et voyez le "Colleen Bawn".
Le mot est dû à Boucicault —
La théorie est sienne ;
Au point où la vie devient un spasme,
Et l'Histoire un Sifflement :
Si cela n'est pas de la Sensation
Je ne sais pas ce que c'est.
Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie
Aura perdu son présent éclat — »
« Et alors », ajouta son petit-fils,
« Nous publierons ça, n'est-ce pas :
Couverture verte — lettres dorées au dos —
En in-douze ! »
Et le vieil homme sourit fièrement
De voir l'ardent garçon
Se ruer follement sur son encre et sa plume
Et son papier buvard —
Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication
Son visage devient grave et triste.
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, traduit par henri parisot, devenir poère | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2014
Paul Celan, Pavot et mémoire,

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Louange du lointain
À la source de tes yeux
vivent les filets des pêcheurs d'eaux folles.
À la source de tes yeux
la mer tient sa promesse.
Je jette là
un cœur qui a vécu parmi les hommes,
jette bas mes vêtements et l'éclat d'un serment :
Plus noir dans le noir je suis plus nu.
Infidèle seulement je suis fidèle.
Je suis tu quand je suis je.
À la source de tes yeux
je suis emporté et je rêve de rapine.
Un filet a pêché un filet :
nous nous séparons enlacés.
À la source de tes yeux
un pendu étrangle sa corde.
Lob der Ferne
Im Quell deiner Augen
leben die Garne der Fischer der Irrsee.
Im Quell deiner Augen
hält das Meer sein Versprechen.
Hier werf ich,
ein Herz, das gewellt unter Menschen,
die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures :
Schwärzer im Schwarz, bin ich nackter.
Abtrünnig esrt bin ich treu.
Ich bin du, wenn ich ich bin.
Im Quell deiner Augen
treib ich und träume von Raub.
Ein Garn fing ein Garn ein :
wir scheiden umschlungen.
Im Quell deiner Augen
erwürgt ein Gehenkter den Strang.
Paul Celan, Pavot et mémoire, traduction de Valérie
Briet, Christian Bourgois, 1987, p. 69 et 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, pavot et mémoire, amour, yeux, toi, promesse | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2014
Paul Celan, Poèmes, traduction de John E. Jackson

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Psaume
Personne ne nous pétrira plus de terre et d'argile,
personne ne conjurera notre poudre.
Personne.
Loué sois-tu, Personne.
Par amour de toi nous
voulons fleurir.
Vers
Toi.
Un rien
étions-nous, sommes-nous, resterons-
nous, fleurissant :
la rose de Rien, la
rose de Personne.
Avec
le style clair d'âme,
l'étamine ciel-désert,
la corolle rouge
du mot-pourpre que nous chantions
par-dessus, ô par-dessus
l'épine.
Psalm
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend :
die Nichts-, die
Niemandsrose
Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.
Paul Celan, Poèmes, traduction de John E. Jackson,
éditions Unes, 1987, p. 37 et 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, poèmes, traduction de john e. jackson, personne, rose, rouge | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2014
Paul Celan, Voix /Stimmen, traduction Martine Broda

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Voix venues du chemin d'orties :
Viens à nous sur les mains.
Qui est seul avec la lampe,
pour y lire, n'a que sa main.
Stimmen vom Nesselweg her :
Komm auf den Händen zu uns.
Wer mit der Lampe allein ist,
hat nur die Hand, draus zu lessen.
Paul Celan, Voix /Stimmen, traduction
Martine Broda, Lettres de Casse,
1984, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, voix stimmen, traduction martine broda, ortie, lampe, main | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2014
Paul Celan, Partie de neige

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan,
À ton ombre, à ton
ombre toute mal-sonnée aussi,
j'ai donné sa chance.
elle, elle aussi
je l'ai lapidée à coups de moi-même,
moi le droit-ombré, droit
sonné —
étoile à six branches
à laquelle tu as
adonné ton silence.
aujourd'hui
adonne ce silence où tu veux,
catapultant du sous-sacralisé par l'époque,
depuis longtemps, moi aussi, dans la rue,
je sors, pour n'accueillir aucun cœur,
jusque chez moi dans le pierreux-
multiple.
Deinem, aux deinem
fehldurchläuteten Schatten
gab ich die Chance.
ihn, auch ihn
besteinigt ich mit mir
Gradgeschattetern, Grad-
geläutetem — ein
Schsstern,
dem du dich hinschwiegst,
heute
schweig dich, wohin du magst,
Zeitunterheligtes schleudernd,
längst, auch ich, auf der Straße,
tret ich, kein Herz zu empfangen,
zu mir ins Steinig-Viele
hinaus.
Paul Celan, Partie de neige, édition bilingue,
traduit de l'allemand et annoté par Jean-Pierre
Lefebvre, Seuil, 2007, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, partie de neige, étoile, amour, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2014
Paul Celan, Poèmes, traduction André du Bouchet

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Parler, la grille
Œil-le-rond entre les ferrures.
Paupières, cillant,
qui rames amont,
élargis ce regard.
Iris, nageur, rogue et sans rêve :
le ciel, cœur gris, n'est pas loin.
Déclive, à ce bec du métal,
l'écharde charbonne.
Où la lumière tire,
tu devines l'âme.
(Si j'étais semblable à toi. Toi-même, à moi.
Ne sommes-nous pas debout
dans un même alizé ?
Nous sommes étrangers.)
Les dalles. Dessus,
entreserrées, l'une et l'autre
flaques gris-cœur :
deux fois
se taire plein la bouche.
*
Sprachgitter
Augenrund zwischen den Stäben
Flimmertier Lid
rudert nach oben,
gibt einen Blick frei.
Iris, Schwimmerin, traumlos und trüb :
der Himmel, herzgrau, muss nah sein.
Schräg, in der eisernen Tülle,
der blakende Span.
Am Lichtsinn
errätst du die Seele.
(Wär ich wie du. Wärst du wie ich.
Standen wir nicht
unter einem Passat ?
Wir sind Fremde.)
Die Fliesen. Darauf,
dicht beieinander, die beiden
herzgrauen Lachen
zwei
Mundwoll Schweigen.
Paul Celan, Poèmes, traduits par André du
Bouchet, Clivages, 1978, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, parler, la grille, andré du bouchet, toi, regard | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2014
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par Martine Broda

En hommage à Jean Bollack : une semaine avec Paul Celan
Mon
âme inclinée vers toi
t'entend
orager,
dans le creux de ton cou mon étoile
apprend comme on sombre
et devient vraie,
des doigts, je la tire au dehors —
viens, entends-toi avec elle,
encore aujourd'hui.
Meine
dir zugewinkelte Seele
hört dich
gewittern,
in deiner Halsgrube lernt
mein Stern, wie man wegsackt
und wahr wird,
ich fingre ihn wieder heraus —
komm, besprich dich mit ihm,
noch heute.
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par
Martine Broda, Clivages, 1985, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, enclos du temps, traduit par martine broda, amour, étoile | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2014
Henri Thomas, Poésies, préface de Jacques Brenner
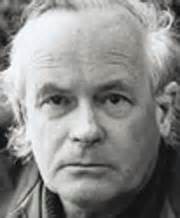
Chauve-souris
La fadeur qui s’en va de la femme endormie
me poursuit vaguement, inquiétant ma vie.
Ce début de poème exprime une tristesse
si confuse qu’un rien la changerait en liesse.
Pourquoi liesse, pourquoi tristesse, pourquoi
ne pas rester tranquille et fort et sûr de soi ?
Un rameau monte de la plaine du sommeil,
c’est le jour, ébloui de renaître pareil.
M’envoler dans ce monde à l’énorme ramure,
aigle ou petit oiseau, quelle belle aventure !
Hélas, chauve-souris de cette voûte obscure,
je dors, alors que s’ensoleille la nature.
L’homme divers, comme un miroir qui bougerait
me fait peur, et la femme aux humides attraits
m’emmène au loin au pays des faibles cris,
des mensonges, et des fatigues de midi.
Le jour s’éteint, salut, crépuscule banal,
il est temps de glisser vers le monde infernal.
Henri Thomas, Poésies, préface de Jacques Brenner, Poésie / Gallimard, 1970, p. 161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, poésies, préface de jacques brenner, chauve-souris, femme, mensonge, tristesse | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2014
Samuel Beckett, Cap au pire
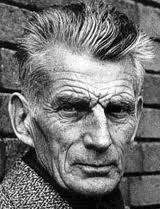
Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’à plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore.
Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit.
Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D’où sortir. Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là encore. Sans bouger.
Tout jadis. Jamais rien d’autre. D’essayé. De raté. N’importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.
D’abord le corps. Non. D’abord le lieu. Non. D’abord les deux. Tantôt l’un ou l’autre. Tantôt l’autre ou l’un. Dégoûté de l’un essayer l’autre. Dégoûté de l’autre retour au dégoût de l’un. Encore et encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’au dégoût des deux. Vomir et partir. Là où ni l’un ni l’autre. Jusqu’au dégoût de là. Vomir et revenir. Le corps encore. Où nul. Le lieu encore. Où nul. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore plus mal encore. Jusqu’à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour de bon. Là où ni l’un ni l’autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes pour de bon.
Samuel Beckett, Cap au pire, traduit de l’anglais par Édith Fournier, éditions de Minuit, 1991, p. 7-9.
*
On. Say on. Be said on. Somehow on. Till nohow on. Said nohow on.
Say for be said . Missaid. From now say for be missaid.
Say a body. Where none. No mind. Where none. That at least. A place. Where none. For the body. To be in. Move in. Out of. Back into. No. No out. No back. Only in. Stay in. On in. Still.
All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
First the body. No. First the place. No. First both. Now either. Now the other. Sick of the either try the other. Sick of it back sick of the either. So on. Somehow on. Till sick of both. Throw up and go. Where neither. Till sick of there. Throw up and back. The body again. Where none. The place again. Where none. Try again. Fail again. Better again. Or better worse. Fail worse again. Still worse again. Till sick for good. Throw up for good. Go for good. Where neither for good. Good and all.
Samuel Beckett, Worstward Ho, London, John Calder, 1983, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, cap au pire, corps, dire, dégoût | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2014
Pierre Jean Jouve, Danse des morts

Pour "commémorer" la boucherie de 1914-1918 (4)
Cadavres
La Mort
Mes cadavres, mes cadavres !
Rampe, ta chair à demi morte,
Combattants d'hier,
Sur ce terrain-là.
Le reconnais-tu ?
Tu y courus, bête sauvage.
— Et regarde :
Cadavres, cadavres !
Des horizons et des marées !
Pacifiés, déchiquetés, les vieux, les jeunes,
Épaisseurs sur épaisseurs dans la terre cadavéreuse,
Brassés par la pluie,
Arrachés par celui qui passe,
Et labourés, et retournés,
Chaque jours par les obus tenaces,
Morts que la mort tue, fusille, crève et fait éclater
Encore !
Ceux de six mois, ceux de deux jours,
Et des terrains morts qui reviennent à l'air ;
Le compagnon qui rigolait la veille :
« T'en fais pas »,
Le voilà,
Torse planté en terre, et la tête penchée,
Avec le ver de ses lèvres entre ses joues,
Te regardant, d'un regard clair !
Restes séchés
Sur les plateaux, pendus aux réseaux de fer.
Par un seul jet de mitrailleuse, hachés ;
Des têtes noires, grouillant de vers,
Fémurs, dents pointues et képis,
Dans un bitume de terre paisible
Qui dévore...
Et les moins anciens, avec leurs rats sous eux,
Et les neufs, figures vertes, puanteur...
Pierre Jean Jouve, Danse des morts [1917], dans Œuvre I,
édition établie par Jean Starobinski, Mercure de
France, 1987, p. 1591-1592.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, danse des morts, cadavres, boue, puanteur | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2014
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir

Ode
Un Corbeau devant moi croasse,
Une ombre offusque mes regards,
Deux belettes et deux renards
Traversent l’endroit où je passe :
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal,
J’entends craqueter le tonnerre,
Un esprit se présente à moi,
J’ois Charon qui m’appelle à soi,
Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source,
Un bœuf gravit sur un clocher,
Le sang coule de ce rocher,
Un aspic s’accouple d’une ourse,
Sur le haut d’une vieille tour
Un serpent déchire un vautour,
Le feu brûle dedans la glace,
Le Soleil est devenu noir,
Je vois la Lune qui va choir,
Cet arbre est sorti de sa place.

Le monde renversé
Sonnet
L’autre jour inspiré d’une divine flamme,
J’entrai dedans un temple, où tout religieux
Examinant de près mes actes vicieux,
Un repentir profond fit soupirer mon âme.
Tandis qu’à mon secours tous les Dieux je réclame,
Je vois venir Phyllis : quand j’aperçus ses yeux
Je m’écriai tout haut : ce sont ici mes Dieux,
Ce temple, et cet Autel appartient à ma Dame.
Le Dieux injuriés de ce crime d’amour
Conspirent par vengeance à me ravir le jour ;
Mais que sans plus tarder leur flamme me confonde.
Ô mort, quand tu voudras je suis prêt à partir ;
Car je suis assuré que je mourrai martyr,
Pour avoir adoré le plus bel œil du monde.
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir, Œuvres choisies, édition présentée et établie par Jean-Pierre Chauveau, Poésie / Gallimard, 2002, p. 88 et 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, après m’avoir fait tant mourir, sonnet, le monde renversé, amour, désir | ![]() Facebook |
Facebook |





