03/08/2013
Guillevic, Accorder, poèmes 1933-1996
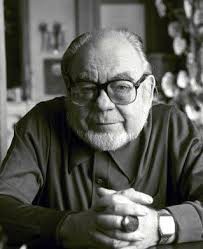
Ce qui dans la pleine nuit
Te manque
Ce n'est pas que la lumière.
Mais cette espèce de plafond
Qui dans le jour forme le ciel.
Cette absence
Gonfle l'immensité
Te diminue encore.
Te voici fourmi
Sans fourmilière,
Égaré comme dans le néant.
24.01.95
Guillevic, Accorder, poèmes 1933-1996, édition établie et
postfacée par Lucie Albertini-Guillevic, Gallimard, 2013,
p. 283.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, accorder, poèmes 1933-1996, la nuit la jour, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2013
Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse
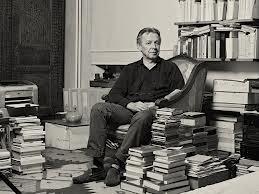
Bouquets à la sauvette
Turc, Roumain, Rom ou Réfugié ?
Un peu jeunet pour fair' ce tour
Des bistrots, des bars et des bouges.
Il s'arrête un moment et toutes
Ses fleurs attendent avec lui
Pour voir la Fille et le Client
Par la fenêtre, avant de fuir
Avec les roses sous la pluie.
Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse,
La Dogana, 2012, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric wandelère, la compagnie capricieuse, roses, à la sauvette, turc, roumain, rom | ![]() Facebook |
Facebook |
01/08/2013
Vadim Kosovoï, Hors de la colline

Ni fleurs ni couronnes
comme désastre ils furent en leur jeunesse gris
au seuil de mort gardant comme crachoir l'œil
lucide
d'un bout de bottes deux fois touchèrent la peste
fécale
où pelucheux poussah l'ours au rencart barbote cabossé
du bonnet
car leur moustique poupon s'est déployé pourceau
broutant tripes pour quatre et va vite crapule
s'étouffer de vipères
plus pur que bleu des ciels ils virent un soubresaut
là-haut du dirigeable
en jeunesse seuil de mort
mais point ne s'inclinèrent devant la solitaire amorce
d'oiseau lancé au frisquet cent frissons
par l'homme bête limpide
Vadim Kosovoï, Hors de la colline, version française de
l'auteur avec la collaboration de Michel Deguy et Jacques
Dupin, illustrations de Henri Michaux, Herman, 1984, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vadim kosovoï, hors de la colline, michel deguy, henri michaux, jacques dupin | ![]() Facebook |
Facebook |
31/07/2013
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Le parfum des asperges
D'une pièce à l'autre du rez-de-chaussée, les odeurs circulent, s'emmêlent, s'adultèrent, se recouvrent, s'annulent ou se rehaussent. Sauf à l'approche de l'heure du coucher, l'odeur du chagrin s'efface devant celles, subtilement étagées, réunies en bouquet ou vigoureusement dissociées, des plaisirs de la table. Plus que le goût, c'est en effet l'odorat que les descriptions proustiennes mobilisent pour donner à éprouver, dans toute la plénitude de la sensation, ce qu'avoir bon appétit veut dire. Toute nourriture semble devoir se résoudre en odeur dans le monde de Combray. Si l'on demandait à une société de lecteurs quel souvenir leur vient en premier des repas combraysiens, une grande majorité d'entre eux évoquerait le parfum des bottes d'asperges. Quiconque a lu Du côté de chez Swann ne pourra plus jamais faire autrement que de penser à Proust lorsque, ayant pris des asperges àdîner, il redécouvre, dans l'intimité des toilettes, le singulier pouvoir qu'elles ont de substituer la subtilité douceâtre de leur parfum à l'âcreté de l'urine. Si « l'essence précieuse » des asperges se reconnaît d'abord à leur robe couleur du temps, au glissement sur leur corps fuselé de couleurs si changeantes que le Narrateur peut les comparer à des aurores naissantes ou à des « ébauches d'arc-en-ciel », elle s'accomplit dans la façon qui leur est propre de jouer, « dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer [le] pot de chambre en un vase de parfum ». L'asperge a ceci de singulier, qui la distingue du commun des nourritures terrestres, qu'elle demande pour libérer son parfum, pour que son odeur, atteignant son seuil de plénitude, mérité le nom de parfum, qu'on se l'incorpore. Le parfum de l'asperge se réalise dans la nuit de l'estomac, dans les replis boueux de l'intestin ; il embaume dans ces lieux malséants, ces cabinets d'aisances, où s'impose à chacun, dans toute sa trivialité, la dimension physiologique des existences.
On pourrait voir dans cette fabrique d'un parfum, qui demande à être distillé dans la nuit des viscères, un emblème assez satisfaisant de l'œuvre. Proust, et c'est l'une de ses grandeurs, ne se détourne pas, par souci d'originalité, par peur du cliché, des beautés répertoriées. Il célèbre sans façon la beauté du monde, sans dérobade, sans crainte de s'émerveiller devant la beauté convenue, pour album de jeune fille, des arbres en fleurs, découvrant dans l'intensité de son admiration de nouvelles façons de dire le soleil rayonnant sur la mer ou de donner à éprouver la gifle du vent sur les visages enflammés par le grand air.
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 75-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, asperge, odeur, parfum, création, beauté | ![]() Facebook |
Facebook |
30/07/2013
Robert Duncan, La profondeur du champ
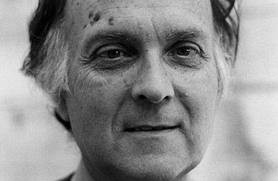
Tenir la rime
Par accent et syllabe
Par changement de rime et de contour
le vers long à la cadence bizarre atteint sa période même.
Le vers court
nous raffinons
et vouons à la candeur.
Nous nous en souvenons
la braise de la flamme
prend le mot dès lors qu'il s'entend
(« Nous devons comprendre ce qui se passe »)
et surgit au désir,
air
à la justesse de l'oiseau.
C'est la bûche du solstice d'hiver qui réchauffe décembre.
C'est l'herbe neuve qui surgit de la terre.
Robet Duncan, L'ouverture du champ, traduction Martin Richet,
éditions Corti, 2012, p. 110.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, la profondeur du champ, rime, vers long, vers court, oiseau, hiver. | ![]() Facebook |
Facebook |
29/07/2013
Lord Byron, Épître à Augusta

Épître à Augusta
IX
Que n'es-tu qu'avec moi ! mais je cultive
De mes désirs que la folie, et j'oublie
Que la solitude, si fort louée,
Perdit son prix en cela — un regret ;
Il en peut être d'autres, que moins je montre ;
Mon humeur n'est plaintive, quoique je sente
La mer descendre en ma philosophie,
Et s'élever le flot à mon œil altéré.
Espitle to Augusta
IX
Oh that thou wert but with me ! — but I grow
The fool of my own wishes, and forget
The solitude, which I have vaunted so,
Has lost its praise n this but one regret;
There may be others which I less may show,
I am not of the plaintive mood, and yet
I fell an ebb in my philosophy,
And the tide rising in my alter'd eye.
Lord Byron, Poèmes, choisis et traduits de l'anglais par
Florence Guilhot et Jean-Louis Paul, Allia, 2012, p. 77 et 76.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lord byron, Épître à augusta, amour, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2013
Jean Tardieu, La première personne du singulier
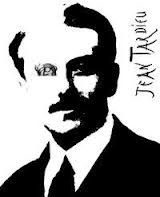
Les surprises du dimanche
La conversation s'engagea au milieu du jardin. Les interlocuteurs, au prix de douloureuses courbatures, faisaient semblant d'être assis, mais aucun siège ne les portait. Ils formaient un cercle parfait autour d'un petit cheval qui était là Dieu sait pourquoi.
(Un peu plus loin, autour de la pelouse, les chaises et les fauteuils faisaient cercle de leur côté.)
On parla d'abord de la question des ponts, puis de la question des ponts de bois, puis des bois de pins, puis des sapins, puis des lapins, puis de la jungle et des ours.
À ce moment (quand on parle du loup !...) un ours parut sur la route, un accordéon sur le ventre, la cigarette au bec. Il dansait en s'accompagnant.
Les chaises et les fauteuils pris de panique rentrèrent précipitamment à la maison.
Les interlocuteurs lassés d'un long effort s'étendirent sur l'herbe.
La nuit vint. L'ours chantait. J'étais heureux.
Le petit poulain grandit, devint plus haut qu'un chêne — et blanc d'écume comme la mer. C'était Pégase, le cheval de la poésie, celui que nous révérons tous.
Jean Tardieu, La première personne du singulier, Gallimard, 1952, p. 117-118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, la première personne du singulier, les surprises du dimanche, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2013
Jean Tardieu, Obscurité du jour

Le commencement de la fin
La quête des origines est un terme vague, un lieu commun, une illusion de l'esprit. Mais c'est aussi la traduction mythique du paradoxe permanent dont nous vivons quand nous situons dans le passé l'espoir invincible du Mieux. Nous sommes pareils à la souris des expériences classiques : toutes les issues sont fermées sauf une. Là, à la sortie du labyrinthe, se montre la mince lumière, le vent frais, la fin du tunnel : rien d'autre que l'espérance de la Nouveauté, seul « rachat » possible dans un monde où l'habitude nous asphyxie.
C'est peut-être l'une des grandeurs de l'art que d'être un des rares domaines, périlleux et fascinants, où puisse être tranchée notre soif de renouvellement, c'est-à-dire notre besoin permanent de transgression.
Ainsi plongeant le jour dans notre nuit comme un fer rouge qui bouillonne au contact de l'eau glacée, ou bien cherchant une aube inconnue à l'orée du souterrain et l'air pur au-delà des fumées, nous confondons, dans une même recherche obstinée, ce qui ne reviendra pas et ce qui pourrait être, car notre terre promise est toujours un paradis perdu.
Jean Tardieu, Obscurité du jour, "Les Sentiers de la création", Albert Skira, 1974, p. 105-106.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, obscurité du jour, le commencement d ela fin, paradis perdu, les origines | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2013
Jean Tardieu, Une Voix sans personne
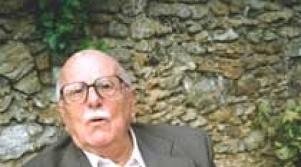
Les mots égarés
Je marchais par une nuit sans fin
sur une route où luisaient seules
des lueurs agitées délirantes
comme les feux d'une flotte en perdition.
Sous la tempête mille et mille voix sans corps
souffles semés par des lèvres absentes
plus tenaces qu'une horde de chacals
plus suffocantes qu'une colère de la neige
à mes oreilles chuchotaient chuchotaient.
L'une disait « Comment » l'autre « Ici »
ou « Le train » ou « Je meurs » ou « C'est moi »
et toutes semblaient en désaccord :
une foule déçue ainsi se défait.
Tant de paroles échappées
des ateliers de la douleur
semblaient avoir fui par les songes
des logements du monde entier.
« Je t'avais dit » — « Allons ! » — « Jamais ! »
« Ton père » — « À demain ! » « Non, j'ai tiré ! »
« Elle dort » — « C'est-à-dire » — « Pas encore »
« Ouvre ! » — « Je te hais ! » — « Arrive ! »
Ainsi roulait l'orage des mots pleins d'éclairs
L'énorme dialogue en débris, mais demande et réponse
étaient mêlés dans le profond chaos ;
le vent jetait dans les bras de la plainte la joie,
l'aile blessée des noms perdus frappait les portes au hasard
l'appel atteignait toujours l'autre et toujours le cri égaré
touchait celui qui ne l'attendait pas. Ainsi les vagues,
chacune par la masse hors de soi déportée
loin de son propre désir, et toutes ainsi l'une à l'autre
inconnues mais à se joindre condamnées
dans l'intimité de la mer.
Jean Tardieu, Une Voix sans personne, Gallimard, 1954, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
25/07/2013
Jean Tardieu, Jours pétrifiés

Regina terrae
À Albert Camus
Comme un souvenir
je t'ai rencontrée,
personne perdue.
Comme la folie,
encore inconnue.
Fidèle fidèle
sans voix
sans figure
tu es toujours là.
Au fond du délire
qui de toi descend
je parle j'écoute
et je n'entends pas.
Toi seule tu veilles
tu sais qui je suis.
La terre se tourne
de l'autre côté,
je n'ai plus de jour
je n'ai plus de nuit ;
le ciel immobile
le temps retenu
ma soif et ma crainte
jamais apaisée,
pour que je te cherche,
tu les as gardés
Sœur inexplicable,
délivre ma vie,
laisse-moi passer !
Si de ton mystère
je suis corps et biens
l'instant et le lieu
ô dernier naufrage
de cette raison,
avec ton silence
avec ma douleur
avec l'ombre et l'homme
efface le dieu !
Faute inexpiable
je suis sans remords.
Dans un seul espace
je veux un seul monde
une seule mort.
Jean Tardieu, Jours pétrifiés, Gallimard,
1948, p. 77-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, regina terrae, albertcamus | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2013
Jean Tardieu, Les portes de toile
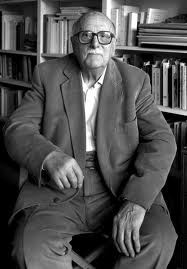
Le miroir de Corot
(Largo)
Je me regarde dans la glace et je vois un objet à peindre.
Un objet dans la lumière du matin.
L'air, autour de cet objet, se répand sans contrainte, agréable et sonore.
L'objet est debout assuré dans ses trois dimensions : sa digne hauteur, sa largeur sans excès, sa paisible épaisseur.
Il a ses creux et ses bosses, comme un arbre, comme un vallonnement, son ombre heureuse ici, là le côté du soleil...
Ma vie que voici, vous êtes cet objet : le bon pain que je coupe, l'huile étale et légère, la lait de la journée et rien de vous ne me sépare : nous parlons sans arrière-pensée.
Jean Tardieu, Les portes de toile, Gallimard, 1969, p. 126.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, les portes de toile, le miroir de corot, peindre | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2013
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean
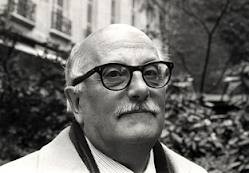
Une bouteille à la mer
Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, c'est-à-dire jusqu'à ces moments privilégiés où un enfant commence à prendre conscience de lui-même et de ce qui l'entoure, il me semble avoir toujours entendu une certaine voix qui résonnait en moi, mais à une grande distance, dans l'espace et dans le temps.
Cette voix ne s'exprimait pas en un langage connu. Elle avait le ton de la parole humaine mais ne ressemblait ni à ma propre voix ni à celle des gens qui me connaissent. Elle ne m'était pourtant pas étrangère, car elle semblait avoir une sorte de sollicitude à mon égard, une sollicitude tantôt bienveillante et rassurante, tantôt sévère, grondeuse, pleine de reproches et même de colère.
Les moments où j'entendais cette voix étaient ceux où ma vie paraissait suspendue dans le vide, interrompue, arrêtée, comme une horloge dont on ne voit plus bouger les aiguilles et dont on n'entend plus le battement.
Cette expérience très ancienne, primitive, sauvage, surtout secrète (car je n'en parlais à personne), s'est reproduite souvent au cours de mon existence, mais jamais elle n'a été aussi expressive, aussi intense que pendant mon extrême jeunesse, car rien ne pouvait alors en fausser la signification : elle résonnait dans une étendue absolument vacante, absolument solitaire.
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean, Gallimard, 1990, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, on vient chercher monsieur jean, une bouteille à la mer, souvenir, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2013
Jean Tardieu, Accents
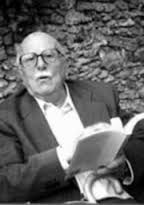
Premier dernier amour
Tout est mort. Même les désirs de mort
Sont morts. Ce qui grandit est sans figure.
Les mains, les yeux, — déserts. Toute mesure
S'effondre après ce feu qui brise un corps.
Rien — ni espoir ni doute — n'ouvre plus
La porte où le soleil vient nous attendre.
Les fruits profonds, par l'orage abattus,
Sont morts : l'esprit possède enfin leurs cendres ;
Avide, — seul, — et maître d'une nuit,
Où le ciel pleut, où le mouvement plonge,
Où, sur l'objet qu'il efface, bondit
L'appel sans voix qui confond tous nos songes.
Jean Tardieu, Accents, Gallimard, 1939, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jena tardieu, accents, premier dernier amour, sans voix, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
21/07/2013
Jean Tardieu, Margeries
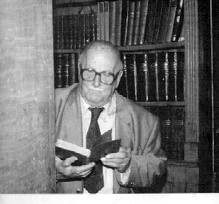
Vraiment, vous perdez le sens !
Préférer ? Préférer ? Bon Dieu ! Pré-fé-rer ?
Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Un pré, un
fer, une fée ? Et finir par un ré ?
Plus je répète ces syllabes, plus je
m'étonne et m'enchante, me déconcerte et
m'égare. Tantôt le mot est vide de tout
sens, tantôt il s'ouvre à tous vents.
Tantôt transparent et désert, tantôt
plein et opaque, une bulle ou une autre, tantôt
un sac magique, un chapeau d'où l'on
peut faire surgir toutes sortes de choses :
un ballon un œuf une colombe un gobelet.
Quoi ! Irais-je préférer un ballon
à un œuf, une colombe, un gobelet ?
Qui vous l'a dit ? cela n'a aucun sens.
Donc je ne préfère rien.
Je m'arrête de préférer.
J'aime mieux ne rien préférer.
Jean Tardieu, Margeries, poèmes inédits 1010-1985,
Gallimard, 1986, p. 289.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, sens des mots, préférer | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2013
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela
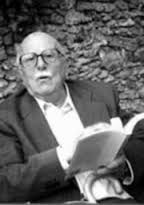
Les songes de l'inanimé
Le vagabond des millions d'années
l'inanimé
s'efforce Il monte il trébuche à travers
le va-et-vient l'affiche lumineuse
des nuits et des jours.
Il s'approche il monte, l'inanimé, le vagabond,
il heurte de son bâton
les bords du chemins éboulé
Il peine il gémit il s'efforce
d'être un jour ce qu'il rêve,
de prendre vie,
de troquer l'insensible contre la douleur
d'échanger l'innombrable
contre l'unique, contre un destin.
Futur empereur future idole
le caillou vagabond
limé couturé par l'embrun
veut gravir les degrés prendre figure
faire éclore sur sa face camuse
une bête qui brame
un philosophe qui bougonne
un saint qui se tait
un dieu qui souffre et qui meurt
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Gallimard,
1979, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, les songes de l'inanimé, aillou vagabond | ![]() Facebook |
Facebook |





