04/05/2020
William Blake, Chants de l'innocence

Chanson du rire
Quand les bois verts rient avec l’accent de la joie,
Et que le ruisseau tout en fossettes rit en courant,
Quand l’air lui-même rit de nos gaies saillies,
Et que la verte colline rit en écho,
Quand les prés rient de leur vert étincelant,
Et que la sauterelle rit dans ce joyeux ensemble,
Quand Marie, Suzanne et Émilie
De leur douce bouche ronde égrènent les notes du rire,
Quand les oiseaux éclatants rient dans l’ombre
Où se dresse notre table offrant cerises et noix,
Viens vivre dans la joie et joindre à moi,
Chantant le doux refrain du rire.
William Blake, Chants de l’innocence, dans Poèmes,
Traduction M. L. Cazamian, Aubier-Flammarion,
1968, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william blake, chants de l’innocence, chanson du rire, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2019
André Frénaud, La Sainte Face

L’irruption des mots
Je ris aux mots j’aime quand ça démarre,
qu’ils s’agglutinent et je les déglutis
comme cent cris de grenouilles en frai.
Ils sautent et s »appellent, s’éparpillent et m’appellent
et se rassemblent et je ne sais
si c’est Je qui leur réponds ou eux
encore dans un tumulte intraitablement frais
qui vient sans doute de mes profondes lèvres.
là -bas où l’eau du monde m’a donné vie.
Je me vidange quand m’accouchent ces dieux têtards.
Je m’allège et m’accrois par ces sons qui dépassent,
issus d’un au-delà, presque tout préparés.
J’en fais le tour après, enorgueilli,
ne me reconnaissant qu’à peine en ce visage
qu’ils m’ont fait voir et qui parfois m’effraie,
car ce n’est pas moi seul qui par eux me démange.
André Frénaud, La Sainte Face, Poésie/Gallimard, 1985, p. 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la santé face, mots, désordre, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2019
Jean-Paul Michel, "Défends-toi, Beauté violente"

« Ordonne ce frais désordre de choses données »
Ordonne ce frais désordre de choses données
Prends
Toute beauté donnée, toutes choses à l’excès données
Prends.
Qu’on sente dans ton pas gémir la terre tendre
Marche. Cadence. Rythme. Chasse.
Tout le parfait réel. Tout le Mal. Prends.
Plonge en lui, Nageur ô crache
Avec le sel l’exultante
Joie.
Jean-Paul Michel, « Défends-toi, Beauté violente ! »,
Poésie/Gallimard, 2919, p. 247.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, « défends-toi, beauté violente ! », désordre, excès, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2018
Emmanuel Godo, Je n'ai jamais voyagé

Les fables de nourrice racontaient votre amour
Quand il n’existait déjà plus
Tu ne sais pas si tu peux marcher encore
Mais tu veux vivre
Les écluses de la nuit sont rouvertes
Ton ventre se soulève doucement
La tristesse est là qui bat la mesure du temps
Le cœur déraciné de son feu
Lève sa dernière lumière à la face de la mort
Tu n’es pas comme l’animal au bord de la vie
Tu es l’animal au bord de la vie
Un souffle te fait regarder de tous tes yeux
Des yeux à la surface des mots
Est-ce le même souffle qui te fera disparaître
Qui t’emportera dans la calme immobilité des choses ?
Le nombre de fois où un paysage
Sans te prévenir t’a pris par la main
Mais quel visage a ta joie ?
Emmanuel Godo, Je n’ai jamais voyagé, Gallimard,
2018, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel godo, je n’ai jamais voyagé, maladie, souffrance, souffle, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2018
Agnès Rouzier, Le fait même d'écrire

Lettre à Magda von Hattinberg
L’enfance — qu’était-ce donc ? Qu’est-ce que c’étaitl’enfance ? Peut-on poser à son propos d’autres questions que celle-là, perplexe, — qu’était-ce — cette façon de brûler, de s’étonner, de ne jamais pouvoir faire autrement, de sentir la douce, la profonde montée des larmes ? Qu’était-ce ?
… Cette enfance qui n’avait aucun refuge en dehors de nous….
… Quand nous la vivions nous ne la connaissions pas, nous la consommions sans savoir son nom, et de ce fait même nous l’avions toute entière, inépuisable ; plus tard les choses prennent des noms qu’elle ne doivent pas dépasser et laissent, par prudence, à moitié vides.
… Autrefois encore mineurs, nous vivions tout, je crois que nous vivions totalement la terreur, la pire terreur, sans savoir que c’en était, et totalementla joie, sans deviner qu’il y en eût une, trop riche pour nos cœurs (elle nous faisait trembler, mais nous la prenions telle quelle) — et peut-être l’amourtout entier(Penser que je l’ai suune fois — quand l’ai-je désappris ?)
… et maintenant avec nos visages encombrés d’extériorité nous demandons qu’était-ce ?
Agnès Rouzier, Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1985, p. 249.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, le fait même d’écrire, enfance, terreur, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2017
Cesare Pavese, Le Métier de vivre

(1944-1945)
La richesse de la vie est faite de souvenirs oubliés.
Il y a des gens pour qui la politique n’est pas universalité, mais seulement légitime défense.
Il n’est pas beau d’être enfant ; il est beau étant vieux de penser à quand on était enfant.
Comme elle est grande cette idée que vraiment rien ne nous est dû. Quelqu’un nous a-t-il jamais promis quelque chose ? Et alors pourquoi attendons-nous ?
Il est beau d’écrire pare que cela réunit deux joies : parler tout seul et parler à une foule.
Cesare Pavese, La Métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 227, 228, 249, 250-251, 259.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, enfance, politique, souvenir, écrire, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2015
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction Pierre Leyris —— Écrire après ?

Il devrait n’être point de désespoir pour toi
Il devrait n’être point de désespoir pour toi
Tant que brûlent la nuit les étoiles,
Tant que le soir répand sa rosée silencieuse,
Que le soleil dore le matin.
Il devrait n’être point de désespoir, même si les larmes
Ruissellent comme une rivière :
Les plus chère de tes années ne sont-elles pas
Autour de ton cœur à jamais ?
Ceux-ci pleures, tu pleures, il doit en être ainsi ;
Les vents soupirent comme tu soupires,
Et l’Hiver en flocons déverse son chagrin
Là où gisent les feuilles d’automne
Pourtant elles revivent, et de leur sort ton sort
Ne saurait être séparé :
Poursuis donc ton voyage, sinon ravi de joie,
Du moins jamais le cœur brisé.
[Novembre 1839]
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction de Pierre Leyris,
Poésie / Gallimard, 1983, p. 87.
Écrire après ?
Face à des innocents lâchement assassinés par d'infâmes fanatiques, la poésie peut peu, pour le dire à la façon de Christian Prigent. Ça, le moderne ? Quoi, la modernité ? Cois, les Modernes… Face à l'innommable, seul le silence fait le poids ; comme à chaque hic de la contemporaine mécanique hystérique, ironie de l'histoire, l'écrivain devient de facto celui qui n'a rien à dire. Réduit au silence, anéanti par son impuissance, son illégitimité. Son être-là devient illico être-avec les victimes et leurs familles.Nous tous qui écrivons ne pouvons ainsi qu'être révoltés par l'injustifiable et nous joindre humblement à tous ceux qui condamnent les attentats du 13 novembre. Et tous de nous poser beaucoup de questions.
Surtout à l'écoute des discours extrémistes, qu'ils soient bellicistes, sécuritaires, islamophobes ou antisémites sous des apparences antisionistes. C'est ici que ceux dont l'activité – et non pas la vocation – est de mettre en crise la langue comme la pensée, de passer les préjugés et les idéologies au crible de la raison critique, se ressaisissent : le peu poétique ne vaut-il pas d’être entendu autant que le popolitique ? Plutôt que de subir le bruit médiatico-politique, le spectacle pseudo-démocratique, les mises en scène scandaculaires – si l'on peut dire -, ne faut-il pas approfondir la brèche qu'a ouverte dans le Réel cet innommable, ne faut-il pas appréhender dans le symbolique cette atteinte à l'entendement, ce chaos qui nous laisse KO ? Allons-nous nous en laisser conter, en rester aux réactions immédiates, aux faux-semblants ? Une seule chose est sûre, nous CONTINUERONS tous à faire ce que nous croyons devoir faire. Sans cesser de nous poser des questions.
Ce communiqué, signé de Pierre Le Pillouër et Fabrice Thumerel, est publié simultanément sur les sites :
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, poèmes, pierre leyris, désespoir, pleur, larme, hiver, vent, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2015
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Une sorte de perte
Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.
Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.
Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.
Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.
De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.
De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.
Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,
porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,
(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)
intrépide en religion car ce lit était l’église.
La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.
Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.
Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.
Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.
Ce n’est pas toi que j’ai perdu,
c’est le monde.
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2015
Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par Henri Deluy, J-P Faye
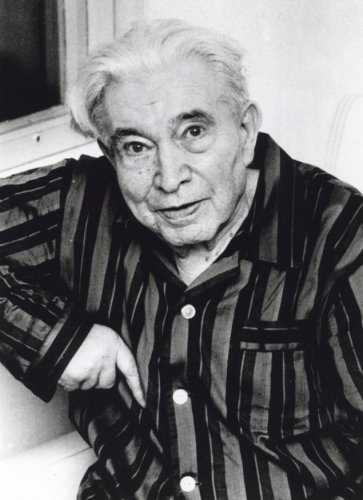
Printanier
Demoiselle au bureau devant ta machine,
Sur tes doigts brille le soleil du printemps,
Tes mains frémissent, mon dieu,
Tu voudrais pouvoir t »en aller.
La vie, vois-tu, est formidablement belle,
Le banc du parc est bien trop dur,
Mais quand on aime toute l’âme poétise
Et ce bois lui-même ne se dédaigne pas.
Oui, je sais, ça n’est pas rien d’aimer,
Le ressac de l’amour nous ballotté,
Un moment à planer haut dans le ciel,
Accompagné jusque)là d’un rayon de soleil.,
Puis soudain l’implacable pesanteur
Nous ramène tout en bas
Et la dure réalité nous visse à la terre ;
Ne t’en fais pas pour ça, tout d’un coup
Tu rejoindras les étoiles, serrée dans ses bras,
Car tu es jeune, avec tes vingt ans,
Et à ton âge tout amour gai attriste,
Car l’amour c’est comme tout le monde :
il est amer bien sûr mais savoureux.
Si tu m’en crois, je peux te donner
Un vrai conseil d’ami,
N’aie jamais peur d’aimer, demoiselle !
et si quelqu’un t’embrasse sur la joue droite,
Tends la gauche.
Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par
Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Change errant
/ Action poétique, 1984, p. 35-36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, traduits par henri deluy, j-p faye, jeune fille, aimer, amertume, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/12/2014
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik (1917-1930)

Lili Brik et Maïakovski
Toi
Elle vint —
d'un coup d'œil
sérieux,
sous le rugissement,
la carrure,
devina simplement le gamin.
Elle prit
son cœur pour elle seule,
et simplement
s'en fut jouer,
comme une fillette au ballon.
Et chacune —
comme devant un miracle —
ici une dame s'en mêle,
là une demoiselle :
« En aimer un comme ça ?
Mais il vous renverserait !
Probable que c'est une dompteuse !
Possible qu'elle sort du Zoo ! »
Et moi je jubile.
Il n'y en a plus —
de joug.
Perdant la tête de joie,
je sautais,
comme un Indien à des noces bondissant,
tant je me sentais gai,
tant je me sentais léger.
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik (1917-1930), traduites du russe par Andrée Robel, Gallimard,
1969, p. 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir maïakovski, lettres à lili brik (1917-1930), amour, miracle, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2014
William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans

L'artiste
Un rêve, un feu sur lesquels je n'ai pouvoir me guident hors des sentiers sûrs et balisés de la solidité et du sommeil que la nature a créés pour l'homme. Un feu dont j'ai hérité malgré moi, et que je dois alimenter de verbe et de jeunesse et du vaisseau même qui le porte — le serpent qui dévore sa propre engeance —, sachant que je ne pourrai jamais donner au monde ce qui en moi cherche à se libérer.
Car où est la chair, dans quelle main le sang, aptes à modeler dans le marbre, sur la toile ou le papier, ce rêve qui est en moi et qui demande à vivre ? Je ne suis, moi aussi, qu'une motte informe de terre humide issue de la douleur et destinée à rire, à lutter, à pleurer, ne connaissant la paix que le jour où l'humidité partie, elle retournera à la poussière originelle et éternelle.
Mais créer ? Qui, parmi vous qui n'êtes pas la proie de ce feu, pour connaître cette joie, si fugace soit-elle ?
William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans, suivi de Mayday, traduit d el'anglais par Michel Gresset, Gallimard, 1988, p. 63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, "la nouvelle-orléans", dans croquis de la nouvelle-orléans, création, feu, rêve, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2013
Giuseppe Conte, Le dieu humble de l'aube

Le dieu humble de l'aube
Ne le voyez-vous pas ? Je ne possède rien.
Vagabond, mendiant,
rien ne me fut donné
de ce qui devait m'échoir.
Je fus blessé, moqué,
poignardé, compris de travers
et laissé pour mort
s'il est vrai que les mots peuvent tuer.
En chaque vaincu je reconnais mon frère.
En chaque rebelle aussi.
Qu'ai-je reçu de toi, ma vie,
si ce n'est cette joie violente dans ma chair,
cette joie déraisonnable
qui fait que certains matins au réveil,
moi, le plus misérable des hommes,
moi qui connais tous les déchirements,
j'esquisse un pas de danse,
laisse monter dans ma gorge un chant
et rends grâce en ce tremblement
au dieu humble de l'aube.
Giuseppe Conte, traduit par Jean-Baptiste Para,
dans PO&SIE, "1975-2004, Trente ans
de poésie italienne", n°109, 2004, p. 277.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe conte, le dieu humble de l'aube, vagabond, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2013
Ghérasim Luca, L'extrême occidentale

Tout ce qui nous caresse ou nous déchire, tout ce qui nous frôle, nous hante, nous griffe et nous trouble, tout ce qui nous pousse en avant, en arrière, contre le mur, vers un autre corps ou au bord de l'abîme, tout ce qui se défait irrémédiablement ou, au contraire se cristallise, tout ce qui grimpe, tout ce qui nous fascine, tout ce qui nous contracte, nous pique et nous questionne, tout ce qui nous touche de près, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous fait signe ou frissonner ou honte et tout ce qui nous plonge, tout ce qui nous absorbe et nous dissimule, tout ce que nous perçons , respirons ou risquons malgré tout, tout ce que nous descendons ou qui nous emporte, tout ce qui nous enlise, tout ce qui rampe, tout ce qui s'élance, tout ce qui est en train de capturer ou de lâcher prise ou de trépigner ou de se recroqueviller et de se détendre, tout ce qui cache une trappe ou deux, tout ce qui rend souple, ivre, invulnérable, tout ce qui d'une touche légère met en mouvement un délicat mécanisme... fait irruption dans ces corps d'hommes et de femmes qui éclatent et s'endorment sous la constante ardeur de leur souffle fondu dans le moule sans forme, sans fond et sans issue praticable d'un labyrinthe de muscles tendus à l'extrême, le seul fil d'Ariane : la joie de l'égarement.
Ghérasim Luca, L'extrême occidentale, éditions Corti, 2013, p. 20-21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, l'extrême occidentale, caresse, corps, énumération, fil d'ariane, joie | ![]() Facebook |
Facebook |





