11/01/2015
Voltaire, Traité de la tolérance

Le liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
(Le Canard enchaîné)
*
[...] Nous avons en Europe plus de cent volumes de jurisprudence sur la sorcellerie, et sur la manière de distinguer les faux sorciers des véritables. L'excommunication des sauterelles, des insectes nuisibles aux moissons a été très en usage et subsiste encore dans plusieurs rituels. L'usage est passé ; on laisse en paix Aristote, les sorciers et les sauterelles. Les exemples de ces graves démences, autrefois si importantes, sont innombrables : il en revient d'autres de temps en temps ; mais quand elles ont fait leur effet, quand on en est rassasié, elles s'anéantissent. [...]
Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Vous avez élevé votre enfant, il vous doit du respect comme à son père, de la reconnaissance comme à son bienfaiteur. Vous avez droit aux produits de la terre que vous avez cultivée par vos mains. Vous avez donné et reçu une promesse, elle doit être tenue.
Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature, et le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est, dans toute la terre : « Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. » Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre : « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras. » [...] Le droit de l'intolérance est [...] absurde et barbare : c'est le droit des tigres, et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger, et nous nous sommes exterminés pour des paragraphes.
Voltaire, Traité sur la tolérance, dans Mélanges, texte établi et annoté par Jacques Van Den Heuvel, Pléiade, Gallimard, 1961, p. 582 et 583-584.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voltaire, traité sur la tolérance, croyance, intolérance, liberté de penser | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2015
André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”

Le matin venu
à André Beaudin
Dans un hôtel jaune,
repoussant les larmes
et les moignons sanglants
ensoleillés par le minuit,
entre l'embonpoint
de l'édredon jaune
et le sang des astres
battant à la volée
dans mes vaisseaux,
le sentier guidé
parmi la pierraille,
l'odeur de la mer
besognant les eaux,
j'égarais les flaques
de péchés maudits,
je mordais la mort
qui perdait haleine
à vouloir m'entendre,
je devenais pâle
pour n'avoir plus peur,
je m'épiais dans l'arbre,
montant et remontant,
m'épuisant à rire
dans cet hôtel jaune,
dans ce lit de fer,
éclairé jusqu'où,
feuille tombée vivante
d'un sommeil sans rêve
au milieu de toi,
promesse souterraine,
pousse nourricière,
douce comme le bleu.
Marseille-Lyon, 14 mars 1949
André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”,
Poésie / Gallimard, 1985, p. 165-166.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, “le matin venu”, peur, sommeil | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2015
Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”

Suite n° 4
retour] .dernier bain de saison
premiers pas sur la terre
neuve dans les dédales
leurs peaux sont
brunes
les filles du port vont autant
qu'elles possèdent les yeux
plus noirs
que l'olive sur l'arbre
l'oursin au fond
du seau
Nos peaux s'apparentent à celles
des serveuses de leurs
époux
en cuisine, en bateau
aux comptoirs des
cabanes
un lieu d'où tu ne m'as point
écrit
en cette journée prolongée
quelque chose de séparé
de certain et d'inclassable
a enfin lieu de sorte
que la rive du voyage
se rapproche aussi
de la fin du voyage
que le temps est
court celui par
lequel l'oracle attendu
par un monde qui
nous abrite
et quelle joie nous
guette .si possible
en plein jour.
Londres : un après-midi : l'entaille
de la couleur sur le mur de droite
dans la grande salle une
suture violette comme un velours
sur la même surface fleurit un imprimé
tons orange et vert empreintes bleu
orage cernées de ciel clair
je tombe tu me retiens
[...]
Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”,
Flammarion, 2011, p. 137-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, “suite 4”, voyage, corps, londres | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2015
Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Violon tzigane, la tempête gémit.
Fillette gentillette au sourire fielleux
me laisserai-je intimider par ton regard bleu ?
Il me faut beaucoup, beaucoup m'est superflu.
Si loin, si dissemblables en somme :
tu es jeune, moi j'ai tout vécu.
Aux jeunes le bonheur, à moi la mémoire seule :
Nuit de neige, étreinte fougueuse.
Câliné ? non. La tempête est mon violon.
Un sourire de toi lève la tempête en moi.
4-5 octobre 1925
Sergueï Essenine, Journal d'un poète, Éditions
de la Différence, 2014, p. 161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d'un poète, mémoire, tendresse | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2015
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, “Sonnets”

Qui cause ? Qui dose ? Qui ose ?
Si j'osais je dirais ce que je n'ose dire
Mais non je n'ose pas je ne suis pas osé
Dire n'est pas mon fort et fors que de le dire
Je cacherai toujours ce que je n'oserai
Oser ce n'est pas rien ce n'est pas peu de dire
Mais rien ce n'est pas peu et peu se réduirait
À ce rien si osé que je n'ose produire
Et que ne cacherait un qui le produirait
Mais ce n'est pas tout ça. Au boulot si je l'ose
Mais comment oserai-je une si courte pause
Séparant le tercet d'avecque le quatrain
D'ailleurs je dois l'avouer je ne sais pas qui cause
Je ne sais pas qui parle et je ne sais qui ose
À l'infini poème apporter une fin
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, “Sonnets”,
in Œuvres complètes, Gallimard, 1989, p. 301-302.

Près de la Dordogne
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, “sonnets”, qui cause ? qui dose ? qui ose ? | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2015
Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Première neige
En route. Silence blanc.
Sous les sabots sonne un galop.
Dans les prés seuls batifolent
des volées de corbeaux gris.
Envoûtée par quelque fée
la forêt somnole en rêvant.
e dirait-on pas le sapin
natté de tresse blanche.
Courbé comme une petite vieille
appuyée sur un bâton.
À la cime du houppier
un pivert martèle le tronc.
Le cheval caracole — vaste, l'espace !
La neige étale son châle de flocons.
Sans fin, la route fuit
comme un ruban à l'infini.
(1914)
Sergueï Essenine, Journal d'un poète, traduit
du russe, présenté et annoté par Christiane
Pighetti, éditions de la Différence, 2014, p. 49.

noyers en décembre
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d'un poète, première neige, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2015
Jean Tardieu, Margeries

Clair de lune
L'image qui s'annonce et qui me suit
Est-ce un rayon qui cherche au sol un doux appui
Ou cette forme qui profite de la nuit
Pour traverser à tire-d'aile sans un bruit
La blanche ville où le travail s'est endormi ?
Approche et marche de ce pas toujours parti !
Nous sommes seuls à travers tout ce qui fut dit
Comme des sages bienveillants qui ont compris.
Rien ne renonce, rien ne bouge, rien ne fuit.
Tout ce que l'ombre m'a donné, tu me l'as pris.
Cueille ce rêve si tu dors, je l'ai promis.
Jean Tardieu, Margeries, Gallimard 1986.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, clair d elune, ville, sommeil, rime | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2015
Jean Tardieu, Da Capo
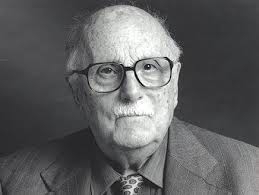
LES MORTS
NOUS TRAHISSENT TOUJOURS
(Hommage à André Frénaud)
Je vais le voir chez lui, où il repose à présent. C'est, comme on dit, un «beau» jour. Un jour qui passe gentiment ses rayons à travers les persiennes fermées comme le facteur glisse un pli dans la boîte aux lettres.
Il est couché dans sa chambre. Près de ses meubles et de ses tableaux. L'un des plus émouvants est une peinture de Raoul Ubac, rigoureuse et sobre, semblable à ses ardoises sculptées : une forme étendue, faite de larges bandes noires et blanches : le style abstrait, mais aussi un chevalier qui vient de mourir au combat.
Je le reconnais bien là, le combattant de la sincérité, sans peur et sans illusions. Je le reconnais malgré sa pâleur, malgré son immobilité. Il s'est endormi hier matin et ne s'est plus réveillé.
Je lui pose tout bas des questions. Mais il refuse de répondre.
Voilà : il ne veut pas répondre. Pour les vivants qui l'aimaient, c'est une ingratitude absolue. Pourquoi ? Parce qu'il est parti de l'autre côté de la barricade, dans une étendue interdite où on ne parle à personne. Comme si on l'avait chassé de notre monde, très loin, au fin fond d'un pays dont nous ne connaissons ni les couleurs, ni les sonorités, ni le langage.
Et maintenant, ce mutisme soudain ! Imposé. Implacable. Celui qui parlait avec son accent bourguignon où roule le bon tambour des R. Il était de ceux qui nous semblaient les plus aptes à nous renseigner, c'est-à-dire un poète qui, par l'acuité de sa vision, par sa «claire-voyance», traduite en mots si justes et si lourds, est un de ceux qui, en somme, n'ont rien fait d'autre, durant leur vie, que parler du scandale irrémédiable de la mort.
Ils nous ont abandonnés, ces ingrats. Leur front si plein, leurs voix si joyeuses ont tout emporté, même les chansons, leurs mains si belles avec ce croisement pareil à des menottes que nous leur imposons sans leur permission, ces mains ne pourront plus nous faire aucun signe, par exemple pour nous inviter à boire un grand verre de vin, ou nous désigner les chemins à prendre, — ou à éviter.
Nous qui sommes restés sur le seuil, à attendre sans rien comprendre, nous n'avons plus qu'une ressource, c'est de partir à notre tour, sans même avoir la récompense qu'ils nous accompagnent.
(Paris, 24 juin 1993)
Jean Tardieu, Da Capo, Gallimard, 1995, p. 34-35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, les morts nous trahissent | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2015
Christiane Veschambre, Versailles Chantiers

Traverse n° 4
une bifurcation inattendue au volant de la voiture je n'ai pas le temps
de réfléchir je choisis de prendre à gauche et immédiatement
nous comprenons que c'est la mauvaise route ce n'est pas une route mais
un chemin non carrossable plein de virages dont la terre s'incline
vers le profond ravin qu'il longe
dans lequel la voiture incontrôlable plonge
nous en sommes éjectés
nous tombons
comme au ralenti mais je sais que nous allons mourir quand nos corps
s'écraseront
je pense à ce que je n'ai pas fini d'écrire
c'est comme ça la mort ça ne laisse pas finir
alors
puisque tu chutes à côté de moi dans ce vide définitif
je prends ta main dans ma main
je n'ai pas peur
c'est entre le 25 et le 26 janvier 2012 que me visite ce rêve heureux,
deux nuits après avoir revu Mrs Muir et le capitaine Gregg partir main dans
la main, par la grâce de Joseph Leo Mankiewicz, de l'autre côté de la mort.
Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photographies Juliette Agnel, éditions isabelle sauvage, 2014, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, versailles chantiers, chute, mort, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2015
Jacques Roubaud, Description du projet : recension
En même temps que Octogone (Gallimard), qui rassemble des poèmes et des proses écrits ces dernières années, paraît Description d'un projet, publié en 1979 dans la revue Mezura sous une forme photocopiée ; on suivra les moments de la construction de ce projet dans le passionnant avant-propos de Jean-Jacques Poucel(1) ; on y comprendra également (p. 18-20) le rôle essentiel des nombres dans l'organisation du Projet et, plus largement, dans la poésie de Roubaud. Le livre relate l'évolution de ce qui a occupé Roubaud de 1961 à 1979 : comment donner sens à ses activités, c'est-à-dire à sa vie, de recherche et d'écriture ; les ouvrages et les articles (essais, poèmes, contes, traductions, etc.) publiés pendant cette période (dont la bibliographie clôt le livre avec la section VIII) s'intègrent eux-mêmes dans le projet.
Il est exclu de simplement décrire l'ensemble de cette biographie bien particulière, ne serait-ce que pour restituer la complexité des recherches dans plusieurs domaines, linguistique et mathématique, et les essais de formalisation dans laquelle le projet trouve sa place. L'intérêt du programme, dont la réalisation dépasse les efforts d'une seule personne, est sans doute de ne pouvoir trouver de fin ; la section VII, consacrée « aux livres préparés ou prévus », indique : « Il est à peu près certain que ce programme ne sera pas rempli en sa totalité. / Certains de ces livres [prévus par le Projet] existeront. Les autres auront pu avoir été. » Quels que soient les détours que semble prendre la recherche, il s'agit avant tout d'un « projet de poésie ».
Roubaud a vécu l'impasse de l'écriture en alexandrins et, tout autant, en vers libres ; il s'est alors tourné vers la tradition, précisément celle du sonnet. C'était pour lui retrouver « un fil formel très ancien », avec une « capacité de multiplication effervescente », et une forme riche également dans d'autres langues européennes ; en même temps, il marquait sa distance par rapport à ce qui s'écrivait au début des années 60. L'écriture de sonnets aboutit, avec l'exemple de Lewis Carroll, à un livre-jeu, fondé pour Roubaud sur le jeu de Go, livre qui offre par sa construction des lectures multiples et constitue parallèlement une histoire du sonnet — publié en 1967, avec un titre imprononçable, Î, grâce à Queneau. Cette histoire le dirige vers la lecture et l'étude des troubadours.
Parallèlement, le décalage entre la phrase dans le vers et la phrase dans la langue conduit Roubaud à l'étude des modèles mathématiques de la syntaxe. De là est construite une hypothèse concernant la nature de la poésie, supportée par deux thèses. La première, provocatrice, propose : "la poésie est mémoire de la langue", d'où l'idée que le changement dans la poésie anticipe les changements dans les théories du langage, et aussi que la mémoire « se manifeste [...] dans l'organisation rythmique » ; la seconde définit le rythme comme « combinatoire séquentielle hiérarchisée d'éléments discrets considérés sous le seul aspect du même et du différent », définition longuement explicitée. L'exploration de ces deux thèses s'effectue à partir de 1969 dans le cercle Polivanov(2). Les projets du cercle, partie du Projet de Roubaud, ont eu une visée totalisante : construire une bibliothèque qui réunirait tout ce qui a été écrit (livres et théories) concernant la poésie ; élaboration d'une métrique générale qui suppose l'étude des mètres dans un grand nombre de langues ; examen de toutes les théories du mètre ; description de tous les systèmes poétiques existants ; relations entre métrique et page ; etc. L'ensemble supposait que soit formé un « réseau international de chercheurs et informateurs » et appelait toute une série de monographies sur des auteurs, des œuvres et des genres.
Inutile de préciser que ce programme n'a eu que des réalisations partielles, mais les écrits de Roubaud prouvent que ce qui est au centre du Projet est toujours resté essentiel : répondre « à la question impossible : la poésie, quoi ? pourquoi ? comment ? » — des réponses au "quoi" et au "comment" sont proposées, mais « le "pourquoi" restera muet ». Réponses qui ont entraîné des recherches incessantes (sur la poésie japonaise, par exemple) et des collaborations nombreuses : Roubaud a participé avec Jean-Pierre Faye à la création de la revue Change — aussi à celle de PO&SIE— revues dans lesquelles il publiera des résultats de ses travaux, ainsi que dans Action Poétique. Réponses qui sont pour le lecteur à construire dans ses livres de poèmes(3), explicites dans son histoire de l'alexandrin ou, autrement, dans son anthologie des troubadours qui, selon l'exemple japonais ou celui de Jerome Rothenberg, constitue une construction poétique à partir de poèmes — un montage, principe auquel correspond celui de destruction : le sonnet émerge sur « les ruines de la forme héritée des troubadours [...], la canzone.»
Pour les lecteurs de le grand incendie de Londres, ils savent que le Projet a été abandonné, ce qu'a noté Roubaud, « En traçant aujourd'hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le projet de mon existence. » Reste que ces travaux, très divers et d'une grande étendue visent à comprendre ce qu'est la poésie et, à long terme, devaient aboutir à une sorte de manuel « pour aider les amateurs à écrire des poèmes ». Utopie ?
Jacques Roubaud, Description du projet, NOUS, 2014, 164 p., 16 €.
Cette recension a paru sur Sitaudis le lundi 22 décembre.
__________________
1. Jean-Jacques Poucel a publié Jacques Roubaud and the Invention of Memory, 2007, University of North Carolina.
2. Choix scientifique et politique : Polivanov (1891-1938), génial linguiste soviétique, spécialiste notamment du japonais et du chinois, était attaché à la poétique ; il a été fusillé dans les prisons staliniennes. Le cercle a été fondé par Léon Robel (slaviste, poéticien et poète) et Roubaud.
3. On reconstruira par exemple ce qu'est le principe de digression dans l'Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, où les décrochages à l'intérieur des phrases sont rendus visibles par la mise en page avec plusieurs couleurs. De même le principe d'opposition est lisible dans deux livres parallèles, Les animaux de tout le monde et Les animaux de personne.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, description du projet, recensio | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2015
Guillevic, Coordonnées

— À t'entendre on dirait
Que le jour s'est muré,
Qu'il ne nous reste sur les yeux
Que de la nuit martyrisée.
— C'est moins que rien, c'est tas d'absence.
Sommeil et masse.
— Le merle veut. Qui dirait mieux ?
Il parle d'air
Teinté de sang la nuit dernière.
— Sang ou musique,
On y voit noir.
— Peut-être un homme au fond du puits,
Grimpant encore
Puisque le noir n'est pas le jour.
— Je veux bien, si les roches
Pratiquent d'autres danses.
— Mais la pervenche a d'autres joies,
Car elle en dit
Plus que le pré ne peut en croire.
— Le tremblement léger
Qui n'arrivait à rien
Qu'à se trouver spirale,
En voie toujours de se former
Sans poids ni lieu.
— Un champ de seigle, un toit de tuile
Pour le soleil, et la fillette
Plus près du seigle que du ciel.
— On pourrait faire un jeu
Où les racines seraient surprises.
On les verrait qui alimentent.
— Presque pareils
A l'eau du lac avec la terre
Qui lui fait bol,
Ainsi nous sommes, quand tu pourras.
— Salue, arbre, salue, salue,
Salue la mer si tu vois loin.
Vous n'aurez pas
D'autres amours.
Guillevic, Coordonnées, éditions des Trois Collines,
Genève-Paris, 1948, p. 109-111.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, coordonnées, jour, nuit, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2014
Paul Claudel, Connaissance de l’Est

DÉCEMBRE
Balayant la contrée et ce vallon feuillu, ta main, gagnant les terres couleur de pourpre et de tan que tes yeux là-bas découvrent, s’arrête avec eux sur ce riche brocart. Tout est coi et enveloppé ; nul vert blessant, rien de jeune et rien de neuf ne forfait à la construction et au chant de ces tons pleins et sourds. Une sombre nuée occupe tout le ciel, dont, remplissant de vapeur les crans irréguliers de la montagne, on dirait qu’il s’attache à l’horizon comme par des mortaises. De la paume caresse ces larges ornements que brochent les touffes de pins noirs sur l’hyacinthe des plaines, des doigts vérifie ces détails enfoncés dans la trame et la brume de ce jour hivernal, un rang d’arbres, un village. L’heure est certainement arrêtée ; comme un théâtre vide qu’emplit la mélancolie, le paysage clos semble prêter attention à une voix si grêle que je ne la saurais ouïr.
Ces après-midis de décembre sont douces.
Rien encore n’y parle du tourmentant avenir. Et le passé n’est pas si peu mort qu’il souffre que rien lui survive. De tant d’herbe et d’une si grande moisson, nulle chose ne demeure que de la paille parsemée et une bourre flétrie ; une eau froide mortifie la terre retournée. Tout est fini. Entre une année et l’autre, c’est ici la pause et la suspension. La pensée, délivrée de son travail, se recueille dans une taciturne allégresse, et, méditant de nouvelles entreprises, elle goûte, comme la terre, son sabbat.
[1896]
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, Poésie/Gallimard 1974, p. 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, décembre, avenir, passé | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2014
François Rannou, Le livre s'est ouvert

À l'insu
ne pas s’arrêter. course, traversée, il n’y aura
aucune description assise. tableaux impossibles car
pour prendre la mesure du flux il n'est pas de mesure
et celui qui forme les lettres n'est pas plus grand qu'alors
les passants sur les digues. qu'il soit, celui-là,
chant aux longs vers rapides, précis, comme si rien ne devait
rester en deçà de la parole que sa prose ramène au plus
nu. les lignes rythmiques plus réelles que leur obscurité
& ses lettres affirment le départ toujours de sa
propre vie : le poème refuse l'immobile version du sujet arrêté.
s'inclure alors dans le cours insaisissable vidant de
l'intérieur nos mots même nos vies, comme d'un bord
à l'autre sans bord, temps traversé de temps. un nageur,
tête hors du courant, par ses gestes, brise,
restaure la surface, l'air plus loin redéployé. le point d'horizon
recule en un point d'orgue qui laisse sans voix.
François Rannou, Le livre s'est ouvert, La Nerthe / La Termitière, 2014
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois rannou, le livre s'est ouvert, traversée, poème, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2014
Joseph Joubert, Carnets, II

Un visage sans trait, un livre dont rien ne peut être cité.
Remplir un mot ancien d'un sens nouveau (dont l'usage l'avait vidé pour ainsi dire ou que sa propre vétusté en avait laissé s'échapper), ce n'est pas innover mais rajeunir. C'est enrichir les langues en les fouillant. Il faut traiter les langues comme champs. Il faut pour les rendre fécondes quand elles ne sont plus nouvelles, les remuer à de grandes profondeurs.
Le poli. Donner le poli. C'est là ce qui exige du temps. Et plus ce qu'on dit est neuf plus il faut de temps et de soins pour donner le poli.
Le poli conserve les livres, le marbre et le bronze. Il s'oppose à leurs rouilles.
Chaque auteur a son dictionnaire et sa manière — c'est-à-dire s'affectionne à des mots d'un certain son, d'une certaine couleur, d'une certaine forme, et à de certaines tournures de style, à de certaines coupes de phrase où l'on reconnaît sa main et dont il s'est fait une habitude.
Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994 [1938], p. 202, 211, 229, 235.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, livre, langue, style | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2014
Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Correspondance


Göttingen, dimanche [17 août 1913]
Cher Rainer,
Ta lettre arrive à l’instant et, mon bagage bouclé, je m’installe entre des courroies de plaid et un sac à main pour t’écrire, mon train part dans trois quarts d’heure. Mais je ne puis te dire combien c’est beau de partager ta rencontre avec Werfel [1], telle que tu la vis. C’est beau : de même qu’en Rodin, le grand âge dont tu rêvais avait étendu sa force sur toi, la jeunesse dont tu rêves se dévoile ici en un autre ; au moment même où Rodin te fuyait, effrayé et craintif, jusqu’à la quatrième chambre, cette jeunesse déjà s’apprêtait à paraître devant toi, vigoureuse, réconfortante, comme une justification de l’existence. Et c’est bien à toi que cela devait arriver : du fait que tout, en toi, à cause de l’intériorité même de ton destin, doit inéluctablement devenir image, dehors, évidence, œuvre presque. C’est pourquoi ce qui s’accomplit là, c’est encore ton propre bien, ton propre destin, obéissant à une nécessité première comme tout accomplissement intérieur, sous forme de dons, de donations qui ne sont jamais que l’envers de tes actes — et qui deviendront par la suite l’immense richesse dont tu auras gratifié la vie de Werfel. Toi seul au monde pouvais donner ainsi à sa parole la confirmation de la plus haute vérité d’existence : « Nous sommes. ».
Je suis très heureuse. J’aimerais prendre ton visage dans mes mains et te regarder ; bien que tu fusses encore ici il y a si peu de temps, te regarder comme pour la première fois. Tout est si bien, vois-tu. Il n’est devant toi que révélations, révélations sans fin.
Cela étant, sache supporter à Berlin ce que le corps ne peut éviter, puisqu’il reste toujours un corps, c’est-à-dire quelque chose de stupide, de craintif, exposé à tout ce qu’on peut imaginer ; et ne lui en veux pas s’il semble parfois s’acharner à faire ce que ton être intime envisage autrement, c’est-à-dire à s’exprimer par des signes et des réalités. C’est alors qu’il devient tourment, comme pour dire : cela me dépasse, moi pauvre sot.
Tu connaîtras encore beaucoup de tourments et de souffrances, mais sois tranquille, sois tranquille, cher, cher Rainer.
Lou.
Rainer Maria Rilke Lou Andreas-Salomé, Correspondance, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Gallimard, 1980, p. 268-269.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke lou andreas-salomé, correspondance, philippe jaccottet | ![]() Facebook |
Facebook |






