26/01/2015
Jules Laforgue, Pierrots
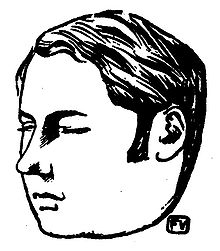
Jules Laforgue par Félix Valloton
Pierrots
(On a des principes)
Elle disait, de son air vain fondamental :
« Je t’aime pour toi seul ! — Oh ! là, là ! grêle histoire ;
Oui, comme l’art ! Du calme, ô salaire illusoire
Du capitalisme l’Idéal !
Elle faisait : « J’attends, e voici, je sais pas « ...
Le regard pris de ces larges candeurs des lunes ;
— Oh ! là, là, ce n’est pas peut-être pour des prunes,
Qu’on a fait ses classes ici-bas ?
Mais voici qu’un beau soir, infortunée à point,
Elle meurt ! — Oh ! là, là ; bon sang, changement de thèmes !
On sait que tu dois ressusciter le troisième
Jour, sinon en personne, du moins
Dans l’odeur, les verdures, les eaux des beaux mois !
Et tu auras, levant encor bien plus de dupes
Vers le Zaïmph de la Joconde, vers la Jupe !
Il se pourra même que j’en sois.
Jules Laforgue, Poésies complètes, Léon Vanier, 1902, p. 172-3.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules laforgue, pierrrots, art, candeur, ressusciter, dupe | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2015
Antoine Emaz, De peu

Bleu très bleu
dans le ciel sans fin d'œil
toute histoire engouffrée
rien
quasi lisse vaste couleur quelle
espèce de bleu
sans honte
tant il est sans mémoire
* * *
ciel plein ciel
sans anges
on rêve leurs battements d'ailes
leurs bruits de mouettes folles
d'envol
alors qu'on veut seulement des mots
pour ici
sous l'aplat de l'été
* * *
comme vivant sans mort
face levée face
au vide du bleu
distendu
couleur d'air
jusqu'à la nuit qui croûte
* * *
soleil fixe
dehors s'efface on s'efface
rien que de la lumière
et plus personne
pour voir
limite basse d'être là
l'été mure
* * *
tristesse sans cause
venue comme du bleu du mot trop court
pour trop de ciel
pas sûr que ce soit si simple
cela n'explique pas
cet abattis de fatigue
pas seulement le bleu
ce qui a lieu dessous
aussi
Antoine Emaz, "Bleu très bleu"
dans De Peu, Tarabuste, 2014, p. 269-270.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de peu, bleu très bleu, mot, tristesse | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2015
Juan Gelman, Vers le sud et autres poèmes, traduction Jacques Ancet

S'éveiller
ces poèmes que tu as écrits hier
tournent dans la chambre/ils ne
brillent pas comme ilsbrillaient dans la nuit/
dressés nus/comme des délires à venir/
ils ont beau marcher ils ne vont pas arriver dans ton pays/
ton pays c'est cette chambre pleine de ton pays/
une carte de ton pays est collée au mur/
bonjour te dit-elle chaque jour/vieille
est la pierre où assis attend l'espoir/tristes
les poèmes d'hier/tu regardes la carte
qui est seule et que frappe l'océan/tandis
que le poème du magnolia a les feuilles qui sèchent/
le poème du moineau ne vole plus/
les astres sont partis du poème du ciel/
le poème d'amour a froid/
et
tu trembleras dans la chambre qui s'est emplie de soir/
et plus tard elle s'emplira de nuit/
et tu tourneras comme un petit oiseau
avec son envol sous le bras/
à carmelo
Juan Gelman, Vers le sud et autres poèmes, traduction
et présentation Jacques Ancet, Poésie/Gallimard,
2014, p. 236.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan gelman, vers le sud et autres poèmes, traduction jacques ancet, s'éveiller | ![]() Facebook |
Facebook |
23/01/2015
Franz Kafka, À Milena

Prague, 8 juillet 1920, jeudi
Jeudi matin
Ta lettre enfin. Tout de suite quelques mots seulement, en hâte, sur l'essentiel, même si la hâte y mêle peut-être des inexactitudes que je regretterai plus tard : je ne connais pas d'autre cas semblable à celui de notre relation à tous les trois [1], et donc on ne doit pas le troubler avec des expériences tirées d'autres cas (cadavres — souffrance à trois, à deux — disparaître de telle ou telle manière). Je ne suis pas son ami, je n'ai trahi aucun ami, mais je ne suis pas non plus pour lui une simple connaissance, je lui suis en fait très lié, peut-être suis-je sur certains plans plus qu'un ami. Quant à toi tu ne l'as pas non plus trahi, car tu l'aimes, quoique tu en dises et quand nous nous unissons (merci, vous les épaules !) c'est à un autre niveau, hors de son domaine. Le résultat de tout cela est que cette situation n'est pas seulement notre situation à garder secrète, pas seulement souffrance, peur, douleur souci — ta lettre m'a effrayé en me tirant d'un calme relatif, calme qui provenait encore de notre rencontre et qui maintenant file peut-être à nouveau vers les tourbillons de Merano, quoi qu'il en soit, il y a de puissants obstacles au retour des conditions de Merano — mais c'est une situation ouverte à trois, claire dans son ouverture, même si tu devrais encore la taire un moment. Je suis très opposé à une réflexion sur les possibilités éventuelles — j'y suis opposé, parce que je t'ai, si j'étais seul, rien ne pourrait m'empêcher d'y réfléchir — dès le présent on s'érige soi-même en arène du futur, alors comment le sol dévasté pourrait-il porter la maison du futur ?
Je ne sais plus rien d'autre maintenant, je suis au bureau depuis trois jours et n'ai pas encore écrit une ligne, peut-être cela va-t-il marcher maintenant. D'ailleurs Max m'a rendu visite pendant que j'écrivais cette lettre, son silence va de soi, pour tous à part ma soeur mes parents la jeune fille et lui je suis passé par Linz.
F.
Franz Kafka, À Milena, traduit de l'allemand par Robert Kahn, éditions NOUS, 2015, p. 101-102.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, À milena, lettre, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
22/01/2015
Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny

Proust introduit ses personnages sans précaution particulière, sans éprouver le besoin de faire les présentations (au contraire de Balzac et de ses portraits en pied), bref en se contentant de les nommer comme si nous les connaissions depuis toujours, ce qui est aujourd'hui parfaitement vrai.
La Berma apparaît ainsi aux côtés de Sarah Bernhardt, dans une liste d'actrices dont la renommée est bien réelle, et cette proximité agit sur nous par contagion. Quant à Albertine, elle est déjà la fameuse « Albertine » (ce dont les guillemets ne permettent pas de douter), la première fois qu'on la nomme. Ce qui est alors vrai pour un groupe restreint de lycéennes l'est bien davantage, et dans un autre sens, pour la cohorte de lecteurs qui ont entendu parler de la nièce de Mme Bontemps, de Swann, de Saint-Loup, de Bergotte et de tant d'autres avant d'avoir lu la moindre ligne de la Recherche. En ce sens, oui, Proust écrit pour la postérité, dont la rumeur est intimement liée au plaisir de la lecture, grâce à l'impression de reconnaissance ainsi porté à son comble.
Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny, Le Bruit du temps, 2014 [1987, Gallimard), p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard macé, le manteau de fortuny, marcel proust | ![]() Facebook |
Facebook |
21/01/2015
Henri Thomas, La joie de cette vie
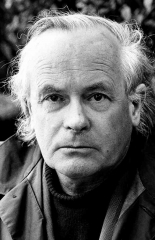
L’invisible chemin des longues plages, tout de suite effacé, regagne le temps. Marcher contre le vent, sans penser, tu reviens un peu sur l’enfance, les compagnons surprenants sont là, par instants, la longue vague, les oiseaux en équilibre sur l’eau qui monte et descend, l’horizon qui est après l’horizon, la myriade de débris, les témoins arrêtés des années…
Jeunes femmes vêtues d’un sac crevé, tenant aux épaules maigres, creuses, mais belles, par deux rubans en ficelle, et le haut du sac vient à mi-dos. Un slip en dessous, c’est parfait. « Je vous vois, mes filles, mes reines. » Il faudra décidément que je vérifie toutes mes citations de Rimbaud.
Les couleurs de la mer changent en une journée, les étendues vert clair, et celles plus sombres et l’air fraîchit, et les îlots jaunissent, s’intensifient. Des bandes brumeuses s’étirent sur l’horizon. L’esprit change, un autre esprit s’approche dans l’air, une balise gémit par intervalles.
Cette herbe déjà jaunie, en pente sur la mer, c’était ma place. J’y ai fait de bonnes lectures, et je descendais dans l’eau transparente. C’était une place pour moi, raisonnablement. Aujourd’hui, je n’y parviens plus, je ne l’ai même pas revue.
Même pas de pluie, qui rafraîchirait mon pauvre esprit et ses souvenirs, et ferait peut-être frissonner l’avenir.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 36 et 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, rimbaud, femme, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2015
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

EMILY B.
(Autour de « Wuthering Heights »)
Psaume I
Chair crayeuse
L’image évincée
De son corps d’enfant
Aux yeux creusés
Une morsure de dent sous la peau
Elle se débat puis voit le sang couler de son pied
Le saccage désormais en guise de destinée
Psaume II
J’attache une lanière au creux de mes reins
Je noie mes cheveux dans le sel ocre
Mes lèvres de givre embrassent l’herbe humide
Psaume III
Je passe l’après-midi à regarder la pluie tomber sur un mur de briques
J’offre mes entrailles à cris répétés
Vous aviez trahi, je l’ai compris.
À travers les maux gênants, la honte de rigueur et l’élan des gestes.
L’ondulation de votre chevelure noire, les tempes ensanglantées, une robe violette.
[...]
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Flammarion, 1997, p. 40-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, pour emily, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
19/01/2015
Pierre Jean Jouve, En Miroir
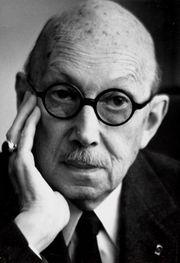
De la poésie
Poésie, art de « faire ». Selon cette définition qui remonte à la science des Anciens, la Poésie tient sous son influence, par rayons droits ou obliques, tous les autres arts de l’homme. Faire veut dire : enfanter, donner l’être, produire ce qui, antérieurement à l’acte, n’était pas. Mais l’esprit qui formule une réalité aussi fondamentale ne peut s’empêcher de la contredire, par une nuance opposée ; sans doute parce que, comme l’amour, la Poésie est soumise à une secrète interdiction. La Poésie, qui est pour les uns la chose la plus nécessaire, peut être aux yeux de beaucoup la chose la plus décriée.
La Poésie est rare. Si elle paraît avoir passé, au cours de son histoire, par tous les rôles et travestissements, ici discours et là ornement, simple convention de cour ou de salon, c’est que, comme toute acte « inventeur », elle est rare.
La Poésie est l’expression des hauteurs du langage.
Elle ne repose pas sur un nombre d’éléments sensibles comme la Musique. Embrassant par l’image, fruit de la mémoire, la totalité du monde virtuel, l’univers — elle est établie sur le mot, signe déjà chargé de sens complexe, et touchant une quantité incertaine du réel.
Univers : l’extérieur comme l’intérieur, la pensée comme la rêverie et tout l’instinct, hier et demain, ce qui est défini et ce qui ne saurait être défini.
Pierre Jean Jouve, En Miroir (1954, édition revue en 1970), dans Œuvre, II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987, p. 1055-1056.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, en miroir, la poésie, langage, rêverie, pensée | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2015
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée

Mort-nés
Ces poèmes ne vivent pas : c’est un triste diagnostic.
Ils ont pourtant bien poussé leurs doigts et leurs orteils,
Leur petit front bombé par la concentration.
S’il ne leur a pas été donné d’aller et venir comme des humains
Ce ne fut pas du tout faute d’amour maternel.
Ô je ne peux comprendre ce qui leur est arrivé !
Rien ne leur manque, ils sont correctement constitués.
Ils se tiennent si sagement dans le liquide formique !
Ils sourient, sourient, sourient, sourient de moi.
Et pourtant les poumons ne veulent pas se remplir ni le cœur s’animer.
Ils ne sont pas des porcs, ils ne sont pas même des poissons,
Bien qu’ils aient un air de porc et de poisson —
Ce serait mieux s’ils étaient vivants, et ils l’étaient.
Mais ils sont morts, et leur mère presque morte d’affolement,
Et ils écarquillent bêtement les yeux , et ne parlent pas d’elle.
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée, édition bilingue,
présentation de Sylvie Doizelet, traduction de Françoise Morvan et Valérie Rouzeau, Poésie/Gallimard, 1999, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d’hiver, précédé de la traversée, françoise morvan, valérie rouzeau | ![]() Facebook |
Facebook |
17/01/2015
Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète

Vous demandez si vos vers sont bons. C’est à moi que vous posez la question. Vous en avez interrogé d’autres auparavant. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d’autres poésies et vous vous inquiétez quand certaines rédactions refusent vos essais. Or (puisque vous m’avez autorisé à vous conseiller), je vous invite à laisser tout cela. Vous portez vos regards au-dehors ; or, c’est précisément ce qu’en ce moment vous devriez ne pas faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n’existe qu’un seul moyen, qui est de rentrer en vous-même. Cherchez le sol d’où procède ce besoin d’écrire ; vérifiez s’il étend ses racines jusqu’au plus profond de votre cœur ; faites-vous l’aveu de savoir si vous devriez mourir au cas où il vous serait interdit d’écrire. C’est cela surtout qui compte : demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit si vraiment il vous faut écrire. Creusez en vous-même jusqu’à trouver la réponse la plus profonde. Et si cette réponse est affirmative, si vous ne pouviez accueillir cette grave question qu’en disant simplement, fortement : « Oui, il le faut », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité ; votre vie doit être, jusqu’en ses instants les plus insignifiants et les plus minimes, la marque et le témoignage de ce besoin.
Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, traduction de Claude David, dans Œuvres en prose, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1993, p. 928.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, lettres à un jeune poète, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
16/01/2015
Renée Vivien, La Vénus des aveugles

Chanson pour mon ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès,
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
À travers champs, par les matins,
Mon ombre me suit comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe
Implacable comme un remords.
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,
Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, chanson pour mon ombre, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2015
André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie


Les Notes sur la poésie, écrites par Paul Éluard et André Breton, ont été publiées dans la Révolution surréaliste en 1929. Elles sont, à la manière de Lautréamont retournant La Rochefoucauld ou Vauvenargues, un démarquage d’une partie de Littérature de Paul Valéry
Les livres ont les mêmes amis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
Dans le poète :
L’oreille rit,
La bouche jure ;
C’est l’intelligence, l’éveil qui tue ;
C’est le sommeil qui rêve et voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui ferment les yeux ;
C’est le manque et la lacune qui sont créés.
La poésie est le contraire de la littérature. Elle règne sur les idoles de toute espèce et les illusions réalistes ; elle entretient heureusement l’équivoque entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création ».
Et ce rôle créateur, réel du langage (lui d’origine minérale) est rendu le plus évident possible par la non-nécessité totale a priori du sujet.
L’idée d’Inspiration est contenue dans celles-ci :
Ce qui coûte deux sous n’est pas ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne s’évalue pas en sous.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle fierté d’écrire sans savoir ce que sont langage, verbe, comparaison, changement d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’œuvre, ni les conditions de sa fin ; pas du tout le pourquoi, pas du tout le comment ! Verdir, bleuir, blanchir d’être le perroquet…
André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie, avec un dessin de Salvador Dali, G. L. M., 1936, non paginé (repris dans Paul Éluard, Œuvres complètes, I, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 473, 475, 476 et 478).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton et paul Éluard, notes sur la poésie, livre, poésie, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2015
Constantin Cavafy, Poèmes

Désirs
Semblables à des corps superbes de morts qui n’ont point vieilli,
ensevelis, au milieu des pleurs, dans un splendide mausolée,
des roses à la tête et des jasmins aux pieds —
semblables à ces corps sont les désirs qui passèrent
sans être accomplis, et dont aucun ne parvint
à une nuit de volupté ou à son lumineux matin.
Les fenêtres
Dans ces chambres obscures, où je passe
des jours qui m’oppressent, je rôde de long en large
cherchant à trouver les fenêtres. — Lorsqu’il s’en ouvrira
une, ce me sera une consolation. —
Mais il n’y a point de fenêtres, ou c’est moi
qui ne puis les trouver. Peut-être en est-il mieux ainsi.
Peut-être la lumière ne serait que nouvelle tyrannie.
Qui sait quelles choses nouvelles elle ferait surgir…
Constantin Cavafy, Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis,
Les Belles Lettres, 1977 (1ère édition, 1958), p. 25 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, poèmes, désir, corps, fenêtre | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2015
Écrits de Laure, texte établi par Jérôme Peignot et le Collectif Change

De la fenêtre présente et invisible
je voyais tous mes amis
se partageant ma vie
en lambeaux
ils rongeaient jusqu’aux os
et ne voulant pas perdre un si beau morceau
se disputaient la carcasse
La solitude ronge comme un chancre
Briser ce cercle
Arracher ce baillon
Tristesse et Amertume
rongent, rongent, rongent
le cœur comme les rats
Honte à toi
sans doute ?
Mais pas sûrement
un si curieux décalage
des mots
Qui braver ?
Le quotidien
le gris le terne
Que m’importe où je suis
si je sais où je vais
puis-je savoir où je vais
sans connaître où je suis
je peux le savoir
dans la mesure où je me situe
Aujourd’hui
c’est l’heure trouble
dans les rues grises et désertes
l’heure où les chauffeurs d’autobus
excédés des journées
enfilent des avenues
qui s’écartent toutes nues comme
des jambes de femme
chacun est rentré chez soi
pour oublier
dans les oins du ménage
qu’il ferait bon vivre
sous le soleil.
À chaque départ
Je prenais le train
Là même où les acrobates
font le saut périlleux :
sous les voûtes vitrées
des grandes gares
Écrits de Laure, texte établi par Jérôme
Peignot et le Collectif Change, éditions
Jean-Jacques Pauvert, 1977, p. 90, 121, 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, texte établi par jérôme peignot et le collectif change, tristesse, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2015
Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photos Juliette Agnel : recension
Les éditions isabelle sauvage débutent avec trois titres une nouvelle collection, ligatures, qui associent poèmes et photographies(1); on retrouve le soin apporté par l'éditrice à la fabrication de ses ouvrages : d'un format inhabituel (25x14,5), chaque livre est comme dans une boîte grâce à une couverture (chacune d'une couleur différente) dont une partie se rabat à l'intérieur ; les photographies, dont le tirage est excellent, sont en relation étroite avec le texte mais elles constituent chaque fois un ensemble que l'on regarde pour lui-même. Une réussite de ces éditions qui se consacrent depuis plus de dix ans à la poésie.
Versailles Chantiers présente de brefs poèmes-récits qui, à quelques exceptions près, débutent par une date — 24 décembre 1938, pour le premier — et dont on s'aperçoit vite que beaucoup d'entre eux ont un contenu autobiographique : on reconnaît dans les premiers personnages nommés, Joséphine T. et Robert V., ceux d'un précédent livre de Christiane Veschambre, Robert et Joséphine(2) ; elle-même rapporte ici qu'elle en fait une lecture de fragments. On relève d'autres éléments, comme la relation d'un voyage à Versailles de Christiane V. avec son époux, André A., dont le nom revient souvent ; etc. Cependant s'attacher à ce seul aspect, soit écrire Christiane V. = Christiane Veschambre n'avance en rien la lecture et il est plus intéressant de lire les récits en laissant de côté la relation avec la biographie.
Un premier texte, en italique pour se distinguer de la suite, explicite les circonstances de l'écriture du livre — invitation d'une Maison de la poésie à écrire autour de la gare de Versailles Chantiers — et en suggère une approche dans son incipit emprunté à l'astronome : « regarder l'espace c'est regarder le temps ». L'espace même de la gare et ses alentours organisent le temps du livre ; il débute en 1938 — Joséphine arrive de Bretagne à la gare pour un travail de bonne à La Jeune France, où Robert vient la chercher — et s'achève le 30 janvier 2012 : Christiane V. se rend dans le village qu'avait quitté Joséphine — partant de Paris, son train ne fait que traverser la gare de Versailles Chantiers. Dans ce cadre, vient s'insérer toute une série de faits liés plus ou moins directement à cette gare.
Le nom même de "Chantiers" évoque la construction du château de Versailles, Les chantiers sont sous la gare et autour d'elle, « comme une ville / enfouie, celle où, à partir de 1661, / se taillèrent, sur plusieurs chantiers, / les pierres du château. » Ces travaux font se souvenir des très dures conditions de travail des ouvriers, des morts nombreuses, et aussi des fêtes de Louis XIV avec la musique de Marin Marais dont Christiane V. écoute l'interprétation de Jordi Savall en 1980. D'autres moments d'un temps plus proche se greffent sur le lieu "gare", comme les ateliers d'écriture qui la prennent pour motif ou l'écoute du chanteur italien Gianmaria Testa qui avait, parallèlement, longtemps continué son métier : chef de gare.
C'est à Versailles Chantiers qu'André A. ôtait ses vêtements de civil et récupérait son vélo pour se rendre au camp de Satory, sur le plateau dominant Versailles, où il était soldat musicien ; un autre soldat y arrivait à un autre moment et distribua une nuit dans ce camp des tracts contre la guerre d'Algérie... Tous deux, sans se croiser, connurent dans ce lieu la fin du conflit en 1962. André A., beaucoup plus tard, retourna avec Christiane V. à la gare ; La Jeune France où il buvait autrefois un café était devenu une banque et la gare elle-même avait profondément changé. Les temps, tout au long des poèmes-récits, se croisent, liés aux espaces — celui de la vie de Robert et Joséphine, de la Seconde Guerre mondiale, du retour du prisonnier Robert, celui de la guerre d'Algérie, du travail, de l'écriture, etc. Quand il s'arrête, c'est dans le parc du château, le soir, au milieu des « buis taillés comme des / flammes consumées en bordure / du ciel qui tient tant de place » : il est alors possible de dire que temps et espaces ont été vécus ensemble, « Tel aura été / mon chantier, se dit-elle, être en vie / avec toi. »
Le lyrisme de Christiane Veschambre, s'il affleure dans cette méditation sur le tissu que forge la relation de l'espace et du temps, apparaît aussi dans les poèmes, intitulés "Traverses", avec des « choses d'un autre espace-temps, étranger, insaisissable, que sont le rêve, la mort, la coïncidence et l'oiseau. » Versailles Chantiers est en effet composé de quatre séquences de cinq poèmes-récits, chacune suivie d'une "traverse", auxquelles succèdent deux séquences de deux poèmes-récits, chacune suivie également d'une "traverse". Ces poèmes semblent bien éloignés des récits, ils en sont en réalité une manière de contrepoint : il n'y a plus que le néant avec la mort d'une amie, « traverse qui barre tout l'être », ou espace et temps comme annulés dans deux rêves de chute lente, ou dans une autre relation à l'humain avec la corneille immobile, « irruption animale de l'insaisissable » devant la fenêtre.
Que dire des photographies ? Juliette Agnel restitue justement, avec des jeux notamment sur le vert sombre des soirées pour les détails d'une voie, d'un escalier, d'une motrice, de l'intérieur d'un wagon, les vues partielles d'un bâtiment, toute la mélancolie du texte et celle que l'on attache aux gares, ces non lieux. Il y a bien ligature entre poèmes et images.
Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photographies de Juliette Agnel, éditons isabelle sauvage, 2014, 68 p., 18 €.
Cette recension a paru le 30 décembre sur Sitaudis
_________
1. En même temps que Versailles chantiers, sont publiés une, traversée, de Yves di Manno, avec des photographies d'Anne Calas, et chair de l'effacement, texte et photographies de Carole Daricarrère.
2. Christiane Veschambre, Robert et Joséphine, Cheyne, 2008.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, versailles chantiers, photographies de juliette agnel, gare, versailles | ![]() Facebook |
Facebook |





