02/10/2024
Jacques Réda, Les ruines de Paris

Tant bien que mal enfin j’attends la place de la Concorde. L’espace devient tout à coup maritime. Même par vent presque nul, un souffle d’appareillage s’y fait sentir. Et, contre les colonnes, sous les balustrades où veillent des lions, montent en se balançant des vaisseaux à châteaux du Lorrain, dont tout le bois de coque et de mâts, et les cordes et les toiles sifflent et craquent, déchirant l’étendard fumeux qui sans cesse se redéploie au-dessus de la ville. Je vais donc comme le long d’une plage, par des guérets.
Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, les ruines de paris, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2024
Ethel Adnan, Je suis un volcan criblé de météores

Poèmes d’amour
I
Ma gitane avait
de l’argent indien
sur tout le corps
Son nombril
comme l’étoile du matin
ses yeux
comme les prairies
des sierras
Elle était un cerf
et un sentier
menant à un archétypes de
lac
Un jour le soleil brilla
dans ses cheveux
et la forêt prit feu
mais la voiture tomba en panne
dans un virage de
a route
Et nous avons dormi sur un lit d’hôpital
afin de renaître
comme l’Arc-en-ciel indien.
(...)
Etel Adnan, Je suis un volcan criblé de météores, Poésie/Gallimard, 2023, p. 125-126.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ethel adnan, je suis un volcan criblé de météores, métamorphose, renaissance | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2024
Vadom Kosovoï, Correspondance Maurice Blanchot–Vadim Kosovoï

Après la lecture de L’Instant de ma mort, de Maurice Blanchot :
La mort en instance, serait-elle toujours la même DEVANT le même jeune homme ou le même enfant ? Et EN lui toujours aussi légère ?
Je la vis sans peut-être la voir (car je fermai les yeux, on le sait) à l’âge de sept ans ou, pour être plus précis, de six ans et demi, dans une petite gare, devant notre train qui devait repartir. Ce fut un lourd obus d’artillerie, trop lourd pour moi, qui gisait à même le sol, couvert d’immondices, (je le remarquai au dernier instant), que je levai péniblement, puis jetai (ou plutôt laissai tomber). Et qui s’enfonça dans mon œil gauche, quasi déchiqueta ma jambe gauche, couvrit ma tête, ma poitrine et mes bras de maintes traces indélébiles de souffrance. Je m’assis, la tête penchée.
Je la revis (si seulement ce « je » m’appartient) de nombreuses fois encore sur les corps mutilés de ces enfants qu’on apportait à l’hôpital, inertes et mugissants, pour les soigner un peu ou plutôt pour les laisser mourir. Je savais, me semble-t-il, que la douleur et l’agonie d’autrui me concernaient de près, qu’elles me promettaient ma propre fin.
Je la revis métamorphosée (mais toujours la même, celle que je croyais connaître, si ce n’est avoir connue) dans mes rêves illuminés, en prison, (deuxième ou troisième année), à travers le feu de plusieurs fins du monde les unes plus fantasmagoriques que les autres.
Je la vis une fois pour toutes (toujours en prison) bien plus calme, voire impassible, pendant une nuit d’adieu et d’extrême épouvante, après une expérience particulièrement lourde de hachisch, une mort qui me rendait mon MOI STRATÉGIQUE, affreusement émietté, dispersé par l’effet du poison [...].
Correspondance Maurice Blanchot –Vadim Kosovoï, Lettre à Maurice Blanchot du 3 novembre (1994 ?), dans PO&SIE, n° 112-113, éditions Belin, 2005, p. 110.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vadim kosovoï, correspondance avec maurice blanchot, mort, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2023
Georg Christoph Lichtenberg,Aphorismes

Les sabliers ne servent pas seulement à nous rappeler la fuite du temps, ils évoquent également la poussière que nous de viendrons un jour.
Une discussion sur l’honnêteté parmi des prisonniers dans la charrette.
L’homme a fait de lui-même un animal domestique, c’est pourquoi il est si corrompu que…
À tout instant comment cela peut-il être amélioré ?
Se métamorphoser en bœuf, ce n’est pas encore se suicider.
Ceorg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, Denoël, 1985, p. 65, 72, 74, 77, 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, métamorphose, amélioration | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2019
Eugène Savitzkaya, Saperlotte ! Jérôme Bosch
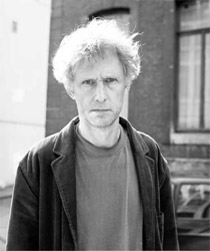
Je suis la plume qui cherche sa place et le pinceau fouillant l’humide obscurité de la couleur. Je bouge par déclics nerveux, je me meus par secousses afin de me débarrasser des peaux mortes et de diverses squames ancestrales. J’ai appris à m’ébrouer segment par segment comme un chien ou une fouine et quand je m’ébroue, je fais lâcher prise aux divers crabes accrochés à la racine de mes poils et me détruisant le dos à coups de rostre et de mandibules. Troué en mille points, peut-être déjà désossé, je peux qu’’avancer par secousses et par bonds. Et me voilà projeté vers l’image inconnue à travers un ciel bleu et gris comme une bonne cendre de bois variés et, à toute force, jusqu’à extinction, je tente de recomposer l’animal bicéphale et je jette mes deux jambes et mes deux bras dans un grand moulin d’huile fine où je perds mon nombril, où je confonds mes yeux avec ceux d’un chat, où je disparais avec mes outils et mes biens.
Eugène Savitzkaya, Saperlotte !, Jérôme Bosch, Flohic, 1997, p. 55 et 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, saperlotte !, jérôme bosch, métamorphose, crabe, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2019
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup

La chasse du cerf
(...)
Avant que de reprendre souffle [Actéon] sent fléchir
Ses jambes et son dos se courbe entraînant sa tête
Soudain plus pesante qu’un boulet de canon
Vers le sol où parmi les feuilles pourrissantes
Dorment des étoiles chapeautées comme des
Champignons sous leurs jupes plissées, il suit
La trace d’artémis à l’odeur de cuit bouilli
Il s’étonne et s’émeut à fouiller les sous-bois
À dévorer goulûment les faines éparses
Dans les sentiers l’herbe tendre et acidulée
La pomme comme un petit sein tendu et ferme
Il s’arrête et frémit une biche paraît
Qui le regarde doucement entre les hautes
Fougères les yeux noirs grands ouverts et profonds
Comme l’abysse où s’enroule au fuseau de la
Flamme le temps sans mémoire de l’être et seule
La turbulence des oreilles trahit la
Blessure d’un désir la divine surprise
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup,
Gallimard, 2007, p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup, artémis, action, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2019
Julien Bosc, La demeure et le lieu
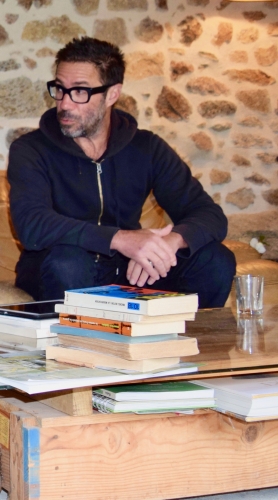
la locution « à bord de nuit »
comme dans « se promener à bord de nuit »
est-elle propre à cette famille de paysans
(de qui je l’affectionne et la tiens)
ou est-elle plus largement répandue
quoi qu’il en soit
si elle touche la corde sensible
c’est que
révélatrice des transmutations et métamorphoses
— où s’accordent mots et songes —
elle fait du crépuscule un navire
des cieux la mer
et
de la nuit
l’augure d’une traversée merveilleuse
— si
à bord
et au large déjà
la côte est laissée derrière soi
Julien Bosc, La demeure et le lieu, Faï fioc, 2018, p. 39.
© Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, la demeure et le lieu, expression, songe, métamorphose, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2019
Eugène Savitzkaya, Saperlotte !
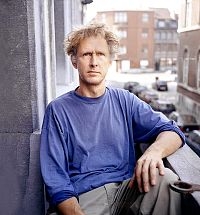
Pourquoi ne suis-je que moi-même, fil entortillé et noué autour d’une carcasse, perfection édentée et précaire ? Je serais autre chose avec plus de profit. Je serais un clou avec plus de profit, un clou planté dans la partie molle d’un pied. Je serais une jeune fille avec plus de profit, une jeune fille portant sur sa tête une poire et qui, nue et harassée, se tient debout comme par miracle. Je serais volontiers une jeune fille couchée sous un arbre et sur laquelle tombent des pétales et du lait de puceron. Je sentirais couler en moi des flux, je rosirais, je serais vulnérable et invincible, je soutiendrais mes seins avec mes bras croisés lorsque je les trouverais trop lourds et pour courir, j’enroulerais sur ma poitrine plusieurs tours de bande de coton qui me ferait comme une cotte de mailles. […]
Eugène Savitzkaya, Saperlotte !, Flohic éditions, 1994, p. 61 et 63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, saperlotte !, métamorphose, jeune fille | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2019
Thomas Kling, Échange longue distance

Actéon 5
petites images trouvées en marge, les idoles piteuses
communiqués de l’Institution idyllique, images radio
d’un relief romain défoncé, description violente,
ici en terrain isolé la nature a échafaudé une œuvre
d’art, grotte en trompe-l’œil du bain de Diane, d’où
transparence jusqu’au fond, la source résonne, trame
où D., nue, surprise par A., n’hésite pas longtemps, prononce peu
de mots : quelque chose comme tabou brisé, pores, mort ignominieuse,
qui entraînent rapidement perte de parole, cellule de cerf,
sa tête s’alourdit de cornes, un écho de brames, aucun répit avec ce
projecteur de cerf qui ronronne jusqu’au bout, puis déchirements. l’antiquité
en accéléré, une scène de chasse, comme des troubles du sommeil la lumière.
Thomas Kling, Échange longue distance, traduction Aurélien Galateau, éditions Unes, 2016, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas kling, Échange longue distance, diane, action, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2018
Bo Carpelan (1926-2011), Un autre langage
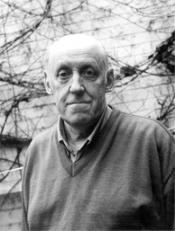
Métamorphoses du paysage
Métamorphoses du paysage, le cri
ivre du sommeil de la mort près du lit
où l’amour a déjà veillé —
paysage éternel
comme les nuages qui tintent dans le vent,
les voix avant que la mort les récolte,
les gens, les troupeaux de bétail
et les nuits tombantes du silence
les reflets tendres
de la vague éternelle
rayonnant à travers le sang :
nomade en toi, je vois
les ombres chinoises du manque
et le poids oscillant des montagnes en flammes.
Bo Carpelan, Un autre langage, traduction du suédois
(Finlande) Pierre Grouix, dans poe&sie, n° 131-132, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bo carpelan, un autre langage, métamorphose, paysage, silence, lit, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2017
Eugène Savitzkaya, Sang de chien

Comme un champignon je serai bientôt, comme un champignon esquinté par un groin si je continue à vivre de la sorte, si je continue à me frotter au vent, car le vent peu à peu me déforme le visage et me rend méconnaissable. Il entre par les narines et gonfle brusquement les sinus jusqu’à ce qu’ils explosent. Si je continue à manger mes peaux mortes, si je dors sur le ventre et la face écrasée contre terre. Si je continue à me coucher sur de la pierre, car la pierre, surtout le granit, contient une réserve d’humidité glacée qui a le pouvoir de se communiquer directement aux os et à la moelle. Si je continue à respirer. Si je continue à manger de la terre, et de la terre la glaise la plus salée, je deviendrai ça, une souche pourrie depuis longtemps et creuse, pleine du bois meulé et digéré par les insectes.
Eugène Savitzkaya, Sang de chien, éditions de Minuit, 1988, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, sang de chien, métamorphose, animalité, terre, insecte | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2017
Dorothea Grünzweig, Album de poésie

Traduis et rêve
Je suis un poème à l’instant traduit
dissous et récréé
ne me rappelle aucune dérive
entre mon moi démonté et remonté
rêve juste que c’est arrivé
Je dis
Viens vieux corps
sois mon hôte dans le nouveau
il vient
est invisible passe en moi
reste dans le présent
si bien que je suis moi et
à ma place
Un ruban me traverse
je n’en vois pas les extrémités
et quelqu’un dit
C’est la corde de l’âme
indissoluble inébranlable
Et dit
Elles seront autour de lui
car le corps n’est que prêté
transformées métamorphosées
Dorothea Grünzweig, Album de poésie,
traduction C. Colomb et M. Millischer,
dans Europe, n°1055, mars 2017, p. 264.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dorothea grünzweig, album de poésie, traduit er rêve, moi, corps, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2016
Oscarine Bosquet, Histoire de géographie, dans Gare maritime 2016

Je n’ai pas appris la leçon à la fin de la civilisation
européenne en Afrique ou en Amérique
la métamorphose des humanistes en bêtes
brutes pour éliminer les sombres autres
autres comme animaux singes
dinosaures
primitifs comme primates
têtes à extirper des terres
qui revenaient aux blancs
les hommes supérieurs
dont nous toi et moi.
Les fossiles d’ils seraient captivants.
Oscarine Bosquet, "Histoire de géographie", dans Gare Maritime 2016, Maison de la Poésie de Nantes, p. 24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscarine bosquet, "histoire de géographie", gare maritime 2016, civilisation, métamorphose, colonisation | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2016
Marie Cosnay, Vie de HB : recension
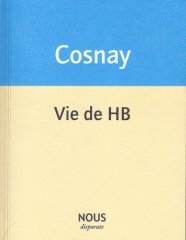
Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.
Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.
Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».
N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »
Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.
Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.
__________________________________________________
- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).
- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
Marie Cosnay, Vie de HB : recension
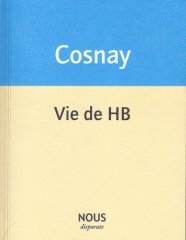
Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.
Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.
Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».
N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »
Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.
Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.
__________________________________________________
- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).
- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |
Facebook |





