09/05/2020
Giorgio Manganelli, Centuries

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à un vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), italo calvino, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2018
Giorgio Manganelli, Amour

[L’Amour]
A. Ainsi deviserons-nous de l’amour.
B. Et d’opportune manière, puisque discourant sur la vertu, la mort, la fuite, l’abolition de l’être, nus avons toujours et uniquement parlé de solitudes, d’abstractions et, même en dialoguant, nous ne sommes en fait jamais sortis du monologue.
A. Tandis que l’amour est mouvement de l’âme, qui exige un destinataire
B. C’est aussi mon avis.
A. Bref, en amour nous aurons un amant et un aimé.
B. Qui aime doit aimer quelque chose.
A. Quelque chose qui existe ? Ou d’aventure serait-il possible d’aimer ce qui n’existe pas ?
B. Quelque chose qui existe, je présume.
A. Une chose aimée, existante, mais aussi, puis-je supposer, distincte, jamais confondue avec qui aime.
B. Bien entendu, constamment distincte.
A. Dans tous les cas ?
B. Assurément, dans tous les cas.
A. Et, à ton avis, la dignité de l’amour réside davantage en celui qui aime, ou en celui qui est aimé ?
B. En celui qui aime, je crois ; ce dernier souffre, médite, s’acharne, s’agite, s’inquiète, il est noctambule et insomniaque, se méprend et ne voit pas ; bref, s’il n’était là pour aimer, quelle condition pourrait bien échoir à l’objet d’amour ? Si l’amour ne le touchait, ce ne serait que pauvre chose, à tous égards semblable à d’autres possibles objets d’amour, qui en aucun cas n’échappent à leur solitude.
A. Ainsi affirmes-tu que le dignité de l’amour, voire l’amour lui-même, sont privilège de l’amant.
B. Tout à fait.
A. Mais penses-tu que l’amant puisse destiner son amour à n’importe quel objet ? J’entends : est-il indifférent à la beauté, la sagesse, la grâce et le gloire ? Peut-il aimer toute chose, même minuscule et inanimée ?
B. Certes non ; l’amant aimera une chose non dénuée de grâce, pourvue d’un je-ne-sais-quoi, une parfaite douceur, de la noblesse.
A. Donc, l’objet aimé n’est pas étranger ou indifférent à ce mouvement de l’âme que nous appelons « amour ».
B. Non, assurément.
A. Et si l’amant aimait une chose d’une totale inconvenance, un homme de lettres mettons, un mathématicien épris d’un singe, un hérisson, une lame rouillée, verrions-nous encore en lui le dépositaire de la dignité de l’amour.
B. Il pourrait l’être, mais sa dignité serait profondément frustrée par le choix malheureux de son amour.
A. Donc, si je comprends bien, qui aime doit aimer un objet convenable ; s’il lui échoit au contraire d’aimer une chose inconvenante, il est alors dépossédé de la la dignité de l’amour.
[…]
Giorgio Manganelli, Amour, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Denoël, 1986, p. 103-105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, jean-baptiste para, dignité, beauté, convenance, dialogue | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2016
Giorgio Manganelli, Amour

Si tu m’aimes — et j’ignore si l’amour est permis à qui rêve — , tu m’aimes comme on peut aimer après bien des amours, au point que les mystères, les inexactitudes, les noms échangés, malicieuse persistance, rendent vague, inepte et hagarde toute tentative de ta part d’envoyer des messages, quel qu’en soit le destinataire naturel, ou laborieusement dénaturé, accessible aux seuls entretiens allégoriques ; tu pourrais avoir recours à des catalogues d’exploits, à des proverbes, à des indices flous mais non dépourvus de loyauté ; proposer des symptômes, des signes d’une maladie dotée de sens, un syndrome élaboré, un callot de rêves pénibles et hirsutes. Je pourrais accepter, me diras-tu, vieil homme, un billet vierge, et ne rien écrire dessus ; mais cette virginité ne sera-t-elle pas déjà une allusion au silence, à d’intolérables vacarmes, une proclamation d’identité, ou l’impossibilité de mesurer la distance et de sonder simultanément le désespoir, la dispersion, l’imminence, les allusions au néant ; ne sera-t-elle pas le plus muet murmure, ce qui reviendrait à dire : « Bien que je sois là, nous n’avons rien à nous dire » ; et même : « Toi et moi, nous nous ignorons depuis toujours. »
Giorgio Manganelli, Amour, traduction Jean-Baptiste Para, Denoël, 1981, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, message, lettre, vide | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2014
Giorgio Manganelli, Dall'inferno (Depuis l'enfer)

Long et flexible corps, serpentin, désossé, apte à glisser entre les doigts d'un astucieux sectateur qui poursuit pour réséquer ; visqueuse peau qui retient une main, livide pour figer de préhensibles chélates, scintillante, afin d'aveugler et dépouiller d'imprudentes paupières. Du cuir d'ailes se détache du buste, parce que voltigeur, en bonds prolongés et lents je passe d'arbre en arbre, de branche en branche ; je puis brièvement faire halte entre ciel et terre, pour lorgner la toile de fond, alentour, vers le haut ennemi ocellé, le diable, souverain putatif de l'ici-bas. Puis, élastiquement, je m'élance pour élire domicile dans une anfractuosité d'arbre faux, ou de roche de théâtre. Je suis reptile, écureuil, rat, taupe, couleuvre, ichneumon, scorpion, chauve-souris, amphisbène ; mais de tous-là, j'ai des choses que d'autres de leur espèce ne connaissent point ; ailes de taupe et regard de chauve-souris, en tant que rat je vole, couleuvre, je creuse des galeries au cœur de la terre. J'ai peur. Les fictions qui se pressent alentour, la fausse forêt, la complexe et sage astuce des vrombissements, des claquements, manifestement élaborés par les mains d'un alchimiste inepte ne me rassurent pas, mieux, m'alarment, comme indice d'invasion calculée et glacée, ruse intentionnelle pour me capturer et manipuler ma plurale nature, me décomposer, me corrompre et me défaire. Inlassables, mes yeux tournent et fixent, je rampe, j'oblique de lieu en lieu, d'ombre en ombre ; ma longue langue goûte les vénéneux engins que je redoute ; si les arbres sont des fictions, ils peuvent être des menaces, des pièges, de divines tromperies. Un insecte frémissant bourdonne, multiplie les pulsations de mes innombrables cœurs, je puis me décomposer en divers animaux en fuite, chacun est capable de méditer, de retrouver le vestige de lui-même, où s'évanouit le péril. Si une ombre change, je prends subitement mon envol. Je scrute, tente de langue, de queue. J'ai peur. Je vois que des formes de terreur jaillissent de mon corps, et que je fais ce que j'ai engendré ; mais ici-bas chacun engendre ses propres erreurs privées. Je fuis avec art, habile et subtil, avocassier, mais cela ne suffit pas : je dois m'interroger sur la chute de la lune. Je n'ignore pas que j'ai été lune.
Giorgio Manganelli, Dall'inferno (Depuis l'enfer), traduit par Philippe Di Meo, Denoël, 1985, p. 62-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, dall'inferno (depuis l'enfer), métamorphose, peur, fiction, illusion | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2013
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves)

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à une vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), jean-baptiste para, fantastique, humour, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2011
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason
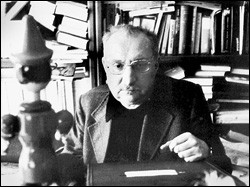 Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Les anciens savaient que chaque mot a un double, et que ce double a un destin qui n’est pas celui du mot. Écho est le double de la parole, qui témoigne pour elle quand elle a passé outre. Ce que nous lisons, écoutons, pensons, est parole, mais ce qui reste en nous est le double sous la forme d’Écho, c’est l’image de la parole « reflétée », mais le reflet n’a pas de reflet. Dans cette triste et gracieuse histoire, Écho se prend d’amour — « Je me suis désespérément prise d’amour » — pour Narcisse, lui-même amoureux, non pas de son double, mais de son image renversée. Il s’ensuit que c’est l’Écho qui permet à la parole de demeurer ininterrompue, car si elle n’avait pas ce double à sa disposition elle finirait par tomber, comme Narcisse, dans un amour spéculaire, porteur de mort comme le sont toutes les tentatives qu’on fait pour se posséder soi-même.
[…]
Giorgio Manganelli, Discours de l’ombre et du blason, ou du lecteur et de l’écrivain considérés comme déments, traduit de l’italien par Danièle Van de Velde, Fiction & Cie, éditions du Seuil, 1987, p. 122-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, discours de l'ombre et du blason, rêve, écrire, lire | ![]() Facebook |
Facebook |





