19/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : Quelque cose

Au matin
Je suis habitant de la mort idiote la tête comme un porridge
Les oiseaux s’envolent à l’avoine noire de fumée (il est quatre heures, il est cinq heures)
Les arbres s’habillent de fond en comble
Dans mon bol des archipels de boue noire qui fondent
Je bois tiède
L’église, le sable, le vent irrésolu
J’avance d’une ligne, à deux doigts
Je voudrais nous coucher tête-bêche
Tes yeux sur ma bouche à la place de ce rien
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, qualquer chose noir, mort, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2024
Zoé Karèlli, Solitude

Solitude
Où irons-nus, mon âme, avec
tout cet exil que nous traînons ?
Avec nous personne et la solitude
est devenue si étrange, qu’elle se confond
avec la compagnie de tous ces gens.
Tu parles et tu te tais et les choses
demeurent intraitables, comme si
nulle volonté ne venait les gouverner.
Plus comiques, les tristes efforts,
pourquoi tant de pessimisme ?... Comme si
le néant avait grandi, gonflé bizarrement,
il montre un visage furieux, informe,
près d’éclater, d’extraire de l’esprit
les foules qui le gardent et à présent
se contractent comme si le néant
se mettait à fourmiller.
Ah quelle misère ils contiennent,
les yeux de la solitude !
Fuyez très loin afin
de ne plus jamais rencontrer
notre image solitaire,
telle qu’aujoure’hui, entière, elle apparaît.
Zoé Karèlli, dans Poètes de Thessalonique (1930-1970),
traduit du grec par Michel Volkovitch,
Le miel des anges, 2024, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoé karèlli, solitude, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2023
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l'immobilité de Douve
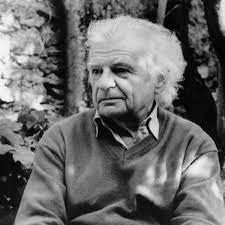
Derniers gestes VI
Sur un fangeux hiver, Douve, j’étendais
Ta face tumultueuse et basse de forêt.
Tout se défait, pensais-je, tout s’éloigne.
Je te revis violente et riant, sans retour,
De tes cheveux au soir d’opulentes saisons
Dissimuler l’éclat d’un visage livide.
Je te revis furtive. En lisière des arbres
Paraître comme un feu quand l’automne resserre
Tout le bruit de l’orage au cœur des frondaisons.
Ô plus noire et déserte ! enfin je te vis morte,
Inapaisable éclair que le néant supporte,
Vitre sitôt éteinte et d’obscure maison.
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve,
Dans Œuvres poétiques, Pléiade/Gallimard, 2013, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de douve, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2023
Carol Ann Duffy, Eurydice

Eurydice
Oh les filles, j’étais morte et au fond
de l’Enfer, un fantôme,
l’ombre de moi-même, un néant.
Cet endroit était le terminus du langage,
un sombre point final, un trou noir
où les mots devaient prendre fin.
Et c’est bien là qu’ils finissaient,
les derniers mots,
célèbres ou pas.
Ça m’allait à merveille.
Alors imaginez moi là,
indisponible,
hors du monde,
puis figurez-vous mon visage dans ce lieu
de Repos Éternel,
le seul où une fille se croit délivrée
du type d’homme
qui la suit à la trace
en écrivant des poèmes,
qui rôde partout quand elle les lit,
l’appelle Sa Muse
et qui a une fois boudé tout un jour et une nuit parce qu’elle avait critiqué son penchant pour les noms abstraits.
Imaginez ma figure
quand j’ai entendu —
Ô Dieux —
un toc-toc-toc familier à la porte de la Mort.
Lui en personne.
(...)
Carol Ann Duffy, Eurydice, dans L’Île rebelle, Anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle, édition bilingue, Choix de Martine De Clerq, préface de Jacques Darras, tous deux traducteurs, Poésie/Gallimard, 2022, p. 333 et 335.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol ann duffy, eurydice, enfer, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2022
John Keats, La poésie de la terre ne meurt jamais

Quand j’ai peur à l’idée que je pourrais cesser d’être...
Quand j’ai peur à l’idée que je pourrais cesser d’être
Avant que ma plume ait glané mon cerveau fourmillant,
Avant qu’une pile de livres, en caractères d’imprimerie,
Engrange le blé bien mûr comme de riches greniers ;
Quand je contemple, sur le visage étoilé de la nuit,
Les immenses symboles nuageux d’une noble idylle,
Et je me dis que je ne pourrai jamais vivre pour suivre
Leurs ombres, avec la main magique de la chance ;
Que je ne poserai jamais plus les yeux sur toi,
Ne connaîtrai jamais de plaisir dans le pouvoir féérique
De l’amour insouciant ! — puis sur la rive
Du vaste monde je me tiens seul, et je réfléchis
Jusqu’à ce qu’Amour et Renom sombrent dans le néant.
John Keats, La poésie de la terre ne meurt jamais, traduction
Cécile A. Holdban, Poesis, 2021, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john keats, la poésie de la terre ne meurt jamais, mourir, écrit, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
18/07/2021
Samuel Beckett, mirlitonnades

en face
le pire jusqu’à ce
qu’il fasse rire
*
rentrer
à la nuit
au logis
allumer
éteindre voir
la nuit voir
collé à la vitre
le visage
*
somme toute
tout compte fait
un quart de milliasse
de quarts d’heure
sans compter
les temps morts
*
fin fond du néant
au bout de quelle guette
l’œil crut entrevoir
remuer faiblement
la tête le calma disant
ce ne fut que dans ta tête
Samuel Beckett, (Poèmes suivi de)
mirlitonnades, éditions de Minuit,
1978, p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, mirlitonnades, pire, nuit, visage, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2020
Norge, La langue verte

La porte
Non, n’ouvre pas cette porte,
Ça donne sur l’océan...
Ça donne sur des cloportes...
Pas compris ? Sur le néant !
Après ça, c’est difficile
D’aller vivoter, Cécile,
C’est difficile, Zaza,
De vivoter après ça.
Disons qu’on a des raisons
De froid, de vent, de tonnerre.
N’ouvre pas, disons, disons
Que c’est pour les courants d’air.
Au bonheur des maisonnées
Il faut des portes fermées,
— Tralalire et troundelaire —
D’ailleurs l’usine a sifflé,
Il est grand temps d’y aller,
Prends bien la porte ordinaire !
Norge, La langue verte, Gallimard,
1964, p. 73-74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, la langue verte, la porte, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2019
John Clare, Poèmes et proses de la folie

Je suis
Je suis ce que je suis pourtant personne ne le sait ni n’en a cure
Mes amis m’ont abandonné comme on perd un souvenir
Je vais me repaissant moi-même de mes peines —
Elles surgissent pour s’évanouir —armée en marche vers l’oubli
Ombres parmi les convulsives les muettes transes d’amour —
Et pourtant je suis et je vis — ainsi que vapeurs ballotées
Dans le néant du mépris et du bruit
Dans la vivante mer des rêves éveillés
Où nul sentiment de la vie ne subsiste ni du bonheur
Rien qu’un grand naufrage en ma vie de tout ce qui me tient à cœur
Oui même mes plus chers soucis — les mieux aimés
Sont étrangers — plus étrangers que tout le reste
Je languis après un séjour que nul homme n’a foulé
Un endroit où jamais encore femme n’a souri ni pleuré —
Pour demeurer avec mon Dieu mon Créateur
Et dormir de ce doux sommeil dont j’ai dormi dans mon enfance
Sans troubler — moi-même introublé où je repose
L’herbe sous moi — couvert par la voûte du ciel
John Clare, Poèmes et proses de la folie, traduction Pierre Leyris, 1969, p. 77 et 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie, pierre leyris, oubli, abandon, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2017
Pierre Reverdy, Sable mouvant

Tard dans la vie
Je suis dur
Je suis tendre
Et j’ai perdu mon temps
À rêver sans dormir
À dormir en marchant
Partout où j’ai passé
J’ai trouvé mon absence
Je ne suis nulle part
Excepté le néant
Mais je porte accroché au plus haut des entrailles
À la place où la foudre a frappé trop souvent
Un cœur où chaque mot a laissé son entaille
Et d’où ma vie s’égoutte au moindre mouvement
Pierre Reverdy, Sable mouvant, Poésie / Gallimard,
2003, p. 87.
27/12/2016
Eugène Savitzkaya, À la cyprine

Crosse de la fougère née de la décomposition du monde, volubilis issu des boues, âpre arum urticant, ortie comme bouclier, boucle du liseron se propageant selon le métré précis qu’indique l’amas des racines, et coiffant les buissons de cassis, enroulement et déroulement, vie après mort, mort après vie, semant, perdant, poussant contre les murs du vide et du néant et rompant la pierre comme pain sec
Eugène Savitzkaya, À la cyprine, les éditions de Minuit, 2015, p. 60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, à la cyprine, nature, mort, vie, vide, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2016
Georges Bataille, Poèmes

ma folie et ma peur
ont de grands yeux morts
la fixité de la fièvre
ce qui regarde dans ces yeux
est le néant de l’univers
nos yeux sont d’aveugles ciels
dans mon impénétrable nuit
est l’impossible criant
tout s’effondre
Georges Bataille, Poèmes, dans
Œuvres complètes, IV, Gallimard,
1971, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, folie, fièvre, peur, néant, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2016
Albert Camus, Carnets III, mars 1953-décembre 1959

Cahier VII, 1953
Nécessité d’une aristocratie. Dans le présent, on ne peut en imaginer que deux : celle de l’intelligence et celle du travail. Mais l’intelligence à elle seule n’est pas une aristocratie. Ni le travail (les exemples, dans les deux cas, sont évidents). L’aristocratie n’est pas d’abord la jouissance de certains droits, mais d’abord l’acceptation de certains devoirs qui, seuls, légitiment les droits. L’aristocratie c’est à la fois s’affirmer et s’effacer. Pour sortir de soi (définition du devoir) l’intelligence ne peut aller vers les privilèges. Les uns font partie d’elle-même, les autres sont le contraire de l’intelligence. Et le devoir ne consiste ni à s’affirmer ni à se supprimer mais à faire servir ce qu’on affirme. Elle ne peut donc aller que vers le travail qui est son devoir et sa limite. Le travail de son côté ne peut aller vers l’abêtissement, inconscient ou conscient (humiliation généralisée de l’intelligence) qui est ou lui-même, ou son contraire (voir plus haut). Il ne peut donc aller que vers l’intelligence… Finalement l’aristocratie du travail et celle de l’intelligence ne sont possibles, dans le présent, que si elles se reconnaissent l’une l’autre, et commencent à marcher l’une vers l’autre pour consacrer un jour une seule image supérieure de l’homme.
La seule source de l’aristocratie c’est le peuple. Entre les deux, il n’y a rien. Ce rien qui est la bourgeoise, depuis 150 ans, essaie de donner une forme au monde et n’obtient qu’un néant, un chaos qui ne se survit encore qu’à cause de ses anciennes racines.
Albert Camus, Carnet III, mars 1953-décembre 1959, Folio / Gallimard, 2013 (1989), p. 122-123, 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets iii, aristocratie, intelligence, travail, bourgeoisie, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2016
Georges Perros, Poèmes bleus

Je te propose ce fugitif compagnonnage
Entre le chien et le loup
De l’aboiement crépusculaire
Je te demande de m’aider
À extraire de nos solitudes jumelles
Un peu de cette magie
Grâce à laquelle se renouvelle le bail
Se rafraîchissent nos tristes idées
Qui sont comme pierres dans un désert sans oasis
Stupidement debout contre le mur du néant
Comme lorsqu’on attend quelqu’un
Qui ne viendra pas
Qui ne viendra plus
Le rendez-vous n’aura pas lieu
Les pierres de Carnac sont comme ces idées
Muettes comme l’éternité
Justes bonnes à attirer ceux qui veulent savoir tout
Par le biais de qui ne sait rien
Ô l’Histoire belle paresse,
Mais vivre en est une autre, histoire,
Rempli d’épines, le chemin,
Et n’ignore-t-on pas encore
L’étrange énigme d’ici-bas ?
Georges Perros, Poèmes bleus, Gallimard,
‘’Le Chemin’’, 1962, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, poèmes bleus, solitude, néant, attente, carnac, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2015
Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours redouté ce qui pourrait me causer quelque ennui, aussi ai-je eu peur successivement de Croquemitaine, des figures de cire des Musées Dupuytren, des places trop fréquentées par les véhicules, des voyous, des pots de fleurs qui tombent sur la tête, des échelles, de la chaude-pisse, de la vérole, de la Gestapo, des V2. La paix n’a bien sûr, en aucune façon, calmé ces alarmes : ainsi, l’autre soir, je mange de la purée de marrons et je me mets à rêver que je suis dans une djip et que le conducteur ne parvient pas à éviter une épaisse colonne, je la vois venir, je me dis qu’on rentre dedans, ça y est, on est rentré dedans, tout noircit ; dans le noir, je me dis : je suis mort, je me dis : c’est comme ça quand on est mort, et puis je me réveille, l’estomac gros et le cœur battant. J’allume, je regarde la montre, il est deux heures, deux heures du matin, bien tôt encore, et je me lève pour aller pisser. Comme je ne pratique pas le pot de chambre, il faut que je me rende aux vécés. Il y a un long couloir. Je le traverse en disant : si ceci, si cela. J’arrive à me faire peur et je pénètre dans les chiottes bien heureux de pouvoir fermer la porte derrière moi, pour couper court, et se sentir chez soi, et non seulement fermer la porte, mais aussi tourner le verrou.
Je pisse.
Je tire sur la chasse d’eau.
Quand l’hygiénique glouglou se fut tu, je perçus dans le couloir la présence de néants, sans ambiance d’existence, ce qui me fit chaud dans les dents, froid sous les ongles, horripilation générale. Une frousse abjecte s’empara de mon âme et, prenant ma tête à deux mains, je m’assis sur le siège des vatères en gémissant sur mon sort immonde.
[...]
Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos, Gallimard, 1981, p. 157-158.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, une trouille verte, contes et propos, peur, rêve, insomnie, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2015
Pascal Quignard, Petits traités, V
Photo E. de Sabbia
Le livre est un petit parallélépipède où nous serrons des mots que nous emplissons de désir. Ces mots sont agencés en sorte qu’ils évoquent des choses nées de rien et qui ne portent aucune ombre. C’est sur fond de néant une énigme autour de laquelle nous tournons immobiles.
Toute lecture est une chimère, un mixte de soi et d’autre, une activité de scènes à demi souvenues et de vieux sons guettés. Il joue avec les chaînes d’or du langage.
Il romance sa vie avec ce qu’il lit. Il emploie son corps à ce qui n’est pas. Il argument avec ce qui argumente. Il rêve dans l’abandon. Il aime et, plus simplement qu’il aime, il hait.
Pascal Quignard, Petits traités, V, Maeght, 1980, p. 51 et 135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, v, livre, mot, énigm, néant, lecture, chimère, haine | ![]() Facebook |
Facebook |






