31/08/2019
John Taylor, Le dernier cerisier : recension
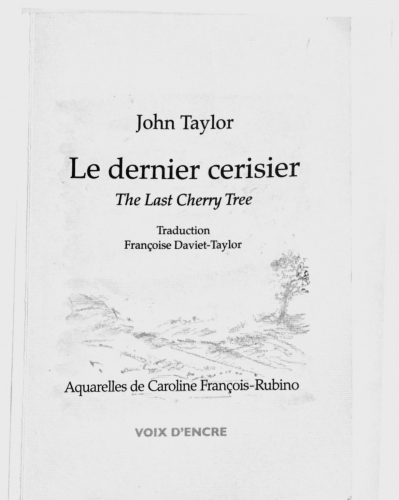
La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.
Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).
La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.
C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.
Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.
John Taylor, Le dernier cerisier, aquarelles de Caroline François-Rubino, Voix d’encre, 2019, np, 19 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 juillet 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2019
John Taylor, Le dernier cerisier

(…)
tout s’élève ou chute
de la matière à la matière
sauf la matière la plus essentielle
que tu as devinée
que tu devines
être en perpétuelle création
non pas de la matière
mais nos vies
montent
doivent descendre
un filet d’eau par terre
ou parmi les pierres
ou est-ce de l’eau de pluie
s’égouttant sur d’anciens chemins
pour nourrir le cerisier
que tu imagines tout en bas de la pente
à la fin
et au commencement
où que tu sois
est ton pays natal
aucun cerisier ne s’y trouve
puis il y en a un
il s’élève dans ton esprit
sur cette feuille de papier
sur cette page
John Taylor, Le dernier cerisier, traduction
Françoise Daviet-Taylor, aquarelles
Caroline François-Rubino, Voix d’encre,
2019, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, matière, création, caroline françois-rubino | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2016
John Taylor, Hublots / portholes, peintures de Caroline François-Rubino
On pourrait sans difficulté relire une partie de la littérature française (pas seulement, mais soyons modestes) à partir du thème de la fenêtre, passage entre le dedans et le dehors. On se souvient du duc de Nemours voyeur, la nuit, de son aimée dans La Princesse de Clèves, et de l’invitation de Baudelaire, dans Le Spleen de Paris, à découvrir l’intime, également la nuit : « Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » ("Les Fenêtres"). Aussi souvent la fenêtre ouvre sur le public, parfois l’inconnu, et l’on pense à la prison de Fabrice, aux Fenêtres de Mallarmé, à Emma Bovary, etc. Paul de Roux, à Paris, regardait de sa fenêtre le mouvement des nuages, la lumière, pour relire un poème d’ Apollinaire : « Tu soulèveras le rideau. Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre. (…) La fenêtre s’ouvre comme une orange. Le beau fruit de la lumière ». Le hublot est aussi une fenêtre, d’un genre particulier puisqu’elle n’est pas ouverture sur un dehors public.
Que voit-on ? Toujours : la mer, les infinies variations de l’eau, crêtes et creux des vagues, et ce qui s’y trouve : une île, un autre bateau ; ou, à l’approche de la terre, une falaise. Selon le moment, les formes changent, nettes sous le soleil, indistinctes, troubles, devenant confuses, s’effaçant presque avec la brume ou le soir venu ; les couleurs se transforment, du gris le plus profond au bleuâtre. Tous ces mouvements disparaissent avec la nuit et seuls les mots peuvent restituer cette absence et, tout aussi bien, ce qui est imaginé, qui prend aussi diverses formes.
C’est surtout cet imaginaire construit dans l’espace du hublot que peint Caroline François-Rubino. Ici pourra-t-on reconnaître la mer et ses mouvements, là le ciel et ses transformations selon l’heure, la saison, mais toujours les nuances et les arrangements du bleu qui laissent toute latitude pour inventer tous les paysages possibles. Ces peintures suggèrent que l’on peut, en laissant errer le regard, voir derrière le hublot des mondes inconnus, ce que dit le poème : il y a, aussi, une fenêtre pour revisiter le temps,
Le hublot
de la mémoire
cercler
teinter de bleu
ce qui est
un vide blanc
Poèmes et peintures conversent, se répondent, d’une certaine manière se commentent ; l’utilisation de la seule couleur bleue est en accord avec le caractère condensé des poèmes en anglais, fort bien adaptés en français. Ce lien très fort entre image et texte donne au livre une unité que n'ont pas toujours les "livres d’artiste".
John Taylor, Hublots portholes, peintures de Caroline François-Rubino, édition bilingue, traduction de Françoise Daviet, L’œil ébloui, 2016, 32 p., 13 €.
Cet article a paru dans Libr-critique.com, revue de Fabrice Thumerel, le 7 novembre 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, hublots portholes, caroline françois-rubino, fenêtre, mer, temps, mémoire, bleu | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2014
John Taylor, La fontaine invisible

Tout en haut de la sombre vallée, au sortir des ombres, tu trouves enfin la source jaillissante, assourdissante de l'Arc : de l'eau bondissant en cascade, de l'eau froide, de l'eau existant pleinement ici, qui s'impose.
Cependant tu souhaites encore qu'elle vienne de quelque Ailleurs. Tu t'es efforcé de monter un chemin escarpé, faisant souvent halte. Arrivant enfin. Cela est vrai. Tu souhaites recevoir une reconnaissance, une récompense.
Le ruisseau périlleux surgit plus loin, comme une langue de feu blanche, de sous un glacier recouvert de terre et de roches brisées. Aucune glace d'un pur cristal bleu. Aucune profondeur insondable, aucune réflexion de lumière.
Après avoir jeté dans l'eau quelques éclats de schiste, après avoir regardé comment ils ricochent et coulent sous l'éphémère surface, tu songes à te risquer plus loin — sautant d'une pierre glissante à la prochaine. Tu ne peux être sûr de pouvoir revenir. Poser le pied sur l'autre rive signifie longer la falaise...
John Taylor, La fontaine invisible, traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise Daviet, Tarabuste, 2013, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, la fontaine invisible, source, ruisseau, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |





