16/01/2021
Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein

[...] Moi non plus je n’aime pas les promenades, mais avec des amis, je fais des promenades, et de telle manière que ces amis s’imaginent que je suis un promeneur passionné, car je me promène toujours de manière si théâtrale qu’ils n’en reviennent pas. Je n’ai absolument rien d’un promeneur, et je ne suis pas davantage un ami de la nature, ni quelqu’un qui connaît la nature. Mais quand des amis sont à, je marche de telle manière qu’ils s’imaginent que j’aime me promener, que j’aime la nature et que je connais la nature. Je ne connais absolument pas la nature et je la déteste parce qu’elle me tue. Je ne vis dans la nature que parce que les médecins m’ont dit que si je voulais survivre, il fallait que je vive en pleine nature, c’est la seule raison. En réalité, j’aime tout, sauf la nature, car la nature me met mal à l’aise, et j’ai appris à connaître dans ma chair et dans mon âme ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, et comme je ne peux contempler ses beautés qu’en songeant en même temps à ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, elle me fait peur et je l’évite tant que je peux.
Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1985, p. 74-75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, le neveu de wittgenstein, promenade, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2019
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
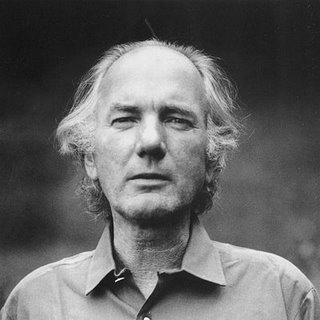
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
rien de ce tourment qui m’épuisait
comme la poésie qui portait mon âme,
rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs
qui me précipitent dans l’abîme.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
que j’ai dû traverser à gué dans le fleuve
dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,
et tu ne sais rien de cette formule magique
que notre Lune m’a révélée entre les branches mortes
comme un fruit du printemps.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,
qui me chassait à travers des forêts plus grandes que la terre,
qui m’apprenait à voir des soleils se lever et se coucher
dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
du trouble qui tourmentait le mortier,
rien de Shakespeare et du crâne brillant
qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,
qui roulait jusqu’aux blanches côtes,
au-delà de la guerre et de la pourriture, avec des éclats de rire.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
car ton sommeil passait par les troncs fatigués
de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, Orphée/La Différence,
2012, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, poésie, lune | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2019
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
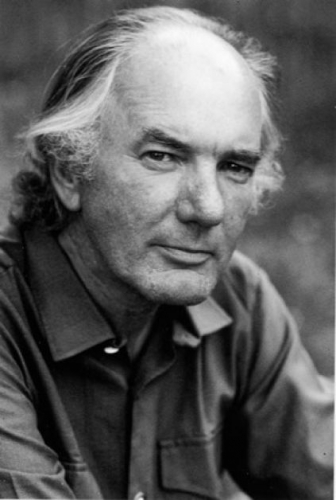
Où me pousse
le vent,
mon cœur,
mon cerveau,
en bas
dans la ville,
là-bas
dans la verdure
des collines délavées,
vers des femmes étrangères
vers
la lune,
mêlant
blanc
et rouge
sur un mur nu
de cimetière,
dans la forêt
qui, noire,
étend les jambes
et dans l’étang
rit,
s’envolent
sauvagement
les oiseaux oubliés
d’un coup,
où
mon vent,
mon cœur,
mon cerveau,
mes larmes ?
Thomas Bernhard, Sur
la terre comme en enfer, traduction
Susanne Hommel, Orphée/La Différence,
2012, p. 93 et 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, cœur, cerveau, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2019
Thomas Bernhard, Mes prix littéraires
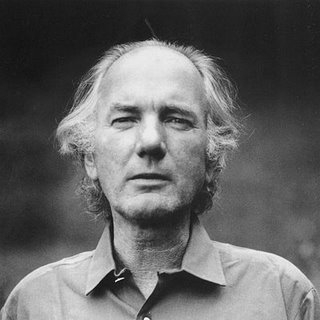
[après la publication de Gel]
[...] lorsque le déluge de critiques, incroyablement violent et complètement contradictoire, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces, a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux , mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensai-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus, située sur la Klosterneuburgerstrasse. Pendant des mois j'ai fait des livraisons de bière pour la célèbre brasserie Gösser. Ce faisant, j'ai non seulement très bien appris à conduire des camions, mais aussi à connaître encore mieux qu'avant la ville de Vienne tout entière. J'habitais chez ma tante et je gagnais ma vie comme chauffeur de poids lourds. Je ne voulais plus entendre parler de littérature, j'avais placé en elle tout ce que j'avais, et elle m'avait récompensé en me jetant au fond d'une fosse. La littérature me dégoûtait, je détestais tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous les livres. Il me semblait qu'en écrivant Gel, j'avais été victime d'une escroquerie gigantesque. J'étais heureux quand, dans ma veste de cuir, je m'installais au volant du vieux camion Steyr et sillonnais la ville en faisant vrombir le moteur. C'est là que se montrait toute l'utilité pour moi d'avoir appris à conduire des camions depuis longtemps, c'était une des conditions pour obtenir un poste en Afrique auquel je m'étais porté candidat, des années auparavant, ce qui finalement ne s'était pas fait, en raison d'un concours de circonstances en réalité très heureux, comme je sais aujourd'hui.
Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, traduit de 'allemand par Daniel Mirsky, "Du Monde entier", Gallimard, 2009, p. 41-42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, littérature, critique | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2019
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
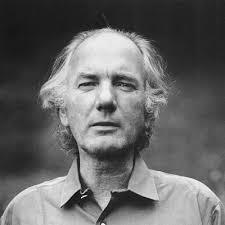
Devant le pommier
Je ne meurs pas, avant d’avoir vu la vache
dans l’étable de mon père,
avant que l’herbe ne rende ma langue acide
et que le lait ne métamorphose ma vie.
Je ne meurs pas avant, avant que ma cruche ne soit remplie à ras bord
et que l’amour de ma sœur ne me rappelle
combien est belle notre vallée
où ils battent le beurre
et tracent des signes dans le lard pour Pâques…
Je ne meurs pas, avant que le forêt n’envoie ses tempêtes
et que les arbres parlent de l’été,
avant que la mère ne sorte dans la rue avec un fichu rouge
derrière la charrette cahoteuse, où elle pousse
son bonheur : pommes, poires, poulets et paille —
Je ne meurs pas, avant que ne se referme la porte par laquelle
je suis venu
devant le pommier —
Thomas Bernhard, Sue la terre comme en enfer, traduction Susanne Hommel, Orphée / La différence, 2012, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sue la terre comme en enfer, pommier, mourir | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2017
Thomas Bernhard, Kulterer
Plus approchait le jour où il serait libéré de la centrale, plus Kulterer craignait de revenir auprès de sa femme. Il menait une vie refermée sur elle-meme, totalement ignorée par ses co-détenus, et il tuait le temps libre, qui était souvent bien trop long à la centrale car ils ne travaillaient, selon le règlement, que cinq à six heures par jour aux machines d’imprimerie, en notant des idées subites ou, pensait-il, des pensées insignifiantes qui l’occupaient presque sans interruption. Par ennui, et parce qu’il eût désespéré sans cela, il se lisait souvent à lui-même de courtes histoires et de courts récits qu’il avait lui-même inventés et rédigés. Le chat par exemple ou La cale sèche ou Les palmipèdes, L’hyène, La régisseuse de la propriétaire terrienne, Le lit de mort. La plupart du temps, ces histoires lui venaient la nuit, et il devait, pour ne pas les perdre, se lever et s’asseoir à la table dans l’obscurité tandis que ses compagnons de cellule dormaient, et noter dans cette même « obscurité effrayante » ce qui lui était venu.
Thomas Bernhard, Kulterer, traduction Claude Porcell, Arcane 17, 1987, p. 81-82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, kälterer, prison, libération, écriture, ennui, survivre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2016
Thomas Bernhard, Mes prix littéraires
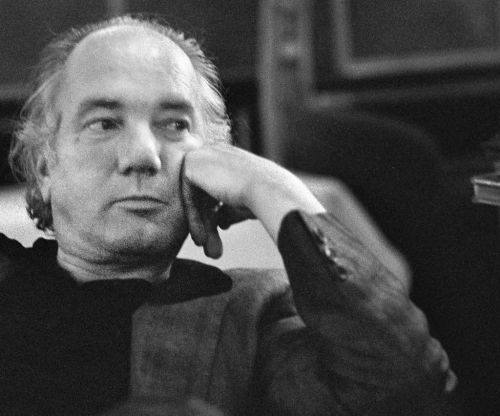
Discours de la remise du prix d’État autrichien
Il n’y a rien à célébrer, rien à condamner, rien à dénoncer, mais il y a beaucoup de choses dérisoires, tout est dérisoire quand on songe à la mort.
On traverse l’existence affecté, inaffecté, on entre en scène et on la quitte, tout est interchangeable, plus ou moins bien rodé au grand magasin d’accessoires qu’est l’État : erreur ! ce qu’on voit : un peuple qui ne se doute de rien, un beau pays — des pères morts consciencieusement dénués de con science, des gens dans la simplicité et la bassesse, la pauvreté de leurs besoins… Rien que des antécédents hautement philosophiques, et insupportables. Les époques sont insanes, le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenues les éléments de notre détresse quotidienne. L’État est une structure condamnée à l’échec permanent, le peuple une structure perpétuellement condamnée à l’infamie et à l’indigence d’esprit. La vie est désespérance, à laquelle s’adossent les philosophies, mais qui en fin de compte condamne tout à la folie.
Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, 2010, p. 142-143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, mort, dérision, état, bêtise, échec | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2015
Thomas Bernhard, Je te salue Virgile
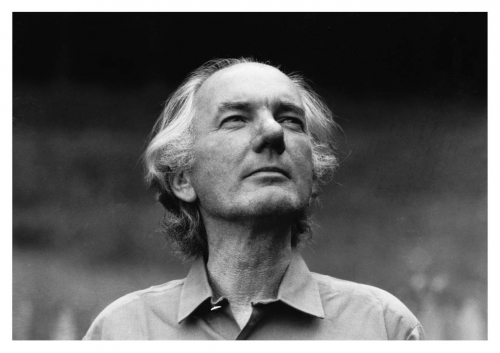
Octobre
Sur ces amas de décombres, ne riment à rien
les lamentations de la mère,
à rien l'intercession du père ivrogne,
à rien le récit mortuaire du lieutenant,
la rébellion des cardinaux à rien,
à rien la projection de l'avenir,
les pleurs de tous les peuples à rien,
à rien l'éther mortifié,
la fin des océans...
Les mâchoires enfouies je les déterre,
ces avilissements,
ma décrépitude, je les fais comparaître
devant ma bouche dépravée,
devant mon crâne desséché
jusque dans ma piteuse fin de matinée...
Dans la nuit
tu compenses les incendies de ce monde
par mon imbécillité fraternelle...
Thomas Bernhard, Je te salue Virgile, traduit de
l'allemand par Kza Han et Herbert Holl,
Gallimard, 1988, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, je te salue virgile, octobre, décombres, lamentations, rien, mère | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2014
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
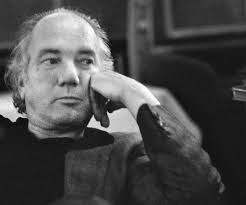
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
rien de ce tourment qui m'épuisait
comme la poésie qui portait mon âme,
rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs
qui me précipitent dans l'abîme.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
que j'ai dû traverser à gué comme le fleuve
dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,
et tu ne sais rien de cette formule magique
que notre Lune m'a révélé entre les branches mortes
comme un fruit de printemps.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,
qui me chassait à travers des forêts plus grande que la terre,
qui m'apprenait à voir des soleils se lever et se coucher
dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit,
du trouble qui tourmentait le mortier,
rien de Shakespeare et du crâne brillant
qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,
qui roulait jusqu'aux blanches côtes,
au-delà de la guerre et de la pourriture avec des éclats de rire.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
car ton sommeil passait par les troncs fatigués
de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée" / La Différence, 2012, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, frère, nuit, savoir, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2014
Thomas Bernhard, Sur les traces de la vérité
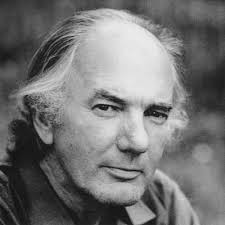
Manie de la persécution ?
Lorsqu'à Hainburg
j'eus soudainement faim,
j'allai dans une auberge
et je commandai,
revenant de Cracovie,
un rôti de porc aux boulettes des pommes de terre
et une pinte de bière.
En traversant la Slovaquie
mon ventre s'était vidé.
Je discutai avec le patron,
il disait, ces Juifs polonais,
ils auraient dû les tuer tous
sans exception.
C'était un nazi.
À Vienne j'allai à l'hôtel Ambassador
et je commandai un cognac,
un cognac de France naturellement,
un Martell par exemple, dis-je,
tout en discutant avec un peintre,
qui affirmait sans cesse au sujet de lui-même
qu'il était un artiste
et qu'il savait ce qu'était l'art,
alors que le reste du monde tout entier ignorait
ce qu'était l'art,
bientôt il s'avéra que
c'était un nazi.
À Linz j'allai au café Draxelmayer
boire un petit café au lait
et je parlai avec le maître d'hôtel
du match de football Rapid Vienne contre LASK Linz
et le chef de rang disait
les joueurs du Rapid, il faudrait tous les gazer,
aujourd'hui Hitler aurait encore plus de boulot
que de son vivant,
bref il s'est avéré très rapidement que
c'était un nazi.
À Salzbourg
j'ai croisé mon ancien professeur de religion,
qui m'a dit droit dans les yeux
que mes livres
et tout ce que j'avais pu écrire jusqu'à présent
étaient du rebut,
mais qu'aujourd'hui on pouvait publier n'importe quel rebut,
à une époque comme la nôtre,
qui était fondamentalement ordurière,
sous le Troisième Reich, disait-il,
je n'aurais pu faire publier aucun de mes livres,
et il souligna que j'étais un salopard,
un chien hypocrite,
puis il mordit dans son sandwich au saucisson,
arrangea sa soutane en tirant dessus des deux mains,
se leva et partit.
C'était un nazi.
D'Innsbruck j'ai reçu hier une carte postale
illustrée du petit toit d'or symbole de la ville,
et sur laquelle on lisait, sans plus d'explications :
Les gens comme toi devraient être gazés ! Tu ne paies rien pour attendre !
J'ai relu plusieurs fois la carte postale
et j'ai eu peur.
Thomas Bernhard, Sur les traces de la vérité, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, Arcades / Gallimard,
2011, p. 258-260.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur les traces de la vérité, nazi, art, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2013
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se mheurt [sic]
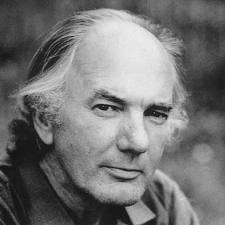
(...) Tant que nous avons vécu chez nos parents, nous étions en réalité enfermés dans deux cachots, et lorsque l'un de nous croyait être enfermé dans le cachot le plus terrible des deux, l'autre avait tôt fait de le détromper en rapportant que le sien était bien plus terrible. Les maisons familiales sont toujours des cachots, rares sont ceux qui parviennent à s'en évader, lui dis-je, la majorité, c'est-à-dire quelque chose comme quatre-vingt-dix-huit pour cent, je pense, reste enfermée à vie dans ce cachot, où elle est minée jusqu'à l'anéantissement, jusqu'à mourir entre ses murs. Mais moi, je me suis évadé, lui dis-je, à l'âge de seize ans je me suis évadé de ce cachot, et depuis je suis en fuite. Ses parents m'avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être cruels, tandis que, réciproquement, les miens lui avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être atroces. Lorsque nous nous retrouvions à mi-chemin entre nos maisons parentales, lui dis-je, sur le banc à l'ombre de l'if, je ne sais plus si tu t'en souviens, nous parlions chaque fois de nos cachots familiaux et de l'impossibilité d'y échapper, nous échafaudions des plans, uniquement pour les rejeter aussitôt comme totalement chimériques, sans cesse nous évoquions le renforcement continu du mécanisme répressif de nos parents, contre lequel il n'y avait aucun remède.
[...]
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se meurt, récits, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, Gallimard, p. 11-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, retrouvailles, goethe se mheurt, parent, haine | ![]() Facebook |
Facebook |
07/05/2013
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
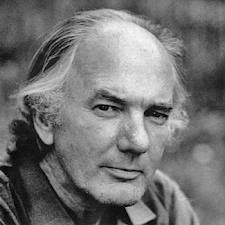
Personne ne te connaît
Du festin de joie ne resta que la cruche du tourment
Chidiock Tichborne
Personne ne te connaît
et quand tu meurs,
ils se glissent dans les manteaux,
pour t'ensevelir.
N'oublie jamais ça !
Personne n'a besoin de toi
et quand tu meurs,
ils battent le tambour
et tiennent leur langue.
N'oublie jamais ça !
Personne ne t'aime
et quand tu meurs,
ils enfoncent ton mal du pays
et le rentrent dans la terre.
N'oublie jamais ça !
Personne ne te tue
et quand tu meurs,
ils te crachent dans ta chope de bière
et tu dois payer.
Dich kennt keiner
Von Freudenmahl blieb mir der Knug der Pein
Chidiock Tichborne
Dich kennt keiner
und wenn du stirbst,
schlüpfen sie in die Mäntel,
um dich zu verscharren.
Vergiß das nie !
Dich braucht keiner
und wenn du stirbst,
schlagen sie auf die Trommel
und halten den Mund.
Vergiß das nie !
Dich mag keiner
und wenn du stirbst,
treten sie dein Heimweh
zurück in die Erde.
Vergiß das nie !
Dich tötet keiner,
doch wenn du stirbst,
spucken sie dir in den Bierkrug
und du mußt zahlen.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer [édition bilingue],
traduit de l'allemand et présenté par Susanne Hommel, Orphée / La Différence, 2012, p. 105 et 104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2012
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
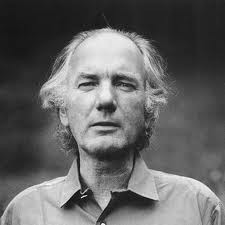
Ma mort viendra bientôt
par le champ, fatiguée,
quand les ombres
des corbeaux noirs
se précipitent sur l'herbe
et, derrière la maison, l'arbre
ferme les paupières
dans la neige
et quand soufflent
les mots
de l'hiver qui approche
L'âme malade, regardant
autour d'elle,
ne glisse plus vers le village.
Mein Tod kommt bald
über den Acker, müd,
wenn in das Gras
die Schatten stürzen
schwarzer Raben
und hintern Haus der Baum
die Lider schließt
im Schnee
und mahen Winters
Worte wehn...
Die kranke Seele huscht
umblickend nicht mehr
auf das Dorf
hinüber.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand
et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée", La Différence, 2012, p. 97 et 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
29/02/2012
Thomas Bernhard, Mes Prix littéraires
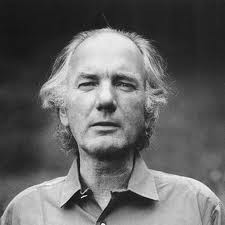
[après la publication de Gel]
[...] lorsque le déluge de critiques, incroyablement violent et complètement contradictoire, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces, a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux , mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensai-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus, située sur la Klosterneuburgerstrasse. Pendant des mois j'ai fait des livraisons de bière pour la célèbre brasserie Gösser. Ce faisant, j'ai non seulement très bien appris à conduire des camions, mais aussi à connaître encore mieux qu'avant la ville de Vienne tout entière. J'habitais chez ma tante et je gagnais ma vie comme chauffeur de poids lourds. Je ne voulais plus entendre parler de littérature, j'avais placé en elle tout ce que j'avais, et elle m'avait récompensé en me jetant au fond d'une fosse. La littérature me dégoûtait, je détestais tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous les livres. Il me semblait qu'en écrivant Gel, j'avais été victime d'une escroquerie gigantesque. J'étais heureux quand, dans ma veste de cuir, je m'installais au volant du vieux camion Steyr et sillonnais la ville en faisant vrombir le moteur. C'est là que se montrait toute l'utilité pour moi d'avoir appris à conduire des camions depuis longtemps, c'était une des conditions pour obtenir un poste en Afrique auquel je m'étais porté candidat, des années auparavant, ce qui finalement ne s'était pas fait, en raison d'un concours de circonstances en réalité très heureux, comme je sais aujourd'hui.
Thomas Bernhard, Mes Prix littéraires, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, "Du Monde entier", Gallimard, 2009, p. 41-42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prix littéraires, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2011
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts
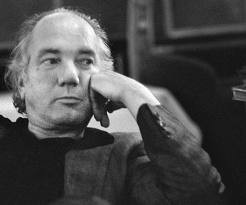 Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.
Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.
L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.
Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |






