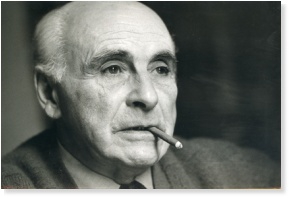08/04/2017
Pétrarque, Le Chansonnier
CCLXXII
La vie s’enfuit et ne s’arrête une heure,
et la mort vient derrière à grand’journées,
et le présent, et les choses passées
guerre me font, et encore les futures,
et souvenir et attente m’afflige
de part et d’autre ; aussi en vérité,
si je n’avais de moi-même pitié,
déjà serai de ces tourments sorti.
À l’esprit me revient le peu de bien
que reçut mon cœur triste ; et d’autre part
vois contre mon voyage les vents irrités,
je vois tempête au port, et déjà las
mon nocher, et rompus mâts et haubans,
et les beaux feux que contemplais, éteints.
Pétrarque, Le Chansonnier, traduction,
Introduction et notes Gérard Genot, Aubier
Flammarion, 1969, p. 203.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrarque, le chansonnier, passage, souvenir, tristesse, métaphore, tempête | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2017
David Constantine, Gare d'Oxford, 15 février 1997
Gare d’Oxford, 15 février 1997
Et puis tout s’arrêta, tout devint très calme.
Je regardais plein nord un petit nuage dans le ciel bleu
Un ciel bleu vers lequel s’éloignaient les rails.
Un bleu, si sereinement bleu, qu’il me troubla
Comme quelque chose d’inimaginable que je pouvais voir
Et pour lequel je n’avais pas de mot, je regardai le nuage
Un seul nuage blanc dans ce ciel sereinement vide
Léger comme une plume au bord des lèvres
Pour tester le souffle, ultime preuve de la vie.
David Constantine, dans Rehauts, n° 39, mars 2017, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david constantine, gare d'oxford, rehauts, nuage, bleu, ciel, vide, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2017
Ariane Dreyfus, La bouche de quelqu'un
C’est ainsi
Hasard légèrement fleuri, s’enracinant à peine,
Je contemple le vent, je respire.
Ne plus dire car personne, et même aucune image ensemble, que je donnais on visage à boire dans tes mains.
Tu l’as renversé, et encore renversé.
Même si je glisse
Non je ne suis pas sur le rocher !
Je tire sur la corde,
Pourquoi tiendrait-elle, tu l’as lâchée.
Pas comme l’amour qui n’ôte pas ses mains. Des miennes je m’accroche aux mots appuyés.
Enflure sans danse
- ardent découpage, oubli passionné.
Un jour, puis deux
Avec leurs joues à embrasser, ne pas embrasser.
Ils viennent tous.
Ariane Dreyfus, La bouche de quelqu’un, Tarabuste, 2003, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, la bouche de quelqu’un, image, amour, oubli, baiser | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2017
Francis Ponge, Prose ou poésie
Prose ou poésie
Bien sûr j'ai lu les Poèmes en prose de Baudelaire et les proses de Mallarmé dans Divagations : sont-ce des poèmes en prose ? Cette antinomie entre poésie et prose est un non-sens. [...] J'aime Connaissance de l'Est de Claudel, mais non pas Les Nourritures terrestres de Gide, un livre que l'on peut appeler de prose poétique. Le fait qu'il n'y a plus de règles fixes de prosodie, proésie, signifie qu'il est impossible de classer intelligemment des proses comme poèmes et d'autres non. Une des premières anthologies de poèmes en prose d'après-guerre s'achève, je pense, sur moi. [...] L'anthologie commençait avec Parny au XVIIIe siècle. Ensuite venaient Aloysius Bertrand, Michaux, moi-même. Mais mes textes critiques, mes textes sur les peintres par exemple, sont tout aussi difficiles, souvent plus difficiles, à écrire que ceux considérés comme poétiques. Je ne fais pas de différence. Mes audaces et mes scrupules sont les mêmes, quelque genre que vous assigniez au texte. Mon premier recueil, publié en 1926, s'intitulait Douze petits écrits et s'ouvre avec trois ou quatre po... choses que l'on peut considérer comme des poèmes, si cela vous plaît.
Francis Ponge, "entretien avec Anthony Rudolf", 4 mai 1971, Modern poetry in Translation, n°21, juillet 1974, dans Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, traduction de l'anglais par Bernard Beugnot, p. 1409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, prose ou poésie, genre, anthologie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2017
Léon-Paul Fargue, Espaces
Les souvenirs, (…) les souvenirs de l’enfance houlaient, se bousculaient pour me regarder, se posaient net et sans bruit comme des insectes, ou passaient par mes yeux, tout faits, d’un seul coup de balancier sur les placards, ou lentement comme une décalcomanie, parfois pathétiques et tachés sourdement, comme l’empreinte sacrée dans le mouchoir, avec des battements de trapèze de ciels mouvants où s’infiltraient délicieusement en moi comme une liqueur qui porte aux larmes. Je voyais le visage de mon père et de ma mère, la bonne figure de la mère Jeanne, des chambres et des chemins de fer, des maisons coupées comme des cartes, la marmite à Papin, des revenants de fiacres et de lumières le long de l’eau, des feux de bois couvés de veillées, des maladies et des chaussons aux pommes. Là-dedans miroitait la maison Deyrolle, rue de la monnaie, berceau d eleur famille, avec une pleine vitrine de Morphe Élénor, son artillerie de microscopes et l’odeur de mort préparée.
Léon-Paul Fargue, Espaces, Gallimard, 1929, p. 146-147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, souvenirs, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2017
Jacques Borel, Commémorations
La collection
Pendant des années, je n’ai pas pu passer par cette étroite rue qui fait un coude, à l’angle d’une place irrégulière où saillent, au milieu, deux ou trois maisons plus anciennes et plus basses, aux hautes toitures de tuiles petites, brunies et rectangulaires comme il n’en existe plus nulle part dans la ville, mais dans des villages seulement, toujours plus reculées, aux alentours, sans m’approcher, une fois de plus, de cette boutique devant laquelle, enfant, adolescent, m’avait, au sortir du lycée, si souvent immobilisé la rêverie, et de nouveau, ramené par la même fascination, je n’étais plus que ce regard qui me quitte, franchit la cloison transparente et coule au loin, dans l’eau, dans l’air empoussiéré de la vitrine, à travers les étoiles de mer séchées, les éponges, les coquillages — corne d’abondance tarie et ridée de l’euplectelle, oreille déchiquetée de la strombe, pareille à celles, monstrueuses, démesurées , de ces idiots couverts de bave, à Ligenèse, spires, volutes, cœur pétrifié du cardium et, sur une étagère en retrait, cette conque aux lèvres entrouvertes où affleure le murmure d’une mer captive—,
(…)
Jacques Borel, Commémorations, Le temps qu’il fait, 1990, p. 165-166.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques borel, commémorations, collection, fascination, vitrine, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2017
Jean Tardieu, Accents
Le solitaire
Ce cloître est grand, que l’absence fait naître ;
Pourtant les murs étoufferaient leur maître
S’ils n’étaient peints de fresques et de fenêtres.
L’une est parfois un miroir vis-à-vis
Où seulement la colline revit,
Pâle trésor à l’univers ravi ;
Et si le jour a des plumes plus douces
Pour déposer le pollen et la mousse
En la cellule où l’amertume pousse,
Le soir envoie une ombre de cyprès
Sur le mur blanc. La lune veille auprès.
La nuit s’engrange au fond d’un cœur secret.
Mais tout le songe enchaîné des images
N’est qu’un captif aux mains de la Plus Sage
Dont les portraits et les mille visages
Sont regardés au long de ce moutier
Et font pleuvoir sur le monde effrayé
Un regard clair et jamais détourné.
Jean Tardieu, Accents, Gallimard, 1939, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, accents, le solitaire, portrait, fresque, monastère | ![]() Facebook |
Facebook |
31/03/2017
Alexander Dickow, Rhapsodie curieuse (diospyros kaki)
[…]
III
Je disais : on ne connaît ni ne cherche le divers. On est, on est dedans un tel mélange de fatras de merveilles qu’on se prive mal d’y oublier un peu son mal et son manque.
Qu’on ne s’y perde pas, qu’on s’y abandonne. Il faut dire — oui, il faut dire ! faut dire que je préfère les rhapsodies aux sonates. Je veux aller au fil du vau-l’eau. Je suis bel et bien l’homme égaré qui ne sait où il va, ou encore :
« Tell me
Which is the way I take :
Out of what door do I go
Where and to whom ?
Je ne sais où je me trouve et me trouverai, pourquoi serais-je ici autrement ?
Alexander Dickow, Rhapsodie curieuse (diospyros kaki), Louise Bottu, 2017, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, indécision, rhapsodie, sonate, rhapsodie curieuse (diospyros kaki) | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2017
Étienne de la Boétie, Vers français

Ores je te veux faire un solennel serment,
Non serment qui m’oblige à t’aimer davantage,
Car meshuy je ne puis, mais un vray tesmoignage
A ceulx qui me liront, que j’aime loyaument.
C’est pour vray, je vivray, je mourray en t’aimant.
Je jure le hault ciel, du grand Dieu l’heritage,
Je jure encor l’enfer, de Pluton le partage,
Où les parieurs auront quelque jour leur tourment ;
Je jure Cupidon, le Dieu pour qui j’endure ;
Son arc, ses traicts, ses yeux & sa trousse je jure :
Je n’aurois jamais fait : je veux bien jurer mieux.
J’en jure par la force & pouvoir de tes yeux,
Je jure ta grandeur, ta douceur & ta grâce,
Et ton esprit, l’honneur de ceste terre basse.
Étienne de la Boétie, Vers français, dans Œuvres complètes,
II, édition par Louis Desgraves, Conseil général de la
Dordogne/William Blake & Co, 1991, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne de la boétie, vers français, dans Œuvres complètes, ii, sonnet, poésie amoureuse, fidélité, éloge | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2017
Bernard Noël, Des formes d'elle

Des formes d’elle
I
vivre dis-tu
c’est la venue
d’un mystère il s’empare
de nous tu vois cette ombre
sur le corps
tu vois
ce fantôme en dessous
la matière a besoin
de matière
ce besoin
est notre infini
ma langue
touche en toi une serrure
intime
tu fais de moi
un moi par-dessus les morts
par-delà les vivants
Bernard Noël, Des formes d’elle, dans
Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L,
2010, p. 279.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, des formes d’elle, les plumes d’Éros, vivre, mystère, matière, langue, moi | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2017
Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et bestiaires en surimpression,

Le vent a troussé les ombrelles
le lac est sombre, le parc s’égoutte.
Aux eaux, où il s’est établi
quelques semaines voici trois mois,
la pluie rebute les curistes
pour le plaisir d’irréductibles
qui, comme lui, ont cette prétention,
la seule, d’apprivoiser le temps.
La bulle, comme l’éprouvette,
la trouvaille plus ou moins gonflée
mais repues de gaz, de vapeur.
On avance, oui, on avance
et vous aurez bientôt un bruit
d’une saloperie inouïe.
Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et
bestiaires en surimpression, suivi de, BÂT.B2, Le
bruit du temps, préface de Jean Roudaut,
2017, p. 68 et 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèmes costumés avec attelages et bestiaires en surimpression, pluie, temps, bruit | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2017
Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng — recension

On connaît Jean-René Lassalle traducteur de poètes allemands contemporains — récemment Oswald Egger, avec Rien, qui soit —, et quand on lit ses traductions on ne peut ignorer que lui-même écrit. Rêve : Mèng est présenté par son auteur comme un livre d’hommage à la poésie classique chinoise, écrite du viie au ixe siècle. Une première partie donne, chacun dans un carré, 4 textes en idéogrammes, chacun de 5 vers de 5 mots, suivis chaque fois, également dans un carré, de leur transcription dans notre alphabet, puis de la traduction mot à mot, la longueur des syllabes étant transposée en français.
Une seconde série de poèmes en chinois est proposée, toujours en carré, écrite par Jean-René Lassalle, « Avec une langue dans laquelle on n’a pas vécu, c’est le rêve qui se poursuit. » Mais, cette fois, la traduction mot à mot est un point de départ pour l’écriture et quatre poèmes sont proposés à partir de quatre modes de lecture indiqués en fin de recueil :
« horizontal (de la première à la dernière ligne, de droite à gauche), palindromique (de la dernière à la première ligne, de droite à gauche), vertical (en colonne de gauche à droite), en spirale ( de la première ligne à gauche jusqu’au mot du centre). »
Le point de départ, pour la dernière étape (transposition en français) donne pour les deux premières lignes du poème "Gare jaune : Huáng zhàn" :
gare tot part trace route
jaune fleurs fond brume ans
— les tons sont indiqués pour chaque mot afin d’introduire dans la prononciation, autant que faire se peut, quelque chose de la mélodie chinoise.
Il s’agit donc d’écrire à partir d’une contrainte, pas plus forte ni plus arbitraire que celle qui régit le sonnet ou la ballade ; on pourrait penser aux règles de l’Oulipo, mais ici la recherche formelle passe par une langue dont la grammaire n’a pas grand chose à voir avec celle du français, et le cheminement de Jean-René Lassalle consiste à travailler aussi cette différence de relation de la langue au monde. Il aboutit à trois séquences de 5 vers et une de 4, en retenant du poème de départ tel mot (« gare », « fleurs »), ou bien il emploie ce que l’on désigne communément par synonyme (partir / démarrer), mais qui modifie la vision ; pour le début de la lecture horizontale :
une gare démarre pour bâtir une voie
fleurs jaunes au fond d’années de brouillard
Les différents jeux de variations font entrer dans un univers parallèle, non pas donné, plutôt à construire par le lecteur ; ainsi pour la lecture en mode vertical :
l’escale dorée dote, c’est une escale-vents
ombelles de gourdes matines furètent début de cycle (etc)
Il faudrait évidemment ne pas citer de vers en exemple : chaque poème est formé de l’ensemble rapidement décrit ici, depuis les idéogrammes jusqu’à la dernière séquence en mode spirale. C’est d’ailleurs le tout, c’est-à-dire les 4 « nouveaux carrés chinois », écrits par Jean-René Lassalle, qui, en regard (en miroir) des 4 carrés des poètes Tang (titrés « dans le style ancien »), constitue un hommage à une poésie trop peu connue. En outre, l’un et l’autre groupement de poèmes lient un passé lointain au présent par la reprise des contraintes (5 vers de 5 idéogrammes / mots dans un carré), formant un texte dont on isole difficilement un fragment, jeu du passé-présent qui donne son sens au titre, "Mèng" signifiant « rêve ».
Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng, éditions Grèges, 2016, 70 p., 12 €.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 2mars 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, rêve : mèng, poésie chinoise | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2017
Thérèse d'Avila, Le Livre de la vie
Chapitre XXXVIII
- Avec le temps, il m’est arrivé et m’arrive encore parfois de recevoir du Seigneur de plus grands secrets ; […] C’étaient de telles visions, que la moindre d’entre elles suffisait à émerveiller mon âme et à la faire avancer vraiment dans le mépris des choses de la vie. Je voudrais donner une idée de la moindre de ces révélations, mais j’ai beau chercher comment y parvenir, je vois que c’est impossible ; pour nous en tenir à ce point, entre la lumière d’ici-bas et celle qu’on voit là-haut où tout n’est que lumière, il n’y a pas de comparaison possible, parce que l’éclat du soleil paraît bien terne. Enfin, l’imagination la plus subtile ne parvient ni à dépeindre ni à décrire cette lumière, ni aucune des choses que le Seigneur me donnait à entendre dans une délectation si savoureuse, qu’on ne peut l’exprimer ; en effet, tous les sens éprouvent une jouissance si vive et si douce qu’on ne saurait en donner l’idée ; aussi, mieux vaut n‘en rien dire de plus.
Thérèse d’Avila, Livre de la vie, dans Œuvres, traduit et présenté par Jean Canavaggio, Pléiade / Gallimard, 2012, p. 269.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thérèse d’avila, livre de la vie, vision, secret, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2017
Louise Labé, Sonnet III

Sonnet IIII
Depuis qu’amour cruel empoisonna
Premierement de son feu ma poitrine,
Tousjours brulay de sa fureur divine,
Qui un seul iour mon cœur n’abandonna.
Quelque travail, dont assez me donna,
Quelque menasse & procheine ruïne :
Quelque penser de mort qui tout termine,
De rien mon cœur ardent ne s’estonna.
Tant plus qu’amour nous vient fort assaillir,
Plus il nous fait nos forces recueillir,
Et toujours frais en ses combats fait estre :
Mais ce n’est pas qu’en rien nous favorise,
Cil qui les Dieus & les hommes mesprise :
Mais pour plus fort contre les fors paroitre.
Louis Labé, Sonnets, dans Œuvres, Slatkine,
1981, p. 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, poison, feu, cœur, combat | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2017
Gilbert Vautrin, Anges et Corbeau
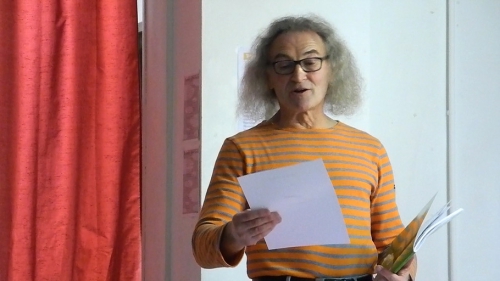
À Bagdad
il y a des yeux comme des soleils voilés
à Bagdad partout sur la terre
il y a des yeux comme des soleils voilés
mais c’est si loin à Bagdad
parce qu’on ne tue pas que le temps…
tu disais hier encore
nous étions tous des anges
aujourd’hui je ne vois plus le paysage
j’appelle je dis ce n’est qu’un geste
comme si l’ombre venait de la parole
parce qu’on ne tue pas que le temps
cette voix qui n’en finissait pas
d’être et de se perdre
là où le cœur est sans pourquoi
cette voix qui n’en finissait pas…
Gilbert Vautrin, Anges et Corbeau, sérigraphies
D’Élisabeth Bard, Æncrages & Co, 2015, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilbert vautrin, anges et corbeau, bagdad, yeux, paysage, temps, voix | ![]() Facebook |
Facebook |