29/10/2019
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, n° 16, 2019 : recension
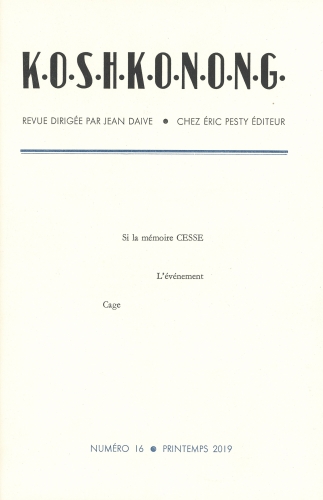
C’est toujours un plaisir de retrouver le talent d’épistolier de Jean Paulhan, dont l’abondante correspondance est encore loin d’avoir été complètement publiée ; le manuscrit d’une lettre à son ami Braque — à qui il consacra un livre, Braque le patron(1945) — est reproduit dans les troisième et quatrième de couverture. Paulhan propose au peintre, qui en fut un des fondateurs, une réflexion sur le cubisme qui serait « la substitution d’une perspective tournante, ou mouvante, à la perspective linéaire et figée de l’art classique. » Pour lui, le cubisme commence avec les papiers collés, qui permettent de construire un espace sans le recours à la couleur, espace mouvant quand on considère le collage par rapport au papier de base. C’est là un témoignage parmi bien d’autres de la curiosité de Paulhan qui œuvra beaucoup pour soutenir la peinture contemporaine.
Marie-Louise Chapelle, dans les pages de "À la réflexion", rend compte de ses lectures de L’ablatif absolu, livre de Michel Couturier qu’a édité en 2016 Marie de Quatrebarbes. Il ne s’agit pas d’une étude mais de ses réactions à certaines caractéristiques des poèmes, notées souvent en commençant par « il y a » et chaque fois sous un titre ; par exemple, sous "Crainte", « Il n’y a pas le mot « terreur » qu’on trouve dans État d’Anne-Marie Albiach, mais je sens tout du long une crainte enfantine. Ou plutôt une anxiété ». La remarque prend tout son sens quand on se souvient que Michel Couturier, vivant à Londres, rejoignit en 1968 Anne-Marie Albiach et Claude Royet-Journoud dans la revue Siècle à mains — de là, sous "Plumes", une note à la manière d’Ambrose Bierce, « Le comble quand on publie dans Siècle à mains : écrire exclusivement à la machine à écrire ». Marie-Louise Chapelle fait part de ses émotions (« Je ressens une grande mélancolie à la lecture de L’ablatif absolu »), rêve de lire le livre à Londres, « Dans un jardin ou une chambre, à l’intérieur, la nuit », se « demande ce que faisait Michel Couturier en 1940. Il avait 8 ans ». Le lecteur qui ne le connaît pas ira sans doute lire L’ablatif absolu, et probablement aussi Marie-Louise Chapelle.
À côté de l’évocation du trop peu connu Michel Couturier (premier traducteur de John Ashbery, en 1975), la revue publie une douzaine de pages, poèmes et prose, d’un écrivain qui, lui aussi, écrivit peu, Roger Giroux*. Il se demande s’il est possible d’écrire « un Livre de Rien », question sans réponse, ou plutôt réponse par le commencement d’un poème en prose, « Ce rien ! Voici déjà que je lui donne présence, ce visage, presque. Ce me regarde et m’appelle en silence, [etc.] », puis par un ensemble de vers elliptiques autour de la difficulté de dire, comme
descendre
entre les arbres
dans l’obscur de septembre
où la voix cherche sa couleur
Plus tard, peut-être le même jour — l’heure (20 h) de la reprise du journal est notée —, Roger Giroux poursuit sa réflexion sur l’écriture, cette fois autour de la possibilité d’écrire plusieurs poèmes en un temps limité, des poèmes « d’essence supérieure ». Son lecteur connaît la réponse et sait qu’il a toujours recherché « le Poème Unique, inatteignable ». Le journal porte la trace de la difficulté à écrire, à se « mesurer avec l’impossible » ; le désir est toujours vif de saisir ce qui devrait l’être — la beauté des choses —, la capacité de le faire est devenue des plus réduites. En outre, écrit-il, « Nul autre mouvement ne me sollicite. Lire, voyager, partager le temps avec d’autres personnes me sont également gris. » Faut-il donc écrire pour seulement survivre ? C’est là, pour Roger Giroux, « vomissure facile », parce que « Écrire exige Tout, et n’accorde jamais rien », et cet engagement total, ce « gaspillage » d’un être, « c’est cela, la folie du Poète ». Cette exigence, que d’autres écrivains ont eue, conduit à définir le poème comme « le seuil de l’au-delà du moi », plus lisiblement peut-être « Le P[oème] entraîne je hors de cet espace qui limite sa parole. » On comprend la difficulté de Roger Giroux à expliciter ce qu’est pour lui « le Poème Idéal, absolu », sa relation à la langue, et, faute d’y parvenir, de conclure « Mieux vaudrait ne pas dire ». Ce qui ne l’empêche pas d’essayer pour l’œuvre ou le poème une autre formulation, « lieu-instant où création et destruction coexistent » et de la gloser.
Lire et relire ces pages dans lesquelles Roger Giroux revient sur sa pratique est fort stimulant. Il est bon aussi de réfléchir à sa propre lecture, on le fera avec "Physique de l’ombre", poèmes en vers de Claude Royet-Journoud, et la longue prose lyrique, comme en aparté, qui les prolonge.
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, n° 16, Éric Pesty éditeur, 2019, 30 p., 11 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 septembre 2019.
* les éditions Éric Pesty ont réédité Journal d’un poème (2011), Lieu-je, Lettre et L’arbre le temps (2016).
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : k.o.s.h.k.o.n.o.n.g, n° 16, jean doive | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2016
Michel Couturier, Poésie complète
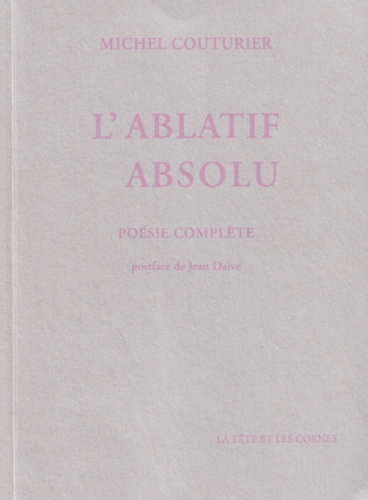
Éditer un poète peu connu et disparu depuis trente ans est une aventure : Michel Couturier (1932-1985) avait publié des poèmes dans la revue Siècle à Mains et quelques minces recueils, tous à peu près inaccessibles, De distance en château (Siècle à Mains, 1964), L’ablatif absolu (Maeght, 1975), Constante parité (1976, Le collet de Buffle) ; Lignes de partage (1985, id.) est posthume. L’ensemble est repris dans le volume et Marie de Quatrebarbes, qui l’a construit, a ajouté un inédit, Ès (1982, dans Banana Split). On lira dans Sitaudis (22 avril 2016) son entretien avec Émmanuèle Jawad à propos de la parution de L’ablatif absolu ; y sont relatées les étapes de la construction du livre et des remarques sur le rapport de Couturier à l’écriture.
La postface de Jean Daive, qui a bien connu Couturier, apporte des données utiles pour situer le poète dans son temps ; il précise notamment ses liens avec Claude Royet-Journoud et Anne-Marie Albiach et leur influence, avec qui il édita à Londres la revue Siècle à mains, et il évoque également ses travaux de traducteur de poètes américains, d’abord de Burn Singer, puis surtout de John Ashbery.
Comme d’autres lecteurs sans doute, j’ai lu pour la première fois Michel Couturier dans sa préface à Fragment, Clepsydre, Poèmes français d’Ashbery (1975) qu’il avait traduit pour la collection ’’Fiction & Cie’’ de Denis Roche. Hors ce qu’il écrivait du poète américain, m’avait retenu la forme de quelques-unes de ses phrases, riches en subordinations successives qui demandaient un retour à leur début. Cette étirement du discours est présent surtout dans les derniers poèmes, au point que la syntaxe est brisée, qu’il est difficile, voire impossible, de reconstruire la phrase : il y a là un « parcours comme une ligne mélodique », écrit Couturier dans Lignes de partage. Pour Jean Daive, les « mots prétendent à une gamme, une vocalisation ou phonation qui est imposée tout d’abord à la voix, ensuite à la lecture sinon au regard. » Donc, phrase suspendue, vers éclatés, et refus de présenter un sens — d’où ici une parenthèse vide, là des vers s’ouvrant par « que qui » sans qu’il soit aisé de retrouver un fil, ou simplement un vers en anglais.
Le refus d’un sens donné est manifeste dès les premiers poèmes publiés (De distance en château), certains vers étant d’abord fondés sur le son : « Tébréo Téréoté / Toré aussi To / Toro alor / d’épée chur au pays d’é ». Parallèlement, la réalité n’est pas abandonnée, avec le nom d’une rue de Londres (Aschurch Grove), ni les formes classiques du vers : se maintient la majuscule en début de vers et plusieurs poèmes gardent un nombre à peu près régulier de syllabes, autour de 12 ou de 10 ; mais les poèmes s’éloignant de toute narration, les vers n’ayant pas (ou fort peu) de relation de sens entre eux. Quand un récit s’amorce avec une entrée comme « en cette vie-là », toute suite est interdite, l’énoncé accumulant impossibilités sémantiques et phrase tronquée, comme dans : « je mendiais les amarres de l’ombre qui délivrée / disais-je d’un visage de haute laine ». Dans un poème où se développe le thème de l’orage, une image rompt le caractère presque convenu de la description :
Travaux d’approche des éclairs
Vers le point d’équilibre des orages
Qui leur permettrait d’agir
D’investir leurs genoux sur les vitres
Si l’on excepte les poèmes en prose de Lignes de partage, brefs récits qui réalisent « le désir / de narration » et où un certaine lyrisme s’exprime avec la récurrence des mots sang et mort, couturier abandonne dans les poèmes en vers à partir de L’ablatif absolu les quelques règles qu’il avait suivies et s’accentue le caractère à la fois vocal et visuel du texte : mots à dire en respectant des silences — comme dans le chant— et disposition dans l’espace de la page qui figurent le mouvement de la voix. Le « je » affirme cependant sa présence ; Jean Daive rapporte que Couturier interrompait une remarque de Royet-Journoud en lui disant « Je continue ma lecture », phrase devenue vers, sibylline sans ce contexte. Il est présent autrement, avec la présence de l’Autre et sa disparition : « Il y a là des yeux très clairs / et qui s’éloignent / qu’il faut accepter de perdre ».
Couturier est aussi dans ses poèmes par la langue qu’il utilise ; ici et là, il introduit des mots rares (« transfixer », « inaccouplé » — néologisme formé en 1845), archaïques (« infiguré »), des sens archaïques (« irréfragable » à propos d’une personne) et, surtout des vocabulaire techniques, ceux des mathématiques et de la grammaire. Il l’est encore par la récurrence de quelques mots, du premier recueil au dernier : « ombre » est le plus fréquent, comme s’il permettait d’exprimer « la perte de l’instant en un / mot ».
Michel Couturier, L’ablatif absolu, poésie complète, postface de Jean Daive, La Tête et les Cornes, 2016, 168 p., 18 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 5 octobre 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel couturier, poésie complète, jean doive, marie de quatrebarbes | ![]() Facebook |
Facebook |





