17/02/2017
Oswald Egger, Rien, qui soit

Tout le temps
[…]
Je me croyais debout au fond d’un lac, en branche de corail difforme à palpes et yeux-ventouses. En plus j’arrive encore à respirer, alors qu’en haut par-dessus les arbres des aiguilles d’os qui se remembrent dans huilerées fente d’amande, s’elles-mêmes dédoublèrent en formes figées : variétés de gras haricots qui poussent en cosses sur roues étoilées jusqu’à ce que les lunes regorgent vermoulues et s’échevèlent sur le sol concassées, dépecées, (mais pas aujourd’hui) ébouriffées ; crèvebasse dégingandée. Nénuphars qui à pluches pêchées du flot surgeonnaient leur calice sans bourgeon en miroir désassombri, ainsi se recueille une membraneuse rêverie solaire dans des rosées à foison avec — le regard qui vacille.
Oswald Egger, Rien, qui soit, traduit de l’allemand par Jean-René Lassalle, Grèges, 2016, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald egger, rien, qui soit, jean-rend vassale, imaginaire, formes, corail, végétaux | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2017
Pauline Klein, Les Souhaits ridicules

Il y a fort longtemps, dans une contrée retirée de Bretagne, je tombais secrètement amoureuse d’un jeune garçon rencontré en été. Il s’appelait Frédéric Bresson. Un après-midi, je l’avais suivi dans sa chambre. Il avait ouvert un coffre à jouets, et m’avait tendu une boussole. C’était une petite boîte ronde, légère et métallique, au fond de laquelle était dessiné un chat gris et noir. On raconte que le soir même, j’étais allée au lit avec l’objet, regardant les aiguilles osciller, et que je m’étais endormie en la serrant dans ma main. On raconte que j’avais passé la fin des vacances avec elle, la déposant à côté du lavabo quand je brossais mes dents, à droite de mon assiette lors des repas en famille, sous ma serviette de plage et sous mon oreiller.
Le jour de notre départ, Frédéric se tenait devant la porte de la maison. Je ne sais pas s’il se souvenait m’avoir offert cette boussole. Elle était là, au fond de ma poche. Nous nous sommes dit au revoir devant nos parents et je me suis installée à l’arrière de la voiture, à côté de mon petit frère. J’ai collé ma joue contre la vitre et j’ai écouté la musique de mon père. J’ai sorti la boussole de ma poche, je l’ai regardée encore, encore.
On raconte que, quelques kilomètres plus loin, mes parents, mon frère et moi nous sommes arrêtés sur le bord de l’autoroute pour déjeuner. J’ai posé la boussole devant moi sur la table. Puis nous sommes retournés à la voiture et repartis. Au bout de quelques minutes, j’ai ouvert mes mains, vides, j’ai fouillé dans mes poches, vides. J’avais oublié la boussole dans la station-service, et il n’était plus question de faire demi-tour.
Pauline Klein, Les Souhaits ridicules, Allia, 2917, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pauline klein, les souhaits ridicules, vacances, amoureux, boussole, séparation, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2017
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux

Je trouve si naturel que l’on ne pense pas
que parfois je me mets à rire tout seul,
je ne sais trop de quoi, mais c’est de quelque chose
ayant quelque rapport avec le fait qu’il y a des gens qui pensent…
Et mon mur, que peut)il bien penser de mon ombre ?
Je me le demande parfois, jusqu’à ce que je m’avise
que je me pose des questions…
Alors je me déplais et j’éprouve de la gêne
comme si je m’avisais de on existence avec un pied gourd…
Qu’est-ce que ceci peut bien penser de cela ?
Rien ne pense rien.
La terre aurai-elle conscience des pierres et des plantes qu’elle porte ?
S’il en est ainsi, et bien, soit !
Que m’importe, à moi ?
Si je pensais à ces choses, je cesserai de voir les arbres et les plates et je cesserai de voir la Terre, pour ne voir que mes propres pensées…
Je m’attristerais et je resterais dans el noir.
Mais ainsi, sans penser, je possède et la Terre et le Ciel.
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux, traduction Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 98-99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, armand guibert, penser, question, terre, ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2017
Emil Cioran, De l'inconvénient d'être né
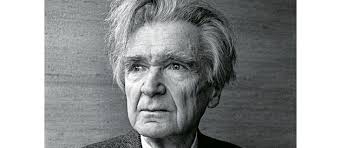
Toute forme de hâte, même vers le bien, trahit quelque dérangement mental.
Les douleurs imaginaires sont de loin les plus réelles, puisqu’on en a un besoin constant et qu’on les invente parce qu’il n’y a pas moyen de s’en passer.
Point de méditation sans un penchant au ressassement.
Nous avons perdu en naissant autant que nous perdrons en mourant. Tout.
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Idées / Gallimard, 1973, p. 65, 65, 70, 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, de l’inconvénient d’être né, dérangement, douleur, imaginaire, méditation | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2017
Emmanuelle Pagano, Saufs riverains (Trilogie des rives, II)

Lundi 9 novembre 2015
La dernière fois que je l’ai empruntée, en septembre, il pleuvait à verse sur l’A75. J’avais pris des jeunes en covoiturage à la gare de Mende, je descendais en leur compagnie distrayante vers la vallée. Je revenais de l’hôpital de Rodez.
Nous avons franchi le viaduc de Millau sous un ciel majestueusement défait. Les jeunes n’avaient jamais entendu parler des luttes du Larzac.
Nous avons ralenti, warning et buée aux vitres, à hauteur du village du Bosc, que nous avons passé juste avant qu’une portion de l’autoroute ne s’effondre,. Les très fortes pluies avaient fragilisé le revêtement et engagé des chutes de rochers qu’aucun filet anti-sous-marin ne retenait. Une brèche venait de s’ouvrit sur le parcours, largement visibles sur les clichés aériens reproduits dans le Midi-Libre. J’ai gardé l’article dans le dossier préparatoire de ce livre. Je regarde l’image de la voie trouée agrandir la blessure toute neuve dans mon histoire.
Emmanuelle Pagano, Saufs riverains (Trilogie des rives, II), P.O.L, 2017, p. 333-334.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuelle pagano, saufs riverains (trilogie des rives, autoroute, covoiturage, recherche, blessure, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2017
Jean Tardieu, Accents
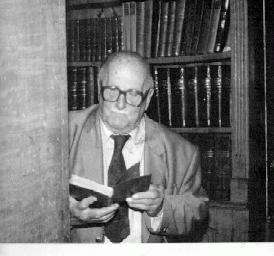
Couple en marche
— Les doigts doublés d’un souvenir d’argile
En mouvement sous le désir des mains ;
— La dent qu’agace une grêle de grains
Mots inconnus aux lèvres malhabiles ;
— Sur l’œil goulu demi-jointes paupières
Fixant la ligne où l’élan se résout ;
— L’ouïe attentive à l’intime tonnerre
Mineur du ciel et du sol coup par coup ;
— Proche tempête, éclaire (que seuls redoutent
Les regards froids, riche orage inventé
Par l’enchanteur à tâtons sur une route
Et tout fumant de lente volonté ;
— Le pas, qu’un contre temps voisin balance,
— Le corps, hanté d’un corps qui l’accomplit,
— Et l’âme, — gerbe, — escalade, — puissance,
En équilibre au versant de la nuit.
Jean Tardieu, Accents, Gallimard, 1939, p. 34.
***
L’association des amis du peintre Gilbert Pastor entre dans sa deuxième année.
Le site internet progresse : http://gilbert-pastor.blogspot.fr <http://gilbert-pastor.blogspot.fr/>
nous espérons qu’il vous intéressera ; n’hésitez pas à envoyer vos remarques et propositions à : jp.sintive@wanadoo.fr
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardiez, accents, couple en marche, corps, âme | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2017
Esther Tellermann, Éternité à coudre

C’est assez
soir désormais
s’incline
dans l’orage lorsque
l’un l’autre
voulions
Jérusalem.
Fournaise jusqu’aux
portes où s’inventent
les lettres
de l’autre côté
qui vient et comble
le même ?
Je voulais que
nous habillent
les aubes
nager jusques
bords
Esther Tellermann, Éternité
à coudre, éditions Unes, 2016, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, éternité à coudre, jérusalem, aube | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2017
Sylvia Plath, Arbres d'hiver

Arbres d’hiver
Les lavis bleus de l’aube se diluent doucement.
Posé sur son buvard de brume
Chaque arbre est un dessin d’herbier —
Mémoire accroissant cercle à cercle
Une série d’alliances.
Purs de clabaudages et d’avortements,
Plus vrais que des femmes,
Ils sont de semaison si simple !
Frôlant les souffles déliés
Mais plongeant profond dans l’histoire —
Et longés d’ailes, ouverts à l’au-delà.
En cela pareils à Léda.
Ô mère des feuillages, mère de la douceur
Qui sont ces vierges de pitié ?
Des ombres de ramiers usant leur berceuse inutile.
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée,
traduction Françoise Morvan et Valérie Rouzeau,
Poésie / Gallimard, 1999, p. 175.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d’hiver, valérie rouzeau, brume, dessin, femme, histoire, léda | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2017
Henri Pichette, les ditelis du rougegorge

Petit propriétaire à la cravate rouge
il chante contre l’intrus
il se rengorge se redresse
il se campe torse bombé
tant le cœur lui bat le sang qui bout
ses yeux flamboient
son corps saccade
et plus il mélodie plus il furibonde
Gare la bagarre !
on pourrait bien se voler grièvement
dans les plumes.
Henri Pichette, Les ditelis du rougegorge,
Gallimard, 2005, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, les dételais du rouge-gorge, oiseau, plume, chanter, cœur | ![]() Facebook |
Facebook |
08/02/2017
Andrèas Embirìkos, Oktàna, traduit du grec par Myrto Gondicas et Michel Volkovitch

Archange en septembre clamant dans la nature
Par les douces journées de septembre, quand il ne pleut pas encore, que les bruits sont plus rares qu’en été, le goût des heures plus fort, que dans les jardins s’ouvrent les grenades, que vibrent les tiges des fleurs toutes droites, que les hibiscus flamboyants palpitent dans leur pourpre, tout pareils à des mariés pleins d’assurance qui frappent à l’huis de leurs belles, alors, comme si c’était toujours l’été (car quelle que soit la saison, le désir est toujours estival), les âmes sont dans l’allégresse, et l’Amour, l’archange le plus blond du Paradis, s’exclame pour tous les corps qu’il touche :
Jette tout et dévêts-toi.
Oublie tout ce qui fait peur.
Printemps, hiver ou été —
En tous lieux et à toute heure _
Mon épée vient vers toi.
Andréas Embirìkos, Oktàna, traduit du grec par Myrto Gondicas et Michel Volkovitch, Le Miel des anges, 201, p. 24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andréas embirìkos, oktàna, myrto gondicas, michel volkovitch, archange, amour, septembre, paradis | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2017
Philippe Beck, iduna et braga. de la jeunesse

F / Un refus
Comme le vaisseau qui souffre et, de la poupe à la proue, a besoin de chants pour évoluer sur les cartes mouvantes, miroirs incertains, ou des sables au relief de pierre de rosette, ainsi l’esprit jeune (plein des vieillesses relatives) complète le Oui et le Non contre les zonages de la traversée. Contre le principe de Geulincx. L’intensité refusante et inquiète voit du bateau ce qu’il n’est pas (la mer mal reposée, la terre qui l’entoure entourée) et océanise l’œil qui multiplie les canots et les périssoires : le pont zoné est le Refusé Avançant. Le poème est l’idée de l’intense complément, à côté des tempes grises chantées, ou d’une intensité que parachève l’impossible accord avec les choses en l’état, doucement ou rudement ; le dégrossi relatif est devant. Le refus est affaire de phrases précises et exactes dans le bois. La jeunesse caractérise une poésie du refus.
Philippe Beck, iduna et braga. de la jeunesse, Corti, 2017, p. 49-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2017
Louis Dubost, Fin de saison

Au lever du jour
la nuit se vide d’un coup
chaque matin
c’est comme ça
la bouche sèche
dès que le corps
petit à petit consent
à se mettre à jour
à remplir le temps
comme une brouette
puis le verser en vrac
encore plus loin
l’ombre l’accompagne
en peau de chagrin
un peu plus recroquevillée
sous le soleil toujours plus haut.
Louis Dubost, Fin de saison,
le phare du cousseix, 2017, p. 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis dubosc, fin de saison, lever du jour, corps, temps, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2017
Bashô, Journaux de voyage

Senteur d’orchidée
aux ailes du papillon
s’est communiquée
À la rosée goutte à goutte
des souillures d’ici-bas
puisse-je me laver
Herbes pour appuie-tête
par l’averse trempé un chien
hurle dans la nuit
Par le montueux
sentier ne sais quel charme
répand la violette
Du cœur de la pivoine
l’abeille s’est arrachée
à grand regret
Bashô, Journaux de voyage, traduction René
Sieffert, P.O.F., 1984, p. 26, 28, 30, 32, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basha, journaux de voyage, rêne sievert, fleur, papillon | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2017
Laurent Fourcaut, Arrière saison

Pas d’histoire
À toute force il faut narrer sinon on crève
le sens est à ce prix quel ennui ! le mouvant
cours des êtres des choses pris dans ce carcan
dépérit. On raconte tant de trucs sur Ève
comment la jouerez-vous ailleurs qu’en la vie brève ?
Sanglante fin d’été de ce sang qu’écrivant
on tire sans arrêt du petit pélican,
il hante le regard lutte contre le rêve.
Ne me parlez pas d’histoire je n’en veux point
je veux l’effondrement dans la meule de foin
l’abrupte samba des corps danse imperceptible
à qui danse le goût qu’on prend au doux comptoir
où le temps se la coule sans faire d’histoir
e où l’on existerait enfin hors de la Bible.
Laurent Fourcaut, Arrière saison, Le Miel de l’Ours, 2016, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison, histoire, narration, vie brève, été, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2017
Georges Bataille, L'expérience intérieure

Récit d’une expérience en partie manquée
Au moment où le jour décline, où le silence envahit un ciel de plus en plus pur, je me trouvais seul, assis dans une étroite véranda blanche, ne voyant rien d’où j’étais que le toit d’une maison, la frondaison d’un arbre et le ciel. Avant de ma lever pour aller dormir, je sentis à quel point la douceur des choses m’avait pénétré. Je venais d’avoir le désir d’un mouvement d’esprit violent et, dans ce sens, j’aperçus que l’état de félicité où j’étais tombé ne différait pas entièrement des états « mystiques ». Tout au moins, comme j’étais passé brusquement de l’inattention à la surprise, je ressentis cet état avec plus d’intensité qu’on ne fait d’habitude et comme si un autre et non moi l’éprouvait. Je ne pouvais nier qu’à l’attention près, qui ne lui manqua que d’abord, cette félicité banale ne fût une expérience intérieure authentique, distincte évidemment du projet, du discours. Sans donner à ces mots plus qu’une valeur d’évocation, je pensai que la « douceur du ciel » se communiquait à moi et je pouvais sentir précisément l’ état qui lui répondait en moi-même. Je la sentais précisément à l’intérieur de la tête comme un ruissellement vaporeux, subtilement saisissable, mais participant à la douceur du dehors, me mettant en possession d’elle, méfaisant jouir.
(…)
Georges Bataille, L’expérience intérieure, Gallimard, 1953 (repris dans Œuvres complètes, V, 1973), p. 143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, l'espérance intérieure, douceur, félicité, mystique, attention, jouissance | ![]() Facebook |
Facebook |





