22/05/2013
Constantin Cavafy, Œuvres poétiques

Maison avec jardin
Je voudrais une maison à la campagne
Avec un grand jardin, moins
Pour les fleurs, les arbres, la verdure
(S'il y en a, tant mieux, c'est superbe)
Que pour avoir des bêtes. Ah ! Je voudrais des bêtes !
Au moins sept chats, deux complètement noirs
Et deux blancs comme la neige, pour le contraste ;
Un grave perroquet que j'écouterais
Bavarder avec emphase et conviction.
Les chiens, trois suffiraient, je pense.
Je voudrais encore deux chevaux (ce sont de bonnes bêtes),
Et sans faute trois ou quatre de ces merveilleux,
De ces sympathiques animaux, les ânes,
Qui resteraient là sans rien faire, à jouir de leur bien-être.
Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, traduction Socrate C. Zervor et Patricia Portier, Imprimerie Nationale, 1992, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, maison avec jardin, animaux, chat, chien, âne, chevaux | ![]() Facebook |
Facebook |
21/05/2013
Giorgio de Chirico, Poèmes Poesie

Chirico, Autoportrait
Forêt sombre de ma vie
Je t'ai toujours aimée forêt sombre
De ma vie.
Forêt plus sombre qu'une nuit sombre
Au pôle sombre...
Voûte du ciel, au pôle, une nuit...
... Nuit sans voiles
Mais sans étoiles
Ni aurores boréales...
Voûte du ciel, au pôle, cette nuit...
Dans mes élans et mes ivresses
Dans mes fatigues et mes bassesses,
Mes fols espoirs, mes douces tendresses,
Mes lourds chagrins, mes bonnes sagesses,
Mes grands courages, mes lassitudes,
mes lâchetés, mes turpitudes,
mes abstractions, mes quintessences,
mes solitudes, mes grandes licences,
mes vains appels, mes lourdes confiances.
Giorgio de Chirico, Poèmes Poesie, présentés par
Jean-Claude Vegliante, Solin, 1981, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio de chirico, poèmes poesie, forêt, nuit, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2013
Jean-Louis Giovannoni, L'invention de l'espace

L'invention de l'espace
I
Tout est un intérieur
et reste à jamais
cet intérieur.
Car rien ne doit sortir
de sa forme.
Rien ne doit se tenir
en dehors.
Rien ne doit se franchir
prendre corps
dans le corps des autres.
Aucun corps
n'a droit au corps
de ce qu'il n'est pas.
Toute chose
doit se tenir en elle-même.
Toute chose
doit se contenir
ne prendre que sa forme
n'occuper que sa place
n'être pas plus qu'elle ne doit.
Surtout
ne pas se détacher
du lieu
imparti à son corps.
Tout doit rester
ce qu'il est
et ne rien ajouter.
En ce monde
tout est déjà trop prononcé.
Tout est bien trop présent
trop au bord
toujours trop poussé
par l'envie de sortir
de prendre la place d'un autre
de gagner en volume
en surface
en espace
en oxygène.
Tout est un intérieur
et doit le rester.
Imaginez
l'espace
avec des choses
ne tenant pas leur intérieur.
Des choses
ne sachant plus
où se tient leur seuil
le côté à ne pas franchir.
Des choses toujours trop pleines
ne pouvant se soustraire.
Des choses
qui menacent de fracturer
de contaminer
l'espace.
Des choses
qui soumettraient
qui réduiraient les autres
par excès de corps
de présence.
Imaginez
tout ce monde
enfermé dans son corps
rêvant de proliférer
d'envahir
de pousser ailleurs
de se multiplier
dans le corps des autres
d'être au présent
de toute chose.
Tout ce monde
impatient
qui n'en peut plus
de se contenir
d'avoir son dedans
dans le dedans de l'espace
sans jamais pouvoir se dégager
sans jamais trouver la faille
le moindre passage
pour s'écouler ailleurs
s'infiltrer dans l'autre
et le faire sien.
[...]
Jean-Louis Giovannoni, Ce lieu que les pierres regardent, suivi de Variations, Pas japonais, L'invention de l'espace, préface de Gisèle Berkman, Lettres vives, 2009, p. 147-154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, l'invention de l'espace, gisèle berkman, corps, lieu, dedans, dehors | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2013
Guillevic, Aguets, dans Relier
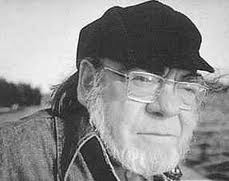
Aguets
Dans ce que je vois
Tout autour de moi
Qu'est-ce qui n'es pas
Avertissements ?
*
Il y a
Ce qu'il y a.
Il y a
Ce qu'il n'y a pas.
Il y a
Ce qui est entre les deux.
*
On voudrait qu'il y ait
Dans la hauteur de l'air
Des espèces de joues
Que l'on pourrait gifler.
*
Comme est loin
Ce qui somnole en moi
Et près de moi
Ce que je cherche
Dans les lointains.
*
Le ciel de la nuit
Est un bal continuel,
Mais jamais d'idylle.
*
Je ne récuserai pas
La terre,
Elle fait ce qu'elle peut,
Mais lui échappe
Ce qui nous échappe
Et nous taraude.
*
Et ce goût de néant —
Comme si le néant
Avait un goût.
*
Le temps,
J'ai tout mon temps,
Mais il en a, lui,
Beaucoup plus.
*
Ce n'est pas rien
D'avoir à porter le monde,
Courage !
(1991)
Guillevic, Relier, Gallimard, 2007, p. 495-497.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, aguets, dans relier, il y a, la terre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2013
Antoine Emaz, Cambouis

On écrit sans doute parce qu'on n'a rien d'autre pour tenir droit dans un monde de travers.
Je crois n'avoir jamais connu que des poètes fêlés. Qu'ils soient bons ou mauvais est une autre affaire, mais ce lien entre écriture et fêlure, oui. Et une fêlure d'être, profonde, pas l'égratignure sociale ou l'écorchure de vanité. Pas non plus des êtres cassés, sinon l'écriture cesserait. Des bancals, des boiteux d'être. Et chez les vrais lecteurs, de même, car il faut pouvoir l'entendre, ce son de cloche fêlée ou d'enfant qui pleure presque en silence.
Toujours se méfier du brio, du brillant. La poésie, vue de ma fenêtre, comme un art du peu, du pauvre.
Rien de magique en poésie : un peu de chance et beaucoup de travail.
Écrivant, on ne s'adresse pas à tout le monde mais à chacun. Cela passe ou pas, selon le lecteur, en fonction de sa culture, ses goûts, son histoire particulière... Ce qu'on nomme le « public » n'existe pas. Les lecteurs viennent un à un, pour des raisons très différentes, voire opposées. Ce qu'on nomme « public » est une somme d'individus qui, pris isolément, ont tous de solides raisons pour aimer ou détester tel ou tel travail. Je ne crois pas qu'il y ait un mouvement de mode, même s'il y a de l'air du temps. C'est bien plus complexe, le poète est seul parmi d'autres poètes, tout comme le lecteur est seul parmi d'autres lecteurs. On ne peut créer un mouvement de foule en poésie. D'où l'illusion des « écoles » « mouvements littéraires ». C'est bien plus émietté : on peut gommer les écarts en soulignant les points communs, mais pas longtemps. Rien que de bien naturel puisque les principes édictés par l'un ne peuvent être suivis par les autres, sauf à à considérer comme valorisante la piètre condition de disciple, émule, remorqué...
Antoine Emaz, Cambouis, Seuil, "Déplacements", 2009, p. 155, 171, 177, 179, 180.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cambouis, poésie, écrire, lecture, fêlure, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2013
Paul Celan, La Rose de personne [Die Niemandsrose]
![Paul Celan, La Rose de personne [Die Niemandsrose], Martine Broda, amante, nom](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/00/01/1915680420.10.jpeg)
Avec toutes les pensées je suis sorti
hors du monde : tu étais là,
toi, ma silencieuse, mon ouverte, et —
tu nous reçus.
Qui
dit que tout est mort pour nous
quand notre œil s'éteignit ?
Tout s'éveilla, tout commença.
Grand, un soleil est venu à la nage, claires,
âme et âme lui ont fait face, nettes,
impératives, elles lui ont tu
son orbe.
Sans peine,
ton sein s'est ouvert, paisible,
un souffle est monté dans l'éther,
et ce qui s'est nué, n'était-ce pas,
n'était-ce pas forme, et sortie de nous,
n'était-ce pas
pour ainsi dire un nom ?
Mit allen Gedanken ging ich
hinaus aus der Welt : da warst du,
du meine Leise, du meine Offne, und —
du empfingst uns.
Wer
sagt, dass uns alles erstarb,
da uns das Aug brach ?
Alles erwachte, alles hob an.
Gross kam eine Sonne geschwommen, hell
standen ihr Seele und Seele entgegen, klar,
gebieterisch schwiegen sie ihr
ihre Bahn vor
Leicht
tar sich dein Schoss auf, still
stieg ein Hauch in den Äther,
und was sich wölkte, wars nicht,
wars nicht Gelstalt und von uns her,
wars nicht
so gut wie ein Name ?
Paul Celan, La Rose de personne [Die Niemandsrose], traduction de Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979 [1963], p. 31 et 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne [die niemandsrose], martine broda, amante, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2013
Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre

Rêve d'hiver
Ce foisonnement estival
tournoiement de mouches
dans une pièce hivernale...
La pensée est une opaque
matière tressaillante
dans ce bourdonnement
il dort barricadé
au sein des lois de l'heure
tel un poulpe cramponné
à son rêve d'hiver
il ouvre parfois un œil
si soleil et braise brillent vaguement
mais il ne voit pas.
Sogno d'inverno
Questo rigurgito estivo
mulinello di mosche
in una stanza invernale...
Il pensiero è un'opaca
materia trasalita
al ronzìo
egli dorme rinchiuso
tra le leggi del momento
come un polipo aggrappato
al suo sogno d'inverno
apre un occhio talvolta
se sole e brace balùginano
ma non vede.
Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre, traduction de
l'italien par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie,
2010, p. 57 et 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bartolo cattafi, l'alouette d'octobre, philippe di meo, reve d'hiver | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2013
Guy Goffette, Solo d'ombres

La femme infranchissable
1
La femme qui s'inverse dans
l'azur
sur l'ordre d'un invisible amant
que dit-elle
qu'on ne peut entendre
qui cependant creuse
un chemin dans mes yeux
2
Croise et décroise tes
jambes sanguine image du
désir
j'attendrai ce qu'il faudra je
grandirai avec
les marges
3
À chacun suffit
le jour à venir
le soleil après la pluie
l'air bleu de la femme
au bout du champ
L'enfant seul griffonne
l'envers des images
4
Debout la nuit
j'invente
la femme à sa place
les mots qu'elle prononce
dans ma bouche
me tiennent à merci
[...]
Guy Goffette, Solo d'ombres, Ipomée, 1983,
p. 129-132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, solo d'ombres, la femem infranchissable, le jour, la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
14/05/2013
Seamus Heaney, L'étrange et le connu

M.
Le phonéticien sourd en étendant la main
Sur le dôme crânien d'un locuteur
Pouvait distinguer diphtongues et voyelles
Aux seules vibrations de l'os.
Un globe cesse de tourner. Appliquant la paume
Sur le relief glacé d'une banquise
J'imagine le chant d'un essieu et le russe
Solide d'Ossip Mandelstam.
M.
When the deaf phonetician spread his hand
Over the dome of a speaker's skull
He could tell which diphtong and which vowel
By the bone vibrating to the sound.
A globe stops spinning. I set my palm
On a contour cold as permafrost
And imagine axle-hum and the steadfast
Russian of Osip Mandelstam.
Seamus Heaney, L'étrange et le connu, édition bilingue, traduit de l'anglais (Irlande) par Patrick Hersant, "Du monde entier", Gallimard, 2005, p. 133 et 132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : seamus heaney, l'étrange et le connu, ossip mandelstam, chant, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
13/05/2013
Matthieu Gosztola, Visage vive

[...]
Notre visage prend le temps
De nous arracher à chaque
Pierre
Du chemin ombragé avec
Qui jouent les branches des
Arbres
Comme s'il s'agissait de dire je
Reviens pardon
Je te rattraperai oui je te
Rattraperai
J'ai couru de plus en plus
Vire avec mon espoir
En tenant ton corps déjà roide
Contre moi
Nos visages ce pourrait être la
Respiration
La douleur est une histoire
Qui écha
ppe totalement
Et dans laquelle on se re
trouve
Est-ce que je peux faire
Certains gestes
Ou certaines paroles
Pour te sauver de la douleur ?
Matthieu Gosztola, Visage vive, Gros textes, 2011, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matthieu gosztola, visage vive, douleur, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
12/05/2013
Jean Tardieu, Les tours de Trézibonde et autres textes

Mon théâtre secret
À Gérard Macé
Le lieu où je me retire à part moi (quand je m'absente en société et qu'on me cherche, je suis là) est un théâtre en plein vent peuplé d'une multitude, d'où sortent, comme l'écume au bout des vagues, le murmure entrecoupé de la parole, les cris, les rires, les remous, les tempêtes, le contrecoup des secousses planétaires et les splendeurs irritées de la musique.
Ce théâtre, que je parcours secrètement depuis mes plus jeunes années sans en atteindre les frontières, a deux faces inséparables mais opposées, bref un « endroit » et un « envers », pareils à ceux d'une médaille ou d'un miroir.
De ce côté-ci, voyez comme il imite, à la perfection, l'inébranlable majesté des monuments : ils semble que je puisse compter toutes les pierres, caresser de mes mains le glacis du marbre, les fractures des colonnes, la porosité du travertin...
Mais, attendez : si je fais le tour du décor (quelques pas me suffisent), alors, de l'autre côté de ces apparences pesantes, de ces voûtes et de ces murailles, mon regard tout à coup n'aperçoit plus que des structures fragiles, des bâtis provisoires et partout, dans les courants d'air et la pénombre poussiéreuse, auprès des câbles électriques entrelacés et des planches mal jointes, la toile rude et pauvre, clouée sur des châssis légers.
Telle est la loi de mon théâtre : à l'endroit, les villes et les paysages, la terre et le ciel, tout est peint, simulé à merveille. À l'envers, l'artisan de ce monde illusoire est soudain démasqué, car son œuvre, si ingénieuse soit-elle, révèle, par transparence, la misère des matériaux qui lui ont servi à édifier ses innombrables « trompe-l'œil ». (Souvent je l'ai vu qui gémissait, le pinceau à la main, mêlant ses larmes à des couleurs joyeuses.) Pourtant, bien que je sois dans la confidence, je ne saurais dire où est le Vrai, car l'envers et l'endroit sont tous deux les enfants du réel, énigme qui me serre de toutes parts pour m'enchanter et pour me perdre.
Jean Tardieu, Les tours de Trézibonde et autres textes, Gallimard, 1983, p. 23-25.
Publié dans Akhmatova Anna, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, les tours de trézibonde, théâtre secret, envers et endroit, décor | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2013
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

1 sonnet
avec la manière de s'en servir
Réglons notre papier et formons bien nos lettres :
Vers filés à la main et d'un pied uniforme,
Emboîtant bien le pas, par quatre en peloton ;
Qu'en marquant la césure, un des quatre s'endorme...
Ça peut dormir debout comme soldats de plomb.
Sur le railway du Pinde est la ligne, la forme ;
Aux fils du télégraphe : — on en suit quatre, en long ;
À chaque pieu, la rime — exemple : chloroforme,
— Chaque vers est un fil, et la rime un jalon.
— Télégramme sacré — 20 mots — Vite à mon aide...
(Sonnet — c'est un sonnet —) ô muse d'Archimède !
— La preuve d'un sonnet est par l'addition :
— Je pose 4 et 4 — 8 ! Alors je procède,
En posant 3 et 3 ! — Tenons Pégase raide :
« Ô lyre ! Ô délire ! Ô...» — Sonnet — Attention !
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, édition établie par Pierre-Olivier Walzer pour T. C., Bibliothèque de la Pléiade, 1970, p. 718.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, sonnet, rime, césure, hmour | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2013
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Dans La Clé des champs, André Breton invite à voir dans la place Dauphine, qui forme triangle à la proue de l'île de la Cité, « le sexe de Paris », le pubis de la Ville Lumière. Le poète, dont la vie croisa brièvement celle de Proust en 1920 — Jacques Rivière lui avait confié la relecture des épreuves du Côté de Guermantes —, a pu admirer — Rivière l'affirme — l'œuvre, si subtilement attentive au monde des rêves, du romancier. Il n'en demeure pas moins que jamais il n'a rien écrit qui puisse accréditer un tel sentiment et que la Recherche figure parmi les œuvres dans lesquelles le surréalisme a reconnu des emblèmes de ce qu'il récuse : l'art supposé mensonger du roman, avec son primat moraliste de la psychologie, la façon qui lui est propre de désenchanter le monde, de dégrader le mystère en effets de continuité et de vraisemblance. Et pourtant, c'est bien à Breton que j'ai pensé, à Nadja, aux lèvres entrouvertes, accueillantes à la fougue du Vert Galant de la place Dauphine, en découvrant que la maison de tante Léonie présente ceci de commun avec le jardin étagé à flanc de coteau du Pré Catelan, qu'elle s'évase en triangle, à partir de la porte étroite, génésique, qui s'entrouvre à son sommet.
Le rapprochement vient sans doute d'autant plus volontiers à l'esprit que le lecteur de la Recherche sait bien que « Combray », la première partie de Du Côté de chez Swann, pour être le livre lumineux de l'enfance, n'en est pas moins inquiété par le mystère de la séparation des sexes, par l'évidence nocturne de l'attraction des corps. Le visiteur qui entrebâille le portail et pénètre dans le jardinet, lorsqu'il s'avance épousant tla courbure de l'allée, vers la façade secrète de la maison, vers ces liserés de faïence d'inspiration ottomane qui, fantaisie « orientaliste » de l'oncle Amiot, rehausse d'azur l'encadrement des fenêtres, chemine dans une nuit matricielle, près qu'il est de s'introduire, comme par effraction, sur le théâtre d'une scène primitive.
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 45-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, andré breton, roman, scène primitive, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2013
Benoît Casas, L'ordre du jour
[...]
1er juin
il est quatre heures
et l'aube luit.
le rêve a toute la valeur
d'une déclaration.
j'étais devenu quelqu'un
de nulle part.
séparé de ses amours
et de ses paysages.
fusain de Sakhaline
virgilier à bois jaune.
ce que nous gardons
de l'expérience d'apprendre :
idée sur la façon d'enseigner.
l'élucidation parlée
est le ressort du progrès.
moments de l'évaporation.
la violence le désarroi des gestes
carambolage.
temps perdu.
ne pouvait pas
s'abandonner
à de l'absence
intégrale.
2 juin
si vite nous
nous sommes dit
tant de choses.
je reste dehors
le plus longtemps possible.
le monde ici
ne semble pas disposé à
se réduire à un seul
mot.
3 juin
au matin soleil déjà vif
jour d'été précoce.
paysages destructifs.
renoncement.
regards remontent sa jupe.
et de suite,
chaque terme
est à sa place logique.
les grandes villes
spécialisent les plaisirs.
lieu de conflit entre
hasard et coup.
Benoît Casas, L'ordre du jour, "Fiction & Cie", Seuil, 2013, p. 116-117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l'ordre du jour, journal, juin, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2013
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre, Notes sauvegardées

Les iris poussent au hasard dans un enclos d'herbes hautes — couleur mauve ou violet sombre — sortis de leurs papiers de soie parmi leurs dures lames vertes. Ou ceux, de couleur jaune, qui poussent dans les marais et les canaux. Et ces toutes petites fleurs basses — jaunes ou roses — qui s'accrochent aux pierres, aux rochers, qui leur tiennent lieu de pelage, doux, gras et chaud, modeste et tenace.
*
Le parfum des iris, très doux, sucré, presque suave, évoquant, me semble-t-il, l'idée qu'on a pu se faire, adolescent, du féminin : de quoi vous tourner la tête... Avec cette espèce de chenille d'un jaune éclatant, solaire, mais si bien cachée sous les pétales bleu pâle comme sous des langues d'eau. Mais le mot "chenille" gêne, et "brosse" tout autant. Une réserve de poudre d'or, un pelage d'or, une toison peut-être, cachée dans la soie de la robe ?
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre, Notes sauvegardées, 1952-2005, Le Bruit du temps, 2013, p. 47, 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil, ou d'ombre, notes sauvegardées, iris, parfum, féminin, couleurs | ![]() Facebook |
Facebook |






