17/04/2013
Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse

La sauterelle
Chaque automne la même sauterelle
Des jardins saute le mur et la route
Pour se retrouver chez elle chez moi.
Patiente à ma fenêtre, sans doute,
Elle trouverait le moyen d'entrer,
Moi celui de la reprendre, le soir,
Car je l'invite, mettons, à dîner
D'herbe et de feuillage sur un mouchoir
Papillon
Même ses ailes au bout du compte
Lui pèsent quand je le relève
De mes mains. La route s'enlève
Pour notre convoi, et je monte
*
Je ne sais vraiment pas pourquoi
Je n'ai plus de fourmis chez moi ;
Les escargots c'est par erreur
Qu'ils voyagent parmi les fleurs.
Le soir, les papillons
Tournent dans la maison.
Le chien dort, les chats rodent
La nuit près d'Anne-Claude.
Feu le chat
Il est mort depuis si longtemps.
Son fantôme a pris place non
Loin de nous dans notre maison
Et le silence comme avant
Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse,
La Dogana, 2012, p. 14, 15, 16, 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric wandelère, la compagnie capricieuse, sauterelle, papillon, chat, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2013
Pascal Poyet, Trois textes

Suivre encore allez poursuivre cette laisse — mais durer toujours ? sur le papier du moins — s'y plaire et encore que peu liant il ne soit pas à la remorque vite facile de s'y prêter au moins s'échinant essaie à ne pas jouer à force la fille de l'air et finir de blanc en blanc pourtant jusque-là ricochant serré par échouer dur où au demeurant on ne s'attarderait pas plus longtemps cherchant ici le point ne trouvant là là facile qu'à se dérider, récupérer, mais quoi, ambitionnant encore de donner à autre chose une promotion, à vouloir en faire un objet, nous y voici mettons, insigne, d'une pierre et tenez en dégotant une un presse-papier
Pascal Poyet, "Trois textes", dans Pascal Poyet et Goria, Trois textes cinq définitions, Ink, sd, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal poyet, trois textes, poursuivre, durer, échouer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/04/2013
Jules Renard, Journal
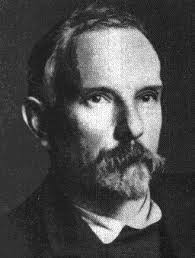
Éloge funèbre. La moitié de ça lui aurait suffi de son vivant.
On se fait des ennemis. Avait-on des amis ?
Le monde serait heureux s'il était renversé.
Un homme qui aurait absolument nette la vision du néant se tuerait tout de suite.
À considérer les appétits bourgeois, je me sens capable de me passer de tout.
Je ne tiens pas plus à la qualité qu'à la quantité des lecteurs.
Les hommes naissent égaux. Dès le lendemain, ils ne le sont plus.
Écrire pour quelqu'un, c'est comme écrire à quelqu'un : on se croit tout de suite obligé de mentir.
Il faut vivre pour écrire, et non pas écrire pour vivre.
Mon ignorance et l'aveu de mon ignorance, voilà le plus clair de mon originalité.
Jules Renard, Journal, texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 1094, 1114, 1118, 1119, 1124, 1128, 1132, 1151, 1164
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, amitié, néant, lecteur, égalité, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2013
Tiphaine Samoyault, Bête de cirque

La première fois que j'ai vu tomber un arbre entier, quand le dernier coup porté l'a cassé en deux après que ses branches ont été déposées une à une et que son bruit a précédé sa chute, je ne crois pas avoir plaint l'arbre mais moi qui le voyais tomber. Tandis que debout il était un géant dont la crête m'apaisait, au sol il devenait sans ressemblance. Sa tête n'était plus l'ombre des nuages, il ne ferait plus l'ombre de cette ombre. Qu'est-ce qui tombe quand quelque chose tombe ? Peut-être toutes les ombres que cette chose a portées. La première fois que j'ai vu tomber un arbre, j'ai vu brusquement tomber du temps, pourtant si lent. On n'entend pas le temps passer dans l'arbre qui pousse mais on l'entend s'effondrer dans l'arbre qui tombe. Le tronc ouvert permet de compter les âges de cet arbre qui ne vieillira plus. Les yeux s'égarent dans cette spire si difficile à suivre qu'on en perd l'âge de l'arbre, de toute façon si vieux. Qu'est-ce qui tombe quand quelque chose tombe ? Un souvenir par seconde et l'âge que nous n'aurons jamais. La première fois que j'ai vu tomber un arbre, quand la perspective matinale d'une journée d'hiver fut soudain dévisagée par sa chute progressive, j'en ai vu tomber un deuxième peu après. Pareillement la cime puis le houppier puis en deux fois le tronc. On se bouche les oreilles pour ne pas voir, sans pouvoir malgré tout s'empêcher de regarder la stèle qui tombe. Et quand on voit combien aussi celui-là manque, on se dit qu'on a vécu près d'un arbre, qu'on n'y a pas été assez sensible.
Tiphaine Samoyault, Bête de cirque, "Fiction & Cie", Seuil, 2013, p. 151-153.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tiphaine samoyault, bête de cirque, arbre, chute, temps, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
13/04/2013
Pascal Quignard, Vie secrète
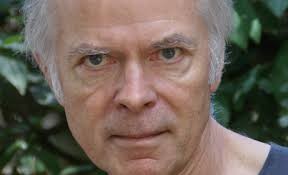
La question que pose l'amour humain — au contraire de l'opportunisme de la violence sexuelle — ne tient pas au choix préférentiel, à la possessivité, à la durée du lieu, à l'exclusivité de ce choix devant tout autre occasion (attachement monogame et fidélité).
Définir ainsi l'amour est préhumain. Cette conjonction se retrouve chez les primates, chez les oiseaux et elle est liée à la fidélisation et au nourrissage.
La question doit porter sur le choix préférentiel (mais préférentiel à l'égard du social, à l'égard de tous les autres liens sociaux qui peuvent se présenter).
L'amour qui naît dans la fascination meurtrière involontaire, meurtrière dans la faim, meurtrière de l'un de ses deux membres, meurtrière de la société du moins dans ses règles d'échange entre les clans et dans l'étagement temporel de la généalogie, désunanimise l'unité commune à chaque famille, décollectivise le groupe. Ce qu'il y a de touchant dans le mythe qui concerne Pâris (qui est le héros grec de ce qu'il en est des choix préférentiels dans l'amour : son jugement est invoqué par les hommes après avoir été mendié par les déesses), c'est que c'est un enfant rejeté, exposé, asocialisé, voué à la mort par la société dont son père est le roi. C'est l'asocialisé qui choisit le lien asocial (à ceci près que la guerre, au contraire de ce que voulaient croire les anciens Grecs, est la plus sociale des activités humaines).
La chasse au congénère jusqu'à la mort est le propre des sociétés humaines.
Les sociétés humaines sont les seules sociétés animales où la mort du congénère ne soit pas inhibée.
Pascal Quignard, Vie secrète, Folio / Galliamrd, 1999 [1998], p. 244-245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, vie secrète, amour, choix, pâris, asocial | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2013
Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur

Fenêtre de droite dans la salle à manger, par les carreaux du bas au-dessus du placard à verres, je regarde la voiture, une Simca bleue décapotable, qui s'éloigne vers le portail, mes parents partent pour La Mans, je suis à la fois curieux de cette journée à passer seul avec les servantes et un petit peu ému sans doute, mais avant que la voiture ne quitte la cour elle s'arrête, les deux bonnes et moi le constatons : qu'est-ce qui ne va pas, chose oubliée ? La scène est cadrée par l'embrasure oblique et profonde de la fenêtre, vue à travers les vieux carreaux légèrement teintés de vert : mon père descend, fouille à l'arrière, sort une boîte et d'un grand coup de pied pour dégagement (il aimait le football au lycée) envoie valdinguer cette boîte de Blédine, contenu s'égaille, couvercle roule de son côté, la voiture a déjà démarré quand le couvercle atteint l'herbe qui est sous les ormes, la voiture disparaît au portail, les servantes : « Oh ! Monsieur a trouvé les fromages ! » Elles m'ont expliqué que ma mère avait emporté des petits fromages pour ses parents, bien enfermés dans une boîte de fer avec l'espoir que mon père ne s'en apercevrait pas, mais l'odeur avait dû filtrer... Or mon père ne supportait ni la vue ni l'odeur des fromages quels qu'ils soient, sur la table ou ailleurs. Ma mère était seulement autorisée à fabriquer quelques fromages à partir du lait de nos vaches pourvu que lui ne les rencontre jamais. Elle les faisait s'affiner dans un garde-manger de plein air, une petite cabane sur pattes dissimulée derrière le laurier-palme, là où était le fagotier (deux étages et, sur quatre faces dont l'une faisait porte, des persiennes doublées de fin grillage). Je devais avoir quatre ou cinq ans mais ce couvercle roule très lentement.
Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur, Gallimard, 1993, p. 97-98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l'espace antérieur, enfance, méoire, campagne, fromage | ![]() Facebook |
Facebook |
11/04/2013
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup

La chasse du loup
À cette heure incertaine où l'obscur dispute
Au jour son royaume la déesse repue
Rappelle ses valets avant que de céder
Au sommeil tous les oiseaux se sont tus et les
Pâles enfants des hommes tremblent dans leurs draps blancs
Lorsqu'un rêve très ancien vient les visiter
À la vitre étoilée de la chambre l'ombre
Bleue de la bête qui regarde et attend
*
À l'enclume de la nuit apollon martèle
La lune vieille casserole cabossée
Et blanchie aux feux ronflants de l'empire des
Morts voici l'heure des métamorphoses et des
Enchantements Ô théâtre où tout s'échange et
Se déplie les mots comme fleurs de papier
*
Elle qui fait pleuvoir des plumes d'argent pour
Son apothéose portée comme un os
Tensoir sur le brancard du ciel montre son ventre
Rond de vierge engrossée par le vent à tout
L'univers comme une lanterne magique et
Darde lumineuse ses flèches innombrables
*
Par les orbites décavées de sa tête
Grottes profondes sortent les loups tour à tour
Dévalant les toboggans de ses rayons comme
Des pistes neigeuses et pentues à vertige et
Culs par-dessus têtes tombent dans les bruyères
[...]
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup,
Gallimard, 2007, p. 43-44.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup, déesse, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
10/04/2013
Gertrud Kolmar (Berlin 1894-Auschwitz 1943), "Premier espace"

L'Étrangère
La ville est pour moi un vin multicolore
Dans la coupe de pierre polie ;
Elle se dresse et scintille vers ma bouche
Et me dépeint en son orbe.
Son cercle creusé reflète
Ce que chacun connaît, mais qu'aucun ne sait ;
Car nous frappent d'aveuglement toutes les choses
Qui sont pour nous communes et quotidiennes.
Les maisons m'opposent un mur abrupt
Avec un suffisant : « Ici chez nous...»,
Le visage vitreux de la petite boutique
Farouchement se ferme : « je ne t'ai pas appelée ».
Mon pavé épie et ausculte mon pas
Plein de suspicion et de curiosité,
Et là où il palpe le bois et la glu,
Il parle une autre langue que chez moi.
La lune tressaille comme un meurtre
Au-dessus d'un corps lointain, d'une parole égarée,
Quand la nuit se fracasse sur ma poitrine
Le souffle d'un monde étranger.
Gertrud Kolmar, "Premier espace", traduit par Fernand Cambon, dans Po&sie, n°142, janvier 2013, p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrud kolmar, "premier espace", l'étrangère, ville, langue, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2013
Peter Gizzi, L'externationale, traduction de Stéphane Bouquet

Samedi et son potentiel festonné
Les visages au contraire de la météo
ne reviennent jamais
peu importe à quel point
ils ressemblent à la pluie
Dans ce théâtre, le temps
n'est pas cruel, juste différent
Ça vous aide ?
Quand le trop large couloir aérien
se calme
les humains s'apaisent
Quand la notion de mythe
ou n'importe quoi de collectif
est défaite par les carillons éoliens
par un doux tintinnabule
Quand l'espoir est ouvert
par un doux tintinnabule
ou une lumière tachetée
criant de joie à la périphérie
Quand la lumière crie de joie
et tachetée fait si plaisir
à un corps au repos
Quand la pensée, ouverte
s'attache pour reposer
sur le front
Quand des brindilles se balançant
juste derrière
la grande vitre de la bibliothèque
font signe, griffent et s'unissent
à une idée de l'histoire
Quand des brindilles griffues
s'unissent à une idée du temps
à une image de l'être
Par exemple être à côté et se muer
être un autre et soi-même
être complet au sein du poème
être soi-même se muant en poème
Peter Gizzi, L'externationale, traduction de Stéphane
Bouquet, "Série américaine", éditions Corti, 2013,
p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, l'externationale, stéphane bouquet, lumière, pensée, poème, mythe | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2013
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments
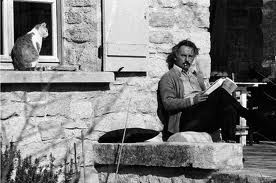
Ce qui s'offre au regard. Mais qu'est-ce donc cela qui s'offre au regard ? Cela me fait parfois songer à ce personnage, lors de la première représentation d'Ubu roi, qui demandait : « C'est bien une plaisanterie, n'est-ce pas ?
Sous la paisible (somme toute) nomination des choses demeure une force explosive, aveuglante. Et toutes les interrogations n'enlèvent nullement e pouvoir d'évidence (que d'autres voies soient possible n'enlève rien). Pouvoir d'évidence, pouvoir aussi de fascination. Niveau simple ! Alors nous devons aussi nous interroger sur ce que ce mot de "simple" fait se dresser devant l'esprit de telles murailles qu'il vaut mieux s'ouvrir à une telle venue, se disposer à une telle venue. Il y aurait là, tout aussi bien, une science terriblement ardue.
Sous-bois. Caresse des branches de pin sur la peau nue. Un peu plus loin, halte sur une pierre. Je quitte mes sandales, croise mes jambes. Un papillon se pose sur mon pied. Je l'accueille bien volontiers. Façon en quelque sorte de me dé-placer. J'entame mon recyclage.
Village au loin comme porté par les nuages, plus vrai sous cette oi errante aux fruits parfois désastreux.
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, Poliphile, 2011, p. 12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, fragments, regard, les choses, papillon, mystérieux | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2013
Colette, Paris de ma fenêtre (1942)

Livrées à la hâte et à la facilité de vivre extérieurement, les époques heureuses sont infidèles à la pensée écrite. Une molle félicité excella toujours à brûler les heures, à les presser de témoigner combien elles sont vides, vaines, volantes. De poignants soucis, une tardive clairvoyance leur redonnent leur poids et leur suc, réduisent à leur valeur les plaisirs qui nous viennent du son et des fuyantes images. Ce qui se fixe en nous par l'œil, ce qui par le caractère imprimé réchauffe en nous la pensée, l'esprit de compréhension et de contradiction, prend tout son prix ; n'est-il pas de meilleures augures que des générations égarées, en cherchant leur voie, retrouvent que lire est un bonheur vital ?
[...]
L'amour de lire conduit à l'amour du livre. Si notre curiosité et notre pauvreté s'accordent en vue de ressusciter les cabinets de lecture, il faut qu'elles ramènent aussi le respect dû au livre. [...]
Lire est, selon le live et le lecteur, une griserie, un bonheur, le service rendu à un culte, une patiente prospection à travers l'écrivain et nous-même. Ce ne sera pas chose facile que d'enseigner le respect du tome périssable, du papier sans durée. Elle ne viendra que si on la cultive, cette pudeur du lecteur qui consiste à ne pas se gratter la tête au-dessus des pages, à s'abstenir de manger en lisant, de corner des feuillets... L'espèce humaine n'a jamais assez de vergogne quand il lui faut cacher les traces de ses haltes. D'un livre que j'achetai sur les quais tomba un affreux petit peigne de poche, édenté. J'en faillis perdre le goût du livre d'occasion, joie de mes promenades. Ainsi faillis-je me dégoûter du chocolat en tablettes pour avoir mis la dent sur un bouton de culotte enrobé dans sa pâte...
Un amour sincère se marquant par la délicatesse, je vois que les jeunes gens qui lisent dans le métro rabattent sur un volume fraîchement acheté une couverture volante et ménagent ses tranches non coupées. Bon nombre de ces lecteurs soigneux seraient en chemin de passer bibliophiles, n'était l'insuffisance de leurs moyens. Posséder sous sa forme aristocratique l'auteur que l'on aime, habillé d'une reliure qui lui est contemporaine, caresser, en le lisant, l'époque évoquée par sa typographie et sa mise en pages, ce sont là des plaisirs que la chance et l'ingéniosité rendent souvent abordables. À côté des "originales" d'époque, inexpugnables sous leur reliure signée, le livre d'occasion relié ne coûte pas — pas encore — plus cher qu'un livre neuf, et défie le temps mieux que lui.
Colette, Paris de ma fenêtre (1942), dans Œuvres IV, édition publiée sous la direction de Claude Pichois et Alain Brunet, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2001, p. 603, 604-605.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colette, paris de ma fenêtre, lire, livre, plaisir | ![]() Facebook |
Facebook |
06/04/2013
Umberto Saba, Oiseaux, dans Il Canzoniere
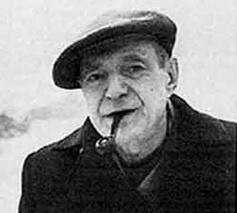
Rouge-gorge
Même si je voulais te garder je ne puis.
Voici l'ami du merle, le rouge-gorge.
Il déteste autant ses pareils
qu'il semble heureux auprès de ce compagnon.
Toi, tu les crois amis inséparables
quand, surpris , à l'orée d'un bois, tu les surprends.
Mais d'un élan joyeux il s'envole, fuyant
le noir ami qui porte au bec une vivante proie.
Là-bas un rameau plie mais que ne peut briser,
juste un peu balancer son poids léger.
La belle saison, le ciel tout à lui l'enivrent,
et sa compagne dans le nid. Comme en un temps
le fils chéri que je nourrissais de moi-même,
il se sent avide, libre, cruel,
et chante alors à pleine gorge.
*
Oiseaux
Le peuple ailé
que j'adore — si nombreux par le monde —
aux coutumes si variées, ivre de vie,
s'éveille et chante.
Umberto Saba, Oiseaux (1948), traduit par Odette Kaan, dans
Il Canzoniere, L'Âge d'homme, 1988, p. 549, 551.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, oiseaux, il canzoniere, rouge-gorge, merle, chanter | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2013
Luc Benazet, La Vie des noms
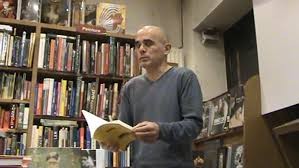
Le titre La vie des noms s'inscrit dans une tradition ancienne, puisque La vie des mots étudiée dans leur signification d'Arsène Darmesteter a été publié en 1877, et La vie du langage d'Albert Dauzat en 1911. Mais si le livre de Benazet traite bien du statut des noms, de leur relation aux objets qu'ils désignent, il n'est pas pour autant un ouvrage de linguistique. Des propositions sont avancées sous la forme d'assertions, type "les noms sont...", qu'il serait malaisé — ou, en apparence, trop aisé — à réfuter quand elles jouent avec les catégories grammaticales classiques, comme dans « attenter est un nom d'action ». C'est bien que le livre déborde les réflexions sur la langue : il mêle des références diverses, souvent fort éloignées de l'étude des noms et pas toujours repérables : c'est un poème de prose dans son écriture comme dans son organisation.
Après un liminaire qui pose la nécessité du lecteur (« une phrase ne serait pas sans adresse, quand même le langage ne serait pas un ») et le refus de la propriété (dont celle des noms), trois parties titrées. La première, "La respiration véritable", — « la respiration qui entre et sort par les noms et par la phrase n'est pas la respiration véritable, mais le rythme véritable du souffle est en relation avec elle » —, peut être entendue comme approche de ce qu'est la lecture à voix haute. Par la mention d'une « ancestrale force » s'opère le passage à "Piété filiale", piété analogue au son d'une cloche parce qu'elle est fabrique d'échos. S'engagent dans ce second ensemble des développements sur la filiation ("On a / son père comme il a lui- / même son père, lequel etc., aussi / s'épuise le savoir qu'on a / des pères") et sur le nom de personne, et d'abord sur celui de "Benazet" : il est écrit verticalement sans ses voyelles ("b n z t"), « les fentes du monde » étant formées par l'espace entre les consonnes — nom image comme en hébreu, et ce n'est pas hasard si le nom "Hamor", qui renvoie à un épisode tragique de la Genèse, se trouve dans la première partie. Le troisième sous-titre, "Une marche de la réalité", apparaît dans un poème de cette seconde partie.
L'écriture mime ici et là celle du discours philosophique — distante, "objective", avec une dominante des assertions —, mais elle est sans cesse rompue par la reprise de propositions, la présence d'anaphores, et les séquences s'achèvent parfois par : [...], comme si le texte était inachevable, à poursuivre ailleurs de même qu'il avait été commencé dans un autre livre : des esquisses sur les noms sont dans Envoi, échanges de courriels datés de 2010 avec Benoît Casas(1). En outre, la mention des références indique au lecteur à la fois qu'il n'a pas affaire à un traité et que la question des noms ne s'arrête pas aux noms "communs". Si l'on reconnaît Rousseau dans "Jean-Jacques R." (avant un extrait de son "Essai sur l'origines des langues") ou l'allusion à Rimbaud avec « l'horrible travail », il est moins aisé de savoir qui est Lucie B. dont est cité le syntagme « voix de l'estomac » ou situer l'auteur du « Requiem for what's name (guitare, M. R.) », titre d'un disque de Marc Ribot, dans lequel un des morceaux s'intitule "Motherless Child" — mais ce sont les pères qui sont le motif du poème de Luc Benazet. Plus transparent est le renvoi au traité de sexualité taoïste, en rapport avec l'association de la Lune et du Soleil (avec majuscule) qui « suivent le souffle originel » — présence de l'Orient (déjà dans Nécrit, 2011), comme de la psychanalyse et de l'opposition dedans/dehors.
Le nom n'existe que prononcé, ce qui lui donne vie, force, sinon il n'est que « pensée de corde éteinte ». Dans les poèmes où les lettres ne sont pas à leur place dans les mots, ou viennent les parasiter, les mots prennent un aspect inhabituel, même s'ils sont toujours reconnaissables (comme le nom de "Benazet" sans consonne) : « Mobn fildrougr et bleu / Pas mamobn on zurz cimporis / Ni ma moto nonplusd / De rien / De rrien ». Il est remarquable que cette transformation soit aussi dans un poème titré "LET-RRES DE / L'AMOUR " où est inscrite l'impossibilité d'une rencontre : « nous ne nous rencontrerons jamais, ni dand la vie, ni dans la mort », et où "dand", "dans" deviennent "dent", puis « Dla, galand / Gland, dans ».
On comprend que ce livre complexe, qui roule des matériaux variés, exige un engagement dans la lecture ; il éloigne le lecteur du lyrisme à fleur de peau qui sévit toujours, et ce n'est pas la moindre de ses qualités ; avec lui, « On ne voudrait pas ne pas être en dehors des choses ».
Luc Benazet, La vie des noms, "collection Antiphilosophique", éditions NOUS, 2013, 88 p., 14 €.
Cette note de lecture a d'abord été publiée sur le site Sitaudis.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc benazet, la vie des noms, nom du père, philosophie, lecteur, langue, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2013
Aurélia Lassaque, Pour que chantent les salamandres

Saint Jean Le Jour
La grange dressée à la frontière des saisons répand son parfum d'herbe chaude.
Les jeunes chevaux piaffent et se font la guerre pour le plaisir de mêler le sueur de leurs corps au goût du premier sang.
Dans les maisons aux volets clos le bois grince
et gonfle d'impatience.
Les hommes, entre hommes, retrouvent leur nature.
On coupe le vin avec des glaçons
pour tromper la clarté du jour
figé comme un tombeau dans le désert.
Le soleil au zénith absorbe le mouvement de la marmaille soudain farouche.
Sant Joan Lo Jorn
La granja quilhada a la termièra de las sasons liura sa flaira de bauca cauda.
Los cavals joves trepejan e se fan la guèrra pel plaser de mesclar la susor de ors còsses al tast del primièr sang.
Dins los ostals de las tampas clausas, la fusta carrinca e se confla d'impaciéncia.
Los òmes, entre òmes, retròban lor natura.
Se còpa lo vin amb de glacets
per enganar la clartat del jorn
calhat coma un tombèl dins l'èrm.
Lo solelh al zenit embeu l'anar de la mainada enferonida.
Aurélia Lassaque, Pour que chantent les salamandres, texte occitan /français, éditions Bruno Doucey, 2013, p. 8-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélia lassaque, pour que chantent les salamandres, occitan, la saint jean, l'été, le jour | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2013
Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929

La pelisse
Je suis bien dans ma pelisse de vieux, c'est comme si je portais ma propre maison sur mon dos. Me demanderait-on : fait-il froid dehors aujourd'hui ? que je ne saurais quoi répondre, peut-être bien qu'il fait froid, mais comment voulez-vous que je le sache ?
C'est bien là une de ces pelisses que portaient les popes et les vieux marchands, cette gent réfléchie, impassible, des malins (qui ne restituent rien aux autres, ne cèdent rien d'eux-mêmes), oui, pelisse ou froc, son col se dresse comme un mur, son grain est fin ; sans retouche, elle ne trahit pas son âge, une pelisse ample, propre, et je la porterais bien, comme si de rien n'était, même si d'autres épaules s'y sont logées, mais voilà, je ne peux pas m'y faire, elle dégage une mauvaise odeur, comme de coffre, et aussi d'encens, de testament spirituel.
Je l'ai achetée à Rostov, dans la rue, jamais je ne pensais que j'achèterais une pelisse. Nous autres de Pétersbourg, peuple remuant poussé par le vent et façonné à l'européenne, nous portons des manteaux d'hiver, mi-figue mi-raisin, des trois-quarts légers, ouatinés, de chez Mandel, avec un col pour enfant, encore heureux s'il est en astrakan. Rostov m'a séduit alors par son marché aux pelisses, la chère ville, pas moyen de résister, car elles coûtent là moins qu'une bouchée de pain.
Cet article, à Rostov, des revendeurs ambulants l'apportent dans la rue. Ils le proposent sans empressement, d'un ait bougon, c'est qu'ils ont leur fierté. Ils ne prononcent jamais le mot million. Ils ont les gros chiffres en horreur. Ils se contentent de dire huit et consentent à trois. Ils ont leur côté à eux dans la rue la plus large, celui du soleil. C'est là qu'ils déambulent du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi, les pelisses jetées sur leurs épaules par-dessus leur veste de peau ou leur méchant manteau. Eux-mêmes endossent ce qu'ils trouvent de plus minable, de moins chaud, pour mettre leur camelote en valeur, pour que la fourrure paraisse par contraste plus séduisante.
Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929), traduit du russe par Jean-Claude Schneider, La Dogana, 2013, p. 37-38.
Roland Klapka est décédé brutalement le 31 mars 2013. C'était un lecteur attentif, exigeant, curieux, généreux qui animait "La lettre de la Magdelaine". On peut lire son dernier article à propos de Christian Prigent, Les Enfances Chino : http://www.lettre-de-la-magdelaine.net/spip.php?article350
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, la quatrième prose, la pelisse, rostov, hiver | ![]() Facebook |
Facebook |





