06/08/2019
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Le 1eraoût
Ceux qui peignent, écrivent, sculptent, etc. se présentent côte à côte, devant le monde. Ils sont les constructeurs d’un chassé-croisé, d’un ombrage pluriel. Ils procèdent par trouées et hybridation. Ils dressent des murs jaunes, des phrases. Ça prend forme. Ça meurt. Ça.
Ce qui les rapproche : la constance de l’action, la sécession. Les profondes dérivations de chaque geste, de chaque pas. Greffe et marcottage. Bientôt les frondaisons et l’ombre de chacun. Bientôt les disparus qui ne se ressemblent plus. La dissidence des corps, l’intrigue des généalogies.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Flammarion, 2016, p. 120.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, peintre, écrivain, sculpteur | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2019
Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète

Large aux séant
Et, pourquoi qu’tu trompaytes ?
j.van hoddis
moins les fesses, d’yeux, cerveaux,
ça suffirait, moins de mains,
bien. moins de texte, ôter l’image ;
moins de mots. nuls relais,
rejets, nulle vapeur ! sans pin-pon
écrire encore, moins de vagues.
plus de papier, moins de trombone,
à cul lisse aussi, dégonflé, nul présent !
Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète,
traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,
NOUS, 2015, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, poésie complète, jeux de mots, alain jadot, christian prigent | ![]() Facebook |
Facebook |
04/08/2019
Henri Michaux, Les commencements

Les commencements
L’enfant à qui on fait tenir dans sa main un morceau de craie, va sur la feuille de papier tracer désordonnément des lignes, encerclantes, les unes presque sur les autres.
Plein d’allant, il en fait, en refait, ne s’arrête plus
…………………………………………………………………………………….
En tournantes, tournantes lignes de larges cercles maladroits, emmêlés, incessamment repris
encore, encore
comme on jour à la toupie
Cercle. Désirs de la circularité.
Place au tournoiement.
Au commencement est la
RÉPÉTITION
Emprise
seuls les cercles font le tour
le tour d’on ne sait quoi de tout
du connu,
de l’inconnu qui passe
qui vient, qui est venu
et va revenir
(…)
Henri Michaux, Les commencements,
Fata Morgana, 1983, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, les commencements, enfant, dessin, ligne, cercle | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2019
Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme

Du soir
Dans les soupirs humides de ta nudité
Tu dérobes un secret. Souriant,
Rien, retenant son souffle, n'est plus doux
Que de t'entendre consumer
Au soleil moribond
L'ultime flamboiement de l'ombre, terre !
Soir
Aux pieds des pas du soir
Coule une eau claire
Couleur d'olive,
Jusqu'au feu bref et sans mémoire.
À cette heure dans la fumée j'entends rainettes et grillons,
Où tremblent tendres les herbes.
Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme, Poésie 1914-1970, Préface de Philippe Jaccottet, Poésie / Gallimard, 2005 [1973], p. 158 (traduction Ph. Jaccottet), 163 (traduction Jean Lescure).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe ungaretti, vie d'un homme, soir, philippe jaccottet, jean lescure | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2019
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt !
Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts pour une édition revue et augmentée de fragments, forêt, maison | ![]() Facebook |
Facebook |
01/08/2019
Ghérasim Luca, Paralipomènes
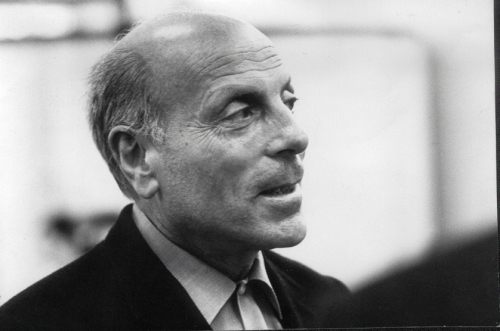
Les cris vains
Personne à qui pouvoir dire
que nous n’avons rien à dire
et que le rien que nous nous disons
continuellement
nous nous le disons
comme si nous ne disions rien
comme si personne ne nous disait
même pas nous
que nous n’avons rien à dire
personne à qui pouvoir le dire
même pas à nous
Personne à qui pouvoir dire
que nous n’avons rien à faire
et que nous ne faisons rien d’autre
continuellement
ce qui est une façon de dire
que nous ne faisons rien une façon de ne rien faire
et de dire ce que nous faisons
Personne à qui pouvoir dire
que nous ne faisons rien
que nous ne faisons
que ce que nous disons
c’est-à-dire rien
Ghérasim Luca, Paralipomènes, dans Héros-
Limite suivi de…, Poésie / Gallimard, 2001,
-
-
-
-
-
-
-
- 212-213.
-
-
-
-
-
-
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, paralipomènes, dire, faire | ![]() Facebook |
Facebook |
31/07/2019
Georges Fourest, La Négresse Blonde

La Négresse Blonde
I
Elle est noire comme cirage
comme un nuage
au ciel d’orage,
et le plumage du corbeau,
et la lettre A, selon Rimbaud,
comme la nuit,
comme l’ennui,
l’encre et la suie !
Mais ses cheveux,
ses doux cheveux,
soyeux et longs
sont plus blonds, plus blonds
que le soleil
et que le miel
doux et vermeil,
que le vermeil,
plus qu’Ève, Hélène et Marguerite,
que le cuivre des lèchefrites,
qu’un épi d’or
de Messidor,
et l’on croyait d’ébène et d’or
la belle Négresse, la Négresse Blonde !
Georges Fourest, La Négresse Blonde,
José Corti, 1937, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges fourest, la négresse blonde, comparaison | ![]() Facebook |
Facebook |
30/07/2019
Paul Claudel, Vézelay
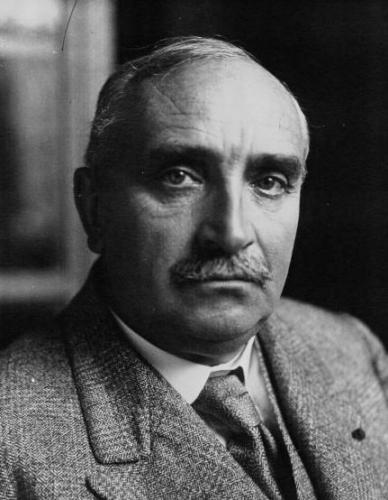
Vézelay
(…)
Il n’y a qu’à lever la tête pour devenir conscient de tout un peuple qui, au sommet de chaque colonne, se livre à l’occupation mystique. Sur deux étages se superposent et se prolongent les rangées de ces canéphores barbares, qui, au lieu d’acanthes et de la gerbe éleusienne, supportent, sur les quatre faces de cette coiffure que leur fait le chapiteau un trophée confus d’événements. Toute l’Histoire sainte s’y mêle au rêve, à la légende et à cette liturgie campagnarde qu’on pourrait appeler le Propre du Temps. Des quatre côtés, sous le poids du sens inclus, cela se penche et se déverse sur nous. On fauche, on presse la vendange, on dort, on fait de la musique, on ramasse les grappes et les essaims, Adam et Ève voisinent avec la punition de l’avare et du calomniateur, les Israélites adorent le Veau d’or, Absalon s’accroche par les cheveux à son chêne, le cor de saint Eustache répond à celui de saint Hubert, et le son en parvient jusqu’à nous, mêlé à celui incessant du mailler qui tape sur le ciseau. Car tout cela est sorti prodigieusement du même atelier, de la même imagination et de la même piété. (…)
Paul Claudel, Vézelay, dans Œuvres en prose, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 319.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, vézelay, histoire sainte, chapiteau | ![]() Facebook |
Facebook |
29/07/2019
Jacques Borel, Un voyage ordinaire
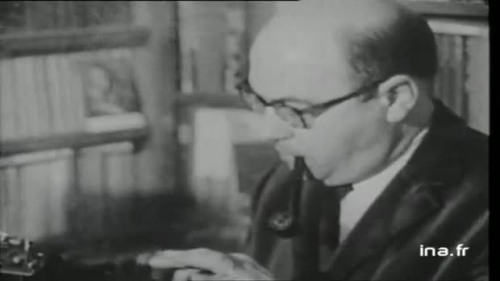
(…) Se trouver, se découvrit, on n’ose plus les employer, ces mots, ça fait sourire, si on en est loin de tout ça ! N’empêche… S’approcher, mettons, se rapprocher. Et voilà ce dont, toi, tu t’es approché. Rongé, pourrissant, le continent englouti que tu avais cru d’abord, quand il a enfin commencé à émerger, à t’apparaître, découvrir plein et rayonnant. Et quand cela serait… Tu accèdes plus tard à ce que les autres et toi-même ne peuvent désormais que rejeter. Raison de plus pour toi de te répéter le mot de Novalis que tu ne cesses, lancinant, obsédant, une espèce d’ordre, de plus en plus, qui se précise, d’entendre résonner en toi : « C’est à présent seulement que je commence à me connaître et à jouir de ce que je suis… c’est pourquoi justement je dois partir. »
— Seulement je ne jouis pas, moi, de ce que je suis. De cela aussi, empêché. Et quand bien même peut-être il n’y aurait pas le lieu d’où je reviens et dont je ne m’éloigne jamais que pour, honteux, accablé, y retourner.
Jacques Borel, Un voyage ordinaire, Le temps qu’il fait, 1993, p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques borel, un voyage ordinaire, novalis, se trouver, se découvrir, se connaître | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2019
Paul Éluard, Médieuses

Au premier mot limpide
Au premier mot limpide au premier rire de ta chair
La route épaisse disparaît
Tout recommence
La fleur timide la fleur dans air du ciel nocturne
Des mains voilées de maladresse
Des mains d’enfant
Des yeux levés vers ton visage et c’est le jour sur terre
La première jeunesse close
Le seul plaisir
Foyer de terre foyer d’odeurs et de rosée
Sans âge sans liaisons sans liens
L’oubli sans ombre
Paul Éluard, Médieuses, dans Œuvres complètes, I,
Pléiade / Gallimard, 1968, p. 911.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, médieuses, mot limpide, chair, oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2019
Jean Genet, Un chant d'amour
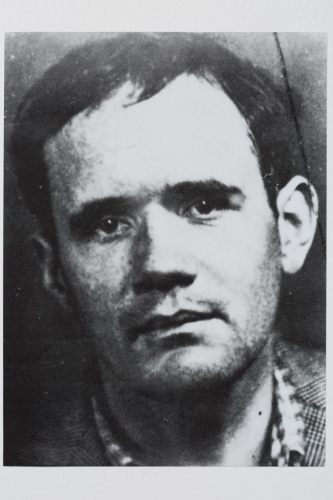
Un chant d’amour
Berger descends du ciel où dorment tes brebis !
(Au duvet d’un berger bel Hiver je te livre)
Sous mon haleine encor si ton sexe est de givre
Aurore le défait de ce fragile habit.
Est-il question d’amour au lever du soleil ?
Leurs chants dorment encor dans le gosier des pâtres,
Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre ;
Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.
O ta grâce m’accable et je tourne de l’œil
Beau navire habillé pour la noce des Iles
Et du soir. Haute vague ! Insulte difficile
O mon continent noir ma robe de grand deuil !
(…)
Jean Genet, Un chant d’amour, dans Le condamné à mort (…),
L’Arbalète, 1966, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un chant d'amour, le condamné à mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2019
Bashô seigneur ermite

Elles mourront bientôt
et pourtant n’en montrent rien —
Chant des cigales
Obscurité de la nuit —
Un pluvier pleure
son nid perdu
Jour après jour
les orges rougissent —
Chant d’alouettes
Souffle le vent d’automne —
Mais les bogues des châtaignes
encore vertes
Invisible printemps _
Des fleurs de pruniers dessinées
au revers du miroir
Bashô, seigneur ermite, édition bilingue
par Makoto Kemmoku et Dominique Chapot,
La table ronde, 2012, p. 255, 272, 276, 285, 293.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, seigneur ermite, printemps, cigale, oiseau, châtaigne | ![]() Facebook |
Facebook |
25/07/2019
Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades

Bien reste immobile
ne bouge pas
ou tu vas te faire tirer dessus
nous partons dans des directions opposées
en poussant des cris dans la plaine
ou en arrivant à toute vitesse
nous nous éloignons
nous sommes lourds
On traverse la rivière
c’est la débâcle
je pense au poète Victor Chklovski
en traversant la rivière
pendant que je traverse la rivière en me frayant
un passage à travers les blocs de glace
Je décide de vous faire confiance
c’est ma décision
je vous vois vous éloigner
sous les branches et le vent léger
nous sommes déjà loin et le vent rougit nos joues
le froid est très vif
(…)
Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades, éditions Unes,
2000, p. 19-20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albane prouvost, ne tirez pas camarades, rivière, victor chklovski | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2019
Jean Queval, En somme
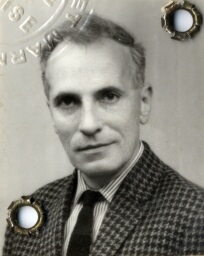
Classique moderne
Dans les bordels les hangars les cartes postales grattées à la guerre
Dans l’usure au crépuscule des us ridicules
Dans les minéraux insondés des anciennes terres
Avec ces matériaux délaissés des héritages délaissés
Tout ce qu’ils avaient dans l’oreille sous les yeux dans la main
Avec leur main d’écrivain quelques-uns n’avaient peur de rien
Dans de vastes canevas aux arcanes subtils aux cavernes vidées
Dans comme tout le discours en récapitulé, ils écrivirent
Les mythologies des anciens temps dans la lumière de ce jour
assez triste, évidemment
Jean Queval, En somme, Gallimard, 1970, p. 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean queval, en somme, classique moderne | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2019
René Char, La fontaine narrative
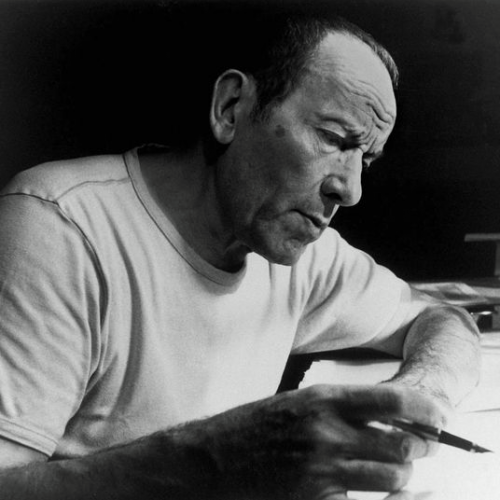
Le martinet
Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison. Tel est le cœur.
Il dessèche le tonnerre. Il sème dans le ciel serein. S’il touche au soleil, il se déchire.
Sa repartie est l’hirondelle. Il déteste la familière. Que vaut dentelle de la tour ?
Sa panse est au creux le plus sombre. Nul n’est plus à l’étroit que lui.
L’été de la longue clarté, il filera dans les ténèbres, par les persiennes de minuit.
Il n’est pas d’yeux pour le tenir. Il crie, c’est toute sa présence. Un mince fusil va l’abattre. Tel est le cœur.
René Char, La fontaine narrative, dans Œuvres complètes, La Pléiade / Gallimard, 1983, p. 276.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, la fontaine narrative, le martinet, l'hirondelle | ![]() Facebook |
Facebook |





