03/02/2026
Henri Thomas, La joie de cette vie

Non, je n’ai pas peur de la mort, ce qui m’effraie, me gêne, m’ennuie, me fait honte, c’est que les hommes ont fait de la mort : une horreur privée, un embarras public.
Je n’avais pas de conversation comme on en a partout, comme j’en écoutais ici et là, sans pouvoir vraiment y participer ; c’était comme de regarder les gens jouer aux cartes quand on est incapable de prendre part au jeu.
Une bonne pat des ennuis de la vieillesse vient des autres, jeunes ou vieux ; ils vous retirent, par prudence ou par indulgence ou par mépris, les outils de la vie, les armes, les fonctions, « dont vous n’avez plus besoin. Reposez-vous, ce serait risqué, ne vous exposez pas… ».
Goût d’écrire suffisant pour noter ce dégoût de vivre alors que je n’aurais pas vécu, ou que j’aurais oublié ce que c’est, ce que ce fut ; tout, sauf la vie ainsi créée — et le poids du vécu-disparu.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1992, p. 49, 50, 53, 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie cette vie, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2026
Henri Thomas, Le monde absent
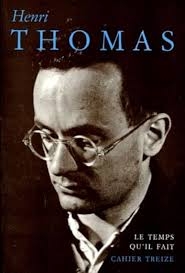
Je ne suis pas vraiment enclos
dans la vie aux barrières vagues,
souvent je tombe, parfois, héros
de l’immobile, sur une vague
je reste, toute une seconde.
Faut-il éviter cette tombe
à chaque instant rouverte ?
Ces stratagèmes pour ma perte,
ces ruses brutales, racontent
un ennemi toujours alerte
qui vole par le monde.
Sur le poème commencé
une lumière tombe
et les mots à peine tracés
se perdent comme l’ombre
des feuilles bougeant en été.
Le ciel enfle sa forme ronde,
immense absurdité.
Henri Thomas, Le monde absent, dans
Poésies, Poésie / Gallimard, 1970, p. 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le monde absent, absurdité | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2025
Henri Thomas, La Joie de cette vie

Il est vrai que j’ai toujours erré seul, c’était mon goût. Mes compagnons étaient les barres de fer des clôtures, les arbres qui vous suivent très peu, le sable endormi u éveillé, le ciel ennuagé ou non. Pourquoi de préférence personne ? Ou bien les bavardages passionnés et incertains, impatients ?
Il n’y a pour un homme que son passé qui existe vraiment, et de plus en plus à mesure que le passé s’approfondit en s’éloignant.
Q’est-ce que la vérité d’un poème — je ne l’ai jamais su ; Mais quelquefois un poème m’a fait plaisir comme un théorème bien compris, après travail et attente, et ce n’était pa s un théorème. Un moment de ma vie, une vivante belle ?
Henri Thomas, La Joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 72, 83, 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, passé, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2025
Henti Thomas, La Joie de cette vie
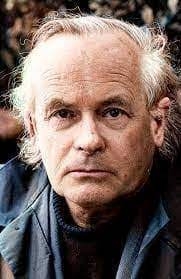
Si l’existence des pauvres (qui seront toujours nombreux, même si le nombre des riches et demi-riches augmente) est fatalement basse, inculte, sans esprit, alors la beauté de la nature est empoisonnée (puisqu’elle n’est que pour les favoris de la fortune) et ce monde est un lieu sinistre. Essayez des systèmes sociaux différents, aucun n’y remédiera.
La parole qui nous libèrerait, qu’est-ce qu’elle peut contre la lourdeur et la bêtise du corps. Elle n’est pas inscrite quelque part où on pourrait la trouver : elle n’est pas avant que tu sois elle, et elle toi.
J’essaie parfois d’imaginer l’absence totale qui ferait que plus rien ne me toucherait. Le monde de l’émotion, des liens du cœur, si puissants ici, aurait disparu. Il n’y aurait plus ni enfermement ni ouverture, dans le nulle part.
Henri Thomas, La Joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 57, 65, 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, lao joie de cette vie, nullipare | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie

N’essaie pas de rejoindre en réalité quelqu’un qui n’a pas la même pensée que toi. Cela ferme beaucoup de chemins ! mais qui a la même pensée que toi, rien ne te séparera de lui, sauf la réalité.
Vivre, être, s’exprimer — je ne vois rien de plus — car voir ne passe pas outre.
Non, je n’ai pas peur de la mort, ce qui m’effraie, me gêne, m’ennuie, me fait honte, c’est ce que les hommes ont fait de la mort : une horreur privée, un embarras public.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 44, 45, 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie

Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c’est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Paulhan a buté là-dessus toute sa vie, « comme une grosse mouche dans une vitre », dixit Leyris.
Un ami —Il lui faudrait des qualités que je n’ose rêver de personne et dont je n’ai pas en moi le modèle. C’est en ce sens que « Ô mes amis, il n’y a pas d’amis ».
Ce n’est pas la vérité qui remonte du puits mais quelque chose de noyé et vivant à la fois, un passé.
Écrire, pour moi, ç’a a toujours été une déclaration d’amour à la vie, et quelquefois elle l’acceptait.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 29, 32, 33, 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2025
Henri Thomas, Le Migrateur

Je ne peux pas vivre les souvenirs des autres, de quelques-uns, d’un seul, rien. Quelle limitation, quelle prison, quel manque de sympathie ! L’idée que d’autres n’ont même pas accès, souvent, à leurs propres souvenirs, n’est pas pour me consoler. Mes propres souvenirs sont aussi un chemins vers ceux des autres (et l’inverse), et, plus loin, vers une mémoire totale, qui est peut-être à l’origine perdue de chaque souvenir.
Oui, mais qu’a-t-on donc à aimer que ce que l’on vit, que ce que l’on a vécu ? C’est là que toutes les extrapolations et paraboles prennent origine. Je ne verrai, je n’imaginerai, je ne devinerai que ce que j’ai aimé, à ma mesure.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
31/03/2025
Henri Thomas, Le Migrateur

Le langage ne nous est ni plus ni moins personnel que la respiration, qui nous vient avant lui et qui le reçoit, de la même source lointaine. « De même que nous avons été enfants avant d’être hommes… » (Descartes), et de même qu’avant d’avoir été enfants, quoi ?
« Je n’ai pas connu la douce folie des enfances paysannes », écrit Sartre dans Les Mots : La douce folie : la dure raison, ni simple ni dialectique, la raison des bêtes et des choses, des éléments, des saisons.
J’ai un peu l’impression d’avoir écrit mes livres comme dans un rêve dont je ne me souviendrais pas, et dont ces livres ne sont pas le récit, mais le résultat, ou le reflet fragmenté, comme écrits dans la marge étroite d’un éveil. Quelquefois aussi, je me souviens de l’amour, et je me demande ce que c’est.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin /Gallimard, 1983, p.156, 187, 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, écrit | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2025
Henri Thomas, La joie de cette vie
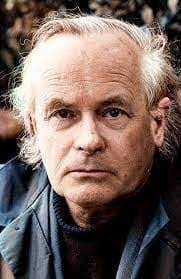
Nous avons un corps, j’ai un corps comme le soleil est là dans le ciel, ni plus ni moins.
Après la mort, mo corps sera une chose comme tous les autres. Jusque-là, il est moi — qui ne suis pas comme les autres.
J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l’on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je n’aurais pas trop d’un océan pour m’aider à vivre/ Mais quelle fatigue de l’atteindre ! Si je mourais en chemine ? Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Incapable de désespérer — en cela pareil aux animaux auxquels nous attribuons l’indifférence devant la mort.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 13, 21, 24, 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2025
Henri Tomas, Le Migrateur
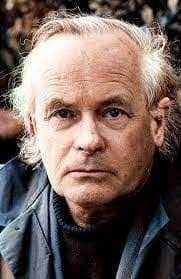
Le soleil du solstice d’hiver sur la mer, par un jour sans nuages. Les ombres des rochers sonnent quelque chose d’étrange à la lande, comme s’il y avait là un langage ignoré qui affleure au jour. Je songe que tout ce que j’ai pensé est en moi de la même manière, sujet au mouvement de la vie que je ne connais pas.
Appelle cela l’inspiration, si tu veux : en tout cas ce n’est pas la raison (ou alors drôlement masquée) qui donne le feu vert aux mots, à tout le train des phrases.
Une des vagues de l’esprit, sans doute — mais on peut en dire autant de tout ce qui bouge.
À la manière dont cette jeune femme s’écrie : « Nuance ! », au Lipp, côté « limonade », on comprend le comique, l’affreux comique du salon Verdurin.
Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 110, 114, 117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, inspiration comique | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2022
Henri Thomas, Nul désordre
La chambre
Neige du corps aux douces pentes,
Plus haut que l’ombre des bas noirs,
Le mouvement des longues jambes
Si loin m’égare certains soirs.
Que cette courbe de ton corps
Est le pays où je m’éveille,
Une terre d’avant les jours,
D’avant le sort, si peu pareille
À cette chambre où tu t’endors,
Mon pauvre amour selon le sort.
Henri Thomas, Nul désordre (1950),
dans Poésies, Poésie/Gallimard, 1970, p. 215.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, nul désordre | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2022
Henri Thomas, Le monde absent
Je viens de la rue aux travaux sans nombre,
j’ai vu l’arroseur matinal changer
le bord du trottoir en azur léger,
sur l’autre trottoir c’est encore l’ombre.
J’ai vu fuir, presque silencieuse,
une automobile merveilleuse,
et les petits bars, très en retard
sur le jour (ils n’ouvrent que le soir).
J’ai vu peu de choses et bien des choses,
la rosée au fond des parcs déserts,
la Seine où mouraient de froides roses,
les chalands de leurs panneaux couverts.
Que m’en restera-t-il dans dix années,
et dans trente, seul, geignant dans un lit ?
Rien peut-être, une incertaine pensée,
ou bien tout un monde, épars dans ma nuit ?
Henri Thomas, Le monde absent (1947), dans
Poésies, Poésie/Gallimard, 1970, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le monde absent | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2022
Henri Thomas, La joie de cette vie
Le bonheur d’être assis ou m’agitant un peu, dans une pièce chauffée et silencieuse, avec livres et carnets.
Une bonne part des ennuis de la vieillesse vient des autres, jeunes ou vieux : ils vous retirent, par prudence ou par indulgence ou par mépris, les outils de la vie, les armes, les fonctions.
Il ne faut pas guetter, il faut attendre.
Si l’existence des pauvres (qui seront toujours nombreux, même si le nombre des riches et demi-riches augmente) est fatalement basse, inculte, sans esprit, alors la beauté de la nature est empoisonnée (puisqu’elle n’est que pour les favoris de la fortune), et ce monde est un lieu sinistre. Essayez des systèmes sociaux différents, aucun n’y remédiera.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 51, 53, 56, 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, livre, carnet, attente, pauvreté | ![]() Facebook |
Facebook |
18/07/2022
Henri Thomas, La joie de cette vie

C’est une occupation de voir les nuages courir au vent, se déformer, diminuer, s’élever, s’étaler, disparaître furtivement, changer de lumière et d’ombres. Les nuages ne s’amassent pas dans le ciel à ma demande, mais presque.
La case-départ, — mais c’est souvent le départ qui n’a pas lieu — on meurt lentement sur la case départ, « on ne part pas » (Rimbaud, Une Saison).
C’est tellement étrange d’exister autrement qu’une plante ou un caillou, qu’il faudra peut-être s’excuser de mourir.
L’invisible chemin des longues plages, tout de suite effacé, regagne le temps. Marche contre le vent, sans penser, tu reviens un peu sur l’enfance, les compagnons surprenants sont là, par instants, la longue vague, les oiseaux en équilibre sur l’eau qui monte et descend, l’horizon qui après l’horizon, la myriade de débris, les témoins arrêtés des années...
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 29, 31, 33, 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, nuage, départ, chemin | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2022
Henri Thomas, La joie de cette vie

Il y a la puissance des machines, des engins de mort accumulés dans un endroit où tout est préparé pour les utiliser ô les moyens de déclenchement et la cible.
Nous vivons dans un monde fait d’épaisseurs superposées, terre, mer, brume, nuages, ciel invisible. Tout cela paraît à peine bouger, sinon la légère ligne ou bave d’écume le long des plages qui s’incurvent vers la droite.
J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l’on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Incapable de désespérer — en cela pareil aux animaux auxquels nous attribuons l’indifférence devant la mort.
Henri Thomas, La joie de cette viee, Gallimard, 1991, p. 12, 17, 21, 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, mer, écrire, désespérer | ![]() Facebook |
Facebook |





