27/12/2019
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
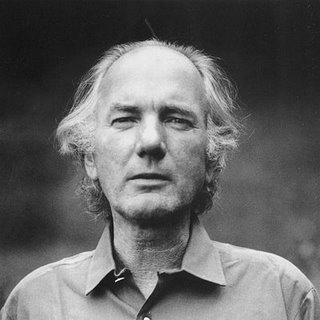
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
rien de ce tourment qui m’épuisait
comme la poésie qui portait mon âme,
rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs
qui me précipitent dans l’abîme.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
que j’ai dû traverser à gué dans le fleuve
dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,
et tu ne sais rien de cette formule magique
que notre Lune m’a révélée entre les branches mortes
comme un fruit du printemps.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,
qui me chassait à travers des forêts plus grandes que la terre,
qui m’apprenait à voir des soleils se lever et se coucher
dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
du trouble qui tourmentait le mortier,
rien de Shakespeare et du crâne brillant
qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,
qui roulait jusqu’aux blanches côtes,
au-delà de la guerre et de la pourriture, avec des éclats de rire.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
car ton sommeil passait par les troncs fatigués
de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, Orphée/La Différence,
2012, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, poésie, lune | ![]() Facebook |
Facebook |
26/12/2019
Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie

Maïakovski à Prague
Entre les coiffeurs et les popes
Un athlète agile comme une antilope
Ses jeux préférés c'étaient
Les vers et le revolver à tambour
Qui veut de la vodka qui se bouche les intestins
Gauche gauche gauche
Quand Maïakovski vint à Prague
J'étais dans un théâtre au vestiaire
Haut-de-forme de maître de poste
Qu'il est impossible d'enlever
C'était futuriste
Comme nos vies brèves
Et comme ce passant superbe
Qui boirait de la jambe gauche
Il avait l'air trop sérieux pour un poète
Il était trop empâté pour une grenouille
Ah tout ce qui serait arrivé
Si la veste et la fiancée étaient de la même cuvée
C'était de la honte
Que naît la haine
Comme les éléphants il dédaignait toute chose
Plus le ciel est lointain plus il est monotone
Surtout dans les bars
Où n'importe qui admire le charlatan
Il l'avait vu danser à Harlem
Il aimait les palmiers autant que les pommes de terre
Des volets
Et Maïakovski est mort
Lui qui pleurait dès qu'il était seul
Tu connais cela et moi aussi je connais cela
Comme nous aimons Prague
Chaque fois qu'il venait quelqu'un de là-bas
Les tavernes et les ménages bouleversés
Et la Voltava tout à coup séduisante
comme une baigneuse
Nous nous éloignons dans la nuit
À l'angle d'une rue Maïakovski agite son chapeau
Tu te jettes tête baissée
Dans des vers indéfinissables comme la nuit
Et Prague est de nouveau vivante
Le charme des blondes de la petite charcuterie
Comme les ouvrières sont belles
Et nous ne le savions pas
Tu marches et tu parles
Les perspectives défilent
Belles et usées
Comme ton manteau marron
Je connais dans les faubourgs un immeuble
Auquel il ressemble
Comme la poésie à la réalité
Et comme la réalité à la poésie sa demi-sœur
Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie, et autres poèmes (1919-1955), traduit du tchèque par François Kérel, Préface de Philippe Soupault, Les Éditeurs Français Réunis, 1960, p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vitezslav nezval, prague aux doigts de pluie, maïakovski, portrait, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2019
Maurice Blanchot, La bête de Lascaux
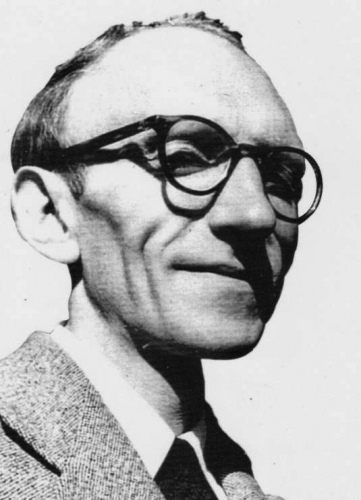
Parole écrite : parole morte, parole de l’oubli. Cette extrême méfiance pour l’écriture, partagée encore par Platon, montre quel doute a pu faire naître, quel problème susciter l’usage nouveau de la communication écrite : qu’est-ce que cette parole qui n’a pas derrière elle la caution personnelle d’un homme vrai et soucieux de vérité ? L’humanisme déjà tardif de Socrate se trouve ici à égale distance de deux mondes qu’il ne méconnaît pas, qu’il refuse par un choix vigoureux. D’un côté, le savoir impersonnel du livre qui ne demande pas à être garanti par la pensée d’un seul, laquelle n’est jamais vraie, car elle ne peut se faire vérité que dans le monde de tous et par l’avènement même de ce monde. Un tel savoir est lié au développement de la technique sous toutes les formes et il fait de la parole, de l’écriture, une technique.
Maurice Blanchot, La bête de Lascaux, Fata Morgana, 1982, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, la bête de lascaux, écriture, oubli, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
24/12/2019
Francis Ponge, Pratiques d'écriture
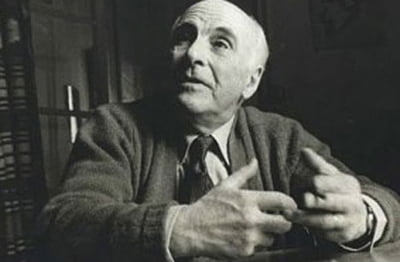
L’écolier
Le langage est donné comme fait. Les hommes parlent et croient se comprendre. Les hommes parlent et croient s’exprimer.
J’y éprouve, tu y éprouves, ils y éprouvent sinon un plaisir du moins la satisfaction naturelle (quoique illusoire absolument) d’un besoin certain.
La littérature est à ce bas niveau de l’expression des hommes, de la conversation. Elle est en partie de l’erreur, de l’imparfait social. Quant à ses rapports avec le besoin d’infini, l’aptitude métaphysique de l’homme, elle n(a pas d’avantages sur le langage courant, elle n’a aucune vertu particulière.
Ce qui précède exprimé de la sorte paraît évident : « inutile de le dire ».
Francis Ponge, Pratiques d’écriture, Hermann, 1984, p. 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, pratiques d'écriture, écolier, langage, évidence | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2019
Max Ernst, Les Malheurs des immortels
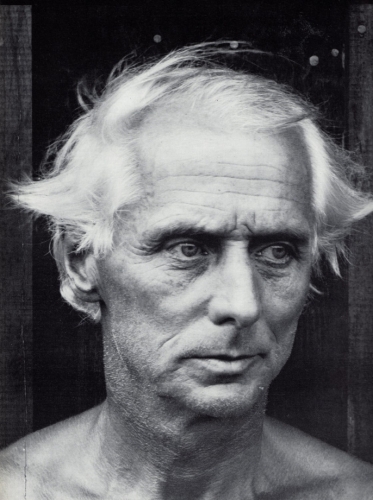
L’heure de se taire
Près de la lèvre vue dans l’eau, la coquette défrisée promène la lampe dans ses yeux dodus comme des amours. Elle aime à montrer sa faculté de sourire à surface miroitante. Elle étend ses doigts peau d’amazone à la force des bras. Elle étend la mâture de ses seins au pied des ruines et s’endort au crépuscule de ses ongles rongés par des plantes grimpantes.
Max Ernst, Les Malheurs des immortels, dans Écritures, Gallimard, 1970, p. 120.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, les malheurs des immortels, dans Écritures, l'heure de se taire, surréalisme | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2019
Jules Laforgue, L'imitation de Notre-Dame la Lune

Stérilités
Cautérise et coagule
En virgules
Ses lagunes des cerises
Des félines Ophélies
Orphelines en folie.
Tarentules des feintises
La remise
Sans rancune des ovules
Aux félines Ophélies
Orphelines en folie.
Sourd aux brises des scrupules,
Vers la bulle
De la Lune, adieu, nolise
Ces félines Ophélies
Orphelines en folie !
Jules Laforgue, L’imitation de
Notre-Dame la Lune, dans Poésies complètes,
Léon Vanier, 1902, p. 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules laforgue, l’imitation de notre-dame la lune, stérilités, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2019
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Je n’écris pas trop mal, parce que je ne me risque jamais.
Il a du talent ou n’en a pas selon qu’on est bien ou mal avec lui. Tout n’est que sympathie ou antipathie.
Brute : pas de cervelle, du cervelas.
Il a perdu une jambe en 70 : il a gardé l’autre pour la prochaine guerre.
Un rhume de cerveau fait bien plus souffrir qu’une idée.
Jules Renard, Journal 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1018, 1018, 1018, 1023,1018, 1025.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910, écriture, talent, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2019
Claude Chambard, le chemin vers la cabane

j’ai scruté le ciel
à la recherche des nuages de pluie
une chauve-souris a traversé la pénombre
les constellations de l’été apparaissaient lentement
le chien a frotté son museau contre ma main
il n’y avait pas un bruit dans la maison
Grandpère disait que ce sont les fantômes
qui font grincer les planchers & les armoires
c’est sans doute pourquoi
je n’aime ni les maisons ni les meubles neufs
j’ai besoin de l’âme des anciens
ils ne me racontent pas leurs histoires
non mais ils me disent que je ne suis pas
seulement un rebut
& que nous avons besoin les uns des autres
pour comprendre un peu
ce que devient la vie
(un fil)
Claude Chambard, le chemin vers la cabane, Le bleu
du ciel, 2008, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, le chemin vers la cabane, un fil, âme, passé | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2019
Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant
Deux bambous verts
Sur une longue bande de papier Seiki a peint deux bambous parallèles de diamètres différents, pas de feuilles, rien que les deux tuyaux d’un vert égal en commençant par les racines. Deux cannes, on dirait : est-ce un sujet pour un peinte ? Mais que les deux tuyaux n’aient pas la même grosseur, est-ce que l’œil ne s’en aperçoit pas aussitôt et ce qui nourrit en nous le sens de la proportion ? Aussi ne vois-tu pas que les jointures très rapprochées près de la racine s’écartent ensuite à des distances calculées qui ne sont pas sur les deux tiges les mêmes ? Et de cette double comparaison ne jaillit-il pas pour l’esprit à la fois une harmonie et une mélodie comme des nœuds d’une double flûte ? l’œil ne se lasse pas de vérifier que la proportion est ce nombre qui n’est capable d’être représenté par aucun chiffre.
Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant, à la suite de Connaissance de l’Est, Poésie/Gallimard, 1974, p. 247.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l’oiseau noir dans le soleil levant, bambou, proportion, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant
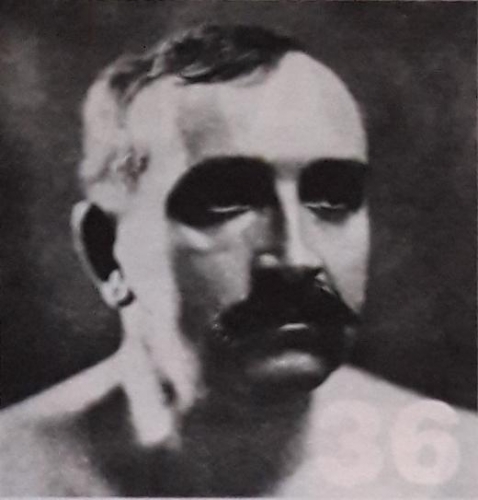
Deux bambous verts
Sur une longue bande de papier Seiki a peint deux bambous parallèles de diamètres différents, pas de feuilles, rien que les deux tuyaux d’un vert égal en commençant par les racines. Deux cannes, on dirait : est-ce un sujet pour un peinte ? Mais que les deux tuyaux n’aient pas la même grosseur, est-ce que l’œil ne s’en aperçoit pas aussitôt et ce qui nourrit en nous le sens de la proportion ? Aussi ne vois-tu pas que les jointures très rapprochées près de la racine s’écartent ensuite à des distances calculées qui ne sont pas sur les deux tiges les mêmes ? Et de cette double comparaison ne jaillit-il pas pour l’esprit à la fois une harmonie et une mélodie comme des nœuds d’une double flûte ? l’œil ne se lasse pas de vérifier que la proportion est ce nombre qui n’est capable d’être représenté par aucun chiffre.
Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant, à la suite de Connaissance de l’Est, Poésie/Gallimard, 1974, p. 247.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l’oiseau noir dans le soleil levant, bambou, proportion, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
17/12/2019
Victoria Xardel, J'ai les moyens
J’ai les moyens
Lorsque la glace cède tous les excréments refont surface
et flics et émeute en viennent à se présupposer réciproquement.
Après avoir châtré une écrevisse je lui envie sa dextérité à mourir.
Kenneth Rexroth soutient que les carcasses de voitures
sont un problème écologique. Vieux con.
Ce qui me rend profondément pessimiste
c’est qu’on ne parle bien que de ce qui est en train de disparaître.
Tu casses les objets par nonchalance. Ton goût pour le désordre
n’est qu’une autre forme de maîtrise.
Une prédilection pour les hypothèses extravagantes
et, comme telles, inattaquables, les maniaques de l’appropriation,
la construction de systèmes mélancoliques.
Victoria Xardel, dans Senna Hoy, n° 1, décembre 2019, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victoria xardel, dans senna hoy, émeute, hypothèse | ![]() Facebook |
Facebook |
16/12/2019
Jean-Paul de Dadelsen, Gœthe en Alsace

Les ponts de Budapest
Ils m'ont pendu pour avoir voulu vivre
Ils m'ont pendu pour n'avoir pas tué
Ils = ce ne sont pas les mêmes tous les jours — m'ont pendu
pour avoir cru ce que prédisent les autres
dans leurs livres d'école du soir pour adultes arriérés. Ils m'ont pendu
pour rien. Pour oublier la peur. Pour étrangler la honte.
Écoute, sur les ponts de Budapest, coexister
les pendus de tous catéchismes, de toutes cosmogonies
Une fois le mauvais moment passé, on se tient compagnie
plus on est de pendus, plus on peut causer
au point où l'on en est, plus on peut rire
Le vent du beau Danube bleu remplit nos poches à jamais vides de grenades
le givre raidit les défroques de nos corps. Six jours durant
j'ai trimé dur : le septième jour je me suis reposé, j'ai vu
D'étranges mandragores vont naître sur les routes
quand les chars, quand les chiens, quand les égouts en débordant
auront disséminé dans toutes les veines de la terre, dans toutes
ses matrices ce foutre de pendu, ce sang
giclant en pluie équatoriale sur les arbres gluants
ces lambeaux de muqueuses et d'os et d'ongles de gamines de treize ans
pour de précoces noces habillées de grenades
se glissant sous les chars pour se faire avec eux sauter
[...]
Jean-Paul de Dadelsen, Gœthe en Alsace, Le temps qu'il fait, 1982, p. 40-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul de dadelsen, gœthe en alsace, les ponts de budapest, pendaison, danube | ![]() Facebook |
Facebook |
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Paysage mauvais
Sable de vieux os — Le flot râle
Des glas : crevant bruit sur bruit.
— Palud pâle, où la lune avale
De gros vers, pour passer la nuit.
— Calme de peste, où la fièvre
Cuit… Le follet damné languit
— Herbe puante où le lièvre
Est un sorcier poltron qui fuit
— La lavandière blanche étale
Des trépassés le linge sale,
Au soleil des loups… — Les crapauds
Petits chantres mélancoliques
Empoisonnent de leurs coliques
Les champignons, leurs escabeaux.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
dans C. Cros, T. C., Œuvres complètes,
Pléiade / Gallimard, 1970, p. 794.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, paysage mauvais, lune, crapaud | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2019
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière
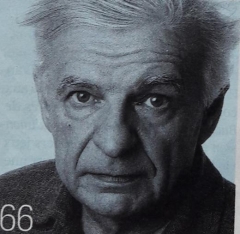
La neige
Elle est venue de plus loin que les routes,
Elle a touchz le pré, l’ocre des fleurs,
De notre main qui était en fumée,
Elle a vaincu le temps apr le silence.
Davantage de lumière ce soir
À cause de la neige.
On dirait que des feuilles brûlent, devant la porte,
Et il y a de l’eau dans le bois qu’on rentre.
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, Poésie/Gallimard,
2007, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, ce qui fut sans lumière, neige, temps, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2019
Jean-Loup Trassard, Paroles de laine

L’été, cette année-là, fut d’une sécheresse exceptionnelle. Dans le village où je venais pour la seconde fois en vacances, les yeux commençaient à briller comme s’ils s’identifiaient à l’eau dont ils ne trouvaient point le signe au fond des puits. Je crois que les gens pensaient à des plantes grasses qu’ils auraient pu entamer au couteau et croquer, mais tous les végétaux comestibles avaient déjà donné leurs graines en juin. Les chiens haletaient, les chevaux baissaient la tête, exténués. Le village était silencieux par économie. Les rideaux en perles de bois avaient fait place aux portes pleines de l’hiver, plus protectrices. Le milieu des places n’était plus traversé par personne et mes yeux éblouis ne voyaient rien du peu de circulation qui vers les épiceries, les cafés suivaient l’ombre des murs.
Jean-Loup Trassard, Paroles de laine, Gallimard, 1969, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, paroles de laine, sécheresse, eau, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |





