30/10/2019
Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poèmes jamais assemblés d'alberto caeiro, présent | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2019
Anne Perrier (1922-2017), Poésie 1050-1986

La voie nomade
I
O rompre les amarres
Partir partir
Je ne suis pas de ceux qui restent
La maison le jardin tant aimés
Ne sont jamais derrière mais devant
Dans la splendide brume
Inconnue
Est-ce la terre qui s’éloigne
Ou l’horizon qui se rapproche
On ne saurait jamais dans ces grandes distances
Tenir la mesure
De ce qu’on perd ou ce qu’on agne
Pour aller jusqu’au bout du temps
Quelles chaussures quelles sandales d’air
Non rien
O tendre jour qu’un mince fil d’été
Autour de la cheville
[...]
Anne Perrier, Poésie 1960-1986, L’Âge d’Homme/
Poche, 1988, p. 193-194.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne perrier, poésie, la voie nomade, horizon, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2019
Cesare Pavese, Travailler fatigue

Le paradis sur les toits
Le jour sera tranquille, froidement lumineux
comme le soleil qui naît ou qui meurt
et la vitre hors du ciel retiendra l’air souillé.
On s’éveille un matin, une fois pour toujours,
dans la douce chaleur du dernier sommeil : l’ombre
sera comme cette douce chaleur. Par la vaste fenêtre
un ciel plus vaste encore remplira la chambre.
De l’escalier gravi une fois pour toujours
ne viendront plus ni voix ni visages défunts.
Il sera inutile de se lever du lit.
Seule l’aube entrera dans la chambre déserte.
La fenêtre suffira à vêtir chaque chose
d’une clarté tranquille, une lumière presque.
Elle posera une ombre décharnée sur le visage étendu.
Les souvenirs seront des nœuds d’ombre
tapis comme de vieilles braises
dans la cheminée. Le souvenir sera la flamme
qui rongeait hier encore dans le regard éteint.
Cesare Pavese, Travailler fatigue, bilingue, traduction
Gilles de Van, Gallimard, 1969, p. 273.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, travailler fatigue, paradis sur les toits, chambre, lit | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2019
James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine

Oiseaux qui sont au loin dans la plaine
Courlis qui sont passés loin quel
cri jeté brille encore à l’extrémité
(peut-être) d’une plaine oh si petite
ou d’une enfance oiseaux poursuivis
précaution fusil pour rien après
des guérets traversés des prairies rases
un autre cri jeté plus loin quel
poème brille (bonheur peut-être oiseaux
solitaires et vrais) que je chasse avec
un autre poème.
Oiseau ventolier les branches
mesurent son effort son aile
sait décliner croître pour
quel point haut dans l’air nul
secret ni leçon à montrer
le vent large l’emporte
un peu plus loin je regarde
à travers un poème un arbre comme
nul moment ni désir mais dans le vent
[...]
James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine,
La Cécilia, 1991, p. 15.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, paysage au fusil (cœur) une fontaine, oiseau, enfance, chasse, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
Dominique Quélen, Avec et sans oiseaux

Avec et sans oiseaux
Qu’on apprivoise un chardonneret et un dé à coudre lui est un petit seau avec lequel il va puiser de l’eau dans un verre. Si ce dé, au lieu d’un verre ou d’un ase, est àmoitié vide ou plein, une goutte d’eau suffit presque à le faire déborder. Ce presque suggère un changement d’angle, d’autres propositions, le fait de laisser remonter à la surface un peu de sable qu’on a déposé au fond et qui est composé de galets minuscules. Dans un temps défini, les densités sont inversées. Un objet contient à son tour celui qui le contient.
[•••]
Dominique Quélen, "Avec et sans oiseaux", dans Rehauts, n°44, octobre 2019, p. 9. Photo Laurence-Quélen.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, "avec et sans oiseaux", apprivoiser, chardonneret | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2019
Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir

Te sourire
Te sourire c’est peut-être mourir,
tendre la parole
à cette terre légère
au coquillage qui bruit
au ciel du soir,
à toute chose qui est seule
et s’aime de son propre cœur.
Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir,
traduction Bernard Simeone, Orphée/
La Différence, 1989, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfonso gatto, pauvreté comme le soir, sourire, mourir, parole | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2019
Issa, Sous le ciel de Shinano

mon éventail
rien que de la prendre en main
et de nouveau j’ai envie de partir
herbes échevelées
le froid se sent
rien qu’à vue d’œil
nuit d’automne
le papier troué d’une cloison
joue de la flute
juste de quoi faire un feu
les feuilles mortes
que le vent m’a apportées
la neige doucement descend
qui urait encore le cœur de rire
sous le ciel de Shinano
Issa, Sous le ciel de Shinano,
traduction Alain Gouvret et
Nobuko Imamura,Arfuyen, 1984, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : issa, sous le ciel de shinano, éventail, neige, vent, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2019
Philippe Jaccottet, Nuages

Thoreau écrit quelque part dans Walden : « Vie et mort, ce que nous exigeons, c’est la réalité. Si nous sommes réellement mourants, écoutons le râle de notre gorge et sentons le froid aux extrémités ; si nous sommes en vie, vaquons à nos affaires. »
Voilà une sagesse à laquelle j’adhère presque* sans réserve. Mais quelle est "notre affaire" ? La suite le dit très bien, par métaphore : « Le temps n’est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J’y bois ; mais tout en buvant j’en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l’éternité demeure. Je voudrais boire plus profond ; pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d’étoiles. Je ne sais pas compter jusqu’à un. Je ne sais pas la première lettre de l’alphabet. [...] Mon instinct me dit que ma tête est un organe pour creuser [...] et en même temps je voudrais miner et creuser ma route à travers ces collines. Je crois que le filon le plus riche se trouve quelque part près d’ici : c’est grâce à la baguette divinatoire et aux filets de vapeur qui s’élèvent que j’en juge ainsi ; et c’est ici que je commencerai à creuser. »
Je crois n’avoir pas fait autre chose que creuser ainsi, mais tout près de moi ; refusant au souci de la mort de me faire lâcher mon outil.
* Pourquoi ce "presque", ce mot prudent devenu chez moi d’un usage presque (encore !) machinal ? Ma réserve tiendrait à ceci, que l’affirmation pourrait être trop belle, la proclamation trop assurée ; et cela, justement, par rapport à la "réalité" de l’expérience vécue. Qui sait si nous serons à la hauteur de ce vœu ? Le vœu, autrefois, je l’ai fait mien.
Philippe Jaccottet, Nuages, Fata Morgana, 2002,p. 9-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, nuages, thoreau, sagesse, vivre, mourir | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2019
Antoine Emaz, Soirs

on peut décrocher d’ici et retrouve la mer le ciel – cette image fixe d’un ciel plat sur une mer sans vague – bleu fer bleu vert – sans rien d’autre : deux plaques de mots dans l’œil ferment l’angle et mettent devant un paysage à la fois calme stable et dur – aucune sorte d’éternité retrouvée – aucun soleil d’ailleurs à y bien regarder.
on pourrait se contenter
de ce trajet
quelque part on se dit
on devrait
c’est déjà beaucoup
mais toujours pas le repos
attendu
comme s’il fallait prendre au filet
non pas tant des poissons
que l’eau
à peu près
ça
Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,
1999, p. 62-63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, mer, ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2019
Octavio Paz, Arbres au-dedans

Dix lignes pour Antonio Tàpies
Sur les surfaces urbaines,
les feuilles effeuillées des jours,
sur les murs écorchés, tu traces
des signes charbons, nombres en flammes.
Écriture indélébile de l'incendie,
ses testaments et ses prophéties
désormais devenus splendeurs taciturnes.
Incarnations, désincarnations :
ta peinture est le suaire de Véronique
de ce Christ sans visage qu'est le Temps.
Octavio Paz, Arbre au-dedans, traduction F. Magne
et J-C. Masson, revue par J.-C. Masson, dans
Œuvres, Pléiade, Gallimard, 208, p. 558-559.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, arbre au-dedans, antonio tàpies, prophétie, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2019
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme

Le jour n’est plus
Le jour n’est plus une belle eau grise
(Elle est venue des montagnes du temps)
Le bouvreuil noue et dénoue son cri
Aux branchages morts de la lampe
Un matin me visitait la voix
Claire et levée des torrents de la joie
C’était au lendemain l’été
Quand le silence blanc l’ombre jetée
Mais constellée aussitôt de myosotis
Avec les mondes légers des cieux lisses
(Elle n’était plus seule en profondeur)
Une âme bleue veillait dans la hauteur
Ô vie comme s’épuise la lumière
Au coin d’une fenêtre devant la nuit
Les murs crouleraient-ils comme des pierres
Dans le grand lac et serais-je promis
À ce trou de lueurs maigres sous la cendre
(Elle disait il faut descendre)
Et je savais ne pouvoir plus
Soudain un soir l’obscur en crue
Franchir de frêles ponts rongés d’abîme
Puis une à une au pâle étang
Ont soufflé leur lucarne les cimes
Un noir dessein de satin lourd
S’est entrouvert de longues marches
Aux menées taciturnes du fond
(Elle m’a guetté du plus sombre) et je marche
Et je tiens pour veilleuse le jour.
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d’abîme,
Gallimard, 1965, p. 15-16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d’abîme, jour, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2019
Vittorio Sereni, Étoile variable

Intérieur
Assez de coups assez. En plein air
tout un après-midi nous nous sommes malmenés.
Que cela finisse à égalité.
Les collines se couvrent de vent. D’autres déjà
bataillent là-dehors, la parole
est aux jeunes branches qui se ruent contre les vitres
aux bruyères aux sauges par vagues
toujours plus drues et troubles,
bientôt une seule dérive.
Serait-ce cela la paix ? Se serrer
contre un feu de bois
contre le goût mourant du pain contre
la transparence du vin
le jour depuis peu disparu
des rochers avec le cri des plateaux
dans la fourrure des précipices dans le velours
des fausses distances avant que le sommeil nous prenne ?
Vittorio Sereni, Étoile variable, traduction
Philippe Renard et Bernard Simeone,
Verdier, 1981, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorio sereni, Étoile variable, philippe renard, bernard simeone, intérieur, paix | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2019
Jaroslav Seifert (1901-1986), Sonnets de Prague
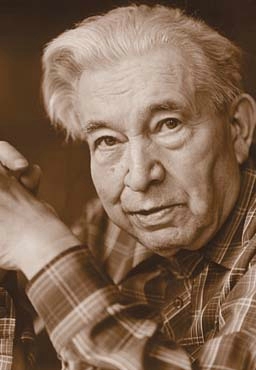
Sonnets de Prague, XIII
Tout cela qui pèse sur mon cœur
quand la honte habituée aux haillons
vient se parer comme un beau mensonge
pour nous parler de la conscience
quand le monde glisse et que le vertige
nous mène presque au bord de l’abîme
quand le mot patrie devient la risée
et quand la canaille partage la proie
quand une sangle trop bien serrée
a noué les masses des corps humains
pour qu’elles supportent un poids plus lourd
même lorsque je m’adresse aux volets
sourds aveugles et fermés
pour vous pourtant je désirais le chant
Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduction
Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Seghers,
1985, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, henri deluy, jean-pierre faye, honte, patrie, canaille | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2019
George Oppen, Poèmes retrouvés
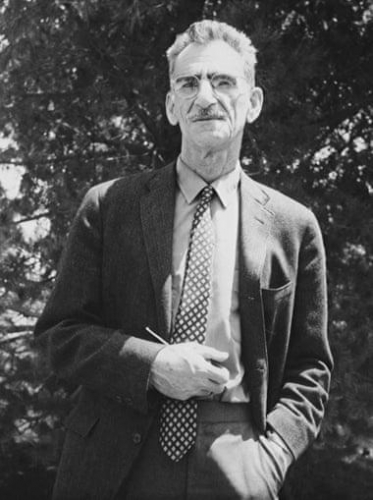
Barbarie
Nous menons nos vies réelles
en rêve, disait quelqu’un signifiant par là
puisqu’il était éveillé
que nous sommes cloîtrés en nous-mêmes
Ce n’est pas de cela qu’il rêvait
dans chaque rêve
il rêvait l’étrange matin
d’un oiseau qui s’éveille
George Oppen, Poèmes retrouvés, traduction
Yves di Manno, Corti, 2019, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poèmes retrouvés, rêver, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2019
Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Sonnets d'amour
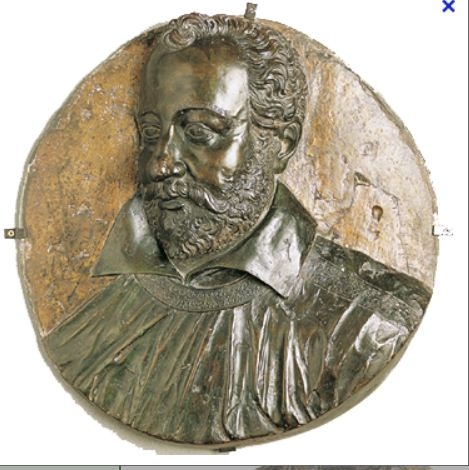
Sonnets d’amour, XI
Tous mes propos jadis ne vous faisoient instance
Que de l’ardent amour dont j’estois embrazé.
Mais depuis que votre œil sur moy s’est appaisé
Je ne puis vous parler rien que de ma constance.
L’ammour mesme de qui j’esprouve l’assistance
Qui sçait combien l’esprit de l’homme est fort aisé
D’aller aux changements, se tient comme abusé
Voyant qu’en vous aimant j’aime sans repentance.
Il s’en remonstre assez qui qui bruslent vivement,
Mais la fin de leur feu, qui s’en va consommant,
N’est qu’un brin de fumée et qu’un morceau de cendre.
Je laisse es amans croupir en leurs humeurs
Et me tiens pour content, s’il vous plaist de comprendre
Que mon feu ne sçaurait mourir si je meurs.
Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Droz, 1978, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, sonnets d'amour, constance | ![]() Facebook |
Facebook |





